De la souveraineté économique européenne
La notion de souveraineté, omniprésente dans les discours récents, reste floue dans ses contours et ambivalente dans ses usages. Ce rapport propose d’en clarifier les fondements politiques et économiques, afin d’identifier les leviers d’une véritable souveraineté économique européenne face aux enjeux stratégiques actuels.


Le mot « souveraineté » envahit le discours politique depuis trois ans et revient encore et encore, soit pour en déplorer la perte et en rechercher les responsables, soit pour appeler à retrouver une souveraineté que l’on présume perdue. Décliné sur tous les tons, à tel point que l’exécutif actuel compte deux ministères chargés d’une forme de souveraineté (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire), il est associé à une grande diversité d’enjeux et de contextes : du conditionnement du Doliprane sur le sol national à l’autonomie agricole en passant par la modernisation de la base industrielle de défense, la quête de souveraineté vient habiller et justifier toutes sortes de projets qui n’ont parfois qu’un lointain rapport entre eux. Indépendance ? Autarcie ? Autonomie ? Capacité à décider pour nous-mêmes ? De quoi parlons-nous au juste ?
Ce bégaiement sémantique traduit la peur, de plus en plus palpable, de ne plus être maîtres de notre destin. Au niveau européen, l’ambition de « se donner les moyens de reprendre le contrôle de notre propre histoire » revient comme un leitmotiv du discours politique bruxellois, dans lequel le Président de la République a été à l’initiative, appelant, le premier, à la construction d’une « souveraineté européenne ». A l’heure où la Russie menace l’Europe économiquement, énergétiquement et militairement, et où le continent a perdu la relation transatlantique sur laquelle il s’appuyait depuis quatre-vingt ans, être à nouveau maîtres de notre destin européen s’impose comme une impérieuse nécessité.
L’objet du présent rapport est ainsi de prendre au sérieux l’idée de souveraineté, de la définir rigoureusement au plan politique comme au plan économique, avant d’en développer les implications concrètes : comment l’Union Européenne, confrontée aux défis géopolitiques de 2025, peut-elle se doter de cette « souveraineté économique européenne » que la France appelle de ses vœux ? Quels instruments créer ou approfondir ? Quel partage des rôles avec les Etats-membres ?
Définir la souveraineté (I)
Comme nous l’avons vu, une grande confusion règne autour de ce terme. Avant toute chose, il importe de fonder solidement la notion de souveraineté dans le champ politique, c’est-à-dire dans le champ où elle a trouvé ses premiers usages. C’est dans le droit international, la philosophie politique et la théologie que le présent rapport propose d’en rechercher une définition rigoureuse. Il en ressort que le souverain s’entend en premier lieu comme celui qui est reconnu comme tel par les autres souverains, c’est-à-dire que la souveraineté comprend un élément de réciprocité. En second lieu, le souverain est identifié à un certain territoire sur lequel s’exerce et auquel s’étend et se limite sa souveraineté (territorialité) et sur lequel il est doté d’un certain nombre d’attributs qui permettent l’exercice effectif de son pouvoir légitime, c’est-à-dire que la souveraineté se définit par un territoire et des instruments. Enfin et en troisième lieu, le souverain est celui qui « décide de la situation d’exception » (Carl Schmitt), c’est-à-dire celui qui peut suspendre l’ordre juridique qu’il a institué mais également décider de ce qui est placé en dehors de cet ordre juridique, de ses frontières, et enfin décider des règles qui s’appliquent dans cet ordre juridique. Dit autrement, il en ressort que le souverain politique est un sujet qui n’existe qu’en vue du devenir qu’il se choisit lui-même : est souverain celui qui est le sujet de son histoire, et non l’objet de celle des autres.
De la souveraineté politique à la souveraineté économique (II)
Le rapport tire ensuite les fils d’une transposition au champ économique : qu’est-ce qu’un souverain économique ? La propriété, la transaction et le marché sont à l’économie ce que le pouvoir, la décision et l’ordre juridique sont à la politique. Le souverain économique est ici le sujet de l’ordre public économique, c’est-à-dire celui qui est capable d’ériger un marché, d’en ordonner le fonctionnement et de dépasser dans son action économique l’application mécanique des règles de l’offre et de la demande pour agir librement en vue des fins qu’il s’assigne. En ce sens, le souverain économique a le monopole des marchés : monopole de leur création, de leur délimitation géographique, de la définition des acteurs, biens et services qui y sont admis ou non, et enfin monopole d’exercice d’un pouvoir de marché, que ce soit par l’action directe ou par la définition, la régulation ou la suppression des positions dominantes.
En Europe, dès lors qu’existe un marché intérieur européen intégré, il fait peu de doute que ce souverain économique est européen : tous les éléments qui viennent d’être énumérés constituent en effet des compétences de l’Union, même si leur mise en œuvre pratique peut être déléguée dans certains cas aux Etats-membres.
S’il existe aujourd’hui un malaise dans la souveraineté, c’est tout d’abord que la construction d’une souveraineté économique commune a beaucoup d’avance sur les progrès de l’intégration des souverainetés politiques : cela a été un choix politique dans le processus de construction européenne que de commencer par l’intégration du marché commun, l’espoir étant qu’en surgirait progressivement une plus grande unité politique. C’est ensuite parce qu’à mesure qu’était mise en commun la souveraineté économique, ce qui restait de souveraineté politique aux Etats-membres ne trouvait plus son répondant dans une souveraineté économique nationale. C’est en outre parce que manquent au niveau européen les moyens politiques de parachever la construction d’un ordre public économique européen et les instruments d’exercice pratique de cette souveraineté économique qui lui a été transférée de jure. C’est enfin parce que dans cette lacune, la souveraineté économique, si elle commence à remplir certains objectifs de politique publique européens ou nationaux, échoue à répondre aux menaces extérieures sur nos souverainetés politiques. Comment faire mieux ? Quels instruments faut-il mobiliser à l’avenir pour qu’un sujet européen puisse enfin s’imposer dans le jeu économique international et y être pleinement reconnu par ses pairs ?
Les instruments d’une souveraineté économique européenne (III)
Dans sa troisième et dernière partie qui est à la fois la plus développée et la plus programmatique, le rapport développe les différents instruments de cette nouvelle souveraineté économique européenne. Il s’inspire pour cela des solutions qui ont pu être trouvées dans d’autres systèmes juridiques pour articuler compétences fédérales et compétences fédérées en matière de souveraineté économique (notamment le modèle américain et le Zollverein allemand du XIXe siècle – c’est-à-dire l’union douanière qui a préfiguré l’Empire bismarckien), tout en s’attachant à éclairer les conséquences pratiques de ces propositions dans le champ de la transition énergétique.
Les frontières extérieures du marché européen. L’une des premières prérogatives du souverain économique est de veiller à ce qui se passe aux frontières de son territoire et de régler les échanges avec les autres souverains. Le présent rapport propose ici d’entrer dans un âge plus stratégique des relations commerciales. Il suggère pour cela de renverser la logique de mise en œuvre de l’article 206 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : là où aujourd’hui l’Union se donne pour objectif en soi la conclusion d’accords de libre-échange et l’abaissement tendanciel des barrières douanières en vue du « développement harmonieux du commerce mondial », elle doit à présent assumer que la politique commerciale est devenue, qu’elle le veuille ou non, un outil de rapport de forces, un jeu stratégique, qu’elle peut employer en vue d’atteindre son objectif politique, qui peut demeurer le développement harmonieux du commerce mondial et l’ouverture des échanges mondiaux (Proposition 1). L’Union pourrait à ce titre assumer, sans changer le Traité, de changer son interprétation, et prendre des mesures commerciales actives contre des partenaires qui menaceraient ses intérêts économiques ou entraveraient ses objectifs politiques. L’Union irait ainsi au-delà de l’approche actuelle consistant à utiliser sa politique commerciale seulement en réaction à d’autres mesures pour en faire l’outil actif de défense de son projet : un monde économique ouvert aux échanges internationaux.
Dans cette même logique, elle devrait faire un usage stratégique des relations commerciales bilatérales (Proposition 2), c’est-à-dire assumer de choisir ses relations – et notamment les partenaires avec lesquels elle conclut des accords de libre-échange – en tenant compte non seulement des avantages économiques que procure l’accord, mais aussi et surtout de l’intérêt stratégique à associer un partenaire plutôt qu’un autre, vis-à-vis de tierces parties hostiles ou non-coopératives. La valeur d’une relation commerciale serait alors appréciée non seulement pour elle-même mais aussi pour ce qu’elle apporte en termes de rapport de forces : rapport de forces entre les deux parties, et rapport de forces externe, permettant d’opposer à d’autres souverains économiques le rapprochement des deux parties à l’accord et de faire bloc, notamment avec les partenaires ayant des valeurs communes avec l’Europe.
Comme nous l’avons vu, être un sujet dans l’ordre économique international implique d’être mutuellement reconnu comme sujet par les autres souverains économiques. C’est pourquoi nous sommes fondés, vis-à-vis de nos principaux partenaires commerciaux économiquement souverains, à nous doter des mêmes instruments qu’eux, et singulièrement des exactes mêmes capacités à intervenir dans notre ordre économique intérieur ou dans nos relations économiques extérieures. Sont ici visés des outils comparables à ceux qui existent aux Etats-Unis, comme l’Export Control Act européen (législation permettant de contrôler les exportations) ou la Section 232 du Trade Expansion Act (Proposition 3). De tels instruments permettraient à l’Union, à l’instar des Etats-Unis, à la fois d’exercer un contrôle stratégique des exportations européennes et de veiller aux impacts des importations sur sa sécurité et celle de ses membres.
Les frontières intérieures du marché européen. Le souverain économique ne veille pas seulement à ce qui se passe aux frontières extérieures de son territoire. Il doit également garantir que celui-ci ne se fragmente pas sous l’effet d’entités de niveau inférieur. C’est pourquoi, si elle veut être réellement souveraine économiquement, l’Europe doit également agir pour réduire au maximum la fragmentation du cadre légal applicable aux entreprises de l’Union (aujourd’hui, 27 régimes distincts de droit des sociétés, de droit des faillites, de droit du travail et régimes fiscaux…). Suivant ici les préconisations du rapport Draghi, le présent travail propose de définir un vingt-huitième régime de droit des sociétés à même d’opérer et d’être reconnu partout en Europe, doté d’une juridiction européenne unique pour la résolution de ses différends internes, et engager les travaux pour construire un droit européen unique des faillites et un régime unique de fiscalité des sociétés relevant de ce régime (Proposition 4). Il suit également le rapport Draghi sur la nécessité d’achever l’Union des marchés de capitaux (Proposition 5).
Mais il ne suffit pas de poser des règles aux frontières extérieures et intérieures. Encore faut-il qu’elles soient respectées partout de la même façon : si jusqu’à présent il a été possible de se reposer sur les services douaniers nationaux qui préexistaient, les perspectives plus complexes pour les échanges internationaux augmenteront notablement les enjeux d’harmonisation des pratiques et d’absence de contournement. Pour cela, une Union économiquement souveraine devrait se doter d’un service douanier européen commun afin de posséder les capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre la politique commerciale commune dans sa dimension stratégique (Proposition 6).
Définir qui (et ce qui) est admis à participer au marché européen. On l’a dit, le souverain économique est également celui qui définit qui est admis à participer au marché, et qui ne l’est pas. De ce point de vue, le présent rapport recommande d’aller vers un contrôle général européen des investissements étrangers, articulé avec une compétence subsidiaire des Etats-Membres, en révisant et approfondissant le règlement 2019/452 (Proposition 7). Toujours dans une logique de réciprocité, les conditions auxquelles sont assujettis les investissements européens réalisés dans des Etats-tiers (par exemple, l’obligation d’avoir un co-investisseur de droit local à part égale, dans de nombreuses géographies sur divers secteurs, notamment la Chine) seraient appliquées de manière symétrique aux investisseurs d’Etats-tiers en Europe dans les mêmes secteurs (Proposition 7bis).
Un souverain économique européen détenant le monopole de la régulation des marchés sur son territoire, devrait également proscrire la création de nouvelles régulations nationales sur le format d’autorisations d’exercer une activité sur un marché donné lorsque le marché en cause n’est pas national mais européen (Proposition 8).
Toujours dans l’idée de s’imposer pleinement comme sujet dans l’ordre économique international, le souverain économique européen doit faire une utilisation stratégique des règles d’accès au marché intérieur pour conduire nos partenaires vers nos politiques publiques sans en faire des outils protectionnistes pour autant (Proposition 9). C’est ce qu’illustre, par exemple, la mise au point du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), par lequel l’Union tend à amener ses partenaires commerciaux à la rejoindre dans l’action climatique, et dont le parachèvement sera un enjeu crucial de la mandature en cours.
Quelle extra-territorialité pour le souverain économique européen ? Le souverain économique européen doit également être doté des capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre les règles communes d’accès aux marchés (Proposition 10). Cela suppose d’évoluer vers une police et une justice européennes communes relatives aux atteintes à l’intégrité du marché intérieur pour ce qui est des fraudes aux règles harmonisées de mise en marché des biens et des services, comme des fraudes au régime de contrôle des investissements étrangers en Europe.
Le principe de réciprocité devrait également conduire à doter le souverain économique européen de moyens de sanction en assumant une compétence extraterritoriale sur les infractions aux personnes physiques ou morales d’Etats-tiers qui appliquent eux-mêmes des régimes extraterritoriaux aux personnes physiques ou morales européennes (Proposition 11).
Assurer le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur. Dans la continuité de la précédente proposition, le rapport propose de permettre à la Commission européenne de transmettre des dossiers pénaux contre les personnes ayant commandité ou participé à des atteintes anticoncurrentielles ayant des effets substantiels sur le marché intérieur au Parquet européen, de créer des infractions pénales communes dédiées, et de confier à une juridiction pénale commune européenne la compétence pour en juger (Proposition 12). Il propose également de se doter d’une autorité unique de surveillance des marchés, renvoyant l’instruction au Parquet européen sous une compétence pénale unique, dotée d’une juridiction unique, conséquence logique de l’Union des marchés de capitaux (Proposition 13).
Agir directement dans le marché intérieur. On l’a vu, le souverain économique est également celui qui exerce un pouvoir de marché, que ce soit pour intervenir lui-même dans le marché, pour exempter certaines activités des règles de concurrence ou pour règlementer l’accès aux marchés publiques. Il peut ainsi réguler des aides d’Etat, comme il le fait actuellement, et reconnaître des Services d’intérêt économique général (SIEG). Le présent rapport propose de clarifier la liste des secteurs pouvant faire l’objet de SIEG afin de permettre à l’ensemble de l’Union de disposer de règles claires coordonnant de véritables services publics d’envergure européenne (Proposition 14).
Le champ de la commande publique appelle également quelques initiatives. Les Etats-Unis disposent ici du Buy American Act (1933) qui impose une exigence de préférence nationale dans les achats publics financés par le gouvernement fédéral. En théorie, le champ des marchés publics fédéraux reste ouvert aux fournisseurs européens moyennant des clauses de réciprocité. Mais, en pratique, beaucoup de marchés relevant des Etats fédérés sont en vertu de lois locales interdits aux fournisseurs européens. En Europe, les mêmes astuces consistant à refuser d’appliquer ces dispositions d’ouverture aux acteurs de droit intérieur ne peuvent prévaloir. En revanche, toujours dans la logique de réciprocité, il serait possible de prévoir, par un texte de niveau européen, que l’Union pour les marchés réalisés pour ses besoins propres, ainsi que pour tout marché public passé par une entité publique bénéficiant de financements européens, impose systématiquement des critères de contenu minimal issu d’Etats parties à l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Il s’agit ici de mettre en place un Buy European Act qui soit un Buy Reciprocal Act (Proposition 15).
Introduction
Les crises qui se sont succédé depuis 2020–2021 ont révélé les dépendances des économies européennes et la vulnérabilité de leurs chaînes de valeur. Le ralentissement net des échanges mondiaux suite à la pandémie, leur reprise plus lente et plus graduelle qu’anticipé en 2021, conduisant à diverses tensions d’approvisionnement en matières premières ou en biens semi-transformés, ont mis en lumière combien nos sociétés et nos modes de vie dépendent d’un accès à une économie mondiale supposée ouverte et interconnectée. Cette prise de conscience a conduit sur un plan politique tout d’abord à des appels à une plus grande résilience en 2021, dans le discours des autorités nationales comme européennes. Ces appels s’articulaient autour de l’idée d’une « triple transition » (écologique, numérique et résiliente), à dire vrai conceptuellement mousseuse : si la transition écologique part de la situation actuelle pour aller vers un point bien identifié, à savoir la neutralité carbone, il est plus difficile d’identifier un point d’arrivée clair pour la « transition numérique », à plus forte raison de donner corps à une « transition résiliente », et encore plus hasardeux de mettre ces trois notions sur un même plan.
Depuis début 2022, ce fragment du discours politique a cédé le pas à un autre élément de langage, à savoir l’invocation d’une « souveraineté industrielle », et plus généralement à un usage du concept de souveraineté dans des champs nouveaux et inattendus, tels que la « souveraineté numérique », la « souveraineté alimentaire », la « souveraineté énergétique » ou la « souveraineté sanitaire » bien loin du champ de la philosophie politique et de la théorie du droit où se limitaient jusqu’alors ses interventions[1]. En France, les ministères économiques et financiers ont ainsi été regroupés sous un Ministère de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique, qui a survécu à son premier titulaire, et dont le décret d’attributions reprenait le concept[2]. Dans le même temps, les notions de « souveraineté énergétique », « souveraineté alimentaire », « souveraineté industrielle » ou « souveraineté sanitaire » sont apparues de manière récurrente dans les interventions publiques du Président de la République : discours du 10 février 2022 en matière énergétique, du 9 septembre 2022 en matière alimentaire, du 16 juin 2023 en matière sanitaire, du 11 mai 2023 en matière industrielle.
Cette prolifération des invocations de la souveraineté en dehors du champ du droit constitutionnel ne s’est pas accompagnée d’un effort de définition permettant de clarifier sa signification. Il serait ici tentant de n’y voir qu’un réflexe politicien, qui emploie un concept vague parce que des concurrents politiques l’emploient pour leur en dénier le monopole, ou qui affirme avec emphase ce que le réel dénie. Les appels à la « souveraineté industrielle » et ses analogues ne seraient ainsi que le long écho de l’impuissance du politique, et a fortiori du politique national – par contraste avec le politique européen – à agir dans le champ de l’économie au-delà de la pure gestion des états de fait. Un écho d’autant plus assourdissant qu’est donné à chacun le spectacle béant de cette impuissance, face aux différentes crises comme face aux interventions de forces externes dans nos économies.
L’épisode médiatique autour de la cession par Sanofi de ses activités dans le domaine des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires, regroupées dans sa filiale Opella, en est un bon exemple. L’annonce dans la presse française de négociations exclusives avec le fonds CD&R le 11 octobre 2024 a ainsi donné lieu à des expressions unanimes de l’ensemble de la classe politique française s’émouvant de la cession d’une activité stratégique[3], à savoir la « production du Doliprane ». Dès le 14 octobre, les ministres concernés, A. Armand et M. Ferracci, se rendront à Lisieux sur un des sites de production du groupe, pour y affirmer que « le Doliprane continue à être produit en France, par des salariés en France » et demander « des garanties extrêmement fortes, de nature à rassurer sur le moyen terme à la fois les salariés et les Français ». Le 21 octobre 2024, l’opération envisagée sera finalement conclue[4], avec pour principale évolution que « BPIfrance devrait participer en tant qu’actionnaire minoritaire à hauteur d’environ 2 % », soit un investissement de l’ordre de 320 millions d’euros de fonds propres. A aucun moment il n’aura été même tenté par l’exécutif de rappeler qu’il n’existe aucun cas documenté dans la littérature médicale de patient qui ait été sauvé de quelque affection significative pour avoir consommé du paracétamol, que celui-ci n’est plus produit en France depuis 2008 et que l’activité d’Opella ne consiste que dans le conditionnement de principes actifs importés, achetés à d’autres entreprises. A aucun moment il n’aura été mentionné que celui-ci n’est qu’un des trois analgésiques non opioïdes figurant sur la liste des médicaments de l’OMS, dont au moins un autre, l’aspirine, est toujours produit en France. A aucun moment il n’aura été évoqué que la présence d’un actionnaire public à hauteur de 2% du capital n’ouvre aucun droit de gouvernance, ni aucun contrôle effectif sur les choix d’investissement de l’entreprise. A aucun moment n’aura été posée la question des priorités dans l’allocation des fonds propres de BPIFrance, et de la pertinence de consommer 320 millions d’euros dans cette activité économique plutôt qu’une autre. A aucun moment enfin n’aura été interrogé le fait que la cession de cette activité par Sanofi s’inscrivait dans une procédure concurrentielle, qui avait conduit à écarter d’autres offres moins disantes : le risque que le politique ait pu être instrumentalisé pour écarter une offre « étrangère » au bénéfice d’un candidat écarté car moins offrant – et au détriment de l’activité de Sanofi et d’Opella qui s’en serait trouvée moins bien capitalisée – n’aura à aucun moment non plus été posé[5] . S’il fallait néanmoins intervenir pour « sauver le paracétamol », c’est parce que celui-ci était depuis 2020 devenu un objet politique, jugé révélateur de notre « perte de souveraineté sanitaire », qu’il était devenu dans les éléments de langage le symbole de notre dépendance sur des consommables « essentiels » de notre système de soin mise en évidence lors de la pandémie, et qu’il faisait à ce titre l’objet d’une action de l’exécutif en vue de réimplanter une filière française[6].
Cet épisode consternant doit nous inviter à poser un cadre de réflexion structuré, qui s’attache à revenir aux définitions des termes employés. Qu’est-ce que la « souveraineté » ? Comment ce concept peut-il trouver du sens dans le champ économique et industriel ? Le plus proche d’une définition qu’ait à ce stade donné l’exécutif se trouve dans le discours du Président de la République du 11 mai 2023, en ces termes : « La réindustrialisation de la France et de l’Europe, c’est un enjeu clé de souveraineté. Si nous ne le faisons pas, nous dépendrons des autres. Il y a à un moment donné une immense tension géopolitique ou des crises […] nous pouvons être en rupture. Je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire. Donc, c’est un élément de souveraineté. ». Ainsi, la souveraineté industrielle se définirait comme le socle d’action politique et d’activité industrielle permettant de limiter nos dépendances à un niveau jugé acceptable. On peut observer que la définition de ce « juste niveau » s’opère par une « heuristique de la peur », par la recherche en soi des risques de rupture qu’on cherche à s’épargner : « je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire ». Il paraît toutefois difficile de s’arrêter à cette définition tant elle semble déconnectée de la pratique politique de cette « souveraineté industrielle » : s’il se produit une crise qui nous amène à être en rupture d’approvisionnement en Doliprane, le pire que nous risquons est une migraine ou un peu de fièvre. S’il est permis de retenir quelque chose de cette définition, c’est que l’usage dans le champ économique et industriel du concept de souveraineté se prête à des amalgames douteux avec les concepts différents d’indépendance ou en tout cas de maîtrise des dépendances, d’autonomie, voire d’autarcie sur certains produits.
Qu’est-ce donc que la « souveraineté » dans le champ politique ? Comment se transpose-t-elle dans le champ économique, et si oui, avec quel sens et quels instruments ? Comment ces instruments s’articulent-ils en Europe et pour quelle souveraineté économique européenne ? Quelles propositions formuler pour permettre à l’Union et ses Etats-membres d’exercer une souveraineté économique crédible, à même de répondre aux défis de notre époque ?
1. Définir la souveraineté
Clov : Signifier ? Nous, signifier ! (Rire bref.) Ah elle est bonne !
Avant d’explorer l’application de la souveraineté au champ économique et industriel, il paraît essentiel, pour fonder notre propos, de rappeler ses définitions. Nous proposons d’en discerner trois : deux découlant du droit international, et une issue de la théorie du droit ou de la philosophie politique, dont nous verrons qu’elles peuvent être présentées comme trois facettes cohérentes entre elles.
La première définition, issue du droit international, envisage la souveraineté comme le propre d’une entité reconnue comme Etat souverain par d’autres Etats souverains. Sans entrer ici dans un long développement historique, cette lecture de la souveraineté procède de la construction du droit des gens (jus gentium) européen à partir de la paix de Westphalie (1648) comme ordre d’une collégialité de sujets de droit international se reconnaissant mutuellement comme sujets : on peut en conclure que la souveraineté comporte un élément de réciprocité. On le perçoit, cette définition ne peut se suffire à elle-même, puisqu’elle ne pose pas une source intrinsèque de la souveraineté, mais elle est sans doute celle qui reflète le mieux la pratique juridique comme la réalité des relations internationales : en témoigne l’existence réelle en droit international – matérialisée par leur participation à des actes juridiques producteurs d’effets, notamment les traités – d’entités souveraines qui ne disposent plus d’aucun autre attribut traditionnel de la souveraineté que celui d’être reconnu par d’autres souverains : gouvernements en exil, organisations internationales, etc.
La seconde définition, également issue du droit international, envisage la souveraineté comme le propre une entité dotée d’un certain nombre d’attributs ou de facultés énumérées. La formalisation la plus courante de ces attributs a été donnée dans la Convention de Montevideo[7] , à travers quatre critères spécifiques, indépendamment de la reconnaissance par d’autres États : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d’établir des relations avec d’autres États. In fine, cette définition renvoie au fait que la souveraineté comporte un élément de territorialité. Pour citer Carl Schmitt[8] , « au commencement se trouve la clôture » : le propre du souverain est d’être capable de délimiter un périmètre déterminé à l’intérieur duquel il exerce son autorité et organise un ordre juridique territorialement fondé (le nomos, dont la définition première est celle de « lieu d’habitation, canton, pâturage », avant de se traduire comme « loi »). Cette définition interagit avec la première : pour que puisse être défini un territoire délimité dans lequel s’exerce une souveraineté, il faut qu’au-delà existe une autre souveraineté reconnue par la première, sans quoi l’exercice de la première s’y étendrait naturellement. Symétriquement, la mutuelle reconnaissance des entités souveraines implique qu’elles reconnaissent leurs périmètres respectifs de compétence, et que ceux-ci s’excluent mutuellement.
La troisième définition est celle exprimée par Schmitt au commencement de la Théologie politique : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »[9] . Il est ici important de revenir à l’allemand : Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Cette version originale prête en effet à deux remarques. La première est que le mot über présente une difficulté de traduction[10] puisqu’il faut rendre en français sa double signification : à la fois la décision du début temporel et du champ d’application de l’état d’exception, et de maîtrise durant cet état. La seconde est que la situation d’exception, ou l’état d’exception, révèle alors plus naturellement son étymologie, à savoir l’état ou la situation de ce qui est « pris en dehors ». Comme l’explique plus loin l’auteur, « par situation exceptionnelle, il faut entendre ici une notion générale de la théorie de l’Etat, et non quelque urgence proclamée ou quelque état de siège ». Il faut ainsi entendre la notion de « décision de la situation exceptionnelle » comme décision déterminant la période et le champ des objets exclus de l’ordre juridique institué par le souverain, ce qui est la stricte réciproque de la fondation par le souverain d’un ordre juridique. Le souverain est celui qui fixe la norme, précisément parce qu’il est celui qui fixe les cas où elle ne s’applique pas ou plus. Comme l’écrit Agamben : « dans toute norme juridique qui ordonne ou interdit quelque chose […] est inscrite, comme exception présupposée, la figure pure et insanctionnable du cas d’espèce qui dans le cas normal, réalise sa transgression »[11] .
Cette définition vient ainsi en extension, et en déduction de la définition de la souveraineté chez Bodin, qui la définit comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République »[12], c’est-à-dire comme source définitive de l’ordre juridique. Bodin est d’ailleurs – comme le relève Schmitt –, confronté à la question de la capacité du souverain à faire exception à l’ordre juridique : vivant dans une société d’ordres, il est nécessairement amené à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles un souverain cesse d’être tenu par ses obligations auprès de son peuple et plus généralement des corps sociaux intermédiaires ayant une existence juridique propre dans un système d’Ancien Régime (noblesse et clergé en tant que titulaires de privilèges, territoires dotés de coutumes propres, etc.). Demandant si les promesses faites par le souverain à ces instances délimitent sa souveraineté, Bodin reconnaît à celui-ci la faculté de s’en défaire « si la nécessité est urgente », et alors d’agir en contradiction avec ces promesses, de modifier les lois et même de les abroger. Bodin reconnaît alors que si, pour exercer cette faculté, le souverain devait demander l’autorisation à ces instances, ces mêmes instances n’étant pas maîtres des lois devraient alors en référer au souverain garant des lois, ce qui créerait une circularité. Ainsi « la prérogative d’abroger la législation en vigueur – dans son ensemble ou au cas par cas – est à ce point la marque propre de la souveraineté que Bodin en déduit tous les autres attributs ».[13]
Ceci place naturellement le souverain dans une posture « à part », en ce qu’il « est en marge de l’ordre juridique normalement en vigueur, tout en lui étant soumis, car il lui appartient de décider si la Constitution doit être suspendue en totalité »[14] : le souverain est ainsi à la fois celui qui est le plus entièrement partie à l’ordre juridique, puisqu’il le fonde et l’ordonne, et celui qui lui est radicalement extérieur, puisqu’il le précède, et peut le suspendre ou l’abolir quand il juge que la situation l’exige. C’est en miroir de cette position singulière du souverain qu’Agamben discerne la figure de l’homo sacer, c’est-à-dire celle de l’individu exclu de l’ordre juridique et dénué de tout droit, réduit à sa « vie nue » – qui paradoxalement par ce processus d’exclusion trouve une place liminale et une identité juridique.
En reprenant les différentes implications de l’exception (Ausnahme), on peut donc poser que la souveraineté réside dans :
− La définition de qui est admis au sein de cet ordre juridique à participer comme sujet de droit, à travers la définition de ceux qui en sont exclus.
− La définition des règles de droit applicables au sein de l’ordre juridique, à travers la décision des situations dans lesquelles cet ordre est suspendu, en temps et en objet, d’une part en ce qu’il s’applique aux relations entre deux sujets de droit internes à cet ordre juridique, et d’autre part en ce qu’il s’applique aux actes juridiques pris par le souverain en tant que sujet de droit interne à l’ordre qu’il a institué.
Comme Schmitt le développe plus loin dans la Théologie Politique[15], « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’Etat sont des concepts théologiques sécularisés. Et c’est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu’ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l’Etat – du fait, par exemple, que le Dieu tout-puissant est devenu le législateur omnipotent –, mais aussi de leur structure systématique ». L’intuition en paraît tout à fait juste : non seulement les concepts de la théorie moderne de l’Etat se mettent naturellement point à point en rapport avec des concepts théologiques, mais le développement historique de la théorie de l’Etat s’est fait en prolongement de la doctrine catholique pour continuer à donner un fondement à des Etats dont le rapport du temporel au spirituel était radicalement altéré par les conséquences de la Réforme. En outre, au-delà de la mise en identité des concepts politiques avec les concepts théologiques, les rapports entre eux des concepts politiques répliquent la structure des concepts théologiques : il n’y a pas seulement bijection (identité point à point entre deux ensembles) mais isomorphisme, c’est-à-dire préservation des structures à travers cette identité point à point.
Ainsi, dire que « le souverain est celui qui décide de la situation exceptionnelle », dans le champ de la théorie de l’Etat, renvoie à la définition thomiste de Dieu comme « acte pur d’exister » si l’on fait l’observation qu’il existe une relation d’analogie entre pouvoir/décision dans le champ politique et être/existence dans le champ théologique : la décision est au pouvoir ce que l’existence est à l’être. Le souverain serait ainsi acte pur de décision dans le champ du politique, au sens où il ne se manifeste comme souverain que dans la décision de suspension de l’ordre juridique qu’il a institué, lorsqu’il intervient en dehors de l’exercice ordinaire des pouvoirs. Ceci se déduit du caractère « absolu et perpétuel » de sa puissance, comme l’écrit Bodin : si la souveraineté était « en puissance », elle ne serait pas absolue, et il est donc nécessaire qu’elle ne soit que purement en acte, et cet acte ne peut être celui du pouvoir – qui s’inscrit dans un ordre juridique défini, mais bien celui de la décision sur cet ordre juridique et ses limites.
Il est ici intéressant de noter qu’en construisant ce rapport d’analogie entre champ de la théorie de l’Etat et champ du théologique, Schmitt fait sans le reconnaître usage non seulement des concepts théologiques mais également d’une méthodologie théologique. Plus précisément, il s’appuie sur le raisonnement analogique aristotélico-thomiste – on se souvient de la Politique d’Aristote, et de la mise en rapport de l’ordre politique de la cité, avec celui de la famille ou celui de l’équipage d’un navire : « Le citoyen, comme le matelot, est membre d’une association. A bord du navire, quoique chacun ait un emploi différent, que l’un soit rameur, l’autre pilote, celui-ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que, malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler une vertu spéciale pour chacun d’eux, tous concourent néanmoins à un but commun, c’est-à-dire au salut de l’équipage, que tous assurent pour leur part, et que chacun d’entre eux recherche également »[16]. Ce parallèle, filé au long du II, n’échappera pas à Thomas d’Aquin, qui reviendra à ce sujet dans son commentaire de la Politique[17] . Pour autant, il le fait dans une analyse historique et sociale des concepts, en rapprochant leurs constructions et leurs articulations pour les effets qu’ils procurent in concreto dans nos ordres juridiques et dans notre compréhension du politique, mais pas en prétendant apporter une identification : il est question de s’appuyer sur les catégories théologiques pour comprendre et éclairer comment les sociétés européennes ont conçu le souverain à partir des constructions théologiques, entendues comme constructions historiques et sociales, mais pas de dévoiler de manière générale la réalité des êtres politiques à partir des catégories théologiques.
Schmitt aurait pu aller plus loin : s’il est exact que les catégories de la théorie de l’Etat se sont construites dans les sociétés européennes modernes à partir des concepts théologiques, la question peut être posée de savoir si, lorsqu’on se déprend d’une analyse historique et sociologique pour s’intéresser à l’essence des choses, plutôt qu’une identité des « structures systématiques » de la théorie de l’Etat avec celles de la théologie, ce n’est pas en réalité une identité des structures du politique avec celles de l’ontologie qui doit être recherchée, et si Schmitt n’aurait pas été victime de la difficulté à discerner la frontière et les rapports entre théologie et ontologie dans la tradition thomiste. Ceci s’explique d’une part par le fait que la Théologie Politique a été composée en 1922 avant qu’une coordination claire soit posée par Przywara, et d’autre part, par le fait qu’en tant que juriste et théoricien du droit public, imprégné de l’idée d’ordre public et de l’image de l’impérialité germanique et romaine, il ne pouvait que davantage s’intéresser à l’Eglise en tant qu’organisation, construction sociale, et structure de pouvoir qu’à son objet, à savoir le message ontologique du Christ. Certes la construction historique de la théorie politique se serait extraite de conceptions issues de la théologie catholique, mais dégager de manière exacte une théorie de l’Etat par cette voie implique de rechercher les parentés entre notre compréhension du pouvoir, et notre compréhension de l’être.
Pour autant il faut ici se garder d’un premier risque qui serait de poser une identité complète entre champ de l’être/existence et champ du pouvoir/décision, entre champ de la théologie et champ du politique : ces deux champs sont distincts, et les rapports qui s’y opèrent également distincts, même s’ils peuvent être identifiés point à point en préservant les structures.
***
D’une part car poser une pleine identité conduit alors à identifier la source de l’ordre juridique et la source de l’ordre naturel. Ceci peut conduire à tomber dans un jusnaturalisme dans le champ politique qui trouve la source de son ordre juridique dans l’ordre naturel institué par le Créateur – ce qui pose à son tour la question, et la probable impasse, de la capacité des hommes à déterminer ces droits naturels s’ils ne trouvent de source que dans un ordre transcendant. D’autre part, sur l’autre versant, cela peut conduire à tomber dans une réduction immanente, matérialiste, et biologique du droit, comme pure détermination et superstructure des états de fait, qui conduit en pratique à une impasse morale, et à un détachement vis-à-vis de la vie humaine qui a démontré son incapacité à fonder un ordre juridique valide. C’est dans ce second versant que Schmitt tombe en bonne mesure, dès le début de son œuvre, tentant d’élucider « un droit naturel sans que le naturalisme ne puisse y pénétrer »[18] . Entièrement distincts, mais mis en relation point à point et structurale, ces deux champs s’articulent pour autant dans une relation d’interdépendance et une conversation, dans la mesure où le sujet dans le champ de l’être trouve sa valeur et sa signification – y compris morale – dans son rapport à l’autre et son existence politique, et où il existe de même une responsabilité des sujets politiques vis-à-vis de ce qui fait que l’être des sujets du champ de l’être a de la valeur pour lui-même, c’est-à-dire la dignité de l’être.
L’identification du souverain en théorie de l’Etat à Dieu en théologie présente en effet un risque qui est celui d’introduire une différence radicale entre le souverain et ceux qui participent à son ordre juridique de même qu’existe une différence radicale entre l’être de Dieu et l’être de ses créatures. Il était inévitable que Schmitt, dans le contexte de la révolution conservatrice allemande, et imprégné de fascination pour l’idée de l’Etat total, ne soit naturellement allé sur cette voie, assumant de placer un souverain monique et total en surplomb de l’ordre qu’il a institué, dans lequel les différents sujets de droit existent de manière très horizontalisée. En témoigne d’ailleurs le fait qu’il parle non de « philosophie politique » mais de « théorie de l’Etat » (Staatslehre), tout simplement car la seule théorie politique qui l’intéresse est celle qui se place au niveau des Etats souverains, dans ce qu’ils ont de statique et dans l’ordre qu’ils instituent. Pour autant, nos ordres juridiques réels mettent en évidence sous les Etats souverains, des hiérarchies de personnes morales plus ou moins complexes, qui créent leurs propres ordres juridiques internes au sein de l’ordre juridique de l’Etat, par exemple des entreprises ou des collectivités locales, et comportent des personnes physiques capables en droit, les citoyens[19] , et des processus dynamiques de formation d’institutions, de participation aux pouvoirs constitués, d’adhésion ou de dissension. Ces sujets de droit, et au premier titre les citoyens, eux aussi décident dans leurs champs propres : est-ce là une décision au sens où on l’entend quand on affirme que le souverain décide de la situation exceptionnelle ? Comment cette décision et l’exercice du pouvoir par ces sujets de droit s’articulent-ils avec la décision qui définit le souverain ? Comment appréhender la souveraineté dans ce qu’elle a de dynamique et de processuel ?
A l’échelle des citoyens, nous faisons, nous aussi, l’expérience concrète de décisions, et de pouvoirs, qui se placent au-dessus et au-delà de la pure exécution de l’ordre normatif existant : quand un juré délibère dans un tribunal, quand nous choisissons de et pour qui voter, etc. De même, lorsqu’un citoyen décide d’enfreindre la loi, non par nécessité ou par intérêt mais comme acte politique, dans le cadre d’une désobéissance civile, il y a une certaine forme de souveraineté qui s’exerce : on voit là que la capacité politique des citoyens, leur souveraineté propre, ne se réduit pas à l’exercice des libertés et des droits qui sont conférés par l’ordre juridique institué par le souverain. Comment cela s’articule-t-il avec la souveraineté de l’Etat ? Comment la décision souveraine des citoyens participe-t-elle à la souveraineté de l’Etat ?
Sur ce point, nous pouvons là encore nous appuyer sur la mise en rapport entre le politique d’une part, et le théologique et l’ontologique d’autre part. La question renvoie dans le champ théologique et ontologique au rapport entre l’être de Dieu et l’être des créatures, et à un des débats structurants de la scolastique : lorsqu’on dit que Dieu est, cet emploi du verbe « être » a-t-il la même signification que lorsqu’on dit que la créature « est » ? Est-ce bien le même être ou y a-t-il une distinction, et si oui, laquelle ? La pensée thomiste a affirmé qu’il existait bien un rapport entre l’être de Dieu et l’être des créatures : ceux-ci ne sont pas univoques, nous enseigne la Somme Théologique, en cela que les créatures ne sont pas de la même manière que Dieu est, tout d’abord car les créatures ne sont pas purement en acte, mais aussi en puissance. Mais il n’y a pas pour autant d’équivoque : il y a analogie de l’être, à la fois d’attribution et de proportionnalité. L’analogie d’attribution est celle qui repose sur les relations entre les êtres, et introduit ce faisant une hiérarchie : il y a analogie d’attribution entre dire qu’un aliment est sain, et dire qu’un être humain est sain, en bonne santé. L’analogie de proportionnalité est celle qui repose sur le rapport entre des rapports, sans s’appuyer sur une relation hiérarchique : dire que l’aile est à l’oiseau ce que la nageoire est au poisson est cette analogie[20] ; de même dire que Dieu est vivant renvoie au fait que les créatures sont vivantes au titre de l’analogie de proportionnalité non pas en ce que Dieu « vit » d’une modalité parfaite de la vie des créatures ici-bas, mais en ce qu’est présent en lui « un principe à nous complètement inconnu, mais qui joue le même rôle que l’âme des vivants terrestres »[21] .
Selon cette lecture, la décision des citoyens renverrait à la décision du souverain en ce que cette dernière serait un reflet imparfait de la décision du premier – analogie d’attribution – et en ce qu’elle serait au citoyen ce qu’est la décision du souverain au souverain – analogie de proportionnalité. Mais alors, s’il existe une disjonction aussi nette entre décision du citoyen et décision du souverain, comment comprendre la participation du citoyen au processus politique du souverain ? Une tentative de synthèse peut être trouvée dans l’œuvre de Przywara[22] , qui cherche justement, dans le champ théologique et ontologique, à expliquer en quoi le rapport de Dieu à la créature ne se résume pas à une relation du sujet à l’objet : c’est en lisant ce rapport suivant non pas le couple « sujet-objet » mais « essence-existence » qu’il est possible de construire cette réconciliation, et d’exposer la créature dans une métaphysique a priori, comme « manifestation de Dieu ». Dit autrement, il y a certes un mouvement du créateur vers la créature en ce qu’il dispose comme sujet de l’ordre général des choses dans lequel s’inscrit l’être des créatures, qui procède de l’être du créateur, mais il y a également une remontée des créatures vers le créateur, qui en sont une manifestation existentielle et un témoignage, ce dont la forme la plus achevée est l’activité de connaissance – dans le champ métaphysique – et de communion – dans le champ théologique ; il n’est par ailleurs pas pertinent de hiérarchiser ces deux mouvements, qui s’opèrent simultanément et sont d’égale importance. Pour revenir à notre problème, la souveraineté politique, le parallèle que nous avons tissé nous permettrait de déduire dans le champ de la théorie de l’Etat que le souverain et le citoyen ne sont pas dans un rapport vertical de sujet de droit à objet de droit, mais bien dans un rapport qui se lit selon le couple « pouvoir-décision » : c’est dans et grâce à l’ordre juridique créé par le souverain que le citoyen peut exercer son autonomie décisionnelle et plus généralement ses libertés politiques, mais c’est également dans chaque acte de décision libre par les citoyens, participant au processus du pouvoir politique, et participant du souverain que se manifeste le souverain : c’est par la continuité du consentement des gouvernés, réelle à chacun de leurs actes de décision politique dans l’ordre juridique qui matérialise leur participation au souverain, que se dévoile l’existence du souverain. Cet angle d’approche permet également d’appréhender le phénomène par lequel s’érige, dans le champ du politique, un souverain nouveau, porté par la continuité des décisions politiques et de la communion d’objectif politique des citoyens, c’est-à-dire le phénomène révolutionnaire : c’est d’une collectivité de citoyens, et de leur décisions politique portées par une conscience commune que peut partir la construction d’un ordre juridique nouveau, hors du souverain existant.
Une autre voie serait de suivre Duns Scot[23], et d’horizontaliser l’être, en lui donnant la même signification, qu’il s’agisse du créateur ou de la créature, en rejetant à la fois l’existence d’une relation d’analogie de l’être – c’est-à-dire une identité relative entre l’être de la créature et l’être du créateur, ce dernier en étant la forme pleine et inaccessible – et d’un équivoque sur l’être – c’est-à-dire une rupture radicale entre ce que signifie « être » pour le créateur, et ce que cela signifie pour la « créature » – pour considérer qu’il existe « un certain concept univoque à lui et à la créature »[24] , c’est-à-dire qu’il s’agit en réalité bien du même « être » dans les deux cas. Il faut en effet penser l’existence, au-delà de l’être en général, d’individus singuliers, chacun doté de caractéristiques qui lui sont propres, et Duns Scot se refuse à confier à la seule matière, toujours indéterminée, ce rôle, que la forme, toujours générale, ne peut jouer non plus. La source de l’individualité se trouve dans un processus d’individuation continu, antérieur à la rencontre de la matière et de la forme : il faut là s’attacher à ce processus continu, en relation constante avec le reste de l’ordre de l’être, davantage qu’à l’individu dans ce qu’il a de statique, selon Deleuze : c’est d’abord au devenir, à l’être en mouvement, vers l’autre, vers autre chose, qu’il faut s’attacher. Pour revenir au champ du politique, il n’y a pas de distinction entre le pouvoir du souverain et celui des citoyens, et la clé de compréhension doit être recherchée dans le processus par lequel se créent dans les entités du corps politique – au premier titre les citoyens – une conscience et une capacité décisionnelle qui soit véritablement politique, c’est-à-dire le processus de politisation. Le souverain ne diffèrerait pas en nature des citoyens pour ce qui est de son pouvoir politique, mais porterait simplement la forme la plus aboutie et « totale » du processus de politisation, en ce qu’il agrègerait le plus grand nombre commun d’acteurs politiques capables de faire communauté. Et surtout, le souverain plus qu’un être statique est-en-devenir.
On le voit, ces deux voies se rejoignent en partie pour leurs conséquences pratiques dans notre objet d’étude. Davantage que la souveraineté comme stock, c’est-à-dire comme ordre institué et permanent, ou comme ensemble d’attributs d’une entité politique, comme peuvent donner à le penser les deux premières définitions, c’est à une souveraineté comme flux que nous devons nous attacher. C’est dans le mouvement continu de participation des citoyens au processus politique que le souverain existe : le souverain est acte pur de décider, car il existe à chaque fois qu’un des citoyens décide politiquement, en tant que participant consentant du souverain. Dans le même temps, le souverain existe comme conséquence émergente du processus de politisation des citoyens et en vue de la poursuite de ce processus. Une souveraineté qui n’existerait que comme stock, c’est-à-dire que comme un ordre juridique institué, sans participation décisionnelle continue et sans processus de politisation, serait une souveraineté morte. Un bon exemple de cette distinction est celle des gouvernements en exil : ceux-ci ne disposent pas d’une souveraineté politique parce qu’ils détiennent tel ou tel attribut de la souveraineté comme stock, comme un gouvernement plus ou moins fonctionnel, établissant des relations avec d’autres Etats, et qui continuerait d’agiter un drapeau et de maintenir tel ou tel signe de la souveraineté. Ils disposent d’une souveraineté politique parce que, et aussi longtemps qu’ils continuent d’être portés par la décision politique de citoyens exilés qui s’organisent dans leur cadre et lui reconnaissent une autorité, et par la dissidence intérieure de ceux restés au pays – autre forme de décision politique, et en vue du déploiement continu et futur de l’idée d’œuvre politique qu’ils portent et auquel les citoyens adhèrent. Londres n’est pas Sigmaringen.
De même, entre l’Etat et les citoyens se déploient d’autres institutions intermédiaires, qui peuvent être dotées dans l’ordre juridique d’une forme de souveraineté propre. Il serait tentant de les renvoyer toujours à la souveraineté de l’Etat qui institue un ordre juridique dans lequel cette souveraineté s’exercerait par délégation : cela paraît notamment être le cas des collectivités locales dans l’ordre juridique français, qui bien qu’elles soient dotées d’une libre administration ne sont pas capables de se créer ou se structurer de manière totalement libre – c’est in fine l’autorité éventuellement déconcentrée de l’Etat qui prend les actes en ce sens – et demeurent soumise à un contrôle de légalité par l’Etat, qui vise précisément à vérifier que leur capacité décisionnelle s’exerce dans le stricte périmètre de l’ordre juridique institué par lui. Pour autant, il existe également des souverainetés composites, par exemple entre un Etat fédéral et ses entités fédérées, ou entre l’Union européenne et les Etats-membres. Si la souveraineté est totale et absolue comme le pose Bodin, comment comprendre qu’elle puisse s’articuler entre plusieurs entités ? Comment se joue la coexistence d’une souveraineté fédérale et le respect de souverainetés fédérées ?
Le développement que nous venons d’opérer permet d’éclairer cette question : les institutions intermédiaires existent dans le champ du politique comme manifestations du processus de politisation des citoyens qui s’organisent, et comme expression d’une souveraineté comme flux[25], ou souveraineté comme devenir. C’est en tant que moyens de participation au politique des citoyens qu’elles disposent d’une forme propre de souveraineté et d’existence politique, concourant au souverain dans un processus dynamique en ce que la conscience politique qu’elles expriment et l’objectif politique qu’elles portent dans leurs décisions participent du souverain, forme la plus totale de la conscience et des décisions politiques. S’il existe des souverainetés fédérées sous la souveraineté fédérale, c’est en tant que dynamique de participation au processus politique fédéral, et en tant que continuité de consentement et de décision de participer à la fédération. S’il existe, d’une certaine manière, une souveraineté européenne et des souverainetés nationales, c’est parce qu’émerge des citoyens et de leurs organisations politiques, dont les Etats-membres, un consentement à un processus décisionnel européen commun dont la dynamique est la création d’une union toujours plus proche, dans un processus de politisation européen, et non plus seulement national, dont l’un des meilleurs témoignages est la cohérence de plus en plus grande entre les mouvements des opinions nationales, attestant de la conscience croissante d’une communauté d’intérêts politiques et l’existence de plus en plus concrète de partis et d’une vie politique européenne dans une sphère publique elle aussi européenne.
La souveraineté nationale s’exerce dans la limite où elle s’inscrit dans cette dynamique ; et la souveraineté européenne trouve sa source, son existence continue, et sa capacité à animer un ordre juridique dans la continuité de participation et de consentement des citoyens et de leurs institutions au projet européen. Symétriquement la souveraineté européenne doit dans cette perspective s’attacher dans l’ordre juridique qu’elle institue et dans son articulation avec la souveraineté des Etats-membres à garantir à ceux-ci et à leurs citoyens la pleine faculté de conduire leur processus de politisation, leur participation continue et consentante au projet européen, ce qui est le fondement du principe de subsidiarité.
Là encore, réduire le paradigme du politique à la distinction « ami-ennemi », réduire l’institution d’un ordre au point de départ qui est cette désignation et cette partition, au sein du corps social ou entre un corps social et un autre en fait un processus purement descendant, et réduit le projet politique du souverain à l’identification et à l’élimination de l’ennemi public, ce qui échoue à lui donner toute dynamique : que devient le souverain une fois le dernier ennemi éliminé, à moins d’en trouver un autre ? Bien plutôt, le paradigme du politique doit être recherché dans les processus de politisation que nous avons mentionnés plus haut, et donc dans des processus de prise de conscience sociale – notamment d’adhésion et de participation commune au souverain – et à partir de cette prise de conscience, d’affirmation d’une subjectivité dans laquelle la décision devient possible. Le paradigme du politique réside dans le processus permanent, et continu, de construction de subjectivités politiques, par chaque citoyen, et ce faisant, de découverte et de construction de la subjectivité politique du souverain. Le paradigme du politique est l’affirmation des citoyens, et du corps politique souverain, non plus comme objet, mais comme sujet commun[26], existant et décidant pour son devenir.
En suivant cette voie reposant sur la méthode analogique et en approfondissant le lien d’analogie entre champ du pouvoir/décision, et champ de l’être/existence, c’est-à-dire entre théorie de l’Etat et ontologie, on parvient à dire de manière plus exacte les choses : la souveraineté est au champ du pouvoir/décision ce qu’est la subjectivité, c’est-à-dire le propre du sujet, dans le champ de l’être/existence. Est souverain celui qui dépasse son statut d’objet juridique pour devenir dans le champ du politique ce qu’est un sujet dans le champ de l’ontologie. On retrouve ici les deux premières définitions, dans un sens plus complet, dans la mesure où ce qui fonde le sujet est la reconnaissance mutuelle de sa subjectivité par un autre – réciprocité –, et sa capacité à s’affirmer dans sa dignité par ce rapport à l’autre comme plus que son objet. Ensuite, ce qui caractérise le sujet politique est qu’il existe en vue du devenir qu’il se choisit, et doit donc être doté des moyens de sa continuité dans l’être, à commencer par une territorialité, au sens d’une extension spatiale et sociale et des moyens d’action concrète dans ce périmètre, et la capacité à organiser en lui les processus de politisation qui le fondent. Enfin, et surtout, le souverain politique ne doit pas être lu comme statique mais comme devenir : à la fois devenir des processus internes qui le fondent et le refondent constamment par la dynamique des processus de politisation, et devenir externe, dans son rapport aux autres souverains et dans la tension qui l’anime d’un projet politique.
2. De la souveraineté politique vers la souveraineté économique
Oh les beaux jours
A présent que nous avons esquissé les contours d’une théorie de la souveraineté politique, reste à identifier comment cette notion peut trouver à s’appliquer au champ de l’économique. Nous allons ici devoir opérer une nouvelle parallélisation : comme nous avons dans la précédente section utilisé le parallèle fécond entre le champ de la théologie – et de l’ontologie métaphysique – et le champ de la théorie de l’Etat, ou plus généralement de la philosophie politique, en assurant une identification point à point et une mise en relation des structures systématiques de l’être et de l’existence d’une part, et du pouvoir et de la décision d’autre part, il est possible d’opérer le même transfert point à point, et la même mise en relation des structures entre le champ du pouvoir et de la décision politique avec le champ du pouvoir et de la décision économique. On peut observer qu’au premier ordre, l’analogue économique du pouvoir politique et de l’être métaphysique est la propriété : détenir le pouvoir sur un objet politique se met en rapport de la détention de la propriété sur un objet économique. Dans la même continuité, l’analogue économique de la décision politique est la transaction, c’est-à-dire l’action économique : le choix économique d’agir sur sa propriété ou d’acquérir une nouvelle propriété, qui se met en relation avec le choix politique d’exercer un pouvoir, ou d’en ériger un nouveau sur son objet politique. Enfin, l’ordre juridique dans le champ politique, comme espace dans lequel les pouvoirs institués forment leurs décisions et les mettent en œuvre se met en regard de l’ordre du marché dans lequel les acteurs économiques disposent de leurs propriétés et réalisent des transactions, ou plus exactement ce que la doctrine constitutionnelle française désigne par ordre public économique, dont le fonctionnement concurrentiel des marchés est une composante fondamentale mais non exclusive[27].
Selon ce parallèle, et en suivant le fil du développement précédent en politique, de même que l’analyse des phénomènes politiques et juridiques doit partir de l’analyse du processus de politisation des citoyens et de leur participation à une souveraineté commune, l’analyse des phénomènes économiques doit partir de l’analyse de l’action humaine, et des termes de l’échange, de la catallactique : ceci nous oriente naturellement vers une approche autrichienne. Comme l’exprimait L. von Mises : « Le sujet de l’économie, ce n’est pas les biens et les services, c’est les actions des hommes vivants. Son but n’est pas de s’étendre sur des constructions imaginaires telles que l’équilibre. Ces constructions ne sont que des outils de raisonnement. La seule tâche de l’économie, c’est d’analyser les actions des hommes, d’analyser des processus.[28] »
Reste alors à élucider ce que peut être la souveraineté dans ce champ économique, en s’appuyant comme nous l’avons fait dans la section précédente sur le parallèle, et le va-et-vient, avec les structures systématiques du politique. Nous l’avons posé : le souverain politique est acte pur de décision, qui dépasse son statut d’objet juridique pour devenir un sujet politique et donc un sujet de droit. Le souverain économique serait donc acte pur de transaction, qui dépasse son statut d’objet des forces du marché pour devenir un sujet du marché. Le souverain économique est donc celui qui est sujet de l’ordre public économique, c’est-à-dire celui qui est capable d’ériger un marché, d’en ordonner le fonctionnement, aux fins des objectifs, de l’idée d’œuvre économique qu’il définit, et celui qui est capable de dépasser dans son action économique l’application mécanique des règles de l’offre et de la demande pour agir librement dans les fins qu’il s’assigne.
La théorie économique et la doctrine juridique appliquées au monde économique comportent une définition des acteurs de marché capables de s’extraire des comportements qui résultent mécaniquement de l’application des forces économiques et des règles de l’offre et de la demande. En droit européen, depuis l’arrêt United Brands (1978)[29], la définition d’une position dominante (monopoly power) renvoie à « la position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs ». L’acteur dominant est sur un marché pertinent donné celui qui dispose d’un pouvoir de marché, ou pouvoir de prix (dans une appréciation lato sensu du prix) et qui est ainsi capable d’agir sur le marché indépendamment des contraintes qu’exerce normalement la concurrence des autres offres face à la demande. Ces acteurs en position dominante exercent alors un pouvoir de marché sur un marché pertinent donné, entendu comme un espace concurrentiel sur lequel existe une substituabilité de la demande[30] : leur apparition au sein de marchés est une manifestation spontanée de l’action des acteurs économiques dans l’ordre du marché qui ont intérêt à s’entendre pour exercer un pouvoir économique dans les transactions. L’ordre du marché contient ainsi en lui-même la possibilité pour les acteurs de s’en extraire, mais s’ils le font et créent un acteur dominant ou un cartel, ils tuent le marché et les vertus économiques qu’apporte son fonctionnement concurrentiel[31]. A l’autre extrême, inclus dans le marché car inclus dans ses processus mais en même temps exclu de participation active à celui-ci et à ses transactions, figure celui qui n’est plus qu’objet des forces de marché, et qui est réduit à l’état de marchandise ou de commodité[32].
Pour autant, les acteurs en position dominante ne sont jamais en position dominante que relativement à un marché pertinent donné. L’acteur qui est sujet du marché de manière absolue, ou la plus totale, est le souverain économique : il est celui qui institue les marchés, qui en définit les limites (« au commencement se trouve la clôture »), et qui peut y agir pour ses propres fins, y compris en disposant des positions dominantes qui peuvent y émerger ; et il est celui qui peut ériger des marchés au-delà de ceux qui résulteraient de l’ordre spontané émergent des agents économiques qui lui préexistent. Le souverain économique est donc celui qui a le monopole des marchés : monopole de les créer, de les délimiter géographiquement et comme marchés en cause, le monopole de déterminer quels acteurs économiques sont admis ou non à y participer, le monopole d’y disposer d’un pouvoir de marché[33], d’une part par l’action directe du souverain dans le marché, d’autre part par la définition, la régulation, ou la suppression des positions dominantes.
Ici à nouveau, il convient de se défier de toute tentation de placer une rupture entre le souverain économique et les agents qui participent à l’ordre économique qu’il institue. Le souverain économique est pleinement partie à l’ordre des marchés, il peut être amené à y participer – ne serait-ce que pour en dériver les ressources nécessaires à son fonctionnement –, se nourrit de l’information qui y est produite, et agit en vue de l’action économique en devenir et de son déploiement, c’est-à-dire du développement économique. Il est tourné vers l’action des agents dans l’ordre qu’il institue, et dérive le sens de son action économique de l’adhésion des agents au devenir économique qu’il anime et de leurs transactions dans les marchés qu’il organise. Il serait permis d’aller jusqu’à poser qu’il est soumis à une mise en concurrence des souverains économiques par les agents économiques, qui peuvent choisir d’arbitrer entre différents marchés plus ou moins bien organisés par rapport à leurs besoins selon leurs intérêts économiques, de même que le souverain politique est soumis à la confiance / censure par les citoyens.
On pose ainsi une définition claire de la souveraineté économique, cohérente avec la définition de la souveraineté politique. Cette définition permet de discerner la distinction entre souveraineté économique et autarcie ou autosuffisance. Pour être souverain économique il n’est pas nécessaire que la totalité du marché d’un bien ou d’un service soit inscrite dans un périmètre géographique déterminé, ou que les acteurs présents dans ce périmètre puissent à eux seuls garantir la satisfaction de la demande : il suffit d’avoir la capacité effective de délimiter qui peut participer ou non à ce marché, et d’en assurer le fonctionnement efficient dans la durée, en prémunissant ce fonctionnement efficient d’interventions externes qui en distordraient les résultats correspondant à l’optimum socio-économique, éventuellement ajusté au regard des objectifs de politique publique assignés par le souverain politique. Dans le cas général, forcer le marché intérieur à n’être satisfait que par des productions locales, ou forcer les productions locales à se doter de moyens dimensionnés pour pouvoir satisfaire toute la demande éloigne ce marché de l’optimum socio-économique, et dégrade la souveraineté économique en ce qu’elle détruit une partie de son efficience concurrentielle, et confère à des acteurs en nombre défini un pouvoir de marché additionnel, en excluant certains de leurs concurrents. L’autarcie ou l’autosuffisance peuvent être des buts recherchés dans certains cas par le souverain économique, qui par définition peut les réaliser s’il est souverain, puisqu’il a le monopole sur des marchés, mais seulement lorsque l’équilibre est favorable entre ce que coûte cette autarcie ou cette autosuffisance au surplus collectif, et ce qu’elle apporte en termes de garantie de la continuité de fonctionnement du marché contre des interventions externes, si l’on veut que cette souveraineté économique soit efficace. Il en va de même en matière politique : c’est dans une logique de subsidiarité également que les interventions du souverain politique pour écarter des parties prenantes de l’ordre juridique ou du processus de politisation doivent se limiter strictement au nécessaire pour assurer la continuité de fonctionnement des processus politiques, notamment face à des atteintes externes.
Elle permet encore de discerner la distinction entre souveraineté économique et indépendance économique. Tout d’abord parce qu’il n’existe jamais réellement d’indépendance économique : puisque la sphère économique est celle de la propriété et de sa transaction, il n’existe que des interdépendances. Si l’un dépend d’un fournisseur pour un bien ou un service peu substituable, ce même fournisseur ou un autre peut aussi avoir des dépendances économiques, et en tout état de cause reçoit en retour paiement dans la transaction. Certes il existe des cas où un fournisseur tiers détient un pouvoir de marché et peut imposer son prix, ou refuser de fournir un bien ou un service donné, mais il n’y a pas de différence du point de vue du souverain économique entre celui qui détient ce pouvoir de marché au sein de son marché intérieur parce qu’il est en position dominante, ou celui qui est un partenaire commercial extérieur, éventuellement doté de motivations politiques à intervenir dans le marché intérieur. Dans les deux cas, s’il est souverain économiquement, il peut prendre des mesures soit à destination d’un acteur externe à son marché, soit pour réguler une position dominante interne à son marché, si cela est nécessaire pour préserver la continuité du fonctionnement efficient et concurrentiel du marché, dans le but identique de maîtriser leur pouvoir de marché – puisque sinon il n’aurait pas le monopole du marché. La souveraineté économique, en tant que détention du « monopole des marchés » réside tout autant dans la capacité à réguler les pouvoirs de marché internes que dans la capacité à réguler les pouvoirs de marché des partenaires commerciaux, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas économiquement mais politiquement déterminés. Elle recouvre le fait d’être le sujet des forces économiques, et donc de ne pas se laisser être l’objet d’autrui, ne pas se laisser soumettre à l’action d’acteurs économiques ou politiques externes qui imposeraient leur pouvoir de marché, comme les partenaires commerciaux, ou internes, comme des positions dominantes, sauf à en avoir décidé ainsi et à ce que cela soit dans son intérêt propre, en vue de la préservation de sa propre dynamique économique.
Elle permet enfin d’éviter de rattacher la souveraineté économique à des « attributs de la souveraineté », comme « battre monnaie », « lever l’impôt » ou disposer du contrôle des prix. De même que ce n’est pas le sceptre ou la couronne qui font le souverain politique, la souveraineté économique ne peut être réduite à aucun de ces éléments. A titre d’exemple, dans le champ monétaire, la souveraineté ne réside pas dans le fait d’exercer par soi-même une force de marché, par exemple en disposant directement du monopole de la création monétaire par l’émission fiduciaire directe : cette création peut être déléguée à d’autres dont on contrôle et régule l’activité à travers le banquier central, mais la souveraineté peut même être exercée précisément dans le choix de refuser de porter atteinte, pour des raisons politiques, à la formation du stock de monnaie selon des processus auxquels le souverain choisit de ne pas avoir prise, pour peu que ce choix soit conscient et procède d’une vision propre du rôle qu’il souhaite avoir dans l’ordre économique qu’il institue : les Etats-Unis d’avant la création de la Federal Reserve (1837–1913) comportaient bien déjà un souverain économique.
Enfin, fréquente est la tentation de rattacher à la notion de « souveraineté économique » dans le discours commun la maîtrise de tel ou tel « secteur stratégique », sans que cette notion ne soit jamais bien clairement définie. Cette tentation est particulièrement forte en France où l’idée de « champions nationaux » portant des « grands projets emblématiques » a été particulièrement ancrée dans le discours politique autour de totems industriels qui mettent autant en avant les succès technologiques passés qu’ils occultent les non moins nombreux échecs. On peut y discerner, notamment, l’ombre portée d’un gaullisme qui s’est pour l’essentiel refusé à une construction doctrinale économique ordolibérale comme les démocraties chrétiennes d’Europe de l’Ouest, et donnait au « Plan » et à la réalisation d’ouvrages emblématiques un rôle politique et symbolique sans pour autant lui dénier toute valeur économique. Bien souvent, cette expression de « secteurs » ou de « filières » stratégiques prête à instrumentalisation, tant l’absence de définition claire comme sa facilité d’usage comme thought terminating cliché du discours politique permet de l’appliquer à n’importe quel secteur. Comme cela a pu être dit, dans la pratique politique, il n’existe pas de définition d’un secteur ou d’une entreprise stratégique, si ce n’est d’être un secteur ou une entreprise qu’un ministre souhaite subventionner.
Là encore, la réflexion construite plus haut autour de la souveraineté politique peut nous éclairer. La souveraineté économique, comme la souveraineté politique, doit s’appréhender comme dynamique, comme flux, et non comme stock. Pour le souverain politique, s’il existe au sein de l’ordre qu’il institue des corps constitués et des actions politiques qui doivent être préservées tout particulièrement, c’est parce que ceux-ci participent à son devenir, s’alignent avec son idée d’œuvre, et conditionnent la continuité et le devenir des processus de politisation des citoyens. Si certains droits politiques, si certaines institutions, comme l’espace public, comme les instances de la démocratie représentative, comme le fonctionnement des pouvoirs exécutifs et judiciaires revêtent une importance particulière, ce n’est pas pour eux-mêmes, mais parce que, et dans la limite où ils permettent la poursuite du devenir politique de la collectivité, et du fonctionnement dynamique des processus de politisation qui l’animent. Et le rôle du souverain à leur égard n’est pas de s’autoriser à agir plus particulièrement dans ces domaines, mais bien au contraire à les protéger, c’est-à-dire s’abstenir d’y agir, et à les prévenir de toute interférence tierce, pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle. Et ces secteurs essentiels du souverain politique ne doivent pas être vus comme simplement ceux qui permettent effectivement le fonctionnement des institutions et du souverain, mais aussi comme ceux en vue desquels son action trouve son sens politique. Il en va de même que dans le champ de l’être, où pour rester sujet, le sujet ne peut se réduire à la protection de son existence très matérielle et de sa vie biologique, mais doit encore défendre sa dignité et sa capacité à exister, pour être plus qu’un objet[34] .
De l’exacte même manière, s’il existe une souveraineté économique, il serait vain de la résumer à la protection de « secteurs stratégiques » énumérés. On n’est pas « souverain » parce qu’on maîtrise une « filière acier » ou une « filière automobile » : il faudrait sinon considérer que ne sont pas souverains ceux qui n’en disposent pas sur leur sol. Pourtant, il faut bien admettre que Singapour, Israël ou le Danemark disposent d’une souveraineté économique, et ce parce que dans les termes des échanges mondiaux auxquels ils participent pleinement, leurs produits sont aussi nécessaires à leurs partenaires commerciaux qu’il leur est nécessaire d’accéder aux échanges, et qu’ils disposent pleinement et librement de la faculté d’agir sur leur ordre économique interne, sur leurs échanges avec les tiers, et sont animés d’agents portés par un processus de développement économique, et imbriqués productivement dans le système économique et politique mondial d’une manière qui rend prohibitivement coûteux pour d’autres souverains politiques ou économiques de porter atteinte à leur souveraineté économique.
On n’est pas davantage « souverains » parce qu’on maîtrise la production et la fourniture de certains biens et services essentiels à la continuité de fonctionnement concurrentiel de l’économie, et aux besoins du souverain politique – ce qui au passage pose la question de ce que signifie « maîtriser » : détenir directement par le souverain économique, disposer d’un contrôle effectif et opérationnel sur ceux qui assurent ces productions ou les prévenir de prises de contrôle externes ? La souveraineté économique revêt une responsabilité vis-à-vis de certains secteurs, à savoir ceux qui conditionnent la bonne marche concurrentielle des marchés et la dynamique des transactions au sein de l’ordre public économique qu’il institue[35], mais sa responsabilité vis-à-vis de ces secteurs est de s’assurer plus particulièrement qu’ils ont un fonctionnement économique concurrentiel, dynamique, transactionnel en interne, ne constituent pas en interne de rigidités ou d’abus et ne font pas l’objet d’immixtions externes au détriment du reste de l’économie et de sa dynamique, et poursuivent leur devenir vers le développement économique. Cette responsabilité particulière se fond dans la responsabilité du souverain économique à assurer au sein de son ordre public économique une dynamique de développement, de découverte de l’information et de réalisation de toutes les potentialités ouvertes par le développement et l’ingéniosité des agents. S’il existe des secteurs stratégiques, c’est en tant qu’ils permettent à l’économie de se développer, pour son devenir, et non pour eux-mêmes ou pour les besoins qu’ils satisfont dans le présent, et le souverain économique doit s’attacher certes à ceux-ci, mais bien davantage à permettre aux secteurs stratégiques de l’économie de demain d’émerger : il le permet non par son action mais précisément en s’assurant qu’existent des espaces de marché où peut continuer à se découvrir l’avenir de l’économie par le processus transactionnel[36] . Lorsque le juge fédéral a établi[37] en 1911 que la Standard Oil violait le Sherman Act, et organisé sa séparation, c’était un acte de souveraineté économique, en ce qu’il permettait dès lors à nouveau au système de prix de révéler efficacement dans quelles directions l’économie pouvait se développer, pour la production d’hydrocarbures et pour sa consommation, et à travers cela pour l’ensemble de l’économie compte tenu du rôle devenu central de cet intrant énergétique, ce que la position dominante prévenait antérieurement. De même, lorsqu’à la même époque[38] a été instituée l’Interstate Commerce Commission – qui sera le prototype des autorités de régulation sectorielles actuelles – c’était pour réguler certains segments de l’économie (transport ferroviaire, puis routier, téléphonique) dont le caractère concurrentiel, et où la formation juste du prix, était essentiel au fonctionnement du reste du système de prix, de l’ensemble de l’économie et ainsi essentiel à la poursuite de son développement. Enfin, lorsqu’en 1938 le gouvernement français a dû, face aux risques économiques encourus par le secteur ferroviaire, nationaliser les lignes principales existantes et les joindre au sein de la SNCF pour maîtriser l’emballement de leur déséquilibre économique, c’était là encore pour maintenir la continuité du fonctionnement du marché intérieur tout autant que pour maintenir un service essentiel à la souveraineté politique. Ces trois exemples illustrent ainsi que même dans ce champ de secteurs « stratégiques », la souveraineté économique est a priori neutre vis-à-vis de choix reposant plus ou moins sur l’intervention directe de l’Etat dans la production elle-même, et peut passer par la constitution de monopoles publics, par la régulation d’acteurs en monopole naturel, publics ou privés, ou par le démantèlement de monopoles privés : elle ne dit rien du mode de détention des moyens de production, elle existe en vue du système de prix et du processus de développement économique qu’il permet.
Ce souverain économique s’articule avec le souverain politique dans une relation d’interdépendance, sans que l’un puisse être identifié à l’autre. Le souverain économique a besoin, pour pouvoir exercer ses prérogatives et notamment pouvoir garantir le fonctionnement des marchés, qu’existe un ordre juridique concret, et qu’un souverain politique puisse faire exécuter la norme. Pour qu’existe un ordre public économique dans lequel s’exerce la propriété et se réalisent des transactions, encore faut-il qu’existe un ordre juridique reconnaissant des droits de propriété et permettant la passation de contrats, et une force exécutive à ces droits et à ces contrats. Pour pouvoir créer un marché, disposer qui est autorisé à y participer, il faut aussi pouvoir réprimer les marchés qu’on ne souhaite pas voir se développer, et réprimer la participation irrégulière à un marché ou à un marché prohibé. Il faut pouvoir assurer le respect des contours territoriaux des marchés que l’on souhaite assigner, ce qui implique, lorsqu’existe une substituabilité de la demande entre offre domestique et offre importée, de pouvoir traiter de manière différenciée les agents et les produits issus du commerce extérieur de ceux participant au marché intérieur, et donc d’une capacité juridique et exécutive à intervenir physiquement sur ces flux et ceux qui les opèrent.
De l’autre côté, le souverain politique doit pouvoir s’appuyer sur un ordre public économique réalisé par le souverain économique. Il doit pouvoir tirer des ressources matérielles des activités économiques humaines, au premier titre par l’impôt, peut utiliser les marchés pour exercer ses décisions politiques, par des sanctions économiques ou pécuniaires, peut pour des raisons politiques vouloir créer des marchés pour assurer l’atteinte d’objectifs de politique publique qu’il décide, les réguler, et au besoin y intervenir. Cet ordre public économique, et les facultés de développement et d’exercice de leurs libertés économiques qu’il leur procure, constitue également dans la plupart des cas une attente forte des citoyens dans leur participation au processus de politisation, symétrique de leurs attentes politiques en termes d’objectifs de politique publique : pour qu’il y ait adhésion et participation au souverain politique, il faut que celui-ci garantisse des protections à la propriété et à l’action économique des citoyens, et non seulement des protections à leur être et à leurs libertés politiques : life, liberty, and property, pour citer Locke. Ainsi, il n’y a pas de souveraineté politique sans souveraineté économique, pas d’ordre juridique sans ordre public économique : les tentatives de construction d’ordres juridiques qui prétendent abolir l’ordre économique, et au premier titre la propriété, soit finissent par la recréer même subtilement, soit finissent par s’intégrer à un ordre économique plus grand qu’elle, soit finissent par s’effondrer. Symétriquement, les tentatives de construction d’un ordre économique pur, sans souveraineté politique, échouent soit face à la nécessité d’assurer le respect effectif du droit de propriété et de l’application des contrats, soit parce qu’ils deviennent ce faisant un projet de nature politique, et donc un processus de politisation.
Pour autant, les deux souverainetés sont bien distinctes et n’opèrent pas dans les mêmes champs, comme nous l’avons vu plus haut des champs politiques et de l’être. Un souverain politique qui entreprendrait de se fondre dans le souverain économique, et absorberait dans le champ du politique toute action économique ferait de toute entreprise économique, c’est-à-dire un « avoir en devenir », une « propriété en vue de la propriété », une institution politique, c’est-à-dire un « pouvoir en devenir », un processus de politisation continu doté d’organes décisionnels en vue d’une certaine idée d’œuvre, et perdrait ce faisant ce qu’apporte l’économique, à savoir le développement des ressources matérielles dans ce qu’il a de politiquement neutre. Si toute action économique est rendue politique, il n’y a pas de marché, et ce faisant pas de découverte de l’information au service de la construction d’optimums économiques collectivement déterminés, et faute d’information, pas de possibilité non plus d’une action politique : « le paradoxe de la « planification » tient à ce qu’il est impossible d’y faire un plan, faute de calcul économique. Ce que l’on dénomme économie planifiée n’est pas une économie du tout. »[39] . A l’inverse, un souverain économique qui prétendrait circonscrire l’ordre juridique dans sa finalité et dans ses moyens dans l’ordre public économique échouerait à répondre aux questions les plus fondamentales du politique. D’une part, la garantie des droits attachés à la dignité humaine, qui ne se résout pas dans la propriété et l’application des contrats : les droits et les libertés des citoyens ne se résument pas aux libertés économiques, bien qu’elles en soient un élément essentiel et coégal aux autres, et d’autre part sa propre préservation contre les interventions d’autres souverains politiques dans son ordre interne, face auxquelles il serait désarmé s’il réduisait toute son action à l’économique.
Cette lecture parallèle du politique et de l’économique, cette homologie des structures systématiques permet également de donner un éclairage sur la manière dont les agents économiques s’organisent en « institutions économiques », de la même manière que la sphère politique fait émerger, entre les citoyens et le souverain des institutions politiques. Comme le pose la définition du doyen Hauriou évoquée plus haut, les institutions politiques sont les entités qui se réalisent et durent dans un milieu social, où en vue d’une idée d’œuvre s’organise une structure de pouvoir, et où entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de cette idée se produisent des manifestations de communion. Elles sont une propriété émergente de l’ordre juridique, qui découle du processus de politisation des citoyens et les voit s’organiser pour la réalisation de leurs idées d’œuvre, c’est-à-dire des valeurs qu’ils souhaitent inscrire en politique. Mais cette considération ne permet pas d’élucider pourquoi ces institutions émergent, ni pourquoi elles se structurent dans une société d’une manière donnée et non d’une autre.
Le parallèle avec la sphère économique est ici encore révélateur : on pressent que l’analogue économique de l’institution politique est l’entreprise, entendue lato sensu, c’est-à-dire une entité qui se réalise et dure dans un corps social en vue de la réalisation d’un objet économique – dans le cas général, le profit – pour lequel s’organisent des structures de propriété, et où entre les membres du groupe social qui y participent se produit une forme économique de communion, par la solidarité de travail et d’intérêt aux bénéfices. De même que l’institution politique existe en vue de l’élucidation des valeurs politiques que les citoyens souhaitent inscrire dans la société, et pour les y réaliser, de même l’entreprise économique existe en vue de l’élucidation des valeurs économiques qui peuvent être trouvées dans l’ordre économique, et pour les y réaliser. Dans le champ de l’économique, si les entreprises émergent, plutôt qu’une organisation du marché qui demeurerait au niveau des agents individuels passant des contrats entre eux, c’est selon Coase[40] parce qu’existent des coûts de transaction : coûts de découverte des informations de marché, de mise en relation avec les contreparties, coûts de négociation, d’exécution des accords passés. Comme l’accès à certains marchés implique des coûts économiques, il est plus efficient pour des agents rationnels de s’agréger au sein d’une entreprise, en y internalisant les transactions, que d’agir individuellement par contractualisation, pour se fournir ces biens ou services au sein de l’entreprise plutôt que via le marché. Plus l’entreprise est grande, moins les gains sont importants à le faire car il devient de plus en plus difficile de coordonner en interne l’allocation efficiente des ressources par rapport à ce que réalise le marché, et car les coûts de structure s’accroissent. La rencontre de ces deux forces contraires conduit à développer des entreprises d’une taille déterminée, pour peu qu’existe un marché concurrentiel entre elles qui incite à rechercher l’organisation productive la plus efficace.
Dans le champ du politique, si les institutions émergent, plutôt que de la pure décision politique au niveau des citoyens, c’est parce que prendre des décisions politiques représente un effort politique – et a aussi un coût économique : coût de rechercher l’information, de produire la décision au plan formel, de l’exécuter dans la durée. Il est ainsi plus efficient politiquement d’organiser des institutions au service de valeurs partagées par un ensemble de citoyens, afin que celles-ci portent et réalisent en commun des décisions concourant à cette idée d’œuvre. Les institutions les plus simples sont par exemple des associations visant à une idée d’œuvre spéciale, bien identifié, par exemple la protection de l’environnement, ou la défense des intérêts d’une catégorie socio-professionnelle : il est plus efficace politiquement pour les citoyens de les constituer et les animer dans leur processus de politisation, et de confier à celles-ci le rôle de porter les décisions relatives à cette idée d’œuvre et la participation au souverain politique dans cet objet déterminé. A plus grande échelle, les partis politiques en sont un autre exemple, qui s’efforce de dégager une idée d’œuvre générale articulée autour d’un ensemble de valeurs auxquelles adhèrent les citoyens, et de porter les décisions politiques qui en découlent : cette organisation est politiquement plus efficace que de revenir systématiquement à la politisation des citoyens. S’ils se développent à l’excès, c’est-à-dire tentent d’amalgamer dans le champ du politique des valeurs de plus en plus hétéroclites et inconsistantes, c’est-à-dire ne proposent plus un cadre de compréhension des situations socio-politiques cohérent avec le système de valeurs qu’ils portent, ils perdent de leur efficacité politique, ce qui les amène à se refragmenter ou à disparaître, dès lors qu’existe dans le champ du politique la possibilité d’autres formes de représentation.
Ce parallèle permet enfin d’éclairer la coexistence de souverainetés économiques à plusieurs niveaux, notamment dans les systèmes politiques où coexistent plusieurs niveaux de souveraineté politique, par exemple entre l’Union européenne et les Etats-membres, ou entre un Etat fédéral et ses états fédérés. On l’a vu, pour fonctionner au plan politique, une telle articulation suppose que le processus de politisation du niveau inférieur soit tourné vers la construction et la participation au processus de politisation du niveau supérieur, et que le niveau supérieur s’attache à établir un ordre juridique commun d’une manière qui permette dans la durée ce mouvement, en respectant un principe de subsidiarité.
Nous avons défini plus haut le souverain économique comme le sujet de l’ordre public économique, ou encore celui qui a le monopole des marchés : monopole de les créer, de les délimiter géographiquement et comme marchés en cause, monopole de déterminer quels acteurs économiques sont admis ou non à y participer, monopole d’y disposer d’un pouvoir de marché, d’une part par l’action directe du souverain dans le marché, d’autre part par la définition, la régulation, ou la suppression des positions dominantes ». Il fait en Europe peu de doute que pour l’essentiel ce souverain économique est européen, dès lors qu’existe un marché intérieur européen intégré : que ce soit la définition des marchés et le cas échéant leur création, la fixation des règles communes de marché, voire le contrôle de leur mise en œuvre, le contrôle de qui est admis à participer ou non au marché intérieur européen par le biais du commerce international, des positions dominantes sur le marché intérieur, tous ces éléments constituent des compétences de l’Union, dont la mise en œuvre pratique peut être déléguée dans certains cas aux Etats-membres et à leurs institutions mais procède bien in fine du Traité. Certes les Etats-membres peuvent intervenir directement dans le marché intérieur mais c’est toujours sous le contrôle soit du droit de la commande publique harmonisé, lorsque cette intervention est pour leurs propres besoins, soit du droit des aides d’Etat et donc d’un contrôle a priori de compatibilité avec le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque cette intervention ne l’est pas.
S’il y a comme un malaise dans la souveraineté, d’où s’explique la prolifération des appels à la souveraineté économique nationale, c’est tout d’abord que la construction d’une souveraineté économique commune a de l’avance sur les progrès de l’intégration des souverainetés politiques : il y a bien une sphère publique européenne, mais elle est encore bien moins intégrée que le marché intérieur, et moins bien protégée par le niveau européen d’ailleurs. Dans le même temps, les processus de participation à la souveraineté politique européenne – et notamment en ce qu’elle interagit avec la souveraineté économique européenne ou nationale – laissent une part congrue au processus de politisation des citoyens européens : l’essentiel des compétences sont concentrées dans une Commission non élue, qui ne parvient pas à entretenir un mouvement avec son corps politique. Développer ce point excèderait largement le cadre de ce travail, mais signalons que tout progrès dans la construction d’une souveraineté politique européenne contribuerait utilement à apaiser ce malaise. C’est ensuite parce qu’à mesure qu’était mise en commun la souveraineté économique, ce qui restait de souveraineté politique aux Etats-membres ne trouvait plus son répondant, à la fois comme moyens de son action politique et comme enjeu à garantir, dans une souveraineté économique nationale. C’est en outre parce que manque au niveau européen les moyens politiques de parachever la construction d’un ordre public économique européen. C’est enfin et par conséquent, parce que dans cette lacune, la souveraineté économique, si elle commence à parvenir à remplir certains objectifs de politique publique européens ou nationaux échoue à répondre aux menaces extérieures sur nos souverainetés politiques : n’est pas pleinement souverain politiquement celui qui se fait placer en état d’exception par autrui, ce y compris par des moyens de nature économique.
Nous allons dans les prochaines sections développer les différents instruments de la souveraineté économique en identifiant ceux portés par les niveaux européens ou nationaux, examiner quelles solutions ont pu être trouvées dans d’autres systèmes juridiques pour articuler compétences fédérales et compétences fédérées en matière de souveraineté économique d’une part, et en matière de souveraineté politique d’autre part. Partant de cette analyse, nous éclairerons comment peut être refondée une souveraineté économique européenne, en prenant en exemple la question de la transition énergétique comme cas topique d’objectifs de politique publique communs comportant une dimension de subsidiarité, et d’interaction entre le champ du politique et le champ de l’économique.
3. Instruments de la souveraineté économique en Europe
Rater mieux.
Nous avons vu plus haut qu’une définition rigoureuse de la souveraineté dans le champ économique pouvait être dégagée par raisonnement analogique. Celle-ci pose le souverain économique comme sujet de l’action économique et de l’ordre des marchés : il dispose d’un pouvoir de marché ou d’un monopole sur l’ordre des marchés. Le souverain économique est donc celui qui pour un marché intérieur en définit les limites et détermine ce qui s’applique à ses frontières mais également le cas échéant les délimitations et la structure interne, les transactions et les agents qui en sont exclus, assure son fonctionnement concurrentiel et régule les pouvoirs de marché qui émergent au sein du marché intérieur, est en capacité d’y agir économiquement et d’y réaliser des transactions sujettes ou non aux règles de l’offre et de la demande qui s’appliquent aux autres agents économiques, et affirme vis-à-vis des souverains politiques ou économiques tiers sa compétence et son statut d’égal à égal.
Le projet européen s’est structuré autour de la conception d’un marché intérieur commun, le Marché unique, ce qui conduit naturellement la souveraineté économique en Europe à être en large partie intégrée et commune, et à s’articuler avec des compétences économiques nationales d’une part, et avec les souverainetés politiques européennes et nationales, de l’autre. La répartition précise des compétences respectives, inscrite dans le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), permet d’éclairer cette articulation : nous la présenterons dans cette section sur chacune des fonctions du souverain économiques décrites plus haut, en élucidant ce qui paraît constituer des angles morts, ou des lacunes dans le processus d’intégration européenne, susceptibles d’expliquer au moins en partie le sentiment d’une « perte de souveraineté ». Nous nous appuierons dans cet examen sur le cas d’autres marchés intérieurs communs, construits initialement comme rassemblement de souverainetés politiques hétérogènes, et dont l’intégration s’inscrit elle aussi dans un processus historique, notamment le cas américain, en rapportant les partages de compétences européens aux partages existants aux Etats-Unis entre niveau fédéral et niveau fédéré, et entre les différentes institutions fédérales.
3.1 Définir les frontières du marché intérieur
« Au commencement se trouve la clôture ». La première des fonctions du souverain économique est de délimiter l’espace économique qu’il institue, d’en fixer et d’en opérer les frontières, en les définissant d’une part, et en imposant ce qu’il souhaite qu’il se produise au plan économique aux dites frontières, de l’autre. Ce n’est évidemment pas un hasard si la question des frontières est aujourd’hui l’objet de toutes les crispations et d’une intense sensibilité politique, tant lorsqu’il s’agit des frontières de la souveraineté politique – autour des questions d’accès des tiers à notre espace politique, à travers les questions migratoires et d’asile, des questions d’interférence entre l’application extraterritoriale des décisions d’autres souverains politiques dans notre propre ordre juridique – mais aussi des frontières de la souveraineté économique. Qu’il s’agisse de réguler et d’organiser nos relations commerciales, de maitriser les flux de biens, de services et de capitaux, chaque évolution de cet ordre fait écho avec une intensité toute particulière dans le débat public, comme en ont témoigné les gesticulations quasi-unanimes du corps politiques français – certes dénuées de tout effet politique ou économique tangible – autour de l’accord entre l’Union Européenne et le Mercosur.
Ces frontières sont d’une part des frontières géographiques : que se passe-t-il lorsqu’une marchandise physique entre ou sort du marché intérieur via des échanges internationaux, lorsque des valeurs mobilières entrent ou sortent du marché intérieur, ou lorsqu’un service est assuré au sein du marché intérieur depuis l’extérieur, ou depuis l’intérieur vers l’extérieur ? Elles sont d’autre part des frontières en nature des biens et services : pour l’exercice de son action économique, et pour la structuration du marché intérieur par les acteurs économiques, quels biens et quels services sont substituables et constituent un même marché pertinent ?
Une seconde dichotomie peut ensuite être opérée, entre d’une part les frontières extérieures du souverain économique, c’est-à-dire celles qui distinguent le marché qu’il institue des échanges internationaux, et les éventuelles frontières internes qui peuvent subsister en son sein : charge au souverain économique de définir dans quelles conditions des subdivisions internes de son marché intérieur peuvent être admises, et le cas échéant quelle en est la structure et les conditions d’interconnexion.
Enfin, le souverain économique fixe les règles qui s’appliquent lors du passage de ces frontières. Il peut y agir en prix, c’est-à-dire assigner des coûts d’interface sous forme pécuniaire (droits de douane) ou d’acquisition de droits spécifiques (ajustement carbone, etc.), il peut y agir en volume, c’est-à-dire fixer des règles quantitatives (quotas d’importation ou d’exportation), il peut enfin y agir en information, c’est-à-dire imposer la reddition de données ou d’informations sur les produits échangés et les conditions des transactions réalisées aux frontières.
* * *
Les frontières extérieures du marché européen
Concernant les frontières géographiques extérieures de l’Union, le TFUE pose sans ambiguïté la compétence exclusive de l’Union pour définir la politique commerciale commune, conformément à l’article 207 du Traité, qui en énumère l’ensemble des composantes et attribue clairement la compétence au niveau européen, sous un régime de co-législation à la majorité qualifiée. Les Etats-membres ne disposent dans le cas général pas du contrôle des mesures de prix aux frontières (tarifs, mesures de défense commerciale lorsqu’elles sont de cette nature) ni du contrôle des mesures en volume, et ce, ni pour les biens, ni pour les services. Les Etats-membres ne peuvent pas sans déroger au Traité conclure leurs propres accords commerciaux, ériger leurs propres mesures douanières ou de défense commerciale et sont convenus de porter cette action ensemble. Cette compétence commune découle naturellement de l’objectif d’intégration du marché européen: en effet, si les marchandises doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur, il est nécessaire qu’elles se voient affecter un traitement rigoureusement uniforme lorsqu’elles franchissent les frontières extérieures de l’Union, sans quoi toute hétérogénéité pourrait être arbitrée et contournée par les importateurs ou exportateurs pour aller rechercher la frontière la plus favorable à la réalisation de leurs échanges, puisqu’ensuite les marchandises et services circulent librement à l’intérieur de l’Union. S’agissant des droits du tarif douanier, ceux-ci sont renvoyés spécifiquement au Conseil, mais seule la Commission dispose d’un pouvoir d’initiative pour les lui proposer[41]. Compte tenu de son caractère fondamental pour la mise en place d’un marché commun européen, cette intégration de la politique commerciale – et notamment douanière – européenne remonte au début du projet européen : la mise en place d’un tarif douanier commun pour toutes les importations extérieures à l’Union date de 1968.
« 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. » [42]
Pour autant, trois domaines s’inscrivent, dans des modalités propres, sous un régime d’unanimité au Conseil :
(i) Les accords « dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs », lorsque l’unanimité est requise en droit interne de l’Union pour certaines dispositions de l’accord (art. 207(4) (§2)),
(ii) Les accords « dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union » (art. 207(4)(a))
(iii) Et les accords « dans le domaine du commerce des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services » (art. 207(4)(b)).
Les négociations de tout accord de libre-échange relèvent de la compétence commune, et c’est à la Commission que revient la charge effective de porter, pour l’Union, les positions dans ‘le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union’. Les objectifs de la politique commerciale de l’Union sont complétés par un second énoncé, qui lui assigne, dans le Traité[43] , de « contribue[r], dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres. ».
Le Traité confie ainsi à l’Union un objectif de mener une politique commerciale alignée sur un objectif de « développement harmonieux du commerce mondial », de « suppression progressive des restrictions aux échanges » et de « réduction des barrières » : l’intention des auteurs du Traité, et l’interprétation faite de l’article 206 par la pratique de la Commission est que celui-ci assigne à la politique commerciale un objectif de libéralisation du commerce mondial et d’ouverture de l’Union aux échanges. Cet objectif a conduit l’Union à nouer trois catégories d’accords commerciaux avec des partenaires tiers : des accords de partenariat économique (APE) pour soutenir le développement d’Etats partenaires d’Afrique, des Caraïbes, et du Pacifique, des accords de libre-échange (ALE), et des accords d’association (AA). Des accords commerciaux sont aujourd’hui en place avec 78 partenaires commerciaux, tandis que des accords avec 27 partenaires sont en cours d’adoption ou de ratification, et avec 7 en cours de négociation.
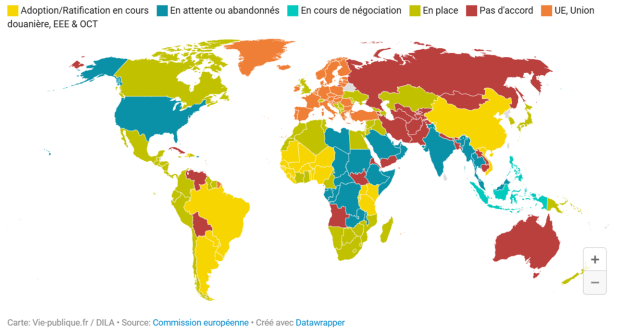
Crédits : Source : commission européenne
Fig. 1 – Statut des accords commerciaux de l’Union
Le projet de libéralisation inscrit à l’article 206 trouve son fondement dans une rationalisation ricardienne et classique des échanges internationaux, qui s’appuie sur l’idée, démontrable dans un cadre théorique mais interrogée dans les situations réelles, que le libre-échange serait un jeu à somme positive, par lequel lorsque deux partenaires ouvrent leurs échanges, le surplus collectif s’améliore des deux côtés de la frontière, lorsqu’on est en concurrence parfaite. Ce raisonnement se complète par le constat selon lequel celui qui institue une mesure commerciale s’expose ensuite à une rétorsion commerciale, qui entrainera une contre-rétorsion, etc. : de même que dans le champ des relations politiques entre souverains toute atteinte unilatérale présente un risque d’escalade, l’exact même risque d’escalade prévaut dans le champ économique, faisant d’une petite atteinte au libre-échange le germe d’atteintes importantes et réciproques destructrices de surplus collectifs à bien plus grande échelle. Le projet porté à l’article 206 s’inscrit par ailleurs dans une perspective historique, celle du cycle de l’Uruguay (1986–1994) parachevé par les accords de Marrakech et la création formelle de l’OMC (1994), puis des espoirs suscités par le cycle de Doha (2001). Cette perspective plaçait sans doute les auteurs du Traité non pas face à un débat politique sur la pertinence de principe d’un objectif de libre-échange mondial, ou sur la possibilité pour l’Europe de poursuivre seule cet objectif, mais sur les mesures d’adaptation, internes pour les territoires et les filières pénalisées, et externe pour les partenaires les moins développés économiquement, afin d’assurer une forme d’équité. De manière générale, il peut être resitué dans une période où existait l’espoir d’une harmonisation des relations politiques internationales par l’harmonisation des relations commerciales, selon l’idée que l’intensification des échanges économiques rendait tendanciellement impossible car prohibitivement coûteuses des atteintes unilatérales aux souverainetés politiques (le principe du « doux commerce des hommes » de Montesquieu) [44].
Depuis le milieu des années 2010, force est de constater que le contexte a changé, et que cet espoir a été battu en brèche par le choc du réel. Si au sein de l’espace européen pouvait être défendue l’idée selon laquelle l’intégration du marché commun et l’intensité des échanges économiques servait un projet politique a minima de pacification, et peut-être d’intégration, il pouvait tirer parti d’un sentiment d’appartenance européenne, même ténu, et de l’émergence, même progressive, d’un espace public et politique européen ; tel n’est pas le cas dans l’ordre international. Pour les autres participants principaux aux échanges internationaux (Etats-Unis, République Populaire de Chine), la politique commerciale continue de revêtir une dimension politique, et l’objectif d’échanges commerciaux internationaux aussi libres que possible, visant à assurer tendanciellement une pleine ouverture et l’abolition de l’ensemble des barrières notamment douanières n’est plus poursuivi : ces autres souverains économiques ont fait le choix de relations et de pratiques commerciales qui découlent d’objectifs politiques, et d’user de leur position dominante dans certains termes des échanges internationaux pour en tirer parti et maximiser localement certaines composantes de leur surplus.
Or pour qu’il y ait des bénéfices à participer au libre-échange, il faut être deux à être libres, c’est-à-dire deux à consentir à ne pas intervenir sur les échanges commerciaux, et il faut qu’il y ait un objectif partagé de concurrence parfaite de part et d’autre de la frontière. Le libre échange est un jeu à somme positive au sens du surplus collectif, mais encore faut-il que les deux partenaires commerciaux prennent leurs décisions sur la seule base du surplus collectif et non sur d’autres considérations politiques dans leur fonction de choix : on ne peut plus jouer constructivement si le partenaire triche, mais pas non plus s’il compte ses points selon des règles différentes, par exemple s’il attribue une valeur au fait de faire perdre, même à ses dépens, un autre joueur. Force est de constater d’une part que nos partenaires commerciaux principaux ne portent pas la même lecture de la concurrence parfaite et de l’égal accès des partenaires commerciaux à leurs marchés intérieurs[45] . Force est également de constater d’autre part que les objectifs poursuivis par leurs politiques commerciales intègrent non seulement la maximisation du surplus collectif mais également d’autres critères politiques d’évaluation, comme la préservation d’intérêts sectoriels[46] ayant une importance politique interne, ou des objectifs de politique extérieure, qui s’inscrivent dans la continuité historique de leur pratique diplomatique, les Etats-Unis ayant une longue histoire d’usage à des fins politiques de l’embargo commercial – et symétriquement d’usage de la force politique pour imposer des fins commerciales –, et la République Populaire de Chine, d’usage de ses ressources industrielles pour renforcer ses relations diplomatiques avec des partenaires.
Aux Etats-Unis, la compétence en matière de politique commerciale et douanière est indiscutablement confiée au niveau fédéral par la Constitution, depuis 1787 : l’article 1 section 8(1), qui énumère les compétences du Congrès lui confie dès le premier alinéa la capacité à « instituer et collecter des taxes, droits, impôts et accises » (taxes, duties, imposts, and excises) et dans le même alinéa précise que ces mesures doivent être uniformes dans l’ensemble des Etats-Unis. Dans le même temps, l’article 1 section 10(2) interdit aux Etats fédérés d’imposer quelque forme que ce soit de droits de douane sur les imports ou exports, hormis ce qui est strictement nécessaire pour couvrir leurs coûts encourus dans l’inspection des biens, les recettes des droits en question étant au bénéfice exclusif du budget fédéral et sous le contrôle du Congrès, disposition héritée de l’article 6(3) des Articles de Confédération.
Ceci procède en premier lieu du fait que pour les Etats du XVIIIe siècle, les droits de douane constituaient une ressource fiscale essentielle – qui restera majoritaire jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle[47] – et qu’il paraissait tout naturel pour un Etat qui venait d’acquérir son indépendance précisément pour des raisons fiscales et douanières de s’y intéresser explicitement dans sa constitution. Cela procède en second lieu de la compétence en matière de régulation des échanges commerciaux avec les Etats-tiers et entre Etats fédérés par le Congrès (Commerce Clause, art. 1, section 8(3)) : il n’y aurait pas de sens à ne pas avoir une politique commerciale homogène aux frontières d’un marché intérieur qui se veut ouvert et intégré. Il est particulièrement intéressant de noter que le débat sur les droits de douane et plus généralement les politiques protectionnistes sera un des deux éléments centraux du débat politique américain de la fin du XIXe siècle[48], au cœur des élections de 1888, 1892 et 1896, dans un contexte où l’industrie américaine, longtemps abritée par des droits élevés sur son marché intérieur, avait acquis une compétitivité et une assise domestique suffisante qui lui permettait d’envisager des politiques plus ouvertes, où les intérêts en la matière divergeaient entre le Nord-Est industriel et le Sud et l’Ouest, conduisant à des politiques démocrates plutôt favorables au libre-échange, et des positions républicaines plutôt favorables à des mesures protectionnistes. Le début du XXe siècle permit graduellement au pays de se doter de recettes fiscales qui remplacèrent rapidement celles des droits de douane avec l’institution d’un impôt sur le revenu et une baisse des droits dans le même texte (Underwood-Simmons Act, 1913), et malgré des efforts républicains pour réinstituer des droits protectionnistes en 1921 (Emergency Tariff, 1921, répondant aux difficultés du secteur agricole confronté à une baisse des cours mondiaux des commodités dans l’immédiat après-guerre) et en 1930 (Smoot-Hawley Act, 1930, en réponse au début de la Grande Dépression), à partir de 1934, la tendance passa clairement à une ouverture résolue des Etats-Unis aux échanges internationaux, d’abord sur le mode de négociations bilatérales, puis à partir de 1945 dans le cadre général du GATT. A l’heure actuelle, on ne peut que constater que l’administration américaine assume pleinement ce retour aux politiques de la fin du XIXème siècle : aux termes du Président Trump au cours de la campagne en 2024 : « le président McKinley a rendu [les Etats-Unis] très riches, par les droits de douane et par le talent. […] Il était un homme d’affaire naturel [natural businessman] »[49] . La crise qui s’est ouverte avec l’entrée en vigueur des tarifs au tournant du mois d’avril a également vu se multiplier les rappels des conséquences aggravantes de la Grande Dépression qu’ont eu les tarifs Smoot-Hawley.
La Constitution américaine ne comporte aucune clause correspondant à l’article 206 européen qui assignerait une fonction ou un objectif général à la politique commerciale et douanière des Etats-Unis. Celle-ci est une composante comme une autre des politiques économiques et diplomatiques du pays, qui fait partie des outils à la disposition de ses institutions pour exercer leurs compétences et atteindre les buts politiques qu’elles définissent, sans rechercher nécessairement l’ouverture des échanges mondiaux. Si la compétence procédait historiquement du Congrès, en particulier en tant que cas particulier de la compétence fiscale, la perte de son rôle de financement du budget fédéral à partir de 1913 a rendu possible une très large délégation de cette compétence du pouvoir législatif à l’exécutif. A partir de 1934, le Reciprocal Tariffs Act (RTAA) a confié au Président la faculté d’abaisser les droits de douane dans le cadre d’accords bilatéraux – autrement édictés par le Congrès[50], initialement pour 3 ans, puis régulièrement prolongée jusqu’en 1961 par le Congrès : sur cette période, les droits passèrent en moyenne de 46% à 12%. Cette compétence fut à nouveau confiée au Président en 1962 par le Trade Expansion Act, et régulièrement déléguée depuis. Au sein du Trade Expansion Act, la section 232 offre la possibilité à toute entité de l’exécutif ou toute partie intéressée de solliciter un examen par le Département du Commerce des impacts sur la sécurité nationale d’importations, du « fait de leurs quantités ou de leurs circonstances » et le cas échéant enjoint à celui-ci de proposer au Président sous 270 jours des conclusions et des mesures, tarifaires, de quotas d’importation ou autres, sans limite de durée. L’évaluation par le Département du Commerce s’appuie sur une double analyse, d’une part en termes de sécurité nationale (i) de la production nationale existante, (ii) des besoins futurs du produit en cause, (iii) des besoins en main d’œuvre, en matières premières, en équipements productifs, et tout autre élément nécessaire à la production dudit produit, (iv) de la dynamique des besoins, y compris les investissements et efforts nécessaires pour les satisfaire dans l’avenir, et (v) de tout autre facteur pertinent. D’autre part, pour les importations, le Département du Commerce doit considérer de même (i) l’impact sur l’industrie nationale considérée importante pour la sécurité nationale, (ii) l’effet du « déplacement de la production nationale », et (iii) tout autre effet réel ou potentiel affaiblissant l’économie nationale. Il s’agit donc d’un instrument très différent des instruments de défense commerciale classique pour répondre à des importations distorsives, et notamment des mesures de sauvegarde prévues à l’article XIX du GATT, aux Etats-Unis définies à la section 201 du Trade Act de 1974 : premièrement car il s’appuie sur un examen dynamique des effets sur la production nationale existante et potentielle (les capacités et outils de production), et sur sa capacité à répondre à des besoins futurs plutôt que dans le seul objectif de rétablir la situation antérieure de l’industrie domestique ; deuxièmement car des mesures peuvent être prises sur cette base unilatéralement, sans répondre nécessairement à une première atteinte ; et troisièmement car il ne comporte aucune limite de durée. La position officielle des administrations américaines successives est que ces dispositions de la section 232 s’inscrivent dans le droit de l’OMC et dans la continuité de l’article XXI du GATT qui permet des restrictions afin de protéger des « intérêts de sécurité essentiels » des Etats-parties, ce que contestent plusieurs Etats (Chine, Inde), dans la mesure où l’article XXI fait une référence très explicite s’agissant de restrictions hors d’une période de guerre ou d’une situation de crise dans les relations internationales (i) aux échanges de matières fissiles et (ii) aux armes, munitions, et équipements directement ou indirectement nécessaires à l’approvisionnement de la défense, conditions qui paraissent plus restrictives que la lettre de la section 232.
Dès 1934, le secrétaire d’Etat Cordell Hull attacha une importance toute particulière à la construction des relations bilatérales – y compris commerciales – avec l’Amérique latine, en utilisant pleinement les facultés nouvelles offertes par le RTAA. Les mesures de la section 232 furent dans le même temps régulièrement employées, soit comme menace, par l’ouverture d’enquêtes du Département du Commerce ne donnant finalement pas lieu à sanctions, soit jusqu’à l’institution de sanctions, notamment par l’embargo sur l’importation de pétrole brut iranien (1979) et lybien (1982).
Sur le plan des exportations, à la même époque, la politique commerciale, et l’institution d’embargo à l’export furent un élément clé des mesures américaines contre l’expansionnisme japonais, à travers un autre instrument légal (Export Control Act, 1940), visant à encadrer les exports de matières premières critiques (notamment ferrailles en 1940, puis pétrole suite à l’invasion de l’Indochine) et d’équipements militaires ou apparentés (équipements d’aviation, etc.). Ce texte fut graduellement amplifié et adapté, puis remplacé en 1949 par un nouvel Export Control Act répondant aux nécessités de son temps, fondant aujourd’hui le cadre de contrôle des exports américains. L’Export Control Act de 1949 et les textes qui lui ont succédé offrent à l’exécutif une grande latitude pour imposer des sanctions et des restrictions à l’export, non seulement pour des biens à double usage ou comportant un usage militaire, non seulement au regard des effets à l’intérieur des Etats-Unis (restriction des effets inflationnistes de la demande internationale sur des biens disponibles en faible quantité) mais aussi des effets à l’extérieur pour atteindre des objectifs de politique étrangère (restriction du développement de certaines capacités des autres pays). Le cadre de contrôle des exports issu de l’Export Control Act de 1949 a par ailleurs pour spécificités son extraterritorialité, puisqu’il s’applique à toute personne où qu’elle soit située, et le fait qu’il enjoint au Président de veiller à l’application des mêmes restrictions à l’export par les partenaires commerciaux des Etats-Unis, en le dotant de la capacité de suspendre l’exécution des programmes d’assistance s’ils ne coopèrent pas (Mutual Defence Act, 1951).
En transférant à l’exécutif la compétence commerciale, à la fois de restriction des importations par des droits de douane ou des quotas, et de restriction des exportations – plutôt par des quotas ou des interdictions générales, celle-ci s’est en même temps déplacée d’un rôle de politique économique intérieure – non exempte de considérations électoralistes – visant à protéger tel ou tel secteur économique particulièrement présent dans telle ou telle circonscription – et de politique budgétaire – vers un rôle de plus en plus clairement adossé à la politique diplomatique du pays, et plus généralement à la conduite de ses relations internationales.
La mise en place de droits de douane par l’administration Trump en janvier, puis mars et juin 2018 de droits de douanes unilatéraux en s’appuyant sur la section 232 du Trade Expansion Act s’inscrit ainsi dans un cadre juridique bien antérieur, qui avait déjà confié à l’exécutif une large compétence discrétionnaire et dans une pratique qui avait déjà utilisé de manière régulière à des fins de politique extérieure la politique commerciale. Sa singularité doit être recherchée ailleurs. Tout d’abord les produits couverts (panneaux solaires et machines à laver, pour la mesure de janvier 2018) paraissent présenter un lien au mieux distant avec la sécurité nationale américaine, mais un lien bien plus tangible avec des considérations électorales, voire clientélistes dans certains Etats-bascule : Whirlpool est un employeur important dans l’Ohio, Etat clé de l’élection de 2016, et le Président Trump y fera en 2020 un discours de campagne remarqué dans une usine du même groupe[51], renouant avec une pratique de la politique commerciale en bonne mesure disparue depuis 1934, et qui trouve ses racines dans la politique républicaine de la fin du XIXe siècle[52] ; de même, les droits sur l’acier et l’aluminium, respectivement à 25% et 10%, institués en mars 2018, s’inscrivent en partie dans une visée politique, afin de défendre des secteurs emblématiques de l’histoire industrielle américaine[53]. En second lieu, elle touche aussi des biens considérés stratégiques pour l’avenir et le développement de l’économie américaine, et ne se place pas dans une pure perspective de protection d’une base industrielle existante (panneaux solaires, acier, aluminium). En troisième lieu, notamment par l’extension de juin 2018 au Mexique, au Canada, et à l’Union Européenne, ces mesures ont touché d’une manière elle sans précédent des alliés stratégiques et diplomatiques des Etats-Unis, qui plus est parties d’un accord de libre-échange pour ce qui concerne le Canada et le Mexique.
Si singularité il y a, elle n’est donc ni dans les outils, ni dans le fait d’utiliser la politique commerciale à des fins de politique extérieure, mais dans le retour dans le champ du débat politique intérieure de la politique commerciale, qui en était sortie depuis les années 1930, et dans le fait d’assumer et de donner à voir un rapport de forces y compris avec des partenaires historiques, et donc dans une manière de pratiquer et de mettre en scène les relations internationales. Il convient ici de souligner que cette nouvelle approche n’a pas été remise en cause après 2020 : les droits de douane sur les panneaux solaires ont été prolongés pour quatre années en 2022, et si sur l’acier et l’aluminium les droits sur certains partenaires commerciaux ont ensuite été levés (Canada, Mexique, Japon, Royaume-Uni, etc.) c’est dans le cadre de négociations bilatérales et sans lever la mesure dans son intégralité, avec pour objectif affirmé en 2021 de converger avec l’Union Européenne et d’autres partenaires clé vers un Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum coordonnant des droits de douane contre les exportations des Etats non parties à cet accord. Si davantage d’attention est donnée à la forme vis-à-vis des partenaires diplomatiques, et vis-à-vis de l’ordre multilatéral, dans le fond, les constats comme les instruments légaux et économiques n’ont pas été remis en cause. Il peut à cet égard être posé la question suivante : si les deux administrations Trump ont fait des droits de douane unilatéraux un outil central de leur action économique et de politique étrangère, est-ce un choix délibéré, ou le résultat de l’état actuel du partage de compétences avec le Congrès, dans la mesure où la plupart des autres outils qui permettraient les actions radicales et spectaculaires promises à l’électorat nécessiteraient l’accord introuvable d’une majorité au Congrès, ce qui conduit naturellement à utiliser l’outil tarifaire, devenu au fil des délégations de pouvoir une quasi-prérogative propre du Président ?
La singularité se trouve également dans un questionnement de l’ordre international d’après-guerre et notamment de l’objectif de libre-échange et d’ouverture du commerce international : le discours devant le Sénat le 15 janvier 2025 de M. Rubio[54] , alors désigné pour être le prochain secrétaire d’Etat et confirmé depuis, pose avec une grande clarté cette nouvelle lecture, sur un mode quasi-paranoïaque : « Alors que l’Amérique a trop souvent continué à donner la priorité à « l’ordre mondial » par rapport à ses intérêts nationaux fondamentaux, les autres nations ont continué à agir comme elles l’ont toujours fait et comme elles le feront toujours : en fonction de ce qu’elles perçoivent comme étant leur meilleur intérêt. Au lieu de s’intégrer dans l’ordre mondial de l’après-guerre froide, elles l’ont manipulé pour servir leurs intérêts aux dépens des nôtres. […] L’ordre mondial d’après-guerre n’est pas seulement obsolète : il est désormais une arme utilisée contre nous. ». Il ne s’agit donc plus de considérer a priori que l’ouverture des échanges apporte des bénéfices aux deux parties, mais de considérer que les parties du commerce international sont en réalité des acteurs stratégiques, qui tentent d’en contrôler les termes pour assurer un rapport de force dans le champ du politique ou pour distordre l’équilibre économique en leur faveur davantage que ne le ferait une concurrence libre et non faussée. L’administration américaine remet ainsi en cause profondément la prémisse de l’article 206 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, à savoir l’idée d’une participation loyale des souverains économiques au jeu du commerce international, dans lequel l’équilibre ricardien apporterait à tous davantage de bénéfices que ne leur coûtent les impacts du libre-échange, et assoit cette remise en cause sur le constat de distorsions difficiles à nier, pour en conclure que « l’orientation […]donnée à la conduite de notre politique étrangère est claire. Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doivent être justifiés par la réponse à trois questions simples : Cela rend-il l’Amérique plus sûre ? Cela rend-il l’Amérique plus forte ? Cela rend-il l’Amérique plus prospère ? »
Il s’agit ainsi de constater que la politique commerciale est redevenue un objet stratégique dans un jeu entre acteurs où s’exercent des rapports de forces, et qui n’a plus comme solution univoque un abaissement tendant vers zéro des barrières douanières, solution qui ne vaut qu’en l’absence de comportements stratégiques des acteurs pour d’autres fins que la maximisation de leur surplus et en concurrence parfaite. Christopher Clayton, Matteo Maggiori, et Jesse Schreger, chercheurs au National Bureau of Economic Research ont développé depuis 2023[55] [56] et modélisé économiquement le concept de « géoéconomie » afin de refléter la manière dont les grandes puissances mondiales utilisent les termes financiers et commerciaux des échanges internationaux pour atteindre des buts géopolitiques dépassant la seule maximisation de leur surplus économique.
Il serait faux d’affirmer que l’Union européenne n’est pas consciente de cette évolution, qui remet en cause les prémisses de sa politique commerciale. Sa nouvelle stratégie commerciale, présentée le 18 février 2021[57] , rappelle le constat tiré par le FMI selon lequel « les restrictions imposées en 2017–2019 ont déjà davantage affecté la valeur des échanges commerciaux qu’au cours de la période 2009–2016 et le FMI considère que les tensions commerciales continuent de représenter un risque grave pour l’économie mondiale, dans une période de faiblesse particulière. » [58]. L’Union pose d’emblée l’affirmation selon laquelle « L’incertitude augmente à l’échelle mondiale, alimentée par les tensions politiques et géoéconomiques. Un renforcement de l’unilatéralisme a pris la place de la coopération internationale et de la gouvernance multilatérale, ce qui conduit à désorganiser les institutions multilatérales ou à les mettre hors-jeu. ». Elle tire donc le constat selon lequel le multilatéralisme ne peut plus répondre seul aux défis posés par le « changement de jeu ». Elle énonce quatre causes-clé de ce changement : premièrement, les tensions croissantes liées aux ajustements économiques causés par l’ouverture des échanges mondiaux, conduisant à « des appels à la démondialisation et à l’émergence de réactions de repli sur soi et d’isolationnisme » [59] ; deuxièmement, l’émergence de la Chine, nommément citée, « qui affiche des ambitions mondiales et applique un modèle distinct de capitalisme d’État » et « pose de plus en plus de problèmes au système établi de gouvernance économique mondiale et empêche les entreprises européennes qui affrontent la concurrence sur les marchés mondiaux et dans l’UE de bénéficier de conditions équitables » [60][61] ; et troisièmement, le changement climatique, qui impose de reconnaître que la transition écologique « objectif déterminant de notre époque […] conduira à une transformation progressive mais profonde de nos économies qui, à son tour, aura une forte incidence sur la structure des échanges commerciaux. »[62] , et enfin la transition numérique. Elle cite enfin la crise du Covid-19 comme élément révélateur et amplificateur de ces transformations, qui a tout à la fois montré l’interdépendance des économies mondiales, la vulnérabilité de l’Europe aux chaînes d’approvisionnement, et la tentation d’un repli sur soi de certains de nos partenaires commerciaux.
Face à ce changement, et confrontée au retour de l’unilatéralisme, la nouvelle politique commerciale de l’Union énonce une doctrine articulée autour du concept d’autonomie stratégique ouverte. Si le concept a pu être critiqué comme une « buzz-phrase »[63] typique du verbiage bruxellois[64] mais à la substance difficile à élucider[65] [66] , ou à tout le moins difficile à réconcilier avec une pratique institutionnelle relativement stable par les institutions européennes, cela ne rend pas tout à fait justice à la communication de la Commission qui esquisse bien une doctrine politique et économique.
Elle pose tout d’abord la nature stratégique de l’adhésion de l’Union au multilatéralisme et à l’ouverture des échanges internationaux : « L’UE doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique. L’ouverture et l’engagement de l’UE sur la scène internationale en font un défenseur crédible de la coopération internationale, du multilatéralisme et de l’ordre fondé sur des règles, qui sont à leur tour essentiels aux intérêts de l’UE » : ce choix de positionnement procède d’un calcul d’intérêts, et est exprimé comme tel. C’est dans ce cadre que l’Union entend répondre d’une part aux questions de résilience et d’accès aux matières premières critiques : « la politique commerciale peut contribuer à la résilience en fournissant un cadre commercial stable et fondé sur des règles, en ouvrant de nouveaux marchés afin de diversifier les sources d’approvisionnement et en mettant en place des cadres de coopération pour assurer un accès juste et équitable aux approvisionnements essentiels. ». L’Union pose l’idée d’une « politique commerciale à l’appui des intérêts géopolitiques de l’UE », visant à « façonner les règles mondiales pour qu’elles permettent une mondialisation plus durable et plus équitable » et de « renforcer la capacité de l’UE à défendre ses intérêts et à faire valoir ses droits, y compris de manière autonome si nécessaire. ».
Ceci n’est pas sans poser question toutefois : y a-t-il réellement calcul stratégique ou s’agit-il d’utiliser les termes du moment pour qualifier en réalité le statu quo dans la pratique effective de la politique commerciale ? Que sont les « intérêts géopolitiques de l’Union » faute de véritable souveraineté politique européenne, et notamment de politique extérieure commune complète ou de vision commune, portée par l’exécutif commun, de nos grands intérêts politiques internationaux ? Peut-on « façonner les règles mondiales » en utilisant comme seule force « l’ouverture et l’attrait du marché unique » ?
La déclaration commune du Conseil européen de Grenade[67] pose pour la première fois avec insistance l’idée d’une souveraineté européenne, sans la qualifier (économique ou politique) et en appelant à la renforcer, au terme de débats intenses entre Etats-membres entre recours à cette notion ou à celle d’autonomie stratégique ouverte. Si nos partenaires changent de jeu, nous devons aussi changer de jeu et examiner à présent avec lucidité les changements de pratique et de droit nécessaires pour en disposer réellement. Si le jeu du commerce international devient un jeu stratégique, choisir d’être l’objet des comportements stratégiques des autres souverains économiques ne fait pas une souveraineté économique européenne : l’Union doit s’assumer comme sujet.
Proposition 1 : Renverser la logique de la politique commerciale européenne : réinterpréter l’article 206
Si l’Union veut une souveraineté économique, la logique de mise en œuvre de l’article 206 doit être renversée. Là où aujourd’hui l’Union se donne pour objectif en soi la conclusion d’accords de libre-échange et l’abaissement tendanciel des barrières douanières en vue du « développement harmonieux du commerce mondial », elle doit à présent assumer que la politique commerciale est un outil de rapport de forces, qu’elle peut employer en vue d’atteindre son objectif politique, qui peut demeurer le développement harmonieux du commerce mondial et l’ouverture des échanges mondiaux.
Un tel changement d’approche est possible dans la mesure où tel que rédigé l’article 206 pose que c’est par l’établissement d’une union douanière (et donc par le caractère homogène de sa politique commerciale) et non par sa politique commerciale que l’Union contribue au développement harmonieux du commerce international, et qui plus est qu’elle le fait « dans l’intérêt commun ». S’il devait être établi que l’Union douanière est menacée, ou que certains des acteurs économiques nécessaires à la poursuite de la vitalité économique du marché intérieur sont menacés par un certain niveau d’échanges avec un partenaire tiers qui abuse des règles, que ce soit par l’irrespect ou le refus de contrôler la protection de la propriété intellectuelle, par des subventions à ses acteurs nationaux ou des règles de préférence dans ses marchés publics, ou le refus de réprimer certaines pratiques anticoncurrentielles de la part de ses acteurs nationaux, ou le non-respect de normes convenues pour l’accès au marché européen ; s’il devait être établi que ces échanges ne sont pas dans l’intérêt commun, et que leur poursuite et le comportement de ce partenaire menace en réalité l’intégrité du marché intérieur comme des échanges mondiaux ouverts au cœur du projet européen, l’Union doit avoir la pleine faculté d’utiliser sa politique commerciale proactivement, pour assurer, y compris par des restrictions quantitatives ou des droits de douane, que les échanges avec ce partenaire évoluent dans une direction plus raisonnée, et qu’un rapport de forces soit établi. Si le champ des échanges internationaux est devenu le champ de rapports entre souverains économiques qui exercent mutuellement des rapports de force, être un espace économique ouvert passif, qui capitalise sur sa seule attractivité – qui procède de sa taille, de son caractère intégré et développé – pour que ses partenaires jouent eux aussi le jeu de l’ouverture conduit à une impasse : l’Union ne peut demeurer l’objet d’autrui si elle veut être un souverain économique. L’Union doit devenir un sujet, et pour cela, assumer d’utiliser pleinement sa politique commerciale, non seulement dans un rôle défensif et réactif, mais aussi afin de s’établir comme souverain économique.
Il est d’autant plus aisé d’interpréter et de réinterpréter différemment l’article 206 que d’une part la portée de cet article n’a fait l’objet d’aucune jurisprudence de la Cour de justice, et d’autre part les auteurs du Traité n’envisageaient pas la situation actuelle de refragmentation des échanges, de retour de l’unilatéralisme, y compris de nos principaux partenaires, et d’abus des règles du commerce mondial par certains des participants, tel que constaté par la Commission elle-même en 2021.
Conséquence pratique de cette nouvelle interprétation, l’Union affirmerait sa capacité à prendre des mesures commerciales actives contre des partenaires commerciaux qui aurait fait le choix de l’unilatéralité et menaceraient ses intérêts économiques ou l’atteinte de ses objectifs politiques : l’Union irait au-delà de l’approche actuelle consistant à utiliser sa politique commerciale seulement en réaction à d’autres mesures. Si ces objectifs ne sont pas pleinement définis dans un cadre intégré, faute d’aboutissement de la construction d’une souveraineté politique commune, certains peuvent toutefois être affirmés sans trop de doutes : Etat de droit, intégrité territoriale des Etats-membres de l’Union, lutte contre le changement climatique, etc. L’Union n’a pas nécessairement besoin de mettre en œuvre ces mesures, mais affirmer qu’elle est prête à y avoir recours, qu’elle accepte une part d’unilatéralité, paraît une nécessité du temps. Bien entendu, ceci n’enlève rien au fait que l’Union pourrait toujours porter cette action au nom de l’objectif qui l’anime d’un retour au multilatéralisme et à des échanges internationaux ouverts. De même que dans le champ politique Karl Popper a démontré dans La société ouverte et ses ennemis qu’il est nécessaire d’être intolérant avec l’intolérance pour préserver la société ouverte, de même dans le champ économique, pour préserver l’idée et la pratique d’une économie ouverte il faut se doter de la faculté d’avoir une politique commerciale répressive avec ceux qui abusent du commerce international.
Proposition 2 : Faire un usage stratégique des relations commerciales bilatérales.
Dans la même logique, l’Union doit utiliser ses relations commerciales bilatérales dans une approche stratégique, c’est-à-dire assumer de choisir ses relations – et notamment les partenaires avec lesquels elle conclut des accords de libre-échange, en tenant compte certes des avantages économiques que procure l’accord pour les deux partenaires, mais aussi et surtout de l’intérêt stratégique à associer un partenaire. Faire un usage stratégique des relations commerciales bilatérales, c’est apprécier la valeur d’une relation commerciale non seulement pour elle-même mais aussi pour ce qu’elle apporte en termes de rapport de forces : rapport de forces entre les deux parties, et donc analyse des incitations au respect strict de l’accord et des rétorsions potentielles en cas d’infraction pesant sur la contrepartie de l’Union, et rapport de forces externe, que permet d’opposer à d’autres souverains économiques le rapprochement des deux parties à l’accord.
Ceci implique d’évaluer tout d’abord en quoi ce lien permet en même temps d’écarter ce partenaire d’un rapprochement avec d’autres souverains économiques qui ne jouent pas le jeu des échanges internationaux ou ont une attitude politique hostile à l’Union, en quoi il ouvre à l’Union un accès libre et non faussé à des ressources qui sinon pourraient lui être soustraites par des actions d’autres souverains politiques ou économiques hostiles, et donc en quoi cet accord renforce le pouvoir de négociation et le rapport de forces de l’Union dans le jeu du commerce mondial, et d’apprécier en second lieu en quoi le partenaire envisagé comporte des caractéristiques qui permettent de penser qu’il continuera dans la durée de jouer avec l’Union un jeu équilibré et une concurrence libre et non faussée. Ceci implique ensuite de faire des accords bilatéraux de libre-échange un outil pour l’atteinte non seulement des buts économiques de l’Union mais également de ses objectifs politiques, et donc d’en faire un outil actif de promotion des valeurs communes. Ceci implique enfin d’évaluer froidement en quoi, même si le partenaire commercial ne joue pas parfaitement le jeu, certaines caractéristiques de ses échanges ne peuvent pas être utilisées à notre avantage, et d’analyser de quels moyens de pression ou de rétorsion nous disposons s’il devait aggraver ses pratiques.
Ces termes et cette approche stratégique, probablement déjà présente en germe dans la lecture par une partie des Etats-membres de certains accords de libre-échange, peuvent et doivent être affirmés par l’Union devant ses partenaires existants ou potentiels, afin de clarifier les règles. Ils ont vocation à peser sur le choix de nos partenaires, comme sur la forme et la structure des accords, qui pourraient par exemple comporter des tranches successives (d’extension à davantage de produits ou d’abaissement progressif des droits) conditionnées à la démonstration du respect de certains points clés pour l’Union, soit au plan économique, soit au plan politique (par exemple : lutte contre le changement climatique, mise en place de politiques environnementales homogènes avec les nôtres, etc.).
En mobilisant dans une logique stratégique, d’amélioration de son pouvoir de négociation et de son influence globale, ce qui est une de ses forces, à savoir sa capacité à construire des partenariats bilatéraux avec ses principaux partenaires commerciaux pour ouvrir avec eux les échanges et construire une relation privilégiée, l’Union répondrait point à point, et subvertirait, la lecture également stratégique du commerce international qui est faite par l’administration Trump. Face à une doctrine Miran[68] qui pose que « Les droits de douane étant un outil de négociation, le président [doit se montrer] flexible dans leur mise en œuvre — l’incertitude quant à leur applicabilité, leur date et leur ampleur ajoute à l’effet de levier dans une négociation, en créant la peur et le doute. », l’Union répondrait en proposant à des partenaires une réduction des droits de douane, un partenariat commercial, certains et durables, gages de confiance, mais dans une logique tout aussi stratégique.
Proposition 3 : Placer la réciprocité au cœur des termes des échanges.
Enfin, être souverain économiquement, c’est-à-dire être un sujet dans l’ordre économique international, implique d’être mutuellement reconnu comme sujet par les autres souverains économiques. Le rapport à l’autre du sujet est un rapport empreint de réciprocité – sans quoi l’un des sujets est un peu l’objet de l’autre.
Ceci implique, vis-à-vis de nos principaux partenaires commerciaux économiquement souverains, de nous doter des mêmes instruments qu’eux, et de nous doter des exactes mêmes capacités à intervenir dans notre ordre économique intérieur ou dans nos relations économiques extérieures, notamment d’un Export Control Act européen, et d’une Section 232 européenne.
En particulier, si nos partenaires considèrent que l’article XXI du GATT permet des mesures telles que celles de la section 232 du Trade Expansion Act, la réponse à des droits de douane sur l’acier européen peut être des mesures de sauvegarde, comme l’Union l’a fait en 2018, mais doit surtout être pour l’Union de se doter du même instrument à la majorité qualifiée, qui permet l’instauration unilatérale de droits de douane pour protéger des secteurs économiques jugés essentiels aux intérêts fondamentaux de l’Union – et notamment la préservation de l’intégrité du marché intérieur – ou à la défense européenne – c’est-à-dire jugés essentiels par les Etats-membres à leur défense, et ce sans limite a priori de durée et sans avoir à justifier d’impacts a priori sur ces secteurs ou de leur importance clé pour la défense. De même, si nos partenaires disposent d’outils de contrôle des exports, sur certains biens ou services présentant une sensibilité particulière, soit du fait d’une avance technologique de l’Union, soit du fait de leur importance potentiellement pour le développement de capacités par des parties hostiles, l’Union doit pouvoir se doter d’un régime de contrôle des exports pour la défense de ses intérêts propres, permettant de prévenir les exports de certains biens ou services sur demande d’un Etat-membre ou à l’initiative de la Commission, selon une règle de majorité qualifiée. De même, si nos partenaires commerciaux appliquent ces contrôles de manière extraterritoriale, c’est-à-dire en les appliquant à des tiers non établis sur leur territoire et en se dotant des moyens exécutifs et répressifs pour les appliquer in concreto, l’Union doit aussi disposer de tels moyens. Nous filerons, au long de la présente section, cette question de la réciprocité, pour éclairer quelles en seraient les conséquences pratiques pour l’Union.
Ceci implique en second lieu de toujours prioriser l’application, dans notre espace économique comme dans nos relations commerciales, de réponses réciproques aux actions d’autres souverains économiques, c’est-à-dire utilisant les mêmes instruments et dans les mêmes modalités et proportions, pour ne garder l’action unilatérale et le recours à des restrictions unilatérales des échanges – tarifaires ou quantitatives – que comme capacité et comme ultime recours. C’est seulement en procédant prioritairement par stricte réciprocité que nous parviendrons à protéger au mieux l’Union des risques d’escalade dans les rétorsions commerciales, et que nous tiendrons une ligne cohérente avec notre objectif principiel d’un ordre multilatéral reposant sur un développement harmonieux du commerce international.
Se doter d’une approche stratégique implique enfin et en troisième lieu de se donner les moyens d’une forme de dissuasion, et donc d’outils de politique commerciale qui dissuadent d’une action hostile non provoquée ou d’une coercition par un tiers, qu’elle soit dans le champ politique ou le champ économique. C’est en montrant clairement que l’Union dispose de moyens de rétorsion commerciale dont l’ampleur des effets serait inadmissible pour nos principales contreparties, qu’elle est capable de s’en servir si ses intérêts vitaux sont atteints (crédibilité), et en définissant clairement la doctrine d’emploi de telles rétorsions ultimes, que l’Union peut jouer stratégique. Pour pouvoir se placer dans le cas normal selon des règles de réciprocité des échanges, il faut aussi que nos partenaires soient clairement informés de notre faculté d’aller au-delà de la réciprocité raisonnable à des atteintes commerciales, si nos intérêts vitaux devaient être atteints, et notamment si les actions de tiers dans notre jeu économique visaient à l’anéantissement du fonctionnement sain du marché intérieur européen ou des institutions et du jeu politique / de l’espace public de l’Union. C’est en exprimant clairement où la réciprocité cesse de jouer, et où commence le recours à l’unilatéralité que la réciprocité devient un objet politique : il faut définir les limites dans lesquelles s’inscrit le jeu pour que le jeu puisse fonctionner selon un calcul rationnel. Cet effet dissuasif est clairement assumé par l’instrument anticoercitif, défini dans le règlement 2023/2675/UE, et dans les déclarations notamment de la présidence du Conseil lors de son adoption.
Ce règlement vise les « coercitions économiques », c’est à dire « lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre. »[69]. On peut à cet égard noter qu’il se réfère à des interventions ayant pour objet un effet juridique particulier, mais non à des actes ayant des effets purement économiques, ce qui constitue une première limite du cadre – qui serait corrigée par la création d’un outil analogue à l’art. 232 en Europe. Il peut en outre être observé que les articles 5 et 6 du règlement s’inscrivent dans une logique de maintien des canaux d’échange et de riposte graduée, visant à asseoir la démonstration de la stricte suffisance des mesures mises en œuvre, au prix d’un certain délai de mise en œuvre et d’une réactivité qui peut être insuffisante face aux impacts élevés d’atteintes par des tiers. A cet égard, disposer d’une définition plus claire de circonstances extrêmes où l’intérêt de l’Union dans son ensemble est en cause (par exemple perturbation du processus politique européen, subversion des instances politiques européennes, atteintes économiques touchant de manière grave l’Union), et donc d’une notion d’intérêts vitaux de l’Union, assortie d’une délégation plus forte à la Commission par le Conseil en majorité qualifiée pour agir dans des délais contraints face à ce type de circonstances, pourrait être envisagée dans une évolution future du mécanisme. Enfin, si l’instrument anticoercition prévoit bien à ses articles 8 et 10 la possibilité d’imposer des sanctions à des personnes physiques ou morales des Etats-tiers (et non seulement des outils de défense commerciale classiques), nous verrons plus loin que les limites de l’intégration des moyens exécutifs de police administrative ou judiciaire afférents à ces sanctions, et des voies pénales propres à ces sanctions, rendent en pratique difficile la mise en œuvre de telles sanctions par l’Union avec la même fluidité d’action et le même caractère immédiatement dissuasif que le sont les sanctions mises en œuvre par le gouvernement fédéral américain.
* * *
Le champ de la transition énergétique et les débats politiques les plus récents en la matière offrent de riches cas d’application de ces trois propositions, qui permettent d’en éclairer la portée pratique.
Les débats sur l’accord UE-Mercosur sont un premier exemple. L’accord signé le 6 décembre 2024 associe par un accord de libre-échange à l’Union cinq pays : l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie, représentant 80% du PIB sud-américain, et formant ainsi un espace économique sur 750 millions d’habitants et 20% de l’économie mondiale, éliminant progressivement 90% des droits de douane entre les deux zones, avec des clauses d’ouverture réciproque des marchés publics (y compris ceux des entités fédérées). L’accord comporte enfin de nouvelles dispositions sur l’accord de Paris pour le climat et la déforestation, permettant à l’UE de suspendre partiellement ou totalement ses relations commerciales avec un pays du Mercosur, dans le cas où ce dernier mettrait en péril l’accord sur le climat : ceci répond à la Proposition 1, dans la mesure où cela permet à l’Union unilatéralement d’utiliser sa relation commerciale pour atteindre un de ses objectifs politiques les plus fondamentaux, à savoir la lutte contre le changement climatique.
Sur un plan stratégique (Proposition 2) il convient ensuite de souligner que l’accord associe étroitement à l’Union un partenaire qui présente une très grande homogénéité de situation : c’est également un marché commun constitué par plusieurs Etats-membres, et qui s’inscrit dans un processus de construction et d’intégration progressive ; de ce fait le Mercosur est confronté aux mêmes défis que l’Union pour construire des positions communes et se définir comme souveraineté politique ou économique, ce qui rend le rapport de force très équilibré. Si un Etat-membre du Mercosur manquait à ses obligations sous l’accord, les autres Etats-membres agiraient à son égard pour le remettre dans le rang, pour éviter de subir des rétorsions européennes, de même qu’en Europe, la Commission et les autres Etats-membres veillent au respect par les Etats-membres de la politique commerciale commune. Ceci constitue en outre une garantie forte quant à la réciprocité dans l’application des normes environnementales et sanitaires les mieux disantes. Les relations commerciales entre l’Union et le Mercosur permettent en outre d’assurer, par l’importance des échanges actuels et leur développement futur, par la diversité des produits en jeu et de leurs importances économiques ou politiques, une incitation au respect continu de l’accord. Enfin, la relative égalité de taille, de puissance économique constitue une troisième garantie de fiabilité de cet accord.
Dans le même temps, il permet au Mercosur comme à l’Union de diversifier leurs partenaires commerciaux : la Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Mercosur, devant l’Union européenne, et y déploie des efforts commerciaux importants. Dans le même temps, le Mercosur est le principal – voire le seul – espace économique à même de produire et d’exporter les matières premières clés de la transition (cuivre, lithium, etc.) dans des conditions environnementales répondant à l’ambition européenne.
Après avoir mis en œuvre un Critical Raw Materials Act qui vise à identifier les dépendances stratégiques de l’Union en matière de métaux stratégiques de la transition et à s’en donner une cartographie et une méthodologie diagnostique, c’est bien en diversifiant nos sources et en créant des partenariats ouverts avec les différents espaces économiques qui disposent de ces ressources que l’Union peut arriver à desserrer ses dépendances. La souveraineté industrielle en la matière passe par le fait de disposer des marchés de ces produits, par le fait d’en assurer un fonctionnement concurrentiel ouvert et de pouvoir y impartir les règles de marché que l’Union souhaite, mais pas nécessairement par la recherche autarcique, à fonds publics perdus, de l’ouverture de mines sur le sol européen pour le principe – l’exploitation des ressources européennes devant être une possibilité pleinement ouverte aux acteurs économiques, y compris en veillant aux simplifications normatives requises, mais dans le cadre du jeu du marché – ni par la constitution a priori de stocks stratégiques ou par des politiques d’investissement public dans des projets miniers hors Union qui demeureraient soumis à des politiques commerciales arbitraires ou à des ingérences d’autres souverains économiques ou politiques [70].
De même, le Mercosur est le principal – voire le seul – espace économique à même d’apporter à l’Union, dont plusieurs Etats-membres, dont la France, seront importateurs structurels de biomasse dans leur trajectoire vers la neutralité carbone, les ressources énergétiques décarbonées (biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique, ammoniac vert, etc.) dont elle a besoin. Le Mercosur est enfin un des principaux espaces économiques dont la population adhère pour une part notable à un système de valeurs proche de celui porté par le projet européen, notamment sur la question environnementale comme sur celle de la protection des consommateurs ou en matière de valeurs démocratiques, et porte un héritage culturel commun.
L’accord UE-Mercosur répond donc indiscutablement aux critères d’analyse que nous avons posés en matière de souveraineté économique européenne. Il y contribue favorablement et sa conclusion s’inscrit, davantage que les précédents accords (UE/NZ, CETA, etc.) dans un projet stratégique, « géoéconomique » clair, relativement bien énoncé par la Commission. L’unanimité de la classe politique française contre cet accord, y compris de gouvernements qui ont porté énergiquement l’importance de désensibiliser l’Europe face à l’approvisionnement en matières premières critiques par la Chine ou d’associer d’autres partenaires stratégiques à la lutte contre le changement climatique, est parfaitement inaudible pour nos partenaires européens car parfaitement contradictoire. Elle a conduit à une perte de crédit majeure de la France dans le jeu européen, dont les positions paraissent refléter aux yeux de nos partenaires non un souci sincère d’équité de contrôle sur les agriculteurs – ce d’autant que le même gouvernement qui remet en cause l’accord sur ce motif, arguant de contrôles bien plus stricts en Europe, appelle dans le discours de politique générale du Premier Ministre à un frein sur les contrôles en France – mais des intérêts picrocholins et électoralistes, traduisant l’emprise de la filière élevage sur le Parlement du fait de la carte électorale et du système de vote pour ces assemblées et les tensions internes au monde agricole dans une période d’élections professionnelles, source de radicalisations cumulatives. C’est en étant cohérente avec elle-même, en portant ses positions à la hauteur de vue que commandent les enjeux, qu’elle apportera sa meilleure contribution à l’œuvre européenne.
Les débats sur le devenir de la relation commerciale avec la République Populaire de Chine sont un second exemple. La Chine est un partenaire commercial structurant pour l’Union Européenne. Elle représentait en 2023 8.8% des exportations européennes (troisième partenaire) et 20.5% des importations (premier partenaire), pour un solde négatif de 291 Mds€, devant les Etats-Unis (13.7%). Seuls quatre Etats-membres avaient en 2023 un solde commercial excédentaire avec la Chine : Allemagne, Finlande, Irlande et Luxembourg. Ce poids fait de la Chine un souverain économique et politique vis-à-vis duquel l’Union européenne doit définir une relation équilibrée si elle souhaite exercer une souveraineté économique réelle.
Dans le champ de la transition énergétique et des équipements clé qui y contribuent, l’Europe est aujourd’hui dans une relation de très forte dépendance. Sur la chaîne de valeur du photovoltaïque, par exemple, la Chine produisait en 2021 79.4% du polysilicium mondial, 96.8% des wafers, 85.1% des cellules, et 74.7% des modules, tandis que l’Europe pèse 17.6% de la demande mondiale[71] . Dans le champ des batteries pour véhicules électriques, le constat est le même, avec près de 75% des capacités de production mondiales de batteries, plus de 50% sur la plupart du traitement des métaux et de la production des composants des batteries[72] .
La domination industrielle chinoise sur ces secteurs se caractérise par – et procède de – une très forte intégration verticale sur l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur, tirant au maximum parti d’économies d’échelle, d’agrégations en clusters industriels, et d’une forte imbrication entre acteurs le long du processus productif[73] , au-delà des soutiens publics et d’une demande intérieure forte. Elle témoigne tout autant d’années de recherche et développement et d’une maîtrise technologique indiscutable même sur les technologies de panneaux les plus avancées et performantes. Aujourd’hui, 40% du polysilicium mondial est produit dans la seule province du Xinjiang, et un panneau sur sept dans le monde vient d’une seule usine en Chine. Si l’on compare[74] l’énergie produite au cours de leur cycle de vie (25 ans de garantie) par les panneaux solaires assemblés chaque année par les principaux producteurs photovoltaïques chinois et celle produite au cours de leur cycle de vie par les barils de pétrole et les mètres cubes de gaz extraits dans la même année par les majors pétrolières occidentales, sept producteurs chinois (Tongwei, GCL Poly, Xinte, Jinko Solar, Longi, Trina et JA Solar) produisent deux fois plus d’énergie qu’Exxon, et Tongwei à lui seul plus que les sept majors pétrolières occidentales, et une seule usine en construction en Chine disposera d’une capacité de production égale à l’ensemble de la demande européenne prévisionnelle. La très forte compétitivité de ces acteurs est aujourd’hui renforcée par les tendances déflationnistes de l’économie chinoise en ralentissement[75] , et par les politiques de relance économique chinoises qui donnent une part importante à l’investissement dans les infrastructures et notamment la production d’énergies renouvelables et bas carbone.
L’Union disposait encore à la fin des années 2010 d’une industrie domestique du photovoltaïque, avec 12.8% de la production mondiale de modules et 19.4% du polysilicium mondial. Le 4 juin 2013, l’Union avait imposé un droit de douane de 11.8% puis 47.6% à compter d’août 2013 contre les importations de panneaux chinois[76] suite à une enquête de 9 mois lancée en 2012 à la demande d’acteurs européens. Malgré des menaces de rétorsions de la Chine, l’Europe maintint en 2015 et 2017 ces mesures, tout en réduisant les droits à 30% et en alignant le prix minimal d’importation sur le marché mondial. En août 2018, la Commission retira finalement ces droits, dans une analyse coûts-bénéfices qui mettait en balance le fait que ce qui restait d’industrie européenne du photovoltaïque n’avait pas réellement pu tirer parti de la réduction des importations chinoises, du fait d’autres concurrences internationales pour lesquels un dumping ne pouvait pas être établi (Asie du Sud-Est), et le fait que l’Union portait des objectifs très ambitieux de développement de la production renouvelable qui tireraient parti d’une réduction des coûts des équipements par une levée des droits antidumping.
Si chacun est libre de son opinion quant à la pertinence de cette décision et des politiques de défense commerciale menées par l’Union dans la décennie 2010, si l’histoire jugera les responsables européens qui en sont les auteurs, la situation actuelle prête à des constats univoques. L’ampleur des économies d’échelle, la taille des acteurs chinois, leur intégration verticale quasi-complète, et leur avance technologique créent un tel écart de compétitivité-coûts (de l’ordre de 35% avec l’Europe[77] ) qu’il paraît illusoire de penser que l’Union puisse diversifier ses sources et recréer une filière domestique par l’imposition unilatérale de droits de douane sur ces importations, qui plus est au risque de rétorsions majeures et très coûteuses pour l’économie européenne, et d’un renchérissement immédiat et insoutenable de notre trajectoire de transition.
Depuis le paquet Fit for 55, et plus précisément la mise en œuvre par les articles 22a, 22b et 25 de la directive relative aux énergies renouvelables d’une part, plaçant des mandats d’incorporation d’énergie renouvelable[78] dans l’énergie finale utilisée pour l’industrie et les transports européens, et d’autre part la révision d’ampleur du système européen de quotas d’émissions et la mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (sur lequel nous reviendrons), l’Union a fait le choix résolu de faire de la performance climatique de ses activités économiques un élément dimensionnant de leur compétitivité. Face à un souverain économique chinois qui a parfaitement compris cet enjeu et transforme son mix électrique à marche forcée, investissant en 2023 377 MdsUSD dans la production d’électricité bas carbone et 106 MdsUSD dans ses réseaux énergétiques[79] , avec autant de puissance photovoltaïque installée en 2023 que le reste du monde, et une capacité renouvelable nouvelle estimée sur la période 2023–2028 de l’ordre de 2062GW (à comparer avec 48.2 GW pour la totalité des capacités éoliennes et photovoltaïques françaises installées depuis 20 ans), l’Europe est face à un dilemme. Elle doit choisir de manière stratégique entre tirer au maximum parti de la compétitivité-coûts d’une transition réalisée avec des équipements chinois compétitifs, là où cela est possible, et en veillant à maîtriser les risques associés, ou chercher à recréer des filières européennes qui ont disparu depuis 10 ans.
Si l’Union peut et doit réduire sa dépendance à la Chine sur les principales briques de la transition (panneaux photovoltaïques, comme décrit plus haut, mais aussi batteries, électrolyseurs, voire éoliennes terrestres ou même en mer) elle doit comme nous l’avons proposé adopter un comportement stratégique (Proposition 2) et mettre sa politique commerciale au service de son objectif d’ouverture des échanges internationaux et de ses buts politiques, dont la lutte contre le changement climatique (Proposition 1). Imposer des droits de douane ou des restrictions sur certains composants irait à l’encontre de ces objectifs, et n’augmenterait pas le pouvoir de marché européen, dans un rapport de forces avec la Chine qui lui est défavorable. C’est donc une option qui doit être écartée.
En revanche, l’Union peut utiliser ses relations commerciales bilatérales avec des Etats-tiers disposant d’une compétitivité coûts, quitte à soutenir les industriels européens qui s’y implantent, dans une relation partenariale de co-développement, pour y faciliter l’émergence de filières compétitives et déprises des grands acteurs chinois, permettant ainsi de diversifier nos sources, de rendre notre approvisionnement plus concurrentiel, sans ralentir la transition et en préservant l’objectif d’un ordre commercial mondial multilatéral et ouvert. Le Net Zero Industrial Act [80], qui enjoint aux Etats-membres d’inclure des critères de diversification des approvisionnements pour les principales briques de la transition dans leurs appels d’offres de régimes de soutien aux renouvelables, c’est-à-dire des critères défavorisant les équipements issus de pays en contrôlant plus de 50% de l’approvisionnement européen, dans la limite d’une hausse des coûts de l’appel d’offres de 15% (art. 26), ouvre une première voie dans cette direction. Il reste à l’Union à mobiliser ses relations commerciales avec d’autres Etats, ses politiques d’aide bilatérale et ses acteurs économiques afin de déployer des capacités contribuant à cette diversification là où cela peut être fait de manière compétitive.
L’Union peut également faire jouer de manière plus stratégique (Proposition 2) les instruments existants du droit commercial, et notamment du droit OMC. De même que cela a pu être fait pour l’acier suite à la fermeture du marché américain aux importations chinoises en 2018, l’Union dispose de la pleine faculté d’instituer, conformément à l’article XIX du GATT, des mesures de sauvegarde, visant à protéger de manière temporaire et proportionnée les acteurs européens du photovoltaïque des reports de flux chinois. Ces mesures peuvent prendre la forme de quotas d’importation représentant une part donnée de la demande européenne, laissant un espace économique à une diversification des sources.
L’Union peut en outre rechercher, dans les principales chaînes de valeur de la transition, ou dans des chaînes qui y sont apparentées, sur quels maillons existent et peuvent être renforcées des dépendances croisées, garantes du respect mutuel des engagements commerciaux et de non-escalade des rétorsions par effet dissuasif. En dehors du champ de la transition énergétique, beaucoup a été dit concernant la dominance de la République de Chine dans l’approvisionnement mondial en semi-conducteurs, qui pendant les dernières décennies aurait constitué un argument clé contre toute intervention hostile ; symétriquement, l’Union dispose d’un maillon clé à travers les capacités uniques, dominantes sur leur marché, concentrées géographiquement, et très difficilement reproductibles d’ASML, entreprise néerlandaise spécialisée dans la production de machines de photolithographie indispensable à la réalisation des semiconducteurs les plus avancés[81]. Dans le champ de la transition, d’autres maillons critiques existent et peuvent s’inscrire dans les mêmes rapports : encore faut-il en avoir un diagnostic, en préserver la criticité, c’est-à-dire la dominance sur leur marché mondial et la concentration géographique, et faire savoir que nous sommes prêts à user en réciprocité des instruments stratégiques proposés plus haut (Export Control Act, etc.) si nos intérêts stratégiques étaient menacés par un souverain économique tiers.
Enfin, une logique de réciprocité (Proposition 3) pourrait inspirer l’action européenne autour de cet enjeu des chaînes de valeur de la transition énergétique et des dépendances stratégiques européennes en la matière. Nous y reviendrons plus loin dans les sections dédiées à la fonction du souverain économique en matière de définition des règles de participation au marché, et à l’intervention directe du souverain économique dans le marché par la commande publique et les aides d’Etat.
Les frontières intérieures du marché européen
Si la définition des règles de traitement aux frontières extérieures du marché européen est un des instruments premiers d’une souveraineté économique européenne, le souverain économique a également à définir des frontières intérieures, ainsi que les subdivisions de l’espace économique qu’il organise. Edicter dans quels champs en son sein les transactions peuvent être réalisées, quels produits sont suffisamment substituables pour être sur le même marché, quelles délimitations doivent être données aux différentes composantes du marché intérieur est la première étape de la souveraineté sur ce marché intérieur : la définition des biens et agents économiques autorisés à y participer et à y réaliser des transactions, et la pleine disposition de l’autorité pour en assurer le fonctionnement efficient des transactions en sont les seconde et troisième étapes.
En matière de délimitations intérieures, le paradigme de fonctionnement de l’Union est celui d’une pleine intégration du marché intérieur, au sein duquel aucune barrière tarifaire n’est tolérée, aucun droit de douane ou taxe d’effet équivalent, et où les restrictions quantitatives d’effet équivalent sont soumises à un contrôle strict du respect d’une liste énumérée de motifs. Ces principes sont inscrits au sein du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, aux articles 26, 28, 30, et 34 à 36.
Art. 26(2) : « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. »
Article 28(1) : « L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. »
Article 30 « Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. »
Articles 34 et 35 : « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » mais l’article 36 dispose que : « les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »
La fonction centrale du souverain économique européen est donc d’assurer l’absence d’atteintes à la libre circulation des marchandises – et, partant, des capitaux et devises, des travailleurs, et des services. Depuis 1979 et l’arrêt Rewe-Zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, dit Cassis de Dijon[82] , la Cour a établi qu’en l’absence de mesures d’harmonisation européennes, tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre conformément à ses règles traditionnelles et équitables et à ses processus de fabrication doit être autorisé sur le marché de n’importe quel autre État membre. L’article 36 reconnaît comme nous l’avons vu certaines exceptions énumérées, auxquelles la Cour a ajouté dans la jurisprudence une faculté générale d’imposition de restrictions techniques pour une « raison impérieuse d’intérêt général »[83] (arrêt Schwarz), l’Etat-membre devant en tout état de cause démontrer – la charge de la preuve lui incombant – le caractère nécessaire et proportionné de la mesure, qui doit se limiter strictement au niveau minimal permettant d’atteindre l’objectif d’intérêt général allégué. Un cadre précis de notification de ces exemptions par les Etats-membres à la Commission, assorti de méthodes d’échange d’information et de contrôle en permettant la supervision a été mis en place, dont la dernière version est inscrite dans le règlement 2019/515[84]. L’Union assure donc un strict contrôle de la libre circulation, qui proscrit a priori toute mesure tarifaire, et contrôle a posteriori, sous un régime très strict, toute mesure quantitative qui viendrait la restreindre. Il est notable que ces interdictions sont de portée générale, et couvrent toute forme de circulation d’une marchandise, que celle-ci s’inscrive ou non dans une activité commerciale, qu’elle soit interne à un Etat-membre ou entre deux Etats-membres.
Le souverain économique américain procède selon une logique légèrement différente dans son organisation interne, avec un objectif et un résultat comparable de pleine intégration du marché intérieur américain. Comme nous l’avons vu plus haut, le Congrès dispose de compétences énumérées à l’article I section 8 de la Constitution : parmi celles-ci figure celle de « regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes », appelée Commerce Clause. Si la compétence exclusive du Congrès sur le commerce international a été clairement établie dès le début – par cohérence avec la compétence également confiée au Congrès de fixation des tarifs douaniers – les modalités dans lesquelles celui-ci s’articulait avec la souveraineté économique des Etats-fédérés sur leurs propres espaces économiques pour réguler le commerce intérieur américain ont fait l’objet d’un développement historique au long du XIXe siècle : en effet, une des raisons mêmes pour l’établissement d’une Constitution était de compléter et prolonger les Articles of Confederation qui ne prévoyaient aucune compétence fédérale sur le marché intérieur, et permettaient de ce fait des comportements discriminatoires de la part des Etats fédérés.
La première clarification de l’interprétation de cette clause fut l’arrêt Gibbons c. Ogden (1824)[85] qui précisa que le terme commerce devait bien être entendu comme toute forme de trafic ou de circulation entre les Etats, que cela soit dans le cadre d’une activité commerciale entre deux parties situées dans deux Etats fédérés distincts ou non. Le cas d’espèce consistant en la compatibilité avec la Constitution d’une législation de l’Etat de New York conférant à Robert Fulton (inventeur de la navigation à vapeur) un monopole de navigation sur les eaux intérieures de l’Etat, qu’il avait délégué à Aaron Ogden : leur lecture, censurée par la Cour, de la Commerce Clause, était que d’une part le trafic fluvial n’était pas en soi du « commerce » au sens des auteurs de la Constitution, et que d’autre part la compétence fédérale ne couvrait que le trafic lorsqu’il traversait la frontière entre deux Etats, mais non au sein d’un Etat donné. La Cour posa premièrement que le commerce était « le trafic [intercourse], dans toutes ses modalités [all its branches], et qu’il est régulé en prescrivant les règles pour la conduite de ce trafic », en second lieu que le commerce « entre les différents Etats [among the several States] » ne s’arrête pas à la frontière extérieure de chaque Etat mais peut comporter la régulation d’actes réalisés à l’intérieur des Etats, et en troisième lieu que le Congrès peut réguler, c’est-à-dire « prescrire les règles par lesquelles est régi le commerce […] de la manière la plus complète [to its utmost extent] et sans qu’il n’y soit soumis à quelques autres limites que celles imparties par la Constitution ». C’est autour du même arrêt que se formalisa l’idée selon laquelle la compétence du Congrès sur la régulation du commerce entre Etats était une compétence exclusive, point qui n’est pas clairement posé dans la constitution : on peut d’ailleurs observer que le fait que sur d’autres compétences du Congrès il soit clarifié que les Etats ne peuvent agir sans l’accord du Congrès aurait prêté à un a contrario, plaçant la compétence en matière de régulation des échanges entre Etats dans le champ des compétences partagées entre niveau fédéral et niveau fédéré, comme la compétence fiscale. Il est à ce sujet établi qu’en 1787, la question faisait l’objet d’un débat entre les auteurs de la Constitution[86] : dans l’arrêt Gibbons c. Ogden précité, la Cour affirme que la compétence en matière de régulation du commerce entre Etats « ne peut jamais être exercée par le peuple lui-même, mais doit être confiée aux mains d’agents, ou rester dormante [or lie dormant] », origine de l’expression « dormant commerce clause », qualifiant l’articulation spécifique entre compétence fédérale et compétence des Etats. Selon cette doctrine de « dormant commerce clause », la régulation d’activités commerciales qui ne comporte pas d’élément discriminatoire et n’impose pas de restriction indue (undue burden) au commerce inter-Etats est une compétence partagée entre niveau fédéral et niveau fédéré, mais si elle en comporte, elle devient une compétence fédérale exclusive. On retrouve donc ici l’esprit du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, à savoir de proscrire les atteintes à la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur américain, et d’en assurer l’intégrité contre des atteintes « protectionnistes », qu’elles soient de nature tarifaire ou quantitative, de la part des Etats fédérés.
Ce n’est qu’au tournant du XIXe siècle que la jurisprudence de la Cour vint reconnaître que la notion de commerce au sens de la commerce clause englobait non seulement la régulation du trafic entre Etats mais également d’activités productives réalisées au sein d’un Etat donné, après plus d’un siècle de débat sur les limites exactes de la notion de « commerce ». En 1888, l’arrêt Kidd c. Pearson (1888)[87] était venu confirmer une loi d’un Etat fédéré (l’Iowa) interdisant la production de spiritueux, y compris aux fins d’un commerce dans d’autres Etats, considérant qu’elle n’empiétait pas sur la compétence du Congrès en matière de régulation du commerce entre Etats car la production (manufacturing) n’était pas du commerce au sens entendu par les Framers. A l’inverse, en 1905, l’arrêt Swift c. United States[88] valida l’action du gouvernement fédéral contre le cartel des abattoirs de Chicago sur le fondement du Sherman Act (1890), bien que son activité économique n’ait lieu qu’au sein d’un Etat donné, l’Illinois. Le raisonnement sous-jacent était que cette activité n’était qu’une étape du « flux commercial » (stream of commerce) dans une industrie qui englobait plusieurs Etats, de l’élevage à la distribution de viande. Si en 1922, la Cour opérait encore une distinction entre commerce et activités de service sans transaction sur un bien (par exemple des spectacles)[89], ou en 1935 entre le commerce et l’activité minière[90], à partir de la fin des années 1930, elle admit que la régulation par le Congrès des prix[91] y compris pour des activités commerciales menées exclusivement à l’intérieur d’un Etat donné ou de quotas de production y compris de production agricole menée par des personnes sur leurs propres terrains pour leurs propres besoins[92] était tout de même de la régulation du commerce entre les Etats, au motif que ces activités avaient un effet sur la formation du prix, et plus généralement des échanges entre Etats, et dès lors entraient dans le champ de sa compétence constitutionnelle. De facto, la compétence du Congrès sur le commerce entre les Etats était devenue une compétence quasi-illimitée y compris sur des faits économiques internes aux Etats. Dans l’arrêt Wickard c. Filburn précité (1942), la Cour affirma que "Les conflits d’intérêts économiques entre ceux qui sont régulés et ceux qui en tirent avantage sont sagement laissés, dans notre ordre juridique, à une résolution par le Congrès, tirant parti de son processus législatif plus souple et comportant davantage de responsabilité. De tels conflits se prêtent rarement à une décision judiciaire. Quant à la sagesse, la faisabilité ou l’équité du mode de régulation, cela ne relève pas de notre compétence.". Cette affirmation fonda la pratique, observée tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle par laquelle la Cour considéra que le fait de déterminer si une législation affectait de manière appropriée les échanges entre Etats relevait in fine du législateur, et d’un débat politique plus que du juge, et donc un champ très large pour la compétence du Congrès.
Le champ exact de la compétence du Congrès actuellement applicable fut dégagé en 1995 dans la décision United States c. Lopez (1995)[93] :
- Le Congrès peut réguler l’usage des canaux du commerce entre Etats (the use of the channels of interstate commerce).
- Le Congrès peut réguler et protéger les instruments (instrumentalities) du commerce entre Etats, et les personnes et choses qui concourent à ce commerce, y compris contre des atteintes qui ne découleraient que d’activités internes à un Etat. Ceci inclut toutes les formes de régulation des réseaux de communication entre Etats, en termes de sécurité, d’accessibilité, etc.
- La compétence du Congrès en matière de commerce inclut également le pouvoir de réguler des activités ayant un lien substantiel (substantial relation) avec le commerce entre Etats. En l’espèce, la Cour est amenée à examiner si l’activité régulée est de nature commerciale ou économique, si la disposition légale qui la régule stipule un champ de juridiction, si le Congrès a évalué ses effets sur le commerce inter-Etats, et si le la régulation prise par le Congrès permet d’atténuer ces effets.
Selon cette interprétation du champ de compétence du Congrès, et selon la doctrine de la dormant commerce clause, la Cour Suprême a par une jurisprudence constante posé l’interdiction de la taxation par les Etats du commerce inter-Etats : c’est par exemple sur cette base que l’arrêt Quill[94] a considéré que les Etats fédérés n’étaient pas fondés à lever d’imposition sur des ventes réalisées par internet. Seules sont admissibles des taxes des Etats portant sur le commerce inter-Etats satisfaisant un test à quatre éléments cumulatifs (test Complete Auto Transit[95]) : existence d’un lien tangible entre l’Etat et le contribuable potentiel, absence de discrimination du commerce inter-Etats par rapport au commerce intra-Etat, taxation à due concurrence de la part de l’activité en cause réalisée dans l’Etat (apportionement), et lien avec des services apportés par l’Etat au contribuable. Ainsi, l’interdiction est plus large dans la mesure où l’Union proscrit celles qui sont d’effet équivalent à un droit de douane (c’est-à-dire discriminatoires entre productions domestiques et productions importées, avec un effet équivalent à celui d’un taux différencié), tandis qu’il existe un faisceau de conditions qui doivent être cumulativement respectées aux Etats-Unis.
S’agissant de restrictions quantitatives, la jurisprudence de la Cour Suprême a dégagé plusieurs principes. Tout d’abord en matière de protection de la santé publique et de la sécurité des consommateurs, une réglementation d’un Etat qui ne comporte pas de discrimination explicite entre commerce intra-Etat et inter-Etat n’enfreint la clause de commerce que lorsque l’atteinte au commerce inter-Etat excède clairement (clearly outweighs) l’objectif d’intérêt général (legitimate purpose) invoqué par l’Etat[96]. Le test de proportionnalité est ici plus restrictif qu’en Europe : la Cour considère que le contrôle de la proportionnalité ne lui incombe que dans des cas – dirait-on en droit européen – d’erreur manifeste d’appréciation par l’Etat fédéré, où l’atteinte est manifestement disproportionnée, mais accorde une présomption forte de compatibilité des mesures instituées par les Etats[97]. En dehors de ces cas de figure pour un motif légitime, la Cour a de manière générale censuré les dispositions par lesquelles un Etat imposait à un opérateur économique donné de ne confier ses produits qu’à des acteurs localement établis pour les traiter ou les transformer en un second produit[98], à l’exception de cas où ce traitement est opéré par un acteur public, opérant pour une mission d’intérêt général[99]. En matière de restrictions quantitatives, il y a donc une tolérance plus forte aux Etats-Unis qu’en Europe, dans la mesure où le niveau fédéral octroie une plus grande déférence aux mesures instituées par les Etats fédérés que l’Union aux Etats-membres (qui portent la charge de la preuve dans le test de l’article 36), et n’impose pas dans la même mesure de règle de mutuelle reconnaissance. La capacité à imposer le traitement d’un bien par un acteur public établi localement est une seconde différence marquante avec le cas européen, où une telle discrimination serait clairement proscrite. Dans le même temps, les motifs légitimes pour lesquels l’Union peut tolérer des restrictions par les Etats sont plus nombreux qu’aux Etats-Unis (ordre public, moralité publique, protection des biens culturels, etc.).
La Cour a également reconnu deux exceptions générales à la clause de commerce dormante. La première est celle où le Congrès a accordé dans une disposition expresse la faculté pour un Etat d’opérer des traitements discriminatoires, selon la logique que la souveraineté économique du Congrès qui découle de la Constitution inclut Constitution inclut y compris la faculté de fragmenter le marché intérieur ou d’y laisser admettre des séparations[100]. Dans de tels cas, le contrôle par la Cour Suprême se limite alors à vérifier s’il existe des contradictions entre une régulation d’une activité donnée par le niveau fédéral et dispositions de niveau fédéré. Un exemple célèbre de cette faculté est celle laissée spécifiquement à l’Etat de Californie dans le Clean Air Act (1963) (du fait des problèmes de pollution atmosphérique à Los Angeles à l’époque de sa préparation au Congrès) de fixer des règles plus strictes d’émissions polluantes atmosphériques par les voitures mises en marché que celles du niveau fédéral (alors que la même loi l’interdit aux autres Etats). Cette faculté encadrée, qui est soumise à un waiver délivrée par l’Agence de Protection de l’Environnement fédérale (EPA) a conduit de facto la régulation californienne à être le standard d’émissions applicable dans l’ensemble des Etats-Unis, qui s’étend au-delà des polluants atmosphériques locaux aux émissions de gaz à effet de serre depuis une décision de la Cour Suprême de 2007. Cette dérogation a fait l’objet d’un intense conflit entre les Etats favorables à ces normes et l’administration fédérale en 2019, avant que la capacité à fixer des normes plus dures ne soit rétablie par le nouvel exécutif fédéral en 2022 – elle est aujourd’hui remise en cause, principalement pour des raisons d’affichage politique, par l’administration Trump. Cette faculté n’existe pas en droit européen : toute régulation européenne qui octroierait explicitement à un Etat-membre la possibilité d’imposer des règles limitant la libre-circulation des marchandises sans considération de proportionnalité à l’objectif poursuivi serait incompatible au Traité.
La seconde exception, cohérente avec l’arrêt United Haulers précité, couvre les cas où les Etats fédérés interviennent directement dans le marché comme participants (market participant exception) et non comme régulateur au-dessus du marché. Dans de tels cas, les entités fédérées ont la pleine capacité de distinguer dans le strict champ du marché où elles opèrent[101] de manière discriminatoire entre contreparties de leur Etat et contreparties extérieures, y compris par refus de vendre à des tiers extérieurs à l’Etat[102]. Dans les termes de l’arrêt qui l’a établi : « Nothing in the purposes animating the Commerce Clause prohibits a State, in the absence of congressional action, from participating in the market and exercising the right to favor its own citizens over others. »[103]. Cette seconde exception n’existe pas non plus en droit européen où rien ne permet a priori à un Etat-membre de favoriser lorsqu’il agit directement dans le marché (par exemple dans la commande publique ou via des entreprises publiques) des contreparties du même Etat par rapport à celles établies dans un autre Etat sans tomber dans une qualification d’aide d’Etat qui doit alors faire l’objet d’un contrôle a priori de compatibilité par la Commission, incluant notamment l’absence d’atteinte disproportionnée au marché intérieur.
Enfin, le droit européen s’est également attaché à proscrire la compartimentation du marché intérieur européen par le comportement d’acteurs économiques qui disposeraient d’un pouvoir de marché suffisant pour y introduire des fragmentations. Telle est la conséquence de l’arrêt Consten/Grundig[104] qui prohibe toute forme d’accord entre un producteur et un distributeur qui tendrait à restaurer des divisions nationales dans les échanges entre Etats-membres, et en particulier des clauses d’exclusivité sur base géographique interdisant au distributeur de revendre en dehors de son périmètre d’exclusivité, posant le fait que « maintenir artificiellement […] des marchés nationaux distincts au sein de la Communauté est […] de nature à fausser la concurrence dans le marché commun » et contrevient à l’objectif même du Traité, à savoir la réalisation d’une intégration toujours plus grande du marché intérieur. La doctrine a dégagé par la suite l’interdiction également des clauses d’exclusivité passives (interdisant des ventes en dehors du périmètre d’exclusivité qui soient sollicitées par le client sans action proactive du distributeur) et le fait que cette interdiction valait y compris lorsqu’elle n’est pas le fait d’une disposition contractuelle expresse mais résulte d’une « pratique effectivement constatée » au sein des réseaux commerciaux. Là encore, le marché intérieur européen comporte des garanties fortes, qui n’existent pas dans le cas américain.
Pour autant, le constat demeure que le marché intérieur européen reste grevé d’hétérogénéités notables, ce malgré les garanties plus fortes de son intégration qui paraissent apportées par le cadre juridique du Traité, en comparaison des souplesses accordées dans la jurisprudence autour de la Commerce Clause américaine. Malgré cette apparente intégrité juridique, la situation économique concrète demeure bien différente. Aux termes de M. Draghi[105], « Nous devons créer les conditions permettant aux entreprises innovantes de se développer en Europe plutôt que d’être confrontées à une alternative impossible : rester petites ou s’installer aux États-Unis. Cela implique de supprimer les barrières internes, de standardiser, d’harmoniser et de simplifier les réglementations nationales, et de promouvoir un marché des capitaux plus équitable. Or à cet égard, nous sommes souvent nous-mêmes notre propre pire ennemi.
Nous avons un marché intérieur de taille similaire à celui des États-Unis. Nous avons le potentiel pour agir à grande échelle. Pourtant, le FMI estime que nos barrières internes équivalent à un tarif douanier d’environ 45 % pour l’industrie manufacturière et de 110 % pour les services. »
Nous reviendrons dans le segment dédié à la définition, par le souverain économique, des acteurs économiques, et des biens et services admis à participer au marché intérieur, sur les causes sectorielles comme générales de cette fragmentation du marché intérieur et de la subsistance de barrières intérieures, tout en développant les moyens organisationnels et juridiques qui permettraient d’en poursuivre l’intégration, passant d’une réalité juridique à une réalité pratique et économique, avec pour objectif de converger vers un marché intérieur européen au moins aussi intégré en pratique que le marché intérieur américain. D’ores et déjà toutefois, il est utile de rappeler que malgré l’avance juridique, deux champs subsistent où des restrictions internes de nature géographiques, transverses aux biens et services ou aux acteurs économiques du marché intérieur, sont encore en place : nous proposons de les araser pour achever la formation d’un marché intérieur dont l’intégration aboutie est la condition nécessaire d’une véritable souveraineté économique.
Si le marché des biens et des services est, comme nous l’avons vu, de jure intégré et assorti en théorie de garanties substantielles pour son intégration, tel n’est pas le cas des marchés de capitaux. Comme le relève le rapport Draghi[106], la zone Euro ne dispose pas d’une véritable Union des marchés de capitaux qui permette aux acteurs économiques européens de mobiliser des financements avec la même profondeur et flexibilité. Cette fragmentation, attribuable à divers traits organisationnels (absence d’union bancaire européenne et de régime unique européen d’assurance des dépôts et résolution qui désincite à une consolidation bancaire à l’échelle du continent et favorise le maintien d’oligopoles nationaux, fragmentation des marchés de fonds propres, absence d’émission d’un actif sûr européen commun, absence d’harmonisation des cadres fiscaux et sociaux d’épargne retraite et d’assurance vie, etc.).
Autre constat[107], la fragmentation du cadre légal applicable aux entreprises de l’Union en vingt-sept régimes distincts de droit des sociétés, de droit des faillites, de droit du travail et régimes fiscaux, sans qu’ait pu être élaboré pour commencer un statut commun de « European Private Company » (Societas Privata Europaea) qui coexisterait avec les régimes nationaux, constitue un élément fort de fragmentation. A l’inverse, si l’incorporation des sociétés aux Etats-Unis relève aussi d’une compétence fédérée et non fédérale, force est de constater une bien plus grande homogénéité des régimes de personnalité morale dans les différents Etats, une plus grande proximité des cadres de droit des sociétés et de droit des faillites. Plus fondamentalement, la doctrine des affaires internes (internal affairs doctrine)[108] pose en droit américain le principe selon lequel le règlement des différends internes à la gestion d’une entreprise, tels que ceux liés à leur gouvernance, à la distribution des dividendes, aux fautes de gestion et aux différends entre mandataires sociaux et actionnaires, relève pour les entreprises opérant dans plusieurs Etats de la juridiction de l’Etat d’incorporation, tandis que les affaires externes, telles que les questions fiscales, sociales, ou environnementales, relève de la juridiction de l’Etat où ont lieu les activités (ou d’une juridiction fédérale). L’existence d’une telle doctrine a permis par concurrence régulatoire aux entreprises américaines d’arbitrer entre plusieurs cadres juridiques pour l’incorporation de celles ayant des activités dans plusieurs Etats, choisissant le cadre juridique le plus favorable pour leurs besoins et apportant le plus de sécurité juridique. En pratique, le régime des sociétés incorporées dans le Delaware offre à la fois un cadre de juridiction attractif car reposant sur des tribunaux dédiés aux litiges des sociétés, où siègent des magistrats professionnels et non des jurys populaires, très peu contraignant sur le nombre de mandataires sociaux (un seul suffit, qui n’a pas besoin d’être résident ou ressortissant américain, et peut demeurer anonyme et opérer via un listing agent), fiscalement favorable (absence de fiscalité sur les bénéfices non réalisés dans l’Etat du Delaware par les sociétés qui y sont établies), et enfin qui offre un cadre de gouvernance équilibré entre actionnaires et mandataires sociaux apportant des garanties aux deux parties jugées raisonnablement protectrices.
Cette différence d’organisation entre Europe et Etats-Unis procède d’une part de considérations historiques, puisqu’aux Etats-Unis le cadre constitutionnel est antérieur à la formation au cours du XIXe siècle du droit des sociétés, tandis qu’en Europe, chaque Etat-membre avait développé son cadre national avant le début du processus de construction européenne, parfois avec des divergences notables d’approches. Elle découle d’autre part de distinctions plus profondes, qui ont trait notamment au développement historique progressif et nuancé de la dormant Commerce Clause par rapport aux piliers de libre circulation et de liberté d’établissement clairement inscrits dans les Traités, ainsi qu’à un traitement différencié dans la constitution américaine entre garanties accordées respectivement aux personnes physiques et aux personnes morales qui apparaît moins clairement dans les Traités européens.
La création en Europe d’un vingt-huitième régime de sociétés, proprement européen, apportant un cadre simple et reconnu dans l’ensemble des Etats-membres, et incluant toutes les flexibilités opportunes pour être attractif, constituerait un élément de plus d’intégration du marché européen, à travers l’intégration des règles de fonctionnement des personnes morales qui y opèrent. Promue par le rapport Draghi, cette piste impliquerait ensuite logiquement d’être parachevée en dotant les sociétés de cette catégorie d’une juridiction européenne unique de règlement des litiges internes, voire d’un régime fiscal et de règlement des faillites commun, inscrit dans un règlement européen (ce qui nécessiterait vraisemblablement l’adoption d’une législation à l’unanimité).
Nous reprenons ici, soucieux de rappeler ces deux axes de travail qui parachèveraient l’intégration encore imparfaite du marché commun au lecteur, ces deux propositions exprimées par le rapport Draghi, renvoyant audit rapport pour leurs modalités précises et leur mise en œuvre. Elles constitueraient une étape utile dans la construction d’un ordre juridique et économique interne proprement européen, et donc dans l’émergence d’une véritable souveraineté économique européenne.
Proposition 4 : Définir un vingt-huitième régime de droit des sociétés à même d’opérer et d’être reconnu partout en Europe, doté d’une juridiction européenne unique pour la résolution de ses différends internes, et engager les travaux pour construire un droit européen unique des faillites et un régime unique de fiscalité des sociétés relevant de ce régime.
Proposition 5 : Achever l’Union des marchés de capitaux.
Un second point qui mérite d’être signalé est le fait que si l’arrêt Consten cité plus haut interdit aux entreprises de l’Union dans leurs pratiques commerciales d’inclure des restrictions verticales assises sur des frontières intérieures géographiques dans le marché intérieur européen, la jurisprudence admet à l’inverse une faculté pour les Etats-membres de ne pas reconnaître les bénéfices apportés pour certains de leurs objectifs de politique publiques par des entreprises situées de l’autre côté d’une frontière dans les mécanismes qu’elles instituent. L’arrêt Alands Vindkraft[109] est venu traiter du cas d’un régime de soutien mis en œuvre par la Suède, qui reposait sur l’obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains consommateurs d’acquérir des garanties d’origine renouvelable délivrées aux producteurs renouvelables établis en Suède : un producteur éolien établi dans les îles Aland, en Finlande, fit grief à cette mesure de ce qu’elle réservait indûment de facto une part du marché électrique suédois et de la satisfaction de cette objectif aux seuls acteurs nationaux, réintroduisant des barrières internes au marché intérieur européen, cette fois-ci non par la politique commerciale d’un acteur privé, mais pas la segmentation des politiques publiques.
Si la Cour a bien reconnu que cette mesure « [était] susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et qu’elle constitu[ait], en conséquence, une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 34 TFUE, à moins que cette réglementation ne puisse être objectivement justifiée »[110], elle a posé « que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte, [et qu’] il est, en principe, permis aux États membres de limiter le bénéfice de tels régimes à la production d’électricité verte localisée sur leur territoire »[111]. Elle a ainsi admis de telles restrictions, posant comme « essentiel, afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de ces régimes en fonction de leur potentiel tout en conservant la confiance des investisseurs »[112] : la compatibilité alléguée de telles mesures avec le droit de l’Union repose sur l’existence d’un objectif d’intérêt européen, la promotion des énergies renouvelables, et sur le respect du critère de proportionnalité, selon la ligne de raisonnement décrite plus haut.
Dix ans plus tard, un bilan critique de cette ligne d’analyse mérite d’être dressé. Est-il légitime que les Etats-membres puissent, dans des régimes extrabudgétaires de soutien aux énergies renouvelables – et plus généralement dans tout régime certificatif analogue assis sur un objectif d’intérêt commun – reposant sur une obligation d’incorporation par les metteurs en marché, ne reconnaître que les produits renouvelables ou remplissant l’objectif recherché qui seraient produits ou incorporés sur leur sol ? Comment réconcilier cette situation avec le principe interdisant les restrictions verticales sur base géographique aux acteurs de marché – puisqu’il s’agit ici bien d’imposer une telle restriction, sur des produits faisant l’objet d’un marché, à savoir celui de certificats négociables ? Si l’Union doit accentuer son action pour la transition énergétique, ne doit-elle pas assumer, pour de tels régimes d’obligations d’incorporation assis sur des certificats échangeables, une reconnaissance mutuelle et une « portabilité » de ces certificats au-delà des frontières nationales, sur l’ensemble du marché intérieur ?
Proposition 5 : Porter dans les régimes de soutien mis en œuvre par les Etats-membres qui reposent sur l’obligation d’achat par des metteurs en marché (par exemple fournisseurs d’énergie) de certificats délivrés en contrepartie de la réalisation d’objectifs de politique publique (par exemple incorporation d’énergie renouvelable, réalisation d’économies d’énergie) un principe de mutuelle reconnaissance des certificats et de liberté de circulation au-delà des frontières nationales, en l’inscrivant dans le droit sectoriel pour forcer un revirement de jurisprudence par rapport au cadre actuel (Alands Vindkraft).
Exécuter les règles aux frontières : compétence douanière et frontières du marché européen
Nous avons dans la présente section décrit les limites de la souveraineté économique européenne pour ce qui est de sa capacité d’action aux frontières du marché intérieur, s’agissant d’une part des frontières extérieures de l’Union et de la définition de sa politique commerciale, et d’autre part de l’aplanissement des frontières intérieures qui subsistent et limitent l’efficience de son action en maintenant des hétérogénéités vestigiales porteuses d’inefficience économique comme de limites indues à son action économique souveraine.
S’agissant de l’action du souverain économique européen en termes de définition des frontières et du traitement des flux économiques aux frontières, il convient enfin de rappeler que la souveraineté s’opère certes par la construction du droit mais également par sa mise en œuvre concrète et exécutive et par le règlement judiciaire des différends et des peines. En l’espèce, l’action exécutive aux frontières, s’agissant des flux commerciaux de biens et de services, est l’objet des services douaniers relevant des Etats-membres, avec un très haut niveau d’harmonisation en termes de procédures et de mise en œuvre réglementaire, mais sous des autorités hiérarchiques comme fonctionnelles qui demeurent nationales, et des juridictions qui demeurent elles aussi nationales.
Il est à cet égard intéressant de noter que par contraste, la création aux Etats-Unis d’une union douanière par la Constitution (cf supra), par le Tariff Act de 1789 a été suivie un mois plus tard par la création d’un service douanier fédéral unique, le United States Customs Service – conséquence mécanique du monopole légal du gouvernement fédéral sur la levée de droits de douane. Ce service est depuis 1789 placé sous l’autorité de la branche exécutive, et donc in fine sous l’autorité du Président, conformément à la première phrase de l’article II, section 1 de la Constitution[113] : sa seule modification structurelle importante dans ses 235 années d’existence aura été son rapprochement en 2003 avec l’Immigration and Naturalization Service pour former le service des United States Customs and Border Protection, dans le cadre de la création du Département de la Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security), rapprochant en une entité unique maîtrise des flux économiques et maîtrise des flux de personnes aux frontières. Les services douaniers américains disposent d’un cadre juridique unique pour l’exercice de leurs compétences de contrôle, sur l’ensemble des frontières du marché intérieur américain, fixé au Titre 19 du U.S. Code[114], de procédures uniques pour les poursuites pénales, déférées devant des juridictions fédérales liées par un unique cadre de précédents. Au plan de l’organisation de leurs activités et de leur plan de contrôle, ils sont placés sous une unité de commandement opérationnel et d’autorité hiérarchique, dépendant in fine du Secrétaire pour la Sécurité Intérieure (Secretary for Homeland Security) – qui a repris cette compétence en 2003 du Secrétaire au Trésor.
Ce choix organisationnel, de se doter d’emblée d’un service douanier à compétence fédérale et d’une juridiction pour instruire les infractions au niveau fédéral, n’est pas celui d’autres systèmes fédéraux qui ont construit un marché intérieur. Le meilleur cas concret est celui de l’Union Douanière (Zollverein) allemande, constituée dans un processus progressif sur soixante-dix ans, de la réforme douanière prussienne de 1818 à l’accession de Hambourg et de Brême en 1888. Ce processus aura été un processus en bonne mesure préfigurateur – et condition nécessaire – mais juridiquement et politiquement parallèle à l’unité allemande. Le Zollverein disposait d’une existence juridique – et il était un sujet de droit international en propre – à côté de la Confédération Germanique (1815–1866) puis de la Confédération d’Allemagne du Nord (1866–1871), ce qui résultait de l’échec de la Confédération Germanique à se saisir politiquement de l’enjeu d’unification douanière et économique dans ses frontières alors que l’acte confédéral du 8 juin 1815 le prévoyait pourtant. Dès le début de la décennie 1820, l’effet de la concurrence britannique, en industrialisation rapide et dont les économies allemandes avaient été abritées par le blocus continental firent monter la pression en vue d’un rapprochement de celles-ci, visant à gagner en efficience économique et à mieux se protéger collectivement. Ces travaux conduisirent à développer trois unions douanières en 1828, structurées autour de la Prusse (Union douanière Prusse-Hesse), de la Bavière et du Wurttemberg dans le sud de l’Allemagne (Union douanière d’Allemagne du Sud), et de la Saxe et de Hanovre (17 Etats regroupés dans l’Union commerciale d’Allemagne centrale), qui se rassemblèrent en 1833 pour constituer une union douanière, le Zollverein, qui s’étendra à partir de 1851 (adhésion de Hanovre) à la quasi-totalité des Etats allemands (hors Empire d’Autriche).
Dans sa gouvernance, le Zollverein était particulièrement soucieux de ménager la souveraineté des – parfois très petits – Etats qui le constituaient, reposant sur une conférence où chaque Etat-partie disposait d’une voix, à l’unanimité. Si cette gouvernance parvint à construire un cadre harmonisé de fixation des droits de douane, de collecte, une nomenclature harmonisée des marchandises (Commerzialnachweisungen), elle ne parvint qu’à des avancées limitées sur l’harmonisation des taxes et accises, sur les monopoles d’Etat ou sur la standardisation, au-delà des questions de poids et mesures et des questions monétaires. Au plan statistique, un bureau central à Berlin (Central-Bureau des ZollVereins nach den amtlichen Mittheilungen der Zoll-Vereines-Staaten) collectait les données de quantité et de nature des marchandises[115] dans chaque marché d’un Etat-partie où elles étaient elles-mêmes collectées par les ministères des finances nationaux, et sur cette base il répartissait ensuite les recettes douanières communes. En revanche, l’exercice de contrôle douanier effectif, de collecte, de constatation des éventuelles infractions et de sanction relevait des autorités douanières de chacun des Etats-parties, et les sanctions pénales des autorités judiciaires de chaque Etat-partie.
Ce n’est qu’à partir de 1866 et de la création de la confédération d’Allemagne du Nord que le processus d’unification politique rattrapa l’intégration douanière : la confédération devint en elle-même adhérente au Zollverein, en lieu et place des Etats qui la composaient, et formant ainsi en son sein un bloc unique de « coopération renforcée » particulièrement fort. Ceci conduisit à une évolution alors de la gouvernance du Zollverein, pour la rapprocher d’un véritable cadre politique fédéral et en faire un outil d’intégration graduelle dans ce qui devait devenir l’Empire Allemand des Etats membres du Zollverein mais non encore parties à la confédération, avec la création d’un Zoll-Bundesrat et d’un Zollparlament, le passage de l’unanimité à la décision à la majorité, et un rôle de présidence confié au roi de Prusse, dans le nouvel accord du Zollverein conclu le 8 juillet 1867. Ce processus d’unification politique, achevé en 1871 à Versailles, conduisit dès 1866 à une unité partielle des services douaniers : la création d’une confédération d’Allemagne du Nord dotée de son propre cadre juridique, préfigurant les instances communes en la matière de l’Empire allemand. A partir de 1871, la Constitution bismarckienne vint consacrer le principe selon lequel les Etats constitutifs de l’Empire allemand continuaient de régir leurs propres administrations douanières sur leurs territoires autant qu’ils les avaient exercées auparavant (donc parfois de manière commune, lorsque de tels accords existaient), mais précisait aussi que « L’Empereur veille à l’exécution des règlements par des fonctionnaires impériaux qu’il adjoint aux bureaux de douanes et perceptions et aux autorités dirigeantes des différents États, après avoir entendu la commission du Bundesrat pour les douanes et impôts. »[116]. Deuxième concession à l’intégration allemande, les villes hanséatiques de Brême et de Hambourg continuaient d’être des ports francs, hors du territoire douanier de l’Empire (ce jusqu’en 1888, et ensuite pour Hambourg via une zone portuaire spécifique au sein du territoire de la ville-libre[117]). En contrepartie, elles devaient participer au budget commun non pas via les recettes douanières mais via une quotité fixe (Aversum)[118]. Troisième concession, les Etats du sud de l’Allemagne (Bavière, Hesse, Bade) disposaient de leur propre capacité fiscale s’agissant des accises sur les bières et spiritueux, et d’un traitement particulier dans le budget commun[119]. En pratique, seuls quatre Etats constituants maintinrent leurs propres services douaniers (Prusse, Bavière, Wurtemberg et Saxe), gérant la logistique et le personnel mais selon des règles impériales et sous supervision d’un corps d’inspection centralisé, tandis que pour les autres (hors cas des villes libres) c’était l’administration impériale directe qui assurait sous une unité de commandement, de règles de sanctions et de procédures, et de juridiction l’exercice concret des douanes[120]. En synthèse, retenons ici que si l’unité douanière a précédé l’unité politique allemande, le passage d’une union supranationale économique à une confédération (Staatenbund), puis à un Etat fédéral (Bundesstaat) a conduit à une harmonisation des services douaniers très forte, plaçant les services nationaux sous une inspection fédérale commune, et de facto sous une unité de commandement et de pratique de contrôle et de sanction[121].
En Suisse, autre cas de construction graduelle d’une unité politique et économique au cours du XIXe siècle, la dynamique a été légèrement différente[122] : le passage par la Constitution du 12 septembre 1848 d’une confédération d’Etats à un Etat fédéral conduisit dans le même temps à faire émerger une union douanière[123] où « ce qui concerne les péages [douanes] relève de la Confédération ». A l’inverse de la politique allemande, qui reposait sur une abolition des frontières douanières intérieures mais un protectionnisme marqué vis-à-vis de l’extérieur, la politique économique suisse d’après 1848 reposait sur une fixation a minima des droits de douane, inscrite directement comme principe à l’article 25 de la Constitution. Faute de nécessiter des services douaniers structurés, la compétence demeura ainsi à des gardes cantonaux, comme avant 1848, hormis dans des cantons connaissant des flux importants, Genève et le Tessin, où des gardes-frontières fédéraux furent institués. Ce ne fut qu’avec l’abandon du libre-échange en 1894 que se créa un véritable corps fédéral de gardes-frontières fédéraux. Cela, tout simplement car l’importance croissante des flux de marchandises assujettis à des droits, et des flux financiers afférant rendait nécessaire un contrôle direct, aux fins d’éviter un arbitrage entre cantons plus ou moins efficients dans leurs contrôles, et plus ou moins rigoureux dans l’application des règles communes par les importateurs ou exportateurs. Ainsi, en Suisse, la création d’un service douanier commun fut postérieure à l’unité politique, plutôt que sa préfiguration comme en Allemagne, et procéda in fine de considérations pratiques à un moment de renforcement de l’action douanière.
La souveraineté économique européenne n’est pas dotée d’une autorité exécutive propre pour assurer le respect des mesures aux frontières qu’elle édicte. Celui-ci relève de services douaniers nationaux, entre lesquels les autorités européennes veillent à assurer une pleine coopération et pour lesquels elles fixent des règles harmonisées, soit un schéma qui se rapproche de celui de l’ancienne union douanière allemande à partir des années 1840. En pratique, ces règles sont établies par un règlement européen, d’application directe, le code des douanes de l’Union (CDU), correspondant au règlement 952/2013, assorti d’actes d’exécution et d’actes délégués.
Aux termes de la Commission, « Le CDU et les actes d’exécution et délégués qui s’y rapportent (adoptés par la Commission européenne au titre de ce règlement) visent à :
- offrir une plus grande sécurité juridique et une uniformité accrue aux entreprises ;
- fournir des orientations plus claires aux agents des douanes de toute l’UE ;
- achever le passage à un environnement sans support papier, entièrement électronique ;
- simplifier les règles et les procédures douanières et renforcer l’efficacité des opérations douanières pour répondre aux besoins de la société moderne ;
- accroître la rapidité des procédures douanières pour garantir le respect et la fiabilité des opérateurs économiques (opérateurs économiques agréés) ;
- protéger les intérêts économiques et financiers de l’UE et de ses États membres, ainsi que la sécurité et la sûreté de ses citoyens ;
- prévoir, dans certains cas, des exemptions de déclaration en douane pour les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’UE par voie maritime ou aérienne ; et
- permettre aux autorités douanières et aux entreprises de poursuivre l’utilisation des systèmes informatiques ou des accords sur support papier existants pour un nombre limité de formalités douanières au plus tard jusque 2025, quand ils seront remplacés par des systèmes informatiques nouveaux ou mis à niveau. »
En pratique, le CDU fixe des règles précises avec un très haut niveau d’harmonisation et d’homogénéité des pratiques s’agissant des obligations déclaratives, des règles de classification des marchandises et de nomenclature, de détermination de l’origine des marchandises, de calcul et de reddition des dettes douanières, de placement sous un des régimes douaniers, de vérification, mainlevée et disposition, de recours aux régimes particuliers, et enfin des règles de sortie du territoire douanier de l’Union. Ainsi, lorsque tout se passe bien, c’est-à-dire lorsqu’une marchandise est en règle, qu’un importateur ou un exportateur respecte les diligences prévues et déclare correctement les marchandises en s’acquittant des montants prévus, il existe un très haut niveau de garantie que le traitement à la frontière de l’Union sera analogue, avec une standardisation achevée des procédures, des documents, y compris par partage de données et recours à des systèmes d’information communs. Pour l’usager en règle, tout se passe comme si il existait un unique service douanier européen.
En revanche, le CDU laisse une très large autonomie aux Etats-membres pour définir les sanctions en cas d’infraction douanière[124], leur assignant seulement d’être « effectives, proportionnées et dissuasives », et encadrant de manière générale la nature des sanctions administratives – lorsque les Etats-membres en disposent complémentairement à des sanctions pénales. Les Etats-membres sont simplement tenus d’en informer la Commission en pratique. Le CDU ne fixe pas davantage les modalités pratiques de constatation des infractions douanières par les services nationaux selon un cadre homogène, ni n’établit de règles uniques pour la transmission aux services judiciaires ou la mise en place des sanctions administratives, et ne dispose pas des règles assurant la coopération en la matière des Etats-membres, qui s’inscrit dans les régimes généraux de coopération entre les justices des différents Etats, sans modalités facilités pour une compétence aussi unifiée que les douanes.
En France, le Titre XII du Code des Douanes fixe ainsi un cadre national de contentieux et de recouvrement douanier, assorti de ses propres infractions pénales, de ses propres modalités de constatation des infractions, d’échange avec les parquets compétents, d’exécution des peines et sanctions, et de responsabilité pénale. Il fixe en outre les règles de secret professionnel et de commissionnement des agents douaniers aux fins de pouvoir assurer ces missions.
Parallèlement, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services douaniers nationaux demeurent une pure compétence nationale, dans laquelle le niveau européen n’intervient que très marginalement, dans la même logique de subsidiarité et de respect des souverainetés nationales (Titre II du code des douanes, s’agissant de leur organisation, de leur régime d’immunité, de sauvegarde et d’obligations, de leurs pouvoirs de visite et de contrôle, et des modalités du contradictoire préalable à la décision). Le choix des moyens qui leur sont alloués, et des budgets correspondants au regard des flux de marchandises et des enjeux de contrôle, relève également de compétences nationales, dans lesquelles l’Union n’intervient pas.
Cette approche fonctionne tout à fait dans un monde structuré par l’ouverture des échanges internationaux, où le rôle des services douaniers était premièrement et prioritairement un rôle de répression pénale des flux de marchandises illicites (contrebande), en lien avec la répression du banditisme national, et donc des enjeux de sécurité intérieure et d’ordre public relevant au premier ordre des compétences nationales.
Deux effets structurels viennent relever les enjeux. En premier lieu, l’évolution radicale des termes du commerce international, qui viennent remettre en cause le postulat multilatéral et ouvert sur lequel reposait l’art. 206 du Traité, comme évoqué plus haut à la proposition 1. Dans un monde où l’institution unilatérale de droits de douane redevient une réalité, et où l’Union doit se doter de moyens d’en mettre en œuvre de manière plus dynamique, dans des montants à prélever et sur des catégories de produits qui évoluent plus vite et en masse financière plus importante, les enjeux d’harmonisation, et le coût potentiel des hétérogénéités de traitement douanier aux frontières de l’Union s’accroissent. Certes jusqu’à présent, le cadre actuel a fonctionné et on ne peut nier que la mise en œuvre du CDU permet une très grande homogénéité de traitement. Comme dans la Suisse de 1894, l’évolution de la posture commerciale de l’Union implique des moyens plus importants mais aussi plus harmonisés pour assurer l’application de la politique commerciale et douanière commune, et donc le rapprochement des services nationaux dans un cadre plus fédéralisé. Une première étape serait d’offrir aux Etats-membres qui en font la demande, sur le mode de la coopération renforcée, une « fédéralisation » de leurs services douaniers nationaux, transférant leurs agents dans un statut européen, sous une unité de commandement européenne rattachée à la Commission, et dotés d’un cadre commun pour les règles de commissionnement, de contrôle, de mise en œuvre des procédures du CDU et de constatation des infractions.
Toutefois, force est de constater aussi que nos partenaires commerciaux les moins coopératifs n’hésitent pas à exercer des pressions sur certains Etats-membres, pour trouver le « maillon faible » de l’exercice des politiques communes – on songera par exemple aux pressions exercées sur la Lituanie en 2023–2024 qui donnèrent lieu aux premières mises en œuvre du règlement anticoercition évoqué plus haut, ou au rôle joué par la Hongrie et la Slovaquie dans les échanges liés au conflit ukrainien et à l’approvisionnement gazier de l’Union – le risque existe que, face à des droits de douane importants devant être mis en œuvre, certains Etats-membres sous pression cessent de coopérer ou du moins mettent en œuvre de manière dégradée le cadre douanier de l’Union, précisément puisqu’il y aura davantage à y gagner. La question peut déjà être posée par exemple sur la mise en œuvre différenciée entre les Etats-membres des contrôles relatifs aux sanctions contre la Russie, s’agissant des flux détournés par des Etats-tiers dont on peut présumer qu’ils réexportent vers la Russie. L’article 12 octies du règlement 833/2014 oblige à une clause de « non réexport » vers la Russie dans les contrats avec des tiers, mais force est de constater que les exportations de l’Union vers l’Arménie, la Géorgie, ou des Etats d’Asie Centrale comme le Kirghizstan ont plus que doublé depuis 2022, sans qu’il soit permis de penser que les échanges économiques réels avec ces pays aient suivi avec la même dynamique. Il peut être allégué que les contrôles de la sincérité des déclarations à ce sujet soient réalisés de manière plus ou moins diligente selon les Etats-membres, en fonction de l’importance de ces flux pour leurs tissus économiques respectifs et des moyens locaux des services douaniers. Se doter d’une inspection centrale européenne des services douaniers permettrait d’avoir une prise directe sur l’adéquation des moyens et sur la mise en œuvre correcte du cadre commun, par le niveau européen, permettant de documenter les éventuels écarts des Etats-membres et d’assurer la pleine homogénéité des pratiques, en substitution des vingt-huit services d’inspection des douanes nationaux.
En second lieu, il peut être observé que même pour les flux de contrebande et les trafics illicites, les réseaux se sont en bonne mesure européanisés et tirent pleinement parti du marché intérieur pour assurer la fluidité des transferts de marchandises illicites au sein de l’Union, une fois passée la frontière extérieure de l’Union la plus perméable. Un progrès dans l’intégration des services douaniers nationaux permettrait dans le même temps, même si cela dépasse le cadre de la présente étude, d’améliorer la coopération des services de police nationaux et des parquets face à des réseaux qui sont à présent pleinement européens. Une première étape dans cette direction peut être de mutualiser les services de renseignements douaniers (DNRED en France) afin d’assurer une unité d’accès aux informations opérationnelles et de renseignement pour l’ensemble des services assurant les contrôles aux frontières, qu’il s’agisse de trafics illicites ou du contournement de mesures de douane.
L’action aux frontières de l’Union risque de s’amplifier, face aux actions hostiles d’Etats-tiers non coopératifs et plus généralement de l’enjeu croissant d’assurer une équité concurrentielle entre le cadre social et environnemental européen et celui de nos partenaires commerciaux : mise en place de tarifs réciproques ou de mesures de défense commerciale, développements anticoercition ou antisubventions, développement de contrôles sur les propriétés des produits mis sur le marché de l’Union pour des motifs environnementaux ou sociaux, par exemple mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, contrôles des critères de durabilité de la biomasse, ou du règlement méthane, respect des critères du règlement 3TG[125] et plus généralement des mesures d’interdiction des produits issus du travail forcé[126]. Ceci va conduire les montants en jeu, qui sont des ressources propres de l’Union pour ce qui est des droits de douane, mais également la complexité de l’exercice de contrôle et d’enquête comme la subtilité des montages frauduleux, à s’accroître très significativement, posant la question de l’adéquation des moyens, parfois limités dans certains Etats-membres, et de l’efficacité à doublonner les outils d’appui et les services centraux.
Enfin, dans la mesure où les recettes douanières sont une ressource propre de l’Union, se pose la question d’harmoniser les sanctions pénales correspondantes, qui relèvent déjà du Parquet Européen, qui a pour objet d’assurer une réponse uniforme et efficace face aux menaces sur les ressources financières de l’Union. Le Parquet européen (EPPO), opérationnel depuis juin 2021, est une autorité indépendante de l’Union européenne chargée d’enquêter et de poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Sa compétence s’étend notamment aux infractions douanières graves, telles que la fraude à la TVA transfrontalière ou la contrebande de marchandises soumises à droits et taxes élevés (voir règlement (UE) 2017/1939[127] art. 3c). En vertu du règlement, le Parquet européen peut intervenir dès lors que les faits dépassent un seuil financier (habituellement 10 000 euros de préjudice pour les délits douaniers). Cette compétence vise à renforcer la lutte contre les fraudes complexes et transnationales que les autorités nationales seules peinent à endiguer. Le Parquet européen travaille en étroite coopération avec les douanes, les polices et les autorités judiciaires nationales. Il peut diligenter des enquêtes, ordonner des perquisitions, saisir des biens et poursuivre les auteurs devant les juridictions nationales compétentes. Sa compétence inclut aussi les fraudes aux accises et autres détournements de recettes européennes. Dès lors que le Parquet Européen est déjà un cadre de coopération renforcée (auquel ne participent que 22 Etats volontaires), rien n’interdit d’aller plus loin pour ceux qui le souhaitent, en créant des infractions pénales « européennes » autonomes et directement applicables à l’échelle de l’Union pour ce qui est des fraudes douanières – puisque la compétence est européenne et qu’il n’existe bien qu’une seule frontière de l’Union, pour ce qui concerne les marchandises – et en se dotant d’une juridiction pénale européenne pour en juger, par exemple adossée à la CJUE.
Proposition 6 : Se doter des capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre la politique commerciale commune dans sa dimension stratégique : vers un service douanier européen commun.
- Proposer aux Etats-membres qui le souhaitent un transfert de leurs services douaniers à un statut européen, un financement européen, et un régime de police administrative et pénale européen, mettant en œuvre le CDU sous l’autorité directe de la Commission.
- Fusionner les inspections nationales des services douaniers en un service commun d’inspection des douanes nationales ou européennes sous l’autorité de la Commission.
- Se doter d’un service européen de renseignement douanier.
- Poursuivre les transferts de compétence déjà engagés depuis 2017 au plan pénal vers le Parquet Européen en le complétant d’un cadre européen d’infractions pénales douanières et d’une juridiction pénale européenne dédiée.
3.2 Définir qui, et ce qui participe au marché intérieur
Selon la définition de la souveraineté économique que nous avons élucidée dans la deuxième partie, celle-ci ne peut se résumer à la détermination des effets économiques appliqués aux frontières du marché intérieur, et donc des droits de douanes et de la politique commerciale, ainsi que des éventuelles frontières internes à l’ordre économique. Elle doit encore comprendre la détermination du fonctionnement interne de cet ordre économique, et donc la capacité à définir les acteurs admis à participer aux marchés qui y sont constitués, à régir et réguler si nécessaire ces marchés pour en assurer le fonctionnement concurrentiel et efficient, et à pouvoir intervenir dans ces marchés, par l’intermédiaire des acteurs économiques ou par une participation directe.
Nous avons vu dans la section précédente comment le processus de construction européenne, et le transfert au niveau européen de la compétence commerciale et douanière, avait conduit certaines compétences essentielles, certains attributs clés de la souveraineté économique s’agissant du contrôle des frontières externes de l’ordre économique, à ne pas être transférées à une autorité réelle et effective de niveau européen ou à ne pas se décliner dans des outils nouveaux de niveau européen qui existaient antérieurement au niveau national ou existent dans d’autres systèmes économiques, tandis que la capacité des Etats-membres à agir dans ces champs s’avérait sinon abolie du moins fortement circonscrite dans le cadre du même processus de construction européenne. Nous avons également vu en quoi le crible que nous proposons pour la notion de souveraineté économique amène celle-ci à s’exercer, dans la conduite des relations commerciales de l’Union, selon certains principes de réciprocité, et plus généralement dans un jeu stratégique où les décisions doivent s’envisager pour le rapport de négociation qu’elles créent tout autant que pour leurs gains en soi.
Définir qui est admis à participer au marché intérieur
Une fois établi ce qui se passe aux frontières, la souveraineté économique européenne a ensuite pour rôle de définir quels acteurs de marché sont admis à participer au marché intérieur, et quels biens et services sont admis à faire l’objet de transactions au sein du marché intérieur. S’agissant de définir quels acteurs sont admis ou non à participer au marché intérieur européen, cet attribut du souverain économique peut se subdiviser en deux fonctions. La première est de déterminer quels acteurs sont de manière générale admis à participer au marché intérieur, et lesquels en sont exclus, pour des motifs tenant à l’incompatibilité entre leur nationalité ou leurs liens d’intérêt avec des Etats-tiers et les activités du marché intérieur européen auxquelles ils souhaitent participer. La seconde porte sur le contrôle spécifique de certaines activités réglementées, compte tenu de leurs enjeux particuliers de protection du consommateur ou de garantie de l’intégrité du marché intérieur, qui sont soumises à des régimes d’encadrement ou de régulation spécifiques.
Concernant le premier cadre de contrôle des participants au marché intérieur, il s’agit des régimes de contrôle des investissements étrangers. Historiquement, l’Union n’était pas dotée d’un cadre unique de contrôle de ceux-ci, qui relevait de l’initiative des Etats-membres, étant entendu que ceux-ci demeuraient libres de ne pas en mettre en place. A titre d’exemple, la France dispose d’un cadre relativement comparable au cadre actuel depuis 1966[128], tandis que le Danemark n’a vu son régime de contrôle entrer en vigueur qu’en 2021[129]. Ce n’est que depuis 2019 que l’Union est dotée d’un règlement ad hoc qui établit un cadre de niveau européen pour le filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, le règlement 2019/452[130].
Le règlement fixe un certain nombre de principes communs – qui sont en pratique le plus petit commun dénominateur des régimes nationaux existants, apportant d’une part des garanties aux investisseurs (application de délais déterminés pour les décisions en la matière, protection des informations confidentielles, possibilité de recours, transparence des règles et procédures, des motifs de filtrage) et d’autre part un cadre indicatif commun pour identifier les secteurs sur lesquels les effets potentiels des investissements étrangers peuvent conduire à exercer un contrôle (infrastructures critiques, technologies à double usage militaire et civil, intrants essentiels, accès aux données, médias) et pour identifier les investisseurs étrangers méritant un traitement spécifique (détenus ou contrôlés directement ou indirectement par des Etats-tiers, ayant des antécédents d’interférences avec la sécurité ou l’ordre public dans un Etat-membre, ou présentant un risque d’exercer des activités illégales ou criminelles). Il donne en outre un cadre de coopération entre Etats-membres, afin de partager l’information sur les investissements étrangers, permettant à un Etat-membre de signaler à un de ses partenaires européens qu’un investissement envisagé ailleurs dans l’Union est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou son ordre public[131], avec pour limite qu’une fois ce problème signalé, l’Etat membre dans lequel l’investissement a lieu n’est pas lié par les signalements de ses partenaires mais doit seulement en tenir « dûment compte »[132]. Enfin, et de manière nouvelle, il permet à la Commission de signaler aux Etats-membres « des investissements directs étrangers […] susceptibles de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public »[133], dont une liste fermée est donnée en Annexe (Horizon 2020, RTE-E et RTE-T, Copernicus, etc.).
On peut donc observer ici plusieurs limites du cadre européen actuel, en partie palliées par les cadres nationaux, qui tiennent au fait qu’il s’agit d’un objet nouveau, qui doit respecter les compétences propres des Etats-membres et pour des raisons de pragmatisme politique ne pouvait leur imposer de transformations radicales ou de convergence sur leurs principes. Tout d’abord il fixe des critères indicatifs mais ne parvient pas à construire un cadre méthodologique rigoureux pour déterminer les circonstances de nature à requérir une autorisation préalable. Nous entendons là la définition d’un cadre permettant d’apprécier des secteurs à protéger, des circonstances propres aux entreprises objet des investissements de nature à requérir une vigilance particulière, ou s’agissant des types d’investissements couverts. Ensuite, il ne porte pas, dans la logique du principe de solidarité qui découle aussi du Traité, d’obligation pour un Etat-membre de prévenir une opération qui atteindrait fortement les intérêts d’un autre, alors que ce cas peut se présenter (par exemple, une prise de contrôle étrangère sur un terminal portuaire qui serait le principal débouché du commerce extérieur d’un Etat-membre donné, ou sur une installation énergétique ou de télécommunications qui desservirait fortement un autre Etat-membre). Enfin, le cadre créé pour les intérêts fondamentaux de l’Union se limite à des projets communs nommément désignés, très limités en nombre, et qui ne recouvrent pas la plénitude des intérêts fondamentaux de l’Union en tant qu’objet politique, ou même de l’Union en tant que marché intérieur.
Comme beaucoup d’Etats-membres, la France dispose d’un cadre de contrôle (screening) des investissements étrangers. Ce cadre est permis par le fait que le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne pose certes à son article 63 un principe général de liberté de circulation des capitaux, mais ménage ensuite à ses articles 64 et 65 des exceptions de deux natures : d’une part une clause de bénéfice d’antériorité à l’article 64(1) pour les restrictions mises en œuvre par les Etats-membres avant 1993 (ou 1999 et 2002 pour certains Etats entrés dans l’Union postérieurement à 1995), et d’autre part à l’article 65(1)(b), la possibilité pour les Etats-membres « de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique. ». C’est dans ce double cadre que s’inscrit le régime français que nous allons à présent décrire.
Le cadre français, codifié aux articles L.151–3 et suivants du Code Monétaire et Financier (dit « régime des IEF », pour investissements étrangers en France) repose sur un principe général de liberté dans les relations financières entre la France et les Etats tiers. Le Gouvernement a néanmoins la faculté d’y déroger en soumettant à autorisation préalable du Ministre de l’économie des investissements étrangers dans des activités « qui, même à titre occasionnel, participe[nt] à l’exercice de l’autorité publique ou relève[nt] de l’un des domaines suivants :
a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. »
Le Ministre est en outre doté de pouvoirs de contrôle, de mise en demeure, de sanction administrative (L.151–3–1), notamment pécuniaire (L.151–3–2), lui permettant de frapper de nullité les engagements contractuels pris par des investissements en défaut d’autorisation (L.151–4). Cette compétence fait l’objet d’un contrôle annuel par le Parlement sur le fondement d’un rapport et d’auditions (L.151–7).
Ce cadre est très régulièrement employé en France, et possède des effets à deux titres. D’une part un effet dissuasif, soit parce que les investisseurs les plus susceptibles d’être concernés n’envisagent même pas des investissements dans les sociétés présentant une certaine sensibilité, soit parce que des retours informels de l’administration, sans attendre une saisine formelle, suffisent à les convaincre de ne pas envisager une opération. Ces effets recouvrent en pratique un nombre important de cas, où l’abandon du projet d’investissement ne donne jamais lieu à une décision explicite ou à des communications médiatisées, ce qui peut conduire à sous-estimer la portée réelle de ce cadre si l’on se fondait seulement sur les décisions recensées, et peut également amener à rendre difficile l’appréciation de la doctrine d’application des articles L.151–3 et suivants du code monétaire et financier pour les investisseurs tiers. Ces effets dissuasifs ont également pour effet de rendre plus difficile l’accès au capital pour les entreprises des secteurs les plus sensibles, en cela que certains investisseurs – même s’ils seraient en pratique probablement autorisés – ne souhaitent pas s’exposer au risque opérationnel ou médiatique d’une décision négative, et donc de renchérir le coût du capital pour les secteurs sensibles. D’autre part, il a naturellement des effets directs, par son application concrète à des cas déterminés, soit que l’investisseur renonce à son projet, soit conduisant celui-ci dans un dialogue avec les autorités à amender son projet pour procéder à un détourage des activités les plus sensibles, parfois nationalisées ou rapprochées d’entreprises publiques ou proches de l’Etat.
Il présente en pratique plusieurs limites, qui tiennent paradoxalement à sa souplesse d’application, et à la plasticité d’un cadre pour lequel le niveau législatif donne à l’autorité administrative une très grande latitude d’appréciation comme d’édiction de conditions pour ses autorisations.
En premier lieu, le champ des activités susceptibles d’être couvertes est difficile à anticiper pour les investisseurs. Au plan purement légistique, l’article R.151–3 du code monétaire et financier en propose une liste sous trois catégories
(i) les « activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique », c’est-à-dire celles directement ou indirectement liées à la défense nationale et à l’ordre public,
(ii) les « activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, lorsqu’elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels », c’est-à-dire celles en lien avec des missions de service public ou des infrastructures, biens ou services essentiels, c’est-à-dire non substituables,
et enfin, (iii) les activités de recherche et développement sur des biens à double usage civil et militaire ou des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté.
On peut observer que cette définition par « liste » présente plusieurs bizarreries, notamment l’inclusion des « activités relatives aux jeux d’argent, à l’exception des casinos » dans le (i), alors que le lien avec la défense et l’ordre public paraît au mieux ténu – et que d’ailleurs si la logique était de couvrir des activités sensibles au plan du blanchiment et de la lutte contre le crime organisé, les casinos y seraient sans doute utilement inclus. De même, plusieurs des sous-catégories sont définies de manière au mieux floue, permettant au politique une très grande latitude d’appréciation quant à la soumission à ce régime. A titre d’exemple, lorsque le Ministère de l’Economie s’est opposé à l’acquisition en décembre 2021 de Carrefour par la société canadienne Couche-Tard[134], c’est au motif implicite qu’il avait la faculté de refuser une autorisation au titre de ce régime administratif, car les hypermarchés Carrefour seraient impliqués dans « la production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». En pratique, la liste très souple des « infrastructures biens ou services essentiels » du (ii), combinée au fait que peuvent être soumises conformément au L.151–3 des activités qui « même à titre occasionnel » participent à celles-ci, permet de manière quasi-universelle en pratique à l’exécutif de se saisir d’un cas d’acquisition, dans le format actuel.
En second lieu, les conditions sur l’investisseur et son pays d’origine et sur ce qui constitue un « investissement » relevant du régime des investissements étrangers en France. Il peut ici être observé que la définition d’un investisseur assujetti à ce régime recouvre toute entité légale de droit étranger (même contrôlée par un ressortissant français), toute personne physique de nationalité étrangère, toute personne de nationalité française mais qui n’est pas résident fiscal français, ou toute entité française contrôlée même indirectement par une de ces trois catégories. Un investissement réalisé en France par un Français résident fiscal en Belgique, par une entreprise belge, ou même par une entreprise de droit belge détenue à 100% par un citoyen et résident fiscal français, sont donc en théorie assujettis. Aucune exclusion a priori du champ de ce contrôle n’est ménagée pour les citoyens ou entreprises dont le contrôle et la prépondérance des intérêts seraient situés dans l’Union européenne, par rapport à celles situées dans le reste du monde, et aucune distinction ou hiérarchisation n’est réalisée entre Etats-tiers « alliés » (ou inscrits dans des accords de libre-échange et de partenariat) et Etats présentant une posture plus inamicale. De même, il peut être noté que la définition des investissements soumis, au R.151–2, ne repose pas sur une logique de « prise de contrôle » mais sur des seuils (à 25% pour les sociétés non cotées et à 10% pour les sociétés cotées) ou la notion de contrôle au sens du code de commerce (L.233–3), ce qui conduit des opérations d’injection de fonds propres qui n’accordent aucun droit de gouvernance nouveau à être soumises, pour peu qu’on franchisse un des deux seuils (cela dépend du pacte d’actionnaires), et de l’autre côté ne soumet pas des opérations qui en pratique confèrent un contrôle très fort sur une entreprise (par exemple dans des cas où un actionnaire minoritaire sous les 25% est par ailleurs le financeur quasi-exclusif en dette convertible ou par d’autres instruments de quasi-fonds propres de la société).
En troisième lieu, la forme de la décision, du régime de police administrative attaché, et le respect du principe de proportionnalité. L’article L.151–3 offre en pratique une latitude totale pour édicter des conditions à la délivrance d’une autorisation, l’article R.151–8 comportant une affirmation purement faciale du fait que ces conditions doivent s’inscrire dans une logique de « proportionnalité » aux enjeux envisagés, bien difficile à contrôler en pratique par un juge et encore plus difficile à apprécier pour un tiers, sans que même des types généraux de critères et de conditions soient précisés à titre illustratif et comme « boîte à outils » pour l’exécutif (nomination d’administrateurs indépendants validés par le Ministre, encadrement des remontées de dividendes hors de France, cession d’activités ou de branches, etc.). De même, l’article R.151–10 permet une très grande latitude pour les mesures d’interdiction, qui relèvent simplement d’un avis motivé, pour des raisons de compatibilité aux principes fondamentaux relatifs aux sanctions administratives. En théorie, ces décisions d’autorisation sous condition ou de refus relèvent des juridictions administratives, mais en pratique, il suffit que le Ministre indique prévoir une décision de refus ou assortie de conditions inacceptables pour que les demandes soient retirées et les opérations abandonnées, tant l’effet réputationnel et sur les conditions de financement de l’opération est important en pratique en cas de décision négative. De l’autre côté, si l’entreprise visée réalise une opération sous conditions, le Ministre est doté de capacités de sanction administrative, notamment d’astreinte voire de nullité des contrats (L.151–3–1), ou en prescrivant la cession de parts, mais il n’est prévu aucune sanction pénale contre les personnes qui soit auraient apporté des éléments délibérément inexacts ou mensongers à l’examen du Ministre, soit ne respecteraient pas les conditions des mesures de sanction, ce qui pose problème à deux titres : d’une part car l’effectivité des seules sanctions administratives contre les personnes morales peut être réduite (notamment si l’entreprise est en difficulté, ou que les comptes ne permettent pas de régler les astreintes), et d’autre part car le Ministre n’est pas tenu de s’en saisir comme il le serait en matière pénale par l’article 40 du code de procédure pénale, qui lui impose de signaler au Parquet toute infraction.
Le cadre américain mérite ici d’être mis en regard des cadres européens et français. Tout d’abord, si les Etats-Unis sont dotés d’un cadre de contrôle des investissements étrangers, via le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), il n’existe aucun cadre de contrôle par un Etat fédéré des investissements réalisés en son sein par des entités issues d’un autre Etat. L’idée que l’exécutif du Minnesota puisse contrôler, voire s’opposer à l’acquisition d’une société locale par une société du Wisconsin ou de l’Illinois prêterait à sourire pour un lecteur américain, là où, nous l’avons vu, les Etats-membres de l’Union ont toute latitude aujourd’hui pour faire obstacle à des acquisitions ou des investissements réalisés par des entreprises d’autres Etats-membres. Une telle distinction serait en tout état de cause très certainement incompatible avec la Constitution, et en particulier le premier alinéa du XIVe amendement (Equal protection clause).
Mis en place par l’Executive Order 11858 en mai 1975[135], sous Gerald Ford, le CFIUS est un comité associant l’ensemble des agences concernées de l’exécutif fédéral afin d’assurer un contrôle des investissements étrangers réalisés aux Etats-Unis, et si nécessaire de recommander au Président qui s’est vu doter de cette faculté en 1988[136], de les bloquer. Il comprend aujourd’hui le Secrétaire au Trésor, le Secrétaire à la Sécurité Nationale, le Secrétaire au Commerce, le Secrétaire de la Défense, le Secrétaire d’Etat, l’Attorney General, le Secrétaire à l’Energie, le Secrétaire au Travail (non-votant, ex officio) et le directeur de la CIA (non-votant, ex officio). Les dispositions qui l’encadrent et définissent le régime de contrôle associé sont inscrites dans le Defense Production Act (1950), régulièrement amendé, à la section 721[137].
Le champ couvert par son contrôle est extrêmement large. Depuis 2018 et le Foreign Investment Risk Review Modernization Act[138], les transactions concernées recouvrent :
- La totalité des opérations de fusion et d’acquisition, sans limitation sectorielle : « toute fusion, acquisition ou prise de contrôle postérieure au 23 août 1988 par ou conjointement à une personne étrangère qui pourrait résulter en un contrôle étranger d’une activité des Etats-Unis, incluant [celles] réalisées à travers une joint-venture »[139], mais aussi
- Un large éventail d’activités immobilières : « l’achat ou location ou concession à une personne étrangère de propriétés immobilières privées ou publiques » qui sont localisées dans un port ou au voisinage d’installations militaires ou du gouvernement fédéral ayant une fonction de sécurité nationale ou les exposeraient à un risque de surveillance ou de captation d’information[140] ;
- Tout investissement, même non contrôlant, dans des technologies ou infrastructures critiques : « tout autre investissement par une personne étrangère dans une activité des Etats-Unis [qui] détient opère fournit ou apporte des services à une infrastructure critique » ou « produit, conçoit, teste, […] une ou plusieurs technologies critiques », ou « maintient ou collecte des données personnelles sensibles de citoyens des Etats-Unis pouvant être utilisées d’une manière portant préjudice à la sécurité nationale » [141] ;
- Tout changement des droits d’une personne étrangère vis-à-vis d’une entité des Etats-Unis dans laquelle elle a déjà investi, si cela conduirait à une prise de contrôle ou un investissement dans un des champs du troisième point.
Les définitions sont elles-mêmes laissées en large mesure à l’autorité propre du CFIUS pour construire sa propre doctrine et sa pratique décisionnelle. A titre d’exemple, les « infrastructures critiques » sont renvoyées « sous réserve des régulations prescrites par le Comité, aux systèmes et actifs, physiques ou numériques, si essentiels aux Etats-Unis que leur mise hors d’état ou leur destruction aurait un impact critique [debilitating impact] sur la sécurité nationale. »[142] Le texte a en outre pris soin de préciser que toute autre définition en droit positif d’une infrastructure critique ne peut ici être opposée[143]. Les technologies critiques recouvrent de même celles intéressant la défense (selon la réglementation propre aux exports d’armement), celles sous régime de contrôle des exports, celles en lien avec le secteur nucléaire, les agents et toxines relevant également de ce type de régimes, et enfin une liste très large de « technologies émergentes et fondamentales », ajoutée en 2018 par l’Export Control Act[144], et que l’exécutif a toute latitude d’amender et d’agrandir selon les besoins qui se présentent.
Le CFIUS dispose depuis 2007 d’une autorité administrative propre, de ressources budgétaires et humaines dédiées. Les personnes physiques ou morales qui envisagent un investissement ou une opération soumise à son régime de contrôle sont tenues de saisir le CFIUS pour validation préalable : le Comité dispose ensuite de 45 jours pour approuver ou démarrer une enquête, puis, si une enquête a démarré, de 45 jours pour proposer au Président de refuser, approuver ou imposer des changements à l’opération. En pratique toutefois, le CFIUS au terme des 90 jours peut demander à retirer et redéposer une demande si nécessaire. Au terme de son examen, le CFIUS forme une recommandation au Président qui dispose de 15 jours pour prendre une décision, délai qui peut être étendu par le CFIUS si nécessaire. Une fois une opération approuvée, elle ne peut plus être remise en cause (safe harbor). En revanche, le CFIUS peut se saisir rétroactivement d’opérations réalisées par le passé qui ne lui auraient pas été notifiées s’il juge qu’elles entrent dans son champ de contrôle, et ce sans prescription. Un régime de sanction est prévu en cas de non-respect des dispositions prises par le CFIUS ou des conditions édictées pour des opérations relevant de son champ de contrôle, qui complète les sanctions pénales dont sont passibles les contrevenants en cas de fausse déclaration.
Dans sa forme issue des évolutions législatives de 2018, le CFIUS jouit d’une très grande latitude d’appréciation, et peut porter son contrôle sur la presque totalité des opérations d’investissement étranger aux Etats-Unis, dans une confidentialité quasi-totale, sans aucune obligation de publicité de ses décisions ou de motivation de celles-ci ou de ses choix d’interprétation en dehors des obligations légales d’information du Congrès et des dispositions réglementaires relevant de sa propre autorité. Le cas du blocage de la fusion d’U.S. Steel et de Nippon Steel, une opération d’un montant de 14.9Mds$, par l’administration Trump en janvier 2025[145], actuellement contesté devant les juridictions par les deux parties, apporte un très bon exemple de ce champ aujourd’hui très large donné à l’exécutif fédéral pour autoriser ou censurer presque toute forme d’investissement étranger sur des motifs de sécurité nationale parfois discutables, et même issu d’Etats coopératifs et alliés stratégiques des Etats-Unis. En pratique, la très forte déférence accordée par les juridictions aux invocations de « motifs de sécurité nationale » par l’exécutif rend quasi-impossible de contester une décision prise par le CFIUS, ce d’autant que les motifs des décisions sont en bonne mesure confidentiels et non-objectivables[146] : à l’inverse, la généralisation et la banalisation de ces motifs en droit des affaires, combinée à la fin de la Chevron Deference depuis Loper Bright Enterprises c. Raimondo (2024), met en risque ces motifs d’être de plus en plus fréquemment examinés au fond par les juges. L’ampleur devenue tentaculaire du champ de contrôle par le CFIUS, et sa capacité à rouvrir des transactions conclues, présente également des effets significatifs tant sur l’attractivité des Etats-Unis pour les investisseurs étrangers que pour le maintien de l’état de droit et du principe de confiance légitime.
Ces grandes souplesses accordées dans le cadre américain, et le manque de transparence de ces décisions ou des échanges préalables à celles-ci, ne sont pas sans porter à questions quant au risque d’instrumentalisation des décisions au titre du régime des IEF par des acteurs économiques, qui peuvent y voir une manière de précipiter les difficultés économiques de leurs concurrents – en faisant pression sur l’exécutif pour qu’il refuse un rapprochement avec un tiers étranger ou un investissement – ou de remporter la mise dans une opération concurrentielle de vente d’une entreprise, contre des concurrents étrangers. Le cadre français n’est de même pas exempt de ces critiques, même si le champ plus limité des contrôles permet de circonscrire les enjeux.
Si l’Union doit devenir un espace de souveraineté économique, il est indéniable qu’elle doit se doter des moyens d’assurer un contrôle des opérations économiques étrangères réalisées en son sein, lorsque celles-ci mettent en jeu ses intérêts économiques fondamentaux, et au premier titre d’entre eux la protection du marché intérieur, de son caractère concurrentiel et efficient et des infrastructures qui lui sont essentielles. Le jour où l’Union deviendra une unité politiquement souveraine, il sera possible d’y adjoindre des intérêts fondamentaux politiques, mais dans un premier temps, le contrôle à ce titre devra rester au niveau des Etats-membres, qui demeurent pleinement dépositaires de la souveraineté politique effective. Ceci suppose donc de compléter le cadre de contrôle des investissements étrangers inscrit dans le règlement 2019/452 par un véritable outil de contrôle européen commun, en transférant davantage de compétences au niveau européen pour ne laisser au niveau national que ce qui ne peut strictement pas procéder d’un contrôle européen.
Pour autant, la création d’un tel régime de contrôle européen devra se prémunir du risque de tomber dans les excès du cadre américain actuel, en apportant sécurité juridique pour les investisseurs, prédictibilité des décisions, qui devront être motivées et pouvoir s’appuyer sur des précédents publics dans la mesure du possible et un cadre méthodologique clair et objectif. C’est en respectant ces principes qu’il sera possible pour l’Union de demeurer aussi attractive que possible pour les investisseurs tiers, et donc de défendre ses intérêts fondamentaux, notamment la vitalité de son marché intérieur, dans une balance des intérêts avec l’enjeu de protection de certains éléments de souveraineté économique. Le contrôle des investissements étrangers est affaire d’équilibre.
Enfin, en transférant davantage de compétences à ce sujet au niveau européen, la décision s’éloignera d’autorités nationales qui ont pu utiliser ce cadre comme un outil protectionniste intra-européen, contrairement à l’esprit des Traités, arguant des motifs de sécurité de l’article 65 du Traité sur des fondements spécieux, voire se prêtant à des menaces de blocage d’opérations reposant sur des raisons tout aussi politiciennes ou liées à des pressions privées que réellement motivées par des préoccupations de sécurité nationale.
Proposition 7 : Aller vers un contrôle général européen des investissements étrangers, articulé avec une compétence subsidiaire des Etats-Membres, en révisant et approfondissant le règlement 2019/452. Il doit ici être relevé que cet approfondissement pourrait requérir une décision à l’unanimité du Conseil[147] s’il était considéré que cette harmonisation et unification des régimes nationaux constituait un « recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers » (ce qui est discutable en soi).
Dans la logique présentée plus haut, serait ainsi constitué un Comité pour les Investissements Etrangers dans l’Union Européenne (CIEUE ) auprès de la Commission européenne, associant les Commissaires et/ou directions générales concernées, ainsi que des représentants du Conseil. Ce comité aurait compétence pour délivrer une autorisation préalable à toute opération qui associerait :
- Soit un investisseur ou une partie prenante extra-européenne suffisamment sensible, à savoir :
- Ceux issus d’une liste d’Etats-tiers non coopératifs définie par concaténation de celles proposées par les Etats-membres au Conseil, plus de celles ajoutées par la Commission. Il est ici important que les Etats-membres puissent désigner les Etats-tiers non coopératifs eux-mêmes, afin de protéger leurs intérêts propres.
- Ceux contrôlés directement ou indirectement par un gouvernement tiers, ou susceptibles de faire l’objet de pressions économiques ou politiques significatives de la part d’un gouvernement tiers.
- Les acteurs étrangers extra-européens ayant des antécédents d’intervention dans le Marché intérieur, notamment ceux déjà sanctionnés par la Commission au titre des articles 101 et 102 du Traité (contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations) ou faisant l’objet de mesures au titre du règlement antisubventions étrangères 2016/1037/UE ou de sanctions prises par toute entité de l’Union.
La définition d’un acteur étranger pourrait quant à elle reprendre celle du droit français (R.151–1 du Code Monétaire et Financier), notamment en ce qu’elle intègre de manière exacte les acteurs en chaîne de contrôle d’un acteur étranger, et les acteurs européens sur lesquels un tiers étranger dispose d’un contrôle effectif.
- Soit un objet d’investissement suffisamment sensible, c’est-à-dire les activités, lucratives ou non, qui :
- Constituent un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur, c’est-à-dire dont la continuité d’activité est nécessaire à la réalisation d’une portion substantielle des transactions économiques réalisées au sein de l’Union, notamment en ce qu’il s’agit d’infrastructures physiques, d’infrastructures numériques, ou de plateformes de marché, selon une liste d’infrastructures-clés (transports, énergie, télécommunication, eau, assainissement, déchets, marchés, données, système de santé, etc.). Il peut être observé que cette première branche de la définition recouvre le champ déjà conféré à l’Annexe du règlement 2019/452, en l’élargissant. Au plan conceptuel, cette notion d’élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur reprend en pratique celle des instrumentalities of interstate commerce sur lesquelles l’autorité fédérale a compétence[148] dans la jurisprudence américaine.
- Sont sensibles pour les intérêts fondamentaux d’un Etat-membre, et notamment la protection de ses activités de défense nationale, de sécurité intérieure, et la protection de sa population et de la santé publique. Cette qualification relèverait d’une procédure de saisine des Etats-membres qui seraient tenus de motiver ce caractère.
- Comportent un pouvoir de marché, direct ou indirect, sur des marchés pertinents à même d’interférer avec des éléments essentiels du fonctionnement du marché intérieur ou avec le fonctionnement des institutions politiques de l’Union. Il s’agit ici de qualifier des cibles d’investissement qui disposent d’une position dominante sur un marché et sont en mesure d’imposer leurs prix ou leurs volumes aux acteurs européens qui opèrent les éléments essentiels du marché intérieur, ce qui leur donne la capacité économique effective de les perturber indirectement. A titre d’exemple, un objet d’investissement qui aurait une position dominante sur le marché de la fourniture de câbles HVDC dispose d’un tel pouvoir de marché sur la totalité des réseaux de transport électrique européen : s’il était sous le contrôle d’un acteur hostile qui lui imposait un comportement ne résultant pas d’un pur calcul économique mais d’un choix politique, consistant à fermer ses production ou à vendre à d’autres acteurs pour pénaliser les gestionnaires de réseaux européen, il pourrait ainsi être porté atteinte au réseau électrique européen. Cette approche présente la vertu de pouvoir s’appuyer sur des notions juridiquement définies de manière très robuste, dans un ensemble de jurisprudences européennes qui remontent à 1978[149], pour ce qui est de la définition de ce qu’est un marché pertinent (à savoir le plus grand marché de produits pour lequel il existe une substituabilité du côté de la demande), et pour la définition d’une position dominante (à savoir le fait de pouvoir s’abstraire du comportement normal de marché). Cette définition permet d’apporter une définition objective de ce qu’est un fournisseur critique des infrastructures essentielles de l’Union : c’est celui qui sur un marché pertinent donné de fourniture, donc marché sur lequel ses produits ne sont pas substituables du point de vue de l’infrastructure essentielle, dispose d’un pouvoir de marché, c’est-à-dire pourrait ne pas être remplaçable par un autre à des conditions de prix et de volume « de marché ».
Les opérations d’investissement couvertes seraient toutes celles qui conduisent à un contrôle de facto, seul ou de concert, par un acteur relevant du (i) dans toute entité de l’Union OU par un acteur étranger dans une entité relevant du (ii), ce quel que soit la nature pratique de l’investissement, y compris si cette prise de contrôle découle d’évolutions de gouvernance sans changement de la structure des fonds propres, ou d’autres effets connexes à une opération financière, quelle qu’en soit la nature.
Au plan pratique, la procédure reposerait sur une saisine préalable du CIEUE par l’une des deux parties de l’opération d’investissement (l’acteur extra-européen réalisant l’investissement, l’activité européenne qui en fait l’objet) ou par l’Etat-membre dans lequel l’opération est envisagée, ou par auto-saisine de la Commission, le cas échéant sur sollicitation ou information de tiers. Afin de préserver le principe de confiance légitime et la sécurité juridique, le pouvoir d’auto-saisine pourrait être limité dans le temps à un délai de 6 mois après la publication ou découverte d’informations relatives à l’investissement.
Une fois saisi, le CIEUE disposerait, comme aux Etats-Unis, de 45 jours pour décider d’approfondir ou non le cas, avec un silence vaut refus pour ceux relevant de la catégorie (i) ET de la catégorie (ii), et sinon un silence vaut accord. Au terme de ce délai, le CIEUE pourrait s’il choisit d’approfondir, saisir les Etats-membres, par l’intermédiaire du Conseil, pour avis motivé sur l’atteinte de cet investissement à leurs intérêts politiques ou économiques fondamentaux, dans un délai de 45 jours, pendant lequel il pourrait également approfondir ses contrôles. Au terme de ce délai, le CIEUE présenterait une proposition d’avis (refus, accord, ou accord avec conditions) à la Commission, qui disposerait d’un délai de 15 jours pour prendre la décision proposée, tous délais non prorogeables, selon le régime de silence vaut accord / silence vaut refus décrit plus haut. Si un Etat-membre saisi exprime un avis de refus ou des conditions à la Commission dans le délai imparti, le CIEUE serait en compétence liée pour en tenir compte, l’avis de l’Etat-membre ne pouvant être contesté qu’en erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions du CIEUE seraient publiques après avoir été rendues, ainsi que l’ensemble des éléments communiqués aux fins d’examen dans le cadre de la procédure, en retirant les éléments commercialement sensibles, ou présentant une sensibilité particulière, notamment les renseignements susceptibles d’être transmis dans ce cadre par les Etats-membres.
Proposition 7bis : Dans une logique de réciprocité, les conditions auxquelles sont assujettis les investissements européens réalisés dans des Etats-tiers (notamment obligation d’avoir un co-investisseur de droit local à part égale, dans de nombreuses géographies sur divers secteurs) seraient appliquées de manière symétrique aux investisseurs d’Etats-tiers en Europe dans les mêmes secteurs.
En contrepartie de ce contrôle commun renforcé, seraient proscrits de manière générale les contrôles des investissements étrangers réalisés par les Etats-membres sur des investissements réalisés par des entités d’autres Etats-membres. Le fait que le régime français de contrôle des investissements étrangers en France puisse bloquer en théorie, et bloque en pratique des investissements d’autres entreprises européennes (belges, allemandes, italiennes, etc.) en France, pour des motifs de sécurité intérieure souvent discutables, mérite à bien des égards d’être contesté à l’heure où l’Union entend poursuivre son approfondissement et où les mêmes autorités françaises envisagent ouvertement d’affirmer que les intérêts vitaux de la France s’étendent à la défense de ses partenaires de l’Union. Les régimes de contrôle des investissements étrangers par les Etats-membres seraient amenés à s’inscrire dans ce cadre commun d’analyse par le CIEUE, en tant que saisine obligatoire du Comité européen s’exprimant seulement sur les intérêts essentiels nationaux (souveraineté politique nationale), les questions de protection des infrastructures essentielles et du marché intérieur (souveraineté économique) relevant exclusivement du contrôle européen.
Comme nous l’avons évoqué au début de la présente section, l’autre forme de contrôle des acteurs autorisés à participer au marché intérieur par le souverain économique porte sur le contrôle spécifique de certaines activités réglementées, compte tenu de leurs enjeux particuliers de protection du consommateur ou de garantie de l’intégrité du marché intérieur, qui sont soumises à des régimes d’encadrement ou de régulation spécifiques.
En l’espèce, l’Union comprend de nombreux régimes d’autorisation prévus dans son droit sectoriel, auxquels s’ajoutent d’autres régimes relevant de l’initiative des Etats-membres ou de la créativité de leur législateur interne. Ces régimes d’autorisation sont dans la plupart des cas confiés à des autorités nationales, qu’elles soient l’autorité exécutive des Etats-membres, voire de leurs collectivités locales et territoriales, ou celle d’autorités de régulation nationales indépendantes, dont l’existence est d’ailleurs souvent prescrite à cet effet par le droit sectoriel.
Le champ du droit de l’énergie permet de donner un éclairage sur ce choix d’organisation interne. On peut identifier, à titre d’exemple dans la directive 2019/944[150] qui organise le marché intérieur de l’électricité, trois régimes d’autorisation :
- Un régime d’autorisation pour la création de nouvelles installations de production (art. 8), laissé intégralement aux autorités nationales pour leur organisation pratique, précisant seulement que celle-ci « doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires », en tenant compte d’une liste de critères ouverte, être intégrée aux procédures d’autorisation pour l’usage des sols (autorisation d’urbanisme), et avoir une procédure publique, informant les demandeurs en cas de refus et leur ouvrant des voies de recours.
- Un régime d’enregistrement des fournisseurs, implicite dans la rédaction (art. 10 notamment), plusieurs passages de la directive indiquant que les fournisseurs doivent être enregistrés dans un Etat-membre, et que les Etats membres édictent des « règles nationales applicables en matière d’autorisation des fournisseurs. » (art. 15bis(11)).
- Un régime purement déclaratif dans lequel les fournisseurs n’ont qu’à se signaler à une autorité compétente dont le rôle se limite à en publier la liste, ce qui est la pratique dans certains Etats-membres s’agissant de la mise en œuvre des articles 10 et 15bis précités.
Selon les Etats-membres, ces régimes sont mis en œuvre de manière extrêmement disparate, ce alors que comme l’exprime le texte, ces régimes d’autorisation comportent une reconnaissance mutuelle : être autorisé à accéder au marché comme producteur dans un Etat-membre implique d’être aussi autorisé à accéder au marché dans l’ensemble de l’Union, puisque les systèmes électriques sont interconnectés et que l’électricité, comme tout bien meuble, circule librement dans le marché intérieur. De même, un fournisseur établi dans un Etat-membre peut alimenter des clients dans tout autre Etat-membre conformément à l’article 10(1).
La question de la pérennité de tels régimes d’autorisation nationale, qui en pratique n’apportent rien d’autre au marché intérieur que d’y maintenir des fragmentations indues par des procédures hétéroclites, différentes d’un Etat-membre à l’autre, mérite d’être posée, ce d’autant que les exigences techniques pour ce qui est du fonctionnement pratique des installations de production et de leur raccordement sont largement harmonisées par les codes réseaux coordonnés par l’ACER, et qu’il est pour ce qui est de la fourniture difficile de justifier qu’alimenter des consommateurs français soit une activité qui mérite beaucoup plus de précautions et de diligences que l’alimentation d’un consommateur belge ou allemand, au point de justifier une procédure d’autorisation lourde et complexe dans un Etat-membre, et une procédure purement déclarative dans un autre.
Certes, il existe des Etats-membres qui ont choisi de mettre en œuvre des régimes de fourniture de secours (en cas de défaillance économique du fournisseur) ou de fourniture de dernier recours, qui emportent une forme de solidarité publique, et justifient un contrôle de l’absence de « passager clandestin » et du respect par les fournisseurs d’un niveau de risque économique maximal. Mais rien ne justifie que ces exigences minimales ne soient pas harmonisées.
Proposition 8 : Proscrire la création de nouvelles régulations nationales sur le format d’autorisations d’exercer une activité sur un marché donné lorsque le marché en cause n’est pas national mais européen, et pour les régimes existants, engager un travail d’harmonisation visant à unifier ces régimes, à terme sous un régime de police administrative unique, confié aux autorités nationales par délégation du niveau européen et sous son autorité fonctionnelle exécutive directe.
Dans le même temps, la question d’un rapprochement graduel des autorités de régulation nationales indépendantes des différents secteurs (CRE en énergie, ART en transports, etc.) ou ayant trait au contrôle de marchés (Autorité de la Concurrence, AMF, CRE), aujourd’hui d’organisation différenciées, et parfois combinées à une autorité indépendante de niveau européen (ACER en énergie) méritera d’être posée. Elle pourrait évoluer vers un schéma dans lequel les formats organisationnels des autorités administratives indépendantes sectorielles seraient harmonisés (structure des collèges, moyens humains, champs des missions, etc.), les budgets en dotation directe du budget de l’Union, et où celles-ci seraient in fine rattachées fonctionnellement aux autorités indépendantes de niveau européen (ACER en énergie, etc.). Dans le cas des autorités des marchés, la question de la fusion des autorités des marchés financiers sera inéluctablement posée si l’union des marchés de capitaux doit être engagée comme proposé dans le rapport Draghi : le cas échéant, une structure conservant des autorités nationales placées sous un cadre de coopération européen largement renforcé et une organisation commune, pourrait être considérée.
Définir quels biens et services participent au marché intérieur
L’autre attribut de souveraineté économique relatif à la participation au marché intérieur est celui de pouvoir décider des biens et services autorisés à être mis en marché sur le marché intérieur. L’Union dispose en la matière d’une capacité normative très forte, qu’elle a largement mise en œuvre depuis plusieurs décennies, et ce tout particulièrement dans le champ environnemental et de la lutte contre le changement climatique – même si nous avons vu qu’elle a aussi commencé à y avoir recours dans le champ de la protection des droits de l’homme[151]. Comme tout souverain économique, l’Union décide de quels produits sont admis sur son marché, et fixe pour cela des prescriptions visant à atteindre les objectifs de politique publique sectoriels qu’elle s’assigne.
On peut citer plusieurs exemples de telles réglementations, dans le champ de la transition énergétique et de l’action climatique que nous avons pris comme fil conducteur de cette analyse. Un premier exemple est celui du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières[152] (MACF), instrument règlementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l’Union Européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits, avec pour objectif de lutter contre les fuites de carbone, dans un contexte de renforcement de l’ambition climatique au niveau européen. Ce mécanisme vient en pratique s’assurer, pour les produits pilotes (acier, aluminium, ciment, engrais azotés, hydrogène, électricité) que tout produit mis en marché sur le marché intérieur européen a acquitté un prix du carbone correspondant aux émissions réelles associées à sa production, qu’il ait ou non été produit au sein de l’Union[153]. Un des principaux atouts du MACF est son caractère proliférant : en effet, pour un partenaire commercial de l’Union, mieux vaut aligner sa politique climatique sur celle menée au sein de l’Union et créer dans son marché intérieur une tarification du carbone à un prix équilibré avec le prix du carbone sur le marché européen, pour maintenir dans son marché national les ressources utiles à la décarbonation, plutôt que d’émettre des gaz à effet de serre et devoir s’acquitter d’un paiement à la frontière lorsque ses produits sont exportés vers l’Europe. Cet effet a conduit ainsi plusieurs partenaires commerciaux clés de l’Union (République Populaire de Chine, Turquie, Japon, Corée du Sud) à envisager ou à déployer des politiques de tarification du carbone, et concourt – sous réserve d’approfondissement et de correction de certains défauts du MACF – à l’amplification de l’action climatique mondiale par « effet tache d’huile » au sein du commerce international.
Un second exemple est celui du règlement méthane[154], qui vise à assurer la réduction des fuites de méthane du secteur de l’extraction fossile : compte tenu du pouvoir réchauffant vingt-cinq fois plus élevé du méthane que du dioxyde de carbone, la lutte contre celles-ci est un enjeu clé dans la lutte contre le changement climatique. Comme l’Union ne pèse qu’une partie minime de l’exploitation pétrolière et gazière dans le monde, et qu’elle est importatrice structurelle de la presque totalité des hydrocarbures qu’elle consomme, apporter des contraintes sur sa seule production domestique aurait été d’un effet très limité. Dans cette logique, le règlement prévoit à ses articles 27, 28 et 29 des exigences portant sur les importateurs de gaz naturel, de pétrole brut et de charbon au sein du marché intérieur en matière de transparence et de partage d’informations sur la performance émissive de leurs produits, sur la bonne mise en œuvre de mesures de surveillance, de déclaration des fuites, et de vérification pour lutter contre les fuites de méthane, selon des standards équivalent à ceux appliqués aux exploitants pétroliers, gaziers, et houillers de l’Union, et sur le respect à partir d’août 2030 d’intensités de méthane (taux de fuite de méthane) inférieures à des valeurs plafond, ce quel que soit le pays d’origine des hydrocarbures importés. Ces mesures, qui comportent elles-aussi un élément d’extraterritorialité, plus assumé que pour le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières, ont eu un effet indéniable sur les pratiques du secteur pétrolier et gazier chez nos principaux partenaires commerciaux, et à ce jour, si le principe en demeure contesté politiquement et fera l’objet de tensions transatlantiques avec la nouvelle administration américaine[155], aucun expert ne remet en cause leur effectivité ou leur pertinence climatique[156].
Enfin, un dernier exemple peut être cité à travers les critères de durabilité de la biomasse et de prévention de la déforestation importée, qui fonctionnent selon une mécanique comparable par laquelle la mise en marché de certains produits pour l’essentiel importés dans le marché européen est soumise à démonstration – par des certifications indépendantes – du respect de certaines caractéristiques environnementales. Ces critères ne sont pas opposables à la mise en marché de ces produits, mais à leur comptage dans l’atteinte des objectifs d’énergie renouvelable assignés par la directive aux Etats-membres. L’article 29 de la directive RED 2[157] précise ces règles et exclut (art. 29(3)) les carburants issus de « terres de grande valeur en termes de diversité biologique », notamment les « forêts primaires et autres surfaces boisées primaires », les « forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité », les zones protégées, les prairies naturelles, mais aussi les terres « présentant un important stock de carbone », telles que les zones humides ou zones forestières continues. Enfin, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière qui sont pris en compte ne peuvent venir que d’Etats parties à l’Accord de Paris, qui ont démontré une contribution nationalement déterminée tenant compte du secteur agricole, sylvicole et d’usage des sols, et disposent de politiques publiques nationales dédiées. Ce cadre se différencie des premiers en cela qu’il ne porte pas sur la performance environnementale de tout produit mis en marché en Europe mais sur la performance environnementale de ceux parmi ces produits qui sont administrativement reconnus pour des obligations pesant sur les Etats-membres – à savoir des mandats d’incorporation pour lesquels la pratique actuelle parlerait de green leads – et en cela qu’il comporte une mention explicite de politiques publiques et de choix d’adhésion à des traités internationaux par des Etats-tiers pour autoriser l’éligibilité de leurs produits à certains mécanismes du marché intérieur européen.
De manière très intéressante, ce cadre a été contesté par l’Indonésie dans un panel OMC. Le 10 janvier 2025, l’OMC a confirmé la validité des mesures climatiques adoptées par l’Union européenne dans un différend opposant celle-ci à l’Indonésie concernant les importations de biodiesel[158]. Ce contentieux portait sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposés par l’UE dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables. L’Indonésie arguait que ces règles constituaient une discrimination injustifiée contre ses exportations, notamment celles issues d’huile de palme. Le panel de l’OMC a jugé que les mesures de l’UE étaient justifiées au regard des exceptions environnementales prévues à l’article XX du GATT. Celui-ci permet en effet en application de ses articles (b) et (g) aux membres de l’OMC d’adopter des mesures incompatibles avec les disciplines du GATT mais nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux (paragraphe b)), ou se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables (paragraphe g)), et c’est au titre de ce dernier que l’Union européenne défend la compatibilité OMC des mesures environnementales qu’elle a pu instituer telles que celle précitée ou encore le MACF. Cette décision historique est venue affirmer que de telles politiques climatiques ambitieuses peuvent être compatibles avec les règles de l’OMC, à condition qu’elles soient proportionnées et non discriminatoires, constituant un précédent significatif pour les futures politiques européennes en matière de durabilité et sur leur pleine intégration dans un cadre commercial international ouvert.
Proposition 9 : Faire une utilisation stratégique des règles d’accès au marché intérieur pour conduire nos partenaires vers nos politiques publiques sans en faire des outils protectionnistes pour autant.
Les trois cas précités illustrent comment la force du marché intérieur européen peut permettre de les utiliser pour assurer l’alignement de nos partenaires commerciaux sur des politiques publiques de l’Union qui ne peuvent reposer que sur la seule action au sein du marché intérieur. L’action climatique est un excellent exemple d’une telle politique publique où l’action européenne sur le seul sol européen ne peut répondre de manière pleinement satisfaisante à l’enjeu, et se dissiperait en tout état de cause dans des distorsions de concurrence inacceptables avec les produits importés (fuites de carbone). La consécration en janvier 2025 par l’OMC dans le panel indonésien précité du fait que des restrictions climatiques en termes de performance environnementale des produits reconnus pour des politiques publiques à finalité environnementale pouvaient être instituées y compris pour des produits importés en application de l’article XX du GATT ouvre la possibilité, de manière générale, d’impartir de telles règles d’accès, de manière plus générale, au marché intérieur européen, comme l’Union a commencé à le faire avec le MACF et le règlement Méthane. L’utilisation stratégique de ces règles d’accès sera dans la durée un outil clé pour amener nos partenaires commerciaux à des niveaux de performance environnementale qui ne sont pas seulement bénéficiaires aux européens mais bien à au monde entier. De ce fait, il est important de rappeler que de telles mesures ne peuvent être considérées être protectionnistes, dans la mesure où elles ont des effets positifs, et créent du surplus, de part et d’autre de la frontière, une fois que les externalités négatives climatiques sont bien prises en compte dans le calcul économique.
Pour y parvenir efficacement, l’Union devra veiller à en faire une utilisation stratégique. Qu’est-ce à dire ? Il s’agit tout d’abord d’utiliser ces mesures appliquées aux produits importés comme locaux lorsque l’Union a un poids dans les échanges internationaux suffisant pour rendre inévitable, pour ses partenaires commerciaux, de se mettre à niveau pour rester dans la course : les importations fossiles de l’Union sont à cet égard d’ampleur suffisante pour l’espérer à travers le règlement méthane, comme celles de biocarburants liquides. Il s’agit ensuite de les utiliser lorsqu’il n’existe pas de voies de contournement de la mesure par les secteurs aval, et lorsque le surcoût de la conformité s’applique bien aux consommateurs finaux de l’Union au premier titre, et non à des activités aval européennes en concurrence mondiale, comme l’illustre a contrario le cas très problématique des secteurs aval du MACF[159]. Il s’agit enfin de les mettre en œuvre lorsque la bascule d’un ou plusieurs partenaires commerciaux de l’Union, facilitée par une adhésion politique de leur part aux mêmes enjeux climatiques ou environnementaux – et parfois par une politique de la « main tendue » commerciale de la part de l’Union, comme pourrait l’être l’accord UE-Mercosur – permettrait ensuite par effet boule de neige d’obtenir une bascule de l’ensemble des politiques publiques à l’échelle mondiale. Jouer sur cet effet d’entraînement, et le favoriser, sera clé pour assurer la diffusion des politiques publiques européennes qui ont une portée mondiale, au premier titre desquelles les politiques publiques environnementales, à travers ce type de mesures.
A l’inverse, ces critères définissent en creux des clés de conception de telles mesures par le souverain économique, s’agissant des produits les plus pertinents pouvant être couverts par des green leads européens (mandats d’incorporation au niveau du produit fini), du soin devant être accordé à l’absence de contournements aval ou par effets de substitution, et de l’attention à porter à l’équilibre de nos partenaires commerciaux et à la capacité à les amener à des politiques comparables aux nôtres.
En réalité, établir de telles conditions d’accès au marché européen, et en assurer l’effectivité par des contrôles réels est bien souvent le compagnon indissociable des politiques de soutien à des filières de production européennes – qu’elles soient d’ailleurs des politiques sectorielles (Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) batteries, PIIEC hydrogène, etc.) visant à développer des acteurs européens de chaînes de valeur identifiées, souvent sur des équipements à contenu technologique jugés « stratégique »[160], ou des politiques transversales (action climatique et soutien à la décarbonation de l’industrie en général, par exemple, via l’InnovationFund européen). En effet, les tentatives de soutien à des filières ou à des efforts spécifiques de l’industrie européenne se dissipent dans la concurrence internationale s’il n’existe pas, en miroir de ce que ces soutiens amènent comme évolutions des choix économiques à l’amont des chaînes de valeur, une demande spécifique de produits « verts » ou présentant les caractéristiques souhaitées en bas des chaînes de valeur, du côté de la demande finale. C’est là que se situe l’intention exprimée dans le Clean Industrial Deal[161] de développer des « green leads », c’est-à-dire des mandats d’incorporation de produits « verts » ou « bas carbone » au niveau des consommateurs finaux publics comme privés. De telles incitations existent notamment dans le champ des batteries[162], où en conjonction des soutiens en capital au développement d’usines de batteries en Europe coordonnés dans le PIIEC batteries depuis 2019[163] sont inscrits des objectifs croissants de performance carbone en cycle de vie des batteries mises en marché en Europe (art. 7).
Mais pour trouver toute son efficacité, cette politique doit se prémunir de toute torsion protectionniste : c’est dans une communauté d’objectifs et de principes de construction avec les incitations portées à l’amont que doivent s’inscrire les mandats d’incorporation à l’aval. En effet, si les mandats portaient sur des critères explicitement ou implicitement protectionnistes, et non sur des critères environnementaux, ils prêteraient immédiatement à l’application de mesures réciproques chez nos partenaires commerciaux, au détriment de l’efficacité globale d’allocation des ressources et de création de surplus économique. En les faisant reposer sur des objectifs environnementaux, alignés avec les objectifs poursuivis par les mesures de soutien au niveau des productions en amont des chaînes de valeur, le principe de réciprocité évoqué plus haut trouve tout son sens : si nos partenaires commerciaux répliquent la mesure – et ils en sont tout à fait libres – l’objectif environnemental européen aura prospéré de part et d’autre de la frontière, garantissant l’atteinte efficiente de l’objectif à l’échelle globale.
Exécuter les règles de marché dans le marché intérieur : quelle extraterritorialité pour l’Europe ?
Nous avons vu plus haut qu’à mesure que s’intensifient et se complexifient les contrôles devant être menés aux frontières de l’Union pour appliquer pleinement une politique commerciale plus raffinée et à même de répondre aux défis de réciprocité posés par le jeu non-coopératif de certains partenaires commerciaux structurants, il sera nécessaire de rehausser les moyens dont disposent les services douaniers de l’Union, et graduellement, d’envisager d’en harmoniser encore davantage le fonctionnement, d’en unifier les procédures, la structure hiérarchique, et les moyens transverses de recherche et de renseignement. La question pourra également être posée de se doter des moyens d’une politique pénale unifiée, franchissant un pas nouveau en complétant le Parquet Européen déjà existant depuis 2017 pour le doter d’une juridiction pénale et de dispositions pénales douanières harmonisées.
A l’intérieur des frontières du marché commun européen, le renforcement, cohérent avec le développement des politiques publiques européennes, de règles d’accès au marché pour les biens et services reposant sur des critères environnementaux – ou sociaux – de plus en plus complexes, tels que des mandats d’incorporation ou green leads, le même enjeu d’harmonisation des pratiques de contrôle, d’homogénéité des moyens, et d’unité des politiques répressives, tant sur les règles pénales que sur les juridictions compétentes et les voies de recours, deviendront peu à peu indispensables. De même, à mesure que seront harmonisées les règles d’accès au marché européen pour des investisseurs tiers, l’enjeu d’unité de l’action répressive se fera également croissant. Ce, d’une part pour éviter que des contrevenants arbitrent entre les différents Etats-membres pour choisir où mettre en marché les produits dans les conditions les moins contrôlées ou selon les règles les plus favorables, risque qui s’accentuera à mesure que – comme nous le proposons plus haut – seront réduites les barrières internes à la libre circulation et que les marchandises – ainsi que les certificats sur leurs propriétés environnementales ou sociales – circuleront sur l’ensemble du marché intérieur sans frictions. D’autre part également, pour des raisons plus principielles, car il n’existe aucune raison pour laquelle le contrôle des règles d’accès et de participation au marché instituées pour le respect de politiques publiques communes, définies au niveau européen, et appliquées à des biens ou des services ou des capitaux circulant sur un marché commun, ne relèvent pas de la mise en œuvre exécutive d’une souveraineté économique commune : c’est là un enjeu de responsabilité de l’autorité européenne, qui doit veiller à fixer des règles que son propre exécutif soit capable de contrôler – sans quoi il serait aisé de fixer des règles complexes qui méconnaitraient les questions pratiques de contrôlabilité opérationnelle.
Sur un plan principiel toujours, il peut en outre être observé que cela constituerait une extension naturelle du champ de compétences déjà dévolu au Parquet européen dans le règlement 2017/1939[164] sur le mode de la coopération renforcée et la directive 2017/1371 s’agissant de l’harmonisation des règles de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union[165]. Jusqu’à présent, l’harmonisation pénale, la constitution d’un parquet commun, l’European Public Prosecutor Office se sont concentrés sur les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, c’est-à-dire les fraudes et détournements relatifs à ses marchés publics, à ses recettes issues de ressources propres, notamment les droits de douane ou la TVA. Mais s’il existe une souveraineté économique commune, ses intérêts fondamentaux, en tant que collectivité, dépassent ses seuls intérêts financiers et doivent aussi inclure les intérêts relatifs à ses politiques publiques communes, en ce qu’elles ont pour support des biens, des services, des certificats en libre circulation qui matérialisent ces politiques, et plus généralement les intérêts économiques fondamentaux, c’est-à-dire la garantie de l’intégrité du marché intérieur et du respect des règles d’accès et de participation audit marché. Il serait en particulier étrange de ne faire relever d’un cadre pénal commun que les atteintes douanières, comme cela est déjà le cas via 2017/1939 (en coopération renforcée) mais pas des atteintes ou des fraudes portant sur les conditions de mise en marché de biens ou services sur le marché intérieur européen, dès lors que ces conditions relèvent du droit européen d’application directe (règlement sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, règlement batteries, règlement REACH, etc.) ou présentent des enjeux d’harmonisation très marqués. Cela est d’ailleurs pleinement dans l’esprit du Traité, qui permet en son article 83(2) « Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation, [à] des directives [d’] établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation en question, sans préjudice de l’article 76. ».
La souveraineté recouvre la définition de ce qui participe ou non au marché intérieur, et implique donc de pouvoir assurer l’effectivité du contrôle des règles qui sont applicables en la matière, sur un plan exécutif et judiciaire, et non seulement la fixation des règles.
Proposition 10 : Se doter des capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre les règles communes d’accès aux marchés : vers une police et une justice européennes communes relatives aux atteintes à l’intégrité du marché intérieur pour ce qui est des fraudes aux règles harmonisées de mise en marché des biens et des services, comme des fraudes au régime de contrôle des investissements étrangers en Europe.
- Proposer aux Etats-membres qui le souhaitent un transfert de leurs services de contrôle compétents et des capacités de police judiciaire associés à un statut européen, un financement européen, et un régime de police administrative et pénale européen sous l’autorité directe de la Commission.
- Poursuivre les transferts de compétence déjà engagés depuis 2017 au plan pénal vers le Parquet européen en le complétant d’un cadre européen d’infractions pénales douanières et d’une juridiction pénale européenne dédiée.
Dotée des moyens d’une police et d’une justice communes pour l’application de sa politique douanière et commerciale commune, et pour la garantie de l’intégrité du marché intérieur, c’est-à-dire du respect des règles d’accès et de participation au marché intérieur, l’Union disposerait enfin, dans le seul champ de sa souveraineté économique – puisque les éléments politiques et régaliens de la souveraineté demeureraient le fait des Etats-membres et donc de leurs exécutifs et juridictions nationaux – de moyens exécutifs et judiciaires propres réels, qui ne se limiteraient pas – comme c’est aujourd’hui le cas pour l’essentiel – à un exécutif normatif et à une justice administrative supranationale. L’Union dotée de la plénitude des moyens pratiques d’un exécutif et d’une justice pénale pourrait entreprendre ce dont le manque béant a pu être constaté au cours des trois dernières années, à savoir l’imposition de sanctions véritables sur les tiers qui portent atteinte à ses intérêts fondamentaux, en ayant la pleine capacité de placer directement et efficacement sous embargo ou sous sanctions des personnes et des entreprises, voire des Etats-tiers hostiles, si cela est dans son intérêt souverain : elle pourrait le faire par ses moyens propres, et pourrait veiller au respect de ces mesures répressives en menaçant en retour de mesures répressives de même nature les personnes physiques ou morales européennes ou ayant des intérêts économiques européens qui continueraient à opérer des transactions avec des entités sanctionnées.
Cette question posera en retour celle des règles de territorialité applicables à ces infractions. La situation ne manquera pas de se présenter où un acteur économique tiers aura agi dans le marché intérieur européen en y mettant en marché des biens ou des services de manière frauduleuse, par exemple sans respecter les règles d’accès au marché imposées par le droit de l’Union harmonisé, ou aura réalisé au sein de l’Union un investissement sans se conformer aux prescriptions imposées dans le cadre du screening par le CIEUE (voir Proposition 7) ou sur la base d’informations frauduleuses, sans qu’il soit possible de lui appliquer de sanctions effectives, car le centre de ses intérêts économiques comme de ses décideurs se situerait hors Union. Il paraît dans ces circonstances pertinent, toujours dans la même logique de réciprocité qui anime cette section du présent rapport, d’envisager d’appliquer aux Etats tiers qui appliquent des régimes extraterritoriaux aux personnes physiques ou morales de l’Union dans leur appréciation de la commission d’infractions, qu’en symétrique la même extraterritorialité soit appliquée à leurs personnes physiques ou morales si elles commettent des atteintes à l’intégrité du marché intérieur et plus généralement aux intérêts économiques de l’Union.
Proposition 11 : Se doter de moyens de sanction en assumant une compétence extraterritoriale sur ces infractions aux personnes physiques ou morales d’Etats-tiers qui appliquent eux-mêmes des régimes extraterritoriaux aux personnes physiques ou morales européennes.
3.3 Assurer le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur
Au-delà du rôle de contrôle des participants admis au marché intérieur, et des biens et services qui peuvent y être échangés, dans des conditions cohérentes avec les autres objectifs de politique publique qu’il porte, le souverain économique a également vocation à assurer la régulation des comportements de marché, tant par son rôle de surveillance des marchés, que par le rôle de contrôle des abus de marché, c’est-à-dire de l’ensemble des comportements qui éloignent les résultats des processus concurrentiels de ceux qui auraient lieu, en prix, en volume, et dans l’ensemble des propriétés des transactions, dans une situation de concurrence libre et non faussée.
Ce rôle de contrôle concurrentiel, de prévention des abus de marché, est au cœur du projet européen, tout particulièrement dans la mesure où il constitue une compétence propre de la Commission européenne, à bien des égards sa principale compétence propre – avec le contrôle des aides d’Etat. Il mérite, dans le contexte actuel, d’être pensé en partant de trois constats principaux. Le premier est qu’il n’existe pas de différence de nature entre l’effet d’un acteur en position dominante sur le marché intérieur européen qui abuse de cette position dominante, et capte au détriment du surplus collectif une rente pour servir ses intérêts propres, et l’effet d’un Etat-tiers qui par des interventions, de quelque nature que ce soit, agit sur l’économie de l’Union en manipulant les prix auxquels il échange des biens ou des services, ou les volumes dans lesquels sont disponibles ces biens ou services à des fins de pression politique ou de captation de valeur économique. Dit autrement, il n’existe pas de différence de nature entre ce que fait à l’économie européenne Gazprom en manipulant les réservations de capacité de stockage de gaz[166] ou l’utilisation des gazoducs ou en limitant artificiellement ses volumes livrés pour tirer vers le haut les prix en Europe et fragiliser l’économie européenne, et ce que font les acteurs chinois du photovoltaïque lorsqu’ils coordonnent ouvertement leurs volumes de production[167], d’export vers l’Europe, et leurs prix avec pour effet de rendre de facto impossible l’émergence d’une filière européenne. Dans les deux cas, il est permis de présumer que ces comportements anticoncurrentiels ou distorsifs ont lieu a minima avec l’assentiment tacite de leurs autorités nationales, mais il est difficile de le démontrer. Les abus de position dominante réalisés par des acteurs, européens ou extra-européens, ont le même effet, et se situent simplement sur un spectre d’implication plus ou moins ouverte de leurs autorités nationales. Il n’existe pas de différence entre les dommages portés au marché intérieur par une position dominante non régulée ou contrôlée pour en aligner le comportement avec les objectifs du souverain économique, et ceux que peut porter sur le marché intérieur un souverain économique externe qui nous soit hostile. Bien souvent d’ailleurs, les positions dominantes ou la constitution de cartels sont un outil d’intervention et de pression des souverains économiques sur d’autres : l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) en est un des exemples les plus manifestes.
Un second constat, exactement symétrique du précédent, est le suivant, exprimé récemment par A. Orain dans les colonnes du Monde : « Une […] réalité, qui reste dans l’ombre tant qu’on raisonne à partir du concept de « néolibéralisme » est l’importance croissante d’un capitalisme de monopole. Il existait évidemment de grandes entreprises à l’époque néolibérale, mais les Etats tentaient, grâce aux lois antitrust, de leur imposer un environnement concurrentiel. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’autre fait nouveau, c’est que ces grandes entreprises revendiquent certaines des prérogatives du pouvoir régalien. »[168] A l’heure où des acteurs disposant de positions dominantes sur des pans entiers de l’économie mondiale – en particulier dans le secteur numérique – se sont constitués, ceux-ci disposent, de plus en plus, de pouvoirs interférant avec ceux du souverain politique, par extension naturelle de la souveraineté économique de facto que leur confère leur rôle considérable dans les échanges mondiaux et la relative impuissance – ou la faible volonté – des autorités de concurrence à agir pour assurer l’équilibre concurrentiel des marchés sur lesquels elles interviennent.
Un troisième constat est que si l’on a historiquement pensé l’abus de position dominante comme une intervention coordonnée sur les conditions d’offre ou de demande sur un marché de biens ou de services visant à extraire une rente du pouvoir de marché dont dispose un acteur, il n’existe pas de différence économique de fond entre l’abus réalisé par celui qui est en position dominante pour fournir un bien, et l’abus informationnel réalisé par celui qui dispose d’une information avant les autres participants de marché et l’utilise pour en tirer indûment une valeur. On peut dire ainsi que l’essentiel des abus de marché (délit d’initié, etc.) ne sont jamais que des abus de position dominante sur le marché de l’information de marché. Dès lors, les rôles de police des marchés, de prévention des abus informationnels, qui relèvent en Europe dans le cadre notamment de la directive 2014/65/UE dite « MIFID II »[169] et du règlement 2011/1227 « REMIT »[170], ne sont jamais qu’in fine une forme particulière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles.
L’Union est dotée d’une large compétence, confiée à la Commission pour la répression administrative des positions dominantes sur les marchés de biens et de services, qu’elle a exercée avec diligence depuis la création du marché intérieur. Elle ne dispose pas de capacités pénales associées qui permettraient, outre la réparation du dommage porté au marché intérieur, un effet dissuasif sur ceux qui entendent en commettre, seuls ou de concert, par des pratiques abusives. Et, à ce jour, elle n’est pas outillée pour le faire au moyen de services d’enquête, d’un parquet européen compétent ou d’une juridiction pénale à même de juger de ces infractions.
A partir des années 1970[171], la Cour de Justice des Communautés Européennes – aujourd’hui Cour de Justice de l’Union Européenne – a graduellement consacré le principe d’une portée extraterritoriale de cette compétence, qui permet à la Commission d’agir, et de réprimer par les outils qui lui sont conférés aux articles 101 et 102 du Traité, y compris sur des abus ou des ententes constituées en dehors de l’Union, même par des entreprises qui ne sont pas établies dans le marché intérieur, pour peu que cela ait des effets substantiels sur le marché intérieur. Il est d’ailleurs très intéressant de noter que l’argumentaire développé par la Cour dans l’arrêt de 1988 qui a stabilisé la doctrine actuelle, l’arrêt Ahlström[172], ce qui fonde la compétence extraterritoriale de la Commission est qu’en tant qu’espace de souveraineté économique – le terme n’est certes pas employé mais c’est bien le raisonnement déployé dans notre première partie – elle est fondée à agir pour prévenir toute atteinte qui a des effets sur le marché intérieur qu’elle protège, ce sans qu’il soit besoin de démontrer que cette atteinte a été commise ou coordonnée dans une certaine territorialité.
Le sens de ces conclusions sera en bonne mesure repris dans l’arrêt Intel[173] en 2017 : « Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé sa compétence territoriale pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE aux pratiques mises en œuvre à l’égard d’Acer et de Lenovo, le Tribunal a, tout d’abord, estimé, au point 244 de l’arrêt attaqué, que, pour justifier la compétence de la Commission au regard du droit international public, il suffisait d’établir les effets qualifiés de la pratique ou la mise en œuvre de celle-ci dans l’Union européenne. Il a ensuite jugé, au point 296 de l’arrêt attaqué, que les effets substantiels, prévisibles et immédiats que le comportement d’Intel était susceptible de produire au sein de l’Espace économique européen (EEE) permettaient de justifier la compétence de la Commission. Enfin, à titre surabondant, il a considéré, au point 314 de l’arrêt attaqué, que cette compétence était également fondée en raison de la mise en œuvre du comportement en cause sur le territoire de l’Union et de l’EEE. ». Il suffit donc que ces effets soient prévisibles, immédiats et substantiels, pour que la Commission ait autorité, et cela est clairement établi dans une jurisprudence constante.
Cette doctrine de la Cour pour le marché européen reprend étroitement la doctrine américaine de la Cour Suprême, dite doctrine des effets, qui pose comme sanctionnable au titre du Sherman Act toute pratique anticoncurrentielle même commise ou mise en œuvre depuis l’extérieur de l’Union pour peu qu’elle ait un effet substantiel sur le commerce ou les consommateurs américains. Dans l’arrêt Hartford Fire[174] (1993), la Cour Suprême affirme et clarifie cette doctrine, rappelant que « the extraterritorial reach of the Sherman Act-has nothing to do with the jurisdiction of the courts. It is a question of substantive law turning on whether, in enacting the Sherman Act, Congress asserted regulatory power over the challenged conduct. […]There is no doubt, of course, that Congress possesses legislative jurisdiction over the acts alleged in this complaint: Congress has broad power under Article I, § 8, cl. 3, « [t]o regulate Commerce with foreign Nations, » and this Court has repeatedly upheld its power to make laws applicable to persons or activities beyond our territorial boundaries where United States interests are affected. ».
Pour autant, la Commission, et plus généralement l’Union, ne dispose aujourd’hui pas de la capacité effective à réprimer ces abus portés depuis l’extérieur de l’Union, si les autorités nationales du pays de commission de l’atteinte ne sont pas coopératives, ce qui est en général le cas. La solution la plus probante serait d’envisager de la doter, dans la continuité des compétences de police pénale, et de sanctions pénales que nous avons envisagées plus haut, de la possibilité de confier à la Commission européenne au titre de ses fonctions de police de la concurrence européenne d’un ensemble de sanctions pénales et de moyens répressifs, dirigés non seulement vers les entreprises commettant les infractions mais également vers les personnes physiques ayant joué dans ce cadre un rôle décisionnel.
Proposition 12 : Dans la continuité des propositions 6 et 10, permettre à la Commission européenne de transmettre des dossiers pénaux contre les personnes ayant commandité ou participé à des atteintes anticoncurrentielles ayant des effets substantiels sur le marché intérieur au Parquet européen, créer des infractions pénales communes dédiées, et confier à une juridiction pénale commune européenne la compétence pour en juger.
Concernant les abus informationnels (délit d’initié, manipulation de cours, etc.), il convient en outre d’observer que l’Union n’est pas dotée d’une compétence harmonisée, celle-ci étant laissée à diverses autorités de surveillance des marchés nationales. Le rapprochement graduel des marchés de capitaux, leur développement, la complexité croissante des outils et des opérations de marché qui y sont réalisées, viendra inéluctablement poser la question d’une pleine harmonisation de la compétence de surveillance des marchés en Europe sous une autorité unique de contrôle des marchés européenne.
Proposition 13 : Se doter d’une autorité unique de surveillance des marchés, renvoyant l’instruction au Parquet européen sous une compétence pénale unique, dotée d’une juridiction unique, conséquence logique de l’Union des marchés de capitaux.
En conclusion de ce développement, une dernière remarque doit être faite. Les abus de marché informationnels existent également sur l’interface entre souveraineté politique et souveraineté économique (prise illégale d’intérêt, etc.). Il serait logique par conséquent que la répression des atteintes à la probité politique puisse relever d’une compétence pénale commune et d’une juridiction commune indépendante, dès lors qu’ils ne sont qu’une forme des abus de marché, où la position politique d’un acteur lui permet de distordre des résultats de marché en sa faveur. L’Office de Lutte Antifraudes est déjà doté de la capacité d’enquêter sur ce type d’infractions mais doit ensuite renvoyer à des juridictions nationales pour leur sanction. La même cohérence conduirait à les renvoyer devant les mêmes juridictions.
3.4 Agir directement dans le marché intérieur
Le dernier attribut du souverain économique que nous explorerons ici est de pouvoir participer directement au marché. Cette participation directe au marché s’exerce par deux voies : les aides d’Etat ou la prestation directe de services dans le marché intérieur d’une part, et la politique d’achat du souverain économique pour ses propres besoins.
Les aides d’Etat et les SIEG
Concernant tout d’abord les aides d’Etat, il convient de souligner la profonde différence entre le cadre européen et tous les autres cadres de souverains économiques fédéraux. L’Union exerce, par les articles 107 et 108 du Traité, un contrôle étroit sur les aides d’Etat accordées par les Etats-membres à leurs acteurs économiques, pour prévenir les distorsions du marché intérieur. Cela est cohérent avec la théorie de la souveraineté économique que nous avons développée dans la première partie, par laquelle ne peuvent être tolérées que des interventions d’institutions internes au souverain qui tendent vers la réalisation des objectifs qu’il poursuit, et c’est bien ainsi qu’est construit le cadre européen des aides d’Etat. Le même contrôle vaut aux Etats-Unis, par la clause de commerce que nous avons également décrite plus haut. Mais la différence fondamentale est qu’en Europe, ce contrôle est exercé a priori par l’exécutif commun européen, la Commission européenne, dont cette compétence de contrôle constitue un des leviers majeurs d’action sur les Etats-membres, tandis que dans le cadre américain – comme dans tous les autres cadres fédéraux qui aient pu être analysés dans le cadre de ce travail – ce contrôle est exercé a posteriori, et jamais par l’exécutif fédéral mais par les juridictions où les acteurs lésés sont libres de porter leurs griefs.
Si nous approfondissons le fonctionnement du cadre européen, il peut tout d’abord être relevé que les activités couvertes par les dispositions du traité relatives aux aides d’Etat sont appréciées de manière large et recouvrent « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement [175] ». La notion d’activité économique est définie comme « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné[176] ».
La Cour refuse de qualifier d’économique une activité qui ne consiste pas à offrir des biens ou des services sur un marché. Par ailleurs, l’absence totale de marché (« au sens d’une offre et d’une demande portant sur les biens ou services en cause ») semble suffisante pour écarter la qualification d’activité économique[177].
La notion d’avantage recouvre de même un spectre très diversifié. La Commission retient que les « subventions, exonérations d’impôts et de taxes, exonérations de taxes parafiscales, bonifications de taux d’intérêt, garanties de prêts consenties dans des conditions particulièrement favorables, cessions de bâtiments ou de terrains à titre gratuit ou à des conditions particulièrement favorables, fournitures de biens ou de services à des conditions préférentielles, couvertures de pertes d’exploitation ou toute autre mesure d’effet équivalent » peuvent constituer des aides d’État[178]. La jurisprudence a en outre établi qu’outre les aides directes (subventionnelles), les avantages consentis par des autorités publiques, sous des formes diverses, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions, peuvent s’entendre comme « non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais aussi des interventions qui allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, sans être des subventions au sens strict, sont de même nature et ont des effets identiques[179] ».
Pour mémoire, une aide d’Etat se définit par quatre critères cumulatifs :
- Aide octroyée au moyen de ressources publiques : Ce premier critère est apprécié de manière très large par la jurisprudence : en pratique toute intervention financière d’une entité publique, voire tout transfert économique résultant d’actions directes ou indirectes des pouvoirs publics est susceptible de respecter ce critère. En particulier, l’arrêt Steinike[180] a introduit le principe selon lequel « l’article 87 englobe les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’aide est accordée directement par l’État ou par des organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne en vue de gérer l’aide ». Lorsque l’aide est octroyée par une entreprise publique, il n’y a pas de présomption automatique de ressources publiques pour l’appréciation du statut comme aide d’Etat[181]. Deux arrêts célèbres ont consacré un champ très large pour la notion de ressources publiques : PreussenElektra et Vent de Colère. L’arrêt PreussenElektra établit que l’avantage octroyé aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, via l’achat de toute leur production à un prix minimal par les entreprises d’approvisionnement en électricité, fait l’objet de transferts financiers « qui ne sont pas et ne seront jamais à la disposition des autorités. Ils ne quittent, en fait, jamais le secteur privé ». En revanche, la Cour a jugé, sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État, que le dispositif français de financement de la compensation des surcoûts imposés aux opérateurs électriques, à raison de l’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur au prix de marché, constituait une intervention au moyen de ressources d’État[182]. En effet, contrairement aux circonstances ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra, les sommes destinées à compenser les surcoûts résultant de l’obligation d’achat, collectées auprès des consommateurs finals d’électricité sur le territoire français sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations, selon un mandat et des règles définies par l’Etat, et doivent donc être considérées comme demeurant sous contrôle public[183]. Dans la même logique, la Commission a considéré le mécanisme d’obligation de capacité français comme relevant d’une aide sur la base du même arrêt Vent de Colère, en indiquant[184] qu’il y avait ressources publiques dans la mesure où :
- (i) les fonds sont alimentés par des contributions obligatoires imposées par l’Etat et donc imputables à celui-ci ;
- (ii) l’Etat fixe des paramètres (critère de sécurité d’approvisionnement et méthodologie pour fixer le prix de référence marché déterminant le prix de règlement des écarts) qui influencent le prix de la capacité et la quantité de certificats globale, même s’ils ne sont pas fixés en tant que tels par l’Etat ;
- (iii) la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est habilitée à imposer des sanctions aux fournisseurs ne respectant pas leurs obligations en termes de règlement des écarts;
- (iv) le gestionnaire du réseau de transport – RTE – a été désigné par l’Etat pour gérer le fonds de règlement des écarts.
- Sélectivité de l’avantage octroyé : Le traité précise que les aides doivent « favoriser certaines entreprises ou productions ». La jurisprudence a consacré une appréciation large de la notion de sélectivité : en particulier, le mécanisme de capacité, bénéficiant à l’ensemble du secteur de la production d’électricité en France a été considérée comme sélective. De manière encore plus extensive, la décision SA.21918 indique que le critère de sélectivité est rempli pour une aide qui peut porter sur l’ensemble des consommateurs d’électricité d’un Etat membre, ce bien qu’on ait peine à comprendre quelles entreprises ou entités économiques significatives sont exclues de ce champ en pratique quasi-universel :
« La Commission estime que le fait que les tarifs standards et de retour soient en principe applicables à toutes les entreprises consommatrices d’électricité ne permet pas de conclure que ces mesures sont des mesures générales. En effet, pour être qualifiées de générales, il faut que les mesures en cause soient applicables à toutes les entreprises et non seulement à celles qui consomment de l’électricité, dont certaines peuvent privilégier cette consommation par rapport à d’autres entreprises qui utilisent d’autres sources d’énergie. [185] »
La sélectivité résulte en outre du fait que « les mesures tarifaires en cause (…) favorisent les entreprises consommant de l’énergie électrique par rapport à celles qui utilisent des énergies fossiles[186] » et « du fait des règles introduites qui définissent des catégories d’entreprises pouvant ou non bénéficier des tarifs réglementés. Le caractère irréversible de l’exercice de l’éligibilité entre les tarifs de marché et les tarifs réglementés […] comporte un élément de sélectivité manifeste[187] ».
- Aide affectant la concurrence (interne à l’Etat-membre ou intra-Union européenne) : La jurisprudence de la CJUE a consacré une appréciation très large du critère d’affectation de la concurrence mentionné à l’article 107(1) du TFUE. Cette affectation peut en particulier être actuelle ou simplement potentielle : il suffit que la mesure soit susceptible d’affecter la concurrence, indépendamment de la réalité d’un tel impact négatif ou de l’existence effective de concurrents (la logique étant que dès lors que l’on est susceptible de porter atteinte à l’émergence de futurs concurrents il y a un enjeu vis-à-vis du traité). Les restrictions de concurrence peuvent être, par exemple, la prise en compte au moyen de ressources publiques, de coûts indirects imputables à une entreprise, qui crée un avantage par rapport à ses concurrents[188]. La Commission doit motiver sa décision en décrivant les atteintes à la concurrence susceptibles d’intervenir[189], et celles-ci ne doivent pas être purement hypothétiques mais constituer un risque réel[190], sans nécessairement qu’elle ait à délimiter ou décrire de manière fine le marché considéré ou son fonctionnement concurrentiel.
- Aide affectant les échanges internes à l’Union européenne : La jurisprudence lie de manière constante affectation des échanges entre Etats-membres et affectation de la concurrence[191]. La Cour a en particulier consacré le principe selon lequel dès lors qu’une mesure renforce la position d’une entreprise par rapport à ses concurrents d’autres Etats-membres qui pourraient offrir les mêmes biens ou services[192]. La jurisprudence a par ailleurs établi qu’une aide à une entreprise qui ne fournit que des biens ou des services localement ou régionalement, sans assurer aucun service en dehors de son Etat-membre, pouvait affecter les échanges dès lors que des entreprises d’autres Etats-membres auraient pu assurer les mêmes missions[193].
Le champ couvert par le cadre européen en matière d’aides d’Etat est donc particulièrement large, plastique et évolutif. Il permet à la Commission d’appréhender de très nombreuses formes d’intervention par les Etats-membres dans leurs marchés. Mais comment sont traitées les interventions directes par les Etats-membres dans le marché intérieur pour fournir des biens ou des services ? Il convient ici de rappeler qu’en droit américain, la market participant exception pose le principe selon lequel la prohibition des atteintes au commerce inter-Etats par les Etats fédérés ne vaut pas lorsque ces derniers interviennent directement dans le marché. Bien davantage, elle pose le principe selon lequel les entités fédérées ont la pleine capacité de distinguer dans le strict champ du marché où elles opèrent[194] de manière discriminatoire entre contreparties de leur Etat et contreparties extérieures, y compris par refus de vendre à des tiers extérieurs à l’Etat[195]. Dans les termes de l’arrêt qui l’a établi : « Nothing in the purposes animating the Commerce Clause prohibits a State, in the absence of congressional action, from participating in the market and exercising the right to favor its own citizens over others. »[196].
Si l’Union européenne est compétente en ce qui concerne l’application des règles édictées par le TFUE et le droit dérivé de l’Union européenne, il demeure de la compétence des États membres de définir les Services d’Intérêt Economique Général (SIEG), ceux-ci retenant en la matière un large pouvoir discrétionnaire en application du principe de subsidiarité. Le traité de Lisbonne a d’ailleurs souligné l’importance des SIEG en son article 14 et dans le cadre du nouveau protocole n°26 annexé au Traité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres sont libres de créer et d’organiser leurs SIEG. L’article 106(2) du TFUE portant sur « les règles applicables aux entreprises » prévoit toutefois que les règles de concurrence et du marché intérieur s’appliquent aux entreprises chargées de la gestion de SIEG dès lors que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission d’intérêt général qui leur est impartie.
La Commission encadre donc l’exercice de cette compétence subsidiaire des Etats-membres, dans un contexte où par ailleurs, il n’existe aujourd’hui pas de véritable service public à portée européenne générale : cet encadrement est porté dernièrement dans le Paquet Almunia, qui clarifie les règles applicables à ces activités de service d’intérêt économique général. La communication Almunia[197] réaffirme la nature évolutive du champ des SIEG, selon notamment, les besoins des citoyens, les évolutions techniques et commerciales et les préférences sociales et politiques propres à chaque État membre.
Pour qu’il y ait SIEG, trois critères doivent être remplis dans la jurisprudence :
- une activité économique, au sens du droit de la concurrence : comme nous l’avons vu plus haut, ceci s’apprécie d’une manière large. Dans le cas d’espèce (plancher de prix), la production décarbonée d’électricité constitue une activité économique.
- une activité d’intérêt général, condition sur laquelle le juge communautaire se borne à contrôler l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, il serait difficile de qualifier d’erreur manifeste d’appréciation le fait de considérer qu’une production sûre et décarbonée d’électricité au bénéfice des consommateurs français constitue une activité d’intérêt général.
- une activité confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique. Ce point supposera probablement, a minima, la conclusion d’accords-cadres avec les entreprises éligibles au plancher, fixant une mission à caractère obligatoire (symétriquement à l’ARENH qui prévoit des accords-cadres pour les fournisseurs exerçant leur éligibilité à l’ARENH) pour ceux-ci. L’arrêt Commune d’Almelo[198] a en particulier consacré l’idée selon laquelle c’est l’existence d’obligations de service public qui fonde le SIEG, et doivent constituer le fondement de l’acte exprès de dévolution de la mission par la puissance publique. Comme réaffirmé dans la communication Almunia, le SIEG doit apporter un service public aux citoyens ou à la société dans son ensemble. En matière d’électricité, la Cour a reconnu l’existence d’un SIEG, dès lors que « l’entreprise doit assurer la fourniture ininterrompue d’énergie électrique sur l’intégralité du territoire concédé à tous les consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans les quantités demandées à tout moment, à des tarifs uniformes et à des conditions qui ne peuvent varier que selon les critères objectifs applicables à tous les clients[199] ».
La première approche est de démontrer que le SIEG remplit les critères Altmark :
- l’entreprise a été expressément chargée d’obligations de service public clairement définies ;
- des paramètres objectifs de calcul de la compensation ont été établis avant son versement ;
- il n’y a pas de surcompensation ;
- la mission de service public a été confiée à l’entreprise à l’issue d’une procédure de marché public permettant de sélectionner celle capable de fournir ce service au moindre coût.
La Cour a consacré la jurisprudence constante selon laquelle les Etats-membres disposaient d’une large faculté d’appréciation pour définir les services d’intérêt économique général, le pouvoir de la Commission se limitant aux erreurs manifestes d’appréciation, et ne saurait en cela se substituer à l’appréciation des autorités des Etats-Membres.
« … le droit de l’Union ne donne pas de définition précise de la notion de SIEG (…). Au contraire, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les États membres ont un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme des SIEG et que la définition de ces services par un État membre ne peut être remise en question par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste. Pour autant, le pouvoir d’agir de l’État membre, en vertu de l’article [106, paragraphe 2, TFUE], et, partant, son pouvoir de définition des SIEG, n’est pas illimité et ne peut être exercé de manière arbitraire aux seules fins de faire échapper un secteur particulier (…) à l’application des règles de concurrence[200] »
L’ordonnance Endesa de 2011 est venue préciser l’articulation entre cette faculté large donnée aux Etats-membres et le contrôle des erreurs manifestes d’appréciation. Le cas présenté à la cour consistait en une compensation des coûts supplémentaires de production de certaines centrales électriques résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon indigène et mise en place d’un “mécanisme d’appel en priorité” en leur faveur.
Tout d’abord, la Cour a rappelé que la définition d’un SIEG ne pouvait être remise en cause par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation, l’Etat membre devant seulement démontrer qu’il y a bien un mandat de service public d’une part avec une mission universelle et obligatoire, et d’autre part préciser les raisons justifiant la qualification en SIEG. Elle circonscrit strictement le périmètre du contrôle par la Commission, tout en précisant l’articulation avec le contrôle par le juge de l’Union.
“Dans la mesure où la requérante tend à remettre en question cette autorisation du SIEG notifié par le Royaume d’Espagne, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les États membres ont un large pouvoir d’appréciation quant à la définition de ce qu’ils considèrent comme des SIEG et que cette définition ne peut être remise en question par la Commission qu’en cas d’erreur manifeste commise par l’État membre concerné, étant précisé que cet État doit seulement, d’une part, fournir la preuve de la présence d’un acte de puissance publique investissant les opérateurs visés d’une mission de SIEG ainsi que du caractère universel et obligatoire de cette mission et, d’autre part indiquer les raisons pour lesquelles il estime que le service en cause mérite, de par son caractère spécifique, d’être qualifié de SIEG (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec. p. II‑81, points 166, 169 et 172, et la jurisprudence citée).
Ainsi, le contrôle que la Commission est appelée à exercer au regard d’un SIEG se limite nécessairement à la vérification de la question de savoir si ce SIEG repose sur des prémisses économiques et factuelles manifestement erronées et s’il est manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis. C’est dans ce contexte que le juge de l’Union doit, quant à lui, notamment examiner si l’appréciation de la Commission à cet égard est suffisamment plausible pour étayer la nécessité du SIEG en cause (voir, en ce sens, arrêt BUPA e.a./Commission, précité, point 266).
En aucun cas, la Commission ne saurait se substituer à l’État membre dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est propre en la matière. Ainsi, elle n’est pas habilitée à vérifier, sur la base des données disponibles, si, d’une part, le marché est susceptible d’évoluer effectivement d’une certaine façon et si, d’autre part, l’application des instruments de régulation prévus par le système notifié deviendra de ce fait, à un moment précis, indispensable pour garantir l’accomplissement de la mission de SIEG en cause. En effet, le contrôle de nécessité n’exige pas que la Commission gagne la conviction que l’État membre ne peut renoncer, au regard des conditions actuelles ou futures du marché, aux mesures notifiées, mais est limité à la recherche d’une erreur manifeste dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation de l’État membre quant à la manière d’assurer que la mission de SIEG puisse être accomplie dans des conditions économiquement acceptables (voir arrêt BUPA e.a./Commission, précité, point 268, et la jurisprudence citée)[201].
Il est particulièrement important, pour le cas d’espèce objet des présentes réflexions de bien constater que dans une logique SIEG, il n’est pas nécessaire que la Commission soit convaincue (ou obtienne la moindre démonstration) que les mesures sont rendues nécessaires par une quelconque défaillance de marché. La Commission n’a pas plus à veiller à l’équilibre concurrentiel du dispositif sur tel ou tel segment de marché ou à analyser d’éventuelles mesures alternatives :
« Contrairement à la thèse défendue par la requérante, il semble ressortir de cette jurisprudence que la Commission n’était notamment pas tenue de vérifier si le Royaume d’Espagne, au lieu d’instaurer ledit SIEG, aurait éventuellement pu envisager des mesures alternatives moins graves. En aucun cas, la Commission n’était obligée de veiller, en lieu et place du gouvernement espagnol, à ce que la position concurrentielle de l’une ou de l’autre des communautés autonomes espagnoles ne fasse pas l’objet d’un traitement privilégié. Cette tâche semble faire partie des prérogatives de la puissance publique espagnole, en application des dispositions constitutionnelles pertinentes.[202] [203] »
En l’espèce, des cas de procédures d’attribution peu concurrentielles ont fait l’objet de décisions consacrant une lecture un peu plus large des deux clauses de sauvegarde (cas où une seule entité répond à la procédure concurrentielle et critères techniques – cf infra). Ainsi, dans le cas SNCM[204], la Cour a considéré qu’un « faisceau d’indices convergents indiquait que la procédure d’appel d’offres n’avait pas entraîné une concurrence réelle et ouverte garantissant le critère de moindre coût pour la collectivité. ». En particulier, elle mentionne expressément que :
- Le recours à « une procédure négociée avec publication confère une large marge d’appréciation au pouvoir adjudicateur et peut restreindre la participation des opérateurs intéressés »
- « il doit être relevé que deux offres seulement ont été présentées à la suite de la publication de l’avis d’appel d’offres », ce, alors qu’en théorie plusieurs autres compagnies auraient pu y participer.
- La procédure négociée avec publication prévoyait non pas un choix sur le critère de l’offre la plus économiquement avantageuse mais sur un critère mixte tel que suit : « Pour l’attribution des contrats, la [CTC] se déterminera en fonction de l’engagement financier global qu’elle sera amenée à prendre et des éléments de qualité de service et de développement économique de l’île fournis par les entreprises soumissionnaires, notamment la part des services et activités envisagés sur le marché insulaire, dans la limite des capacités et des types de production. »
- Le cahier des charges comportait des critères techniques nombreux, pour lesquels la Cour observe que ces contraintes circonscrivaient la faculté de répondre à la seule SNCM[205].
Il apparaît donc difficile de s’abstraire d’une procédure concurrentielle. Toutefois, comme l’observe la Commission dans le livre blanc sur les services d’intérêt général de 2003 : « En l’absence d’harmonisation communautaire, les pouvoirs publics concernés dans les États membres sont, en principe, libres de décider de fournir eux-mêmes un service d’intérêt général ou de le confier à une autre entité (publique ou privée). Néanmoins, les fournisseurs de services d’intérêt économique général, y compris les fournisseurs de services internes, sont des entreprises et sont dès lors soumis aux règles de concurrence prévues par le traité. » Il demeure donc une latitude pour les Etats-membres à choisir d’opérer en régie un SIEG.
L’arrêt Teckal[206] vient ainsi offrir une possibilité de s’exonérer de la nécessité d’une procédure concurrentielle dans certains cas précis, en précisant ce que le juge de l’Union considère être la réalisation d’une mission en régie par une entité publique et dans quels cas ces entités publiques assurant directement un service peuvent déroger aux règles de mise en concurrence. Dans le cas Teckal, le juge communautaire devait se positionner sur la faculté d’une collectivité à attribuer sans marché public un marché de service public de chauffage urbain pour des bâtiments communaux, entre une commune et une communauté de communes. Il précise qu’il est possible de s’abstenir de procédure de mise en concurrence lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- L’entité adjudicatrice et l’exécutant du marché sont deux personnes juridiquement distinctes ;
- Il existe un « contrôle analogue du pouvoir adjudicateur sur le prestataire, c’est-à-dire égal à celui qu’il exerce sur ses propres services » ;
- Le prestataire réalise « l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent. »
L’objet de cet arrêté est avant tout de consacrer le principe selon lequel les dispositions de droit européen relatives aux marchés publics ne font pas obstacle à la faculté d’une collectivité (ou d’un Etat-membre) à réaliser les services qu’il estime nécessaire en régie, ce qui garantit le respect du principe de subsidiarité prévu dans le TFUE (et par ailleurs crée un cadre cohérent avec le principe constitutionnel français de libre administration des collectivités, et ses analogues dans d’autres systèmes constitutionnels européens). Les arrêts Stadt Halle[207] puis Consorzio Aziende Metane (Coname) / Communa di Cingia de Botti (dit « arrêt Coname »)[208] sont venus durcir le critère relatif au contrôle par l’entité adjudicatrice sur l’entité assurant la mission de service public, qui doit être un contrôle intégral : « En revanche, la participation, fût‑elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.[209] »
Malgré ce cadre qui en pratique devrait laisser une très large autonomie d’appréciation, de définition du champ desdits services, et une relative autonomie de sélection des prestataires par des logiques concurrentielles – sauf à opérer en régie publique, la pratique de la Commission concernant l’article 106(2) a visé à circonscrire au maximum le recours à cette catégorie juridique. En pratique, la quasi-totalité des SIEG existant aujourd’hui sont concentrés dans le domaine des services postaux, ainsi que de très rares cas d’installations énergétiques répondant à des défaillances de marché et des besoins locaux très particuliers (systèmes insulaires notamment), et des cas de services de transport, notamment à des fins de continuité territoriale et de desserte de territoires enclavés ou distants.
Si l’Union doit poursuivre l’intégration du marché intérieur, et constituer une Union toujours plus étroite, la question de la prestation de services publics à la population, ce y compris dans des secteurs libéralisés, et de la capacité propre des Etats-membres à faire le choix politique d’assurer eux-mêmes cette prestation de biens ou services, continuera d’être posée. L’Union n’a aucune raison juridique ou constitutionnelle de proscrire une action directe de prestation de tels services d’intérêt économique général à ses citoyens par ses Etats-membres, tant que celle-ci s’inscrit pleinement dans les règles du marché intérieur – ce que le caractère public du prestataire ne parvient pas à exclure a priori – et tant qu’elle concourt à des fins de poursuite de l’intégration ou cohérentes avec des objectifs de politique publique de l’Union. Exclure a priori cette catégorie est infondé juridiquement, même s’il est naturel d’exercer une vigilance quant à l’absence de distorsion du marché intérieur par les prestataires publics.
Proposition 14 : clarifier la liste des secteurs pouvant faire l’objet de SIEG.
Il pourrait ainsi être proposé de refonder le cadre Almunia en explicitant une liste de domaines dans lesquels sont possibles a priori des interventions des Etats-membres en matière de SIEG, et en clarifiant les conditions dans lesquelles l’exercice de cette compétence peut se produire sans atteindre le marché intérieur.
La commande publique
Le dernier champ d’intervention du souverain économique est celui de la commande publique, au cœur de débats particulièrement vifs, entre tenants de pratiques de préférence locale pour les achats publics, et la doctrine actuellement pratiquée en Europe qui a priori ne favorise pas de telles clauses de contenu. De manière particulièrement célèbre, les Etats-Unis disposent du Buy American Act, adopté en 1933 par le Congrès des États-Unis. Il constitue l’un des instruments juridiques les plus emblématiques du protectionnisme économique américain.
Le Buy American Act de 1933, désormais codifié aux articles 41 U.S.C. §§ 8301–8305[210], impose une exigence de préférence nationale dans les achats publics financés par le gouvernement fédéral américain. Il s’agit d’une norme de contenu local, imposant aux agences fédérales de privilégier les biens d’origine nationale, sauf exception.
L’article §8302(a)(1) dispose que : « Only unmanufactured articles, materials, and supplies that have been mined or produced in the United States, and only manufactured articles, materials, and supplies that have been manufactured in the United States substantially all from articles, materials, or supplies mined, produced, or manufactured in the United States, shall be acquired for public use. »
Autrement dit, les produits achetés dans le cadre des marchés publics doivent être soit non manufacturés et d’origine américaine, soit manufacturés aux États-Unis, avec une proportion substantielle de composants nationaux. En pratique, selon les règlements d’application, cette « proportion substantielle » est définie par la Federal Acquisition Regulation (FAR) à plus de 50 % de la valeur du contenu, selon des règles complexes[211]. Ce seuil a été modifié récemment par l’Executive Order 14005 signé par le Président Biden en janvier 2021, lequel prévoit un relèvement progressif du seuil à 60 %, puis 65 %, et enfin 75 % d’ici 2029, via la règle finale publiée en mars 2022.
L’article §8302(a)(2) prévoit toutefois des exceptions à cette obligation. Trois motifs de dérogation sont explicitement reconnus :
- Incompatibilité avec l’intérêt public (« public interest »).
- Inaccessibilité en quantité suffisante ou en qualité satisfaisante des produits américains.
- Prix excessif des biens américains par rapport aux alternatives étrangères.
La mise en œuvre du Buy American Act est précisée dans le Federal Acquisition Regulation à la §25.1, qui encadre notamment les critères d’évaluation des offres, les procédures de dérogation et les méthodes de calcul du différentiel appliqué au prix des offres étrangères. En pratique, un écart de 20 % à 30 % peut être ajouté au prix des biens étrangers lors de l’évaluation comparative, en fonction du statut de l’entreprise (grande ou petite). En outre, l’article §8303 interdit aux fournisseurs d’introduire des étiquetages fallacieux affirmant une origine américaine, renforçant ainsi la véracité de l’origine déclarée, ce sous peine de sanctions pénales.
Signalons enfin qu’il convient de distinguer le Buy American Act du Buy America Act de 1982, qui concerne spécifiquement les achats liés aux projets d’infrastructures de transport financés par le Department of Transportation. Les deux instruments poursuivent néanmoins des objectifs analogues de soutien à l’industrie américaine.
L’approche américaine mérite plusieurs commentaires au regard des erreurs qui sont souvent faites à son sujet. En premier lieu, il est important de relever que les Etats-Unis affirment que sa portée est limitée par les accords internationaux, en particulier l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’OMC[212]. En vertu de cet accord, les États-Unis doivent ouvrir une partie de leurs marchés publics à la concurrence étrangère, sous peine de représailles commerciales, en réalité assez théoriques. Officiellement, les Etats-Unis affirment que sont traités de manière identique par les services en charge des achats au niveau fédéral des prestataires nationaux américains et des prestataires issus d’Etats également parties à l’AMP, dont l’Union Européenne. Des exemptions sont prévues pour les achats en dessous des seuils de couverture définis dans l’AMP, ce qui permet de maintenir l’application du Buy American Act pour de nombreux achats courants.
Un second commentaire est que l’appréciation de ce qui constitue un marché public au sens du Buy American Act. Tout d’abord il ne s’applique uniquement qu’aux acquisitions de biens effectuées par le gouvernement fédéral des États-Unis, à des fins d’usage public. L’article 41 U.S.C. § 8302(a) établit que le Buy American Act concerne l’acquisition : “for public use [of] only […] articles, materials, and supplies […] mined, produced, or manufactured in the United States.”
Le terme « public use » renvoie aux besoins propres de l’administration fédérale, ce qui exclut les marchés passés par les États fédérés, les collectivités locales ou le secteur privé, sauf si ces entités agissent pour le compte de l’État fédéral via des subventions ou financements directs. Le Buy American Act s’applique en outre aux acquisitions directement financées par des fonds fédéraux. Il ne s’applique pas aux achats effectués par des entités non fédérales (États, municipalités, etc.), même si ces dernières reçoivent des subventions fédérales, sauf disposition expresse : celles-ci sont libres de définir leurs propres règles d’achat public. Ce point est particulièrement crucial dans la mesure où l’essentiel des achats publics ne relève pas du niveau fédéral mais bien des entités de niveau fédéré et inférieur. La pratique par celles-ci est beaucoup plus souple vis-à-vis du droit OMC, et si les États-Unis reconnaissent que le droit de l’OMC (et plus largement le droit international) peut entrer en conflit avec des législations adoptées par les États fédérés, ils considèrent qu’un tel conflit n’entraîne pas nécessairement l’invalidité de ces lois au regard du droit interne américain. S’agissant de l’OMC, dans l’affaire Corus Staal[213], la cour fédérale a clairement jugé :
“WTO decisions are not binding on U.S. law unless and until they are implemented through domestic legislation.”
Même si une règle OMC est violée par une loi fédérée (ex : une préférence locale new-yorkaise contraire à l’AMP), cela n’entraîne pas l’invalidation de la loi par les tribunaux américains.
Dans le cas d’espèce, la société Corus Staal BV, producteur néerlandais d’acier inoxydable, contestait l’imposition par les autorités américaines de droits antidumping calculés selon une méthode déclarée incompatible avec les règles de l’OMC par l’Organe de règlement des différends (ORD). L’Union européenne avait en effet gagné un différend contre les États-Unis devant l’OMC dans une affaire parallèle (DS294), concernant cette méthode. La Cour a souligné qu’en vertu de la loi d’exécution de l’Uruguay Round Agreements Act (URAA) de 1994 – qui a permis l’entrée en vigueur des accords de l’OMC aux États-Unis – le Congrès a expressément prévu que :
“No provision of any of the Uruguay Round Agreements […] shall be construed to be self-executing.”
(19 U.S.C. § 3512(a)(1))
Et plus loin :
“No person other than the United States […] shall have any cause of action or defense under any of the Uruguay Round Agreements.”
(19 U.S.C. § 3512©(1))
La Cour a dans ce cadre réaffirmé ainsi que seule une modification législative adoptée par le Congrès peut adapter le droit interne aux obligations internationales issues de l’OMC, sous le principe énoncé dans l’article VI §2 de la Constitution « “This Constitution, and the Laws of the United States […] and all Treaties made […] shall be the supreme Law of the Land” » (Supremacy Clause), et dans la continuité de la théorie développée dans l’arrêt Medellin selon laquelle un traité international qui n’est pas self-executing (qui ne comporte pas ses propres dispositions d’application) n’a pas de force obligatoire en droit interne.
En théorie donc, le champ des marchés publics fédéraux est bien réservé aux produits comportant du contenu américain, mais ouvert avec des clauses de réciprocité aux fournisseurs européens. En pratique, beaucoup de marchés relevant des entités de niveau fédéré ou inférieur sont en vertu de lois locales interdits aux fournisseurs européens, et bien qu’incompatibles avec le droit OMC ratifié par les Etats-Unis, ces dispositions demeurent de pleine application tant que le législateur fédéral n’en aura pas disposé autrement en revenant sur le caractère non self-executing des accords OMC.
L’Europe a quant à elle choisi de ratifier le cadre OMC, dont l’Union est partie, et le cadre du Traité confère sans objection possible une compétence de l’Union pour veiller à l’application du droit international par les Etats-membres dans le cadre de leur participation au marché intérieur. Les mêmes astuces consistant à refuser d’appliquer ces dispositions aux acteurs de droit intérieur ne peuvent ainsi prévaloir.
En revanche, dans la logique du principe de réciprocité que nous avons développé tout au long de ce travail, il serait tout à fait possible de prévoir, par un texte de niveau européen, que l’Union pour les marchés réalisés pour ses besoins propres, ainsi que pour tout marché public passé par une entité publique bénéficiant directement ou indirectement de financements européens, impose systématiquement – éventuellement avec un seuil de minimis – des critères de contenu minimal issu d’Etats parties à l’accord AMP. Ceci est la manière la plus cohérente tant avec le droit international auquel l’Europe est partie qu’avec le souci d’une pleine efficience concurrentielle des marchés publics et d’une prévention de mesures de rétorsion de nos partenaires commerciaux de renforcer la cohérence entre action publique européenne et développement compétitif de notre économie.
Proposition 15 : Mettre en place un Buy European Act qui soit un Buy Reciprocal Act
Enfin, à l’heure où la presse s’est fait l’écho de courriers adressés directement par les autorités américaines à des entreprises étrangères, signalant que la conduite par ces entreprises de politiques de diversité et d’inclusion au travail était susceptible de les écarter à l’avenir des marchés publics américains[214], la même logique de symétrie et de réciprocité permettrait à l’Union d’apporter une réponse immédiate à ce type d’approches. Celle-ci consisterait à adresser un courrier à l’ambassade américaine auprès de l’Union indiquant que si de tels critères étaient appliqués, l’Union se réserverait le droit de limiter l’accès aux marchés publics de l’Union aux entreprises qui mettent en œuvre ce type de politiques internes.
[1] Un examen sur Google Trends des occurrences de « résilience » et de « souveraineté industrielle » ou « souveraineté alimentaire » montre que les premières sont en reflux tendanciel depuis mars 2022, tandis que les secondes et troisièmes sont apparues à la même époque, avec presqu’aucune occurrence auparavant, et se maintiennent depuis à des fréquences d’occurrence sans précédent avant mars 2022.
[2] Décret n° 2022–1016 du 20 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
[3] « Scandale », « aberration », « on vend les bijoux de famille »… Les sénateurs vent debout contre le passage de Doliprane sous pavillon américain – Public Sénat – 14 octobre 2024.
[4] Communiqué de presse : Sanofi et CD&R s’allient pour soutenir les ambitions d’Opella dans la santé grand public – 21 octobre 2024
[5] Hormis l’allusion contenue dans un communiqué de Sanofi du 17 octobre, « s’étonnant » d’avoir reçu dans un calendrier si opportun une offre réévaluée à la hausse de la part d’un candidat.
[6] Paracétamol : la France veut relocaliser toute la chaîne de production d’ici trois ans – Le Parisien – 18 juin 2020
[7] Convention de Montevideo sur les droits et les devoirs des Etats, 1931, art. 1
[8] Le Nomos de la Terre, C. Schmitt, p. 78
[9] Théologie politique : quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté, C. Schmitt, I.
[10] Les lignes de force de la pensée politique de Carl Schmitt, J. Freund, Nouvelle Ecole, n.44, printemps 1987, p.17
[11] Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue, G. Agamben, Le paradoxe de la Souveraineté, 1.3
[12] Les Six Livres de la République, J. Bodin
[13] Théologie politique : quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté, C. Schmitt, I.
[14]Théologie politique : quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté, C. Schmitt, I.
[15] Théologie politique : quatre chapitres sur la théorie de la souveraineté, C. Schmitt, III
[16] Politique – II §1 – Aristote, voir aussi ibid. III, 4, §4
[17] Commentaire de la Politique d’Aristote – Thomas d’Aquin – III, 5,5 §388
[18] La valeur de l’État et la signification de l’individu, C. Schmitt (1914). On pourra notamment citer le passage, plus loin dans la même œuvre : « L’impératif kantien, dit ainsi Schmitt, selon lequel l’homme est toujours un but et jamais un moyen, ne vaut que si le présupposé d’autonomie est satisfait, ce qui ne concerne que les purs êtres de raison et pas un exemplaire d’une quelconque espèce biologique. », ré-interrogation de l’impératif catégorique non sans échos (dès 1914) dans Eichmann à Jérusalem, publié 50 ans plus tard par H. Arendt (1963) où son évocation au procès fait l’objet d’un développement approfondi qui revient sur sa subversion.
[19] Nous entendrons par « citoyen » les êtres humains en tant que participants à la sphère du politique.
[20] L’analogie de proportionnalité chez saint Thomas d’Aquin – B. Landry – Revue Philosophique de Louvain – 1922 – pp. 454–464
[21] L’idée thomiste de l’être et les analogies d’attribution et de proportionnalité – André Marc – Revue Philosophique de Louvain – 1933 – pp. 157–189
[22] Analogia entis, E. Przywara, PUF, coll. « Théologiques », 1990, 192 p.
[23] Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant – J. Duns Scot
[24] Op. cit., p.108–110
[25] On retrouve ici la théorie de l’institution du doyen Hauriou, qui la définit comme « Une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. Pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes. D’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures. » (La théorie de l’institution et de la fondation – M. Hauriou – 1925).
[26] On retrouve ici l’idée d’Y.-C. Zarka selon laquelle le critère déterminant du politique ne serait pas la distinction ami/ennemi mais la distinction liberté/servitude (Carl Schmitt ou le mythe du politique)
[27] L’ordre public économique – T. Pez – Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel – oct. 2015 – p.44–57
[28] L’Action humaine, traité d’économie – L. von Mises – 1985
[29] United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes. – Bananes Chiquita. – CJUE – Affaire 27/76, §65
[30] Ibid, notamment §12
[31] Là encore, le parallèle est saisissant avec le fait que tout ordre politique contient en lui-même la possibilité pour ses acteurs d’y concentrer le pouvoir politique, au risque de perdre les vertus politiques qu’apporte son fonctionnement concurrentiel.
[32] On peut arguer que cette tension entre deux extrêmes du marché, d’une part le monopole comme participant du marché qui peut y fixer ses propres règles, et d’autre part le prolétaire comme participant du marché qui n’y est plus qu’une commodité est une des idées qui sous-tend l’analyse des tendances du capitalisme dans l’Impérialisme, stade suprême du capitalisme de Lénine (1917), bien que l’essentiel de son propos soit concentré sur une critique historique de l’émergence des impérialismes et de sa conséquence pratique pour le mouvement communiste.
[33] Soit le pendant « économique » du « monopole de la violence légitime » en politique.
[34] Et c’est d’ailleurs à ce titre, et au fond percevant ce parallèle, que le juge administratif a attaché la protection de la dignité de la personne humaine à l’ordre public, assurant que le souverain politique ne soit pas investi que de la protection de ses propres processus ainsi que de l’être des personnes et des biens, mais également de la protection de la dignité des personnes. Si l’Etat ne protégeait les personnes qu’en tant qu’objets, il manquerait à ses devoirs devant les sujets qu’ils doivent être dans l’être pour pouvoir en être dans le champ politique, voir notamment : Conseil d’Etat, Assemblée, du 27 octobre 1995, 136727, publié au recueil Lebon, Commune de Morsang s/ Orge.
[35] Y inclus ceux qui concourent au fonctionnement du souverain politique, compte tenu de la mutuelle dépendance entre souverain économique et souverain politique, voir infra.
[36] C’est-à-dire que sa responsabilité interne est de préserver la catallaxie, « l’ordre engendré par l’ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché [c’est-à-dire] l’espèce particulière d’ordre spontané produit par le marché à travers les actes des gens qui se conforment aux règles juridiques concernant la propriété, les dommages et les contrats. » (Droit, législation et liberté – F. Hayek – T.2 p. 131
[37] Standard Oil Co. of New Jersey v. United States (1911)
[38] Interstate Commerce Act (1887)
[39] Ludwig von Mises, Socialisme
[40] The Nature of the Firm – R. Coase – 1937 – Economica. 4 (16). Blackwell Publishing: 386–405
[41] Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Art. 31 : « Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission. »
[42] Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne – Art. 207
[43] Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne – Art. 206
[44] Idée également dégagée par Ricardo au cours du débat sur les Corn Laws, soulignant que si l’importation de blé par le Royaume-Uni créait une dépendance aux producteurs continentaux, elle induisait en retour une dépendance des secteurs agricoles continentaux aux achats britanniques et aux devises qu’elles apportent, qui rendait durablement difficile à encaisser politiquement une rupture ou une atteinte aux échanges.
[45] Nous y reviendrons dans le segment sur les marchés publics.
[46] Au-delà des secteurs auxquels l’Union accorde aussi une protection particulière par la règle d’unanimité de l’article 207(4)
[47] Tariffs and Federal Finances: A Thumbnail History – Congressional Research Service – 10 jan. 2025
[48] Avec celui sur le devenir monétaire du pays et la fin du bimétallisme.
[49] Analysis: Trump points to McKinley’s tariffs as a success. History says otherwise – 91.7 WXVU, NPR, 7 fév. 2025
[50] Le Congrès ne conservant la possibilité de s’opposer à une baisse de droits de douane qu’à une supermajorité des deux tiers, très difficile à convoquer en pratique et qui supposait un accord bipartisan à ce sujet, retirant dès lors du champ du débat partisan la question commerciale et douanière.
[51] https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-whirlpool-corporation-manufacturing-plant/
[52] Guzik, Erik (October 31, 2024). « Tariffs are back in the spotlight, but skepticism of free trade has deep roots in American history ». The Conversation.
[53] Les tensions politiques autour de l’avenir de US Steel et de sa potentielle reprise par Japan Steel sont un autre exemple de la sensibilité politique particulière du secteur, dans un contexte où US Steel n’est plus un acteur majeur du secteur et où les Etats-Unis sont structurellement importateurs.
[54] https://legrandcontinent.eu/fr/2025/01/18/revisionnisme-et-desinhibition-lempire-de-trump-dans-la-doctrine-marco-rubio/
[55] Christopher Clayton, Matteo Maggiori, et Jesse Schreger. A framework for geoeconomics. 2023.
[56] Christopher Clayton, Matteo Maggiori, et Jesse Schreger. The political economics of geoeconomic power. 2023.
[57] Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme – COM (2021) 66 final – 18 fév. 2021
[58] IMF Strategy, Policy and Review Department (2020), Developments in Global Trade Policy: Broadening Conflict May Hinder Recovery, 1er octobre 2020.
[59] Problème qui n’est pas nouveau, et était comme nous l’avons indiqué déjà le paradigme central du débat politique sur l’ouverture des échanges mondiaux lors de la mise en œuvre du Traité.
[60] Ibid., p.3
[61] La Commission va jusqu’à préciser que « ce problème [chinois] se manifeste tout particulièrement dans les industries à forte intensité énergétique, et notamment dans le secteur sidérurgique, où des solutions à l’échelle planétaire sont nécessaires pour remédier aux déséquilibres considérables sur le marché mondial qui nuisent aux entreprises européennes et compromettent la réussite de la transition écologique de cet écosystème »
[62] Ibid., p.3
[63] “Open strategic autonomy” as an industrial policy compass for the EU competitiveness and growth: The good, the bad, or the ugly? – S. Mariotti, JIBE, Sept. 2024
[64] ‘The European Union’s Sovereignty Agendas: A Quest for Technological Power: From Strategic Autonomy to Technological Sovereignty’ – R. Csernatoni – Carnegie Europe Article, August 12.
[65] European Strategic Autonomy: Operationalising a Buzzword – Dr. Pauli Järvenpää, Dr Claudia Major, Sven Sakkov – Oct. 2019, Konrad Adenauer Stiftung, RKK-ICDS
[66] Beyond Autonomy Rethinking Europe as a Strategic Actor – LSE Ideas / Friedrich Naumann Foundation, 2021
[67] Déclaration de Grenade, 6 oct. 2023, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/10/06/granada-declaration/
[68] Le Grand Continent – 28 février 2025 – La doctrine Miran : le plan de Trump pour disrupter la mondialisation.
[69] Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers, art. 2.
[70] La sécurité d’approvisionnement en métaux critiques passe par le fait d’intégrer à notre espace économique suffisamment de zones qui disposent de ces ressources et sont des partenaires fiables, plutôt que par une vision un peu infantile de la souveraineté industrielle, définie comme le fait d’avoir de petites mines pavoisées de petits drapeaux français ou européen…
[71] IEA (2022), Solar PV Global Supply Chains, IEA, Paris
[72] IEA (2022), Global Supply Chains of EV Batteries, IEA, Paris
[73] Clean energy innovation in China: fact and fiction, and implications for the future, A. Hove, Oxford Institute for Energy Studies.
[74] Solar power’s giants are providing more energy than big oil – Bloomberg – D. Fickling – 14 juin 2024
[75] Soit dit en passant, le déversement de surcapacités chinoises sur le marché européen témoigne certes de la compétitivité chinoise mais aussi et surtout de la situation très difficile de la demande intérieure chinoise, et peut être lu comme un signal avancé d’une crise économique plus profonde qu’il n’y parait.
[76] MEMO/13/497
[77] IEA (2022), Solar PV Global Supply Chains, IEA, Paris
[78] Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
[79] IEA (2024), World Energy Investment 2024, IEA, Paris
[80] Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724
[81] Il est à cet égard frappant que ce soit le souverain économique américain, et non européen, qui exerce des pressions documentées dans la presse sur les autorités néerlandaises comme sur ASML pour imposer une restriction des exports de ces équipements vers la Chine (voir Exclusive: Targeting Chinese chips, US to push Dutch on ASML service contracts, Reuters, 4 avril 2024), dans un contexte d’intenses échanges entre les autorités néerlandaises, l’exécutif américain, et la direction de l’entreprise pour en maintenir les activités sur le sol néerlandais (voir Aux Pays-Bas, l’éventuelle délocalisation du géant ASML agite les autorités politiques – Le Monde, 12 mars 2024).
[82] Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, arrêt du 20 février 1979, Aff. 120/78
[83] Georg Schwarz contre Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, arrêt du 24 nov. 2005, Aff. C-366/04
[84] Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008
[85] U.S. Supreme Court – Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 9 Wheat. 1 1 (1824) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/22/1/)
[86] M. Farrand, Records of the Federal Convention of 1787
[87] U.S. Supreme Court – Kidd v. Pearson, 128 U.S. 1 (1888) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/128/1/)
[88] U.S. Supreme Court – Swift & Co. v. United States, 196 U.S. 375 (1905) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/196/375/)
[89] U.S. Supreme Court – Federal Baseball Club v. National League, 259 U.S. 200 (1922) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/259/200/)
[90] U.S. Supreme Court – Carter v. Carter Coal Company, 298 U.S. 238 (1936) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/298/238/)
[91] U.S. Supreme Court – United States v. Wrightwood Dairy Co., 315 U.S. 110 (1942) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/315/110/)
[92] U.S. Supreme Court – Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/317/111/case.html)
[93] U.S. Supreme Court – United States v. Alfonso D. Lopez, Jr., 514 U.S. 549 (1995) (http://supreme.justia.com/us/514/549/case.html)
[94] U.S. Supreme Court – Quill Corp. v. North Dakota, 504 U.S. 298 (1992) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/298/)
[95] U.S. Supreme Court – Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 U.S. 274 (1977) (https://supreme.justia.com/us/430/274/case.html)
[96] U.S. Supreme Court – Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U.S. 456 (1981) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/449/456/)
[97] U.S. Supreme Court - Bibb v. Navajo Freight Lines 359 U.S. 520, 524 (1959) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/359/520/)
[98] U.S. Supreme Court - South-Central Timber Development, Inc. v. Wunnicke, 467 U.S. 82 (1984) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/82/)
[99] U.S. Supreme Court – United Haulers Ass’n v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550 U.S. 330 (2007) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/550/330/)
[100] U.S. Supreme Court - Western & Southern Life Ins. v. State Board of California, 451 U.S. 648 (1981) (https://supreme.justia.com/cases/federal/us/451/648/) : “If Congress has specifically authorized states to regulate in a certain area, a law that discriminates and retaliates against out-of-state commercial actors in that area is not unconstitutional.”
[101] Voir South-Central Timber précité.
[102] U.S. Supreme Court - Reeves, Inc. v. Stake, 447 U.S. 429 (1980)
[103] U.S. Supreme Court - Hughes v. Alexandria Scrap Corp., 426 U.S. 794 (1976)
[104] Consten SaRL et Grundig GmbH c. Commission (1966) – Aff. 56/64
[105] M. Draghi, discours au Parlement Européen, 18 février 2025.
[106] The Future of European Competitiveness, Part B, Septembre 2024, M. Draghi, p. 288
[107] Ibid., p. 315
[108] U.S. Supreme Court - Edgar v. MITE Corp., 457 U.S. 624 (1982) : “The internal affairs doctrine is a conflict of laws principle which recognizes that only one State should have the authority to regulate a corporation’s internal affairs—matters peculiar to the relationships among or between the corporation and its current officers, directors, and shareholders—because otherwise a corporation could be faced with conflicting demands.”
[109] Ålands Vindkraft AB contre Energimyndigheten (2014) – Aff. C-573/12
[110] Ibid, §78
[111] Ibid., §94
[112] Ibid., §99
[113] “The executive Power shall be vested in a President of the United States of America.” – Constitution des Etat-Unis, Art. II, Sec. 2.
[114] U.S. Code – Title 19, https://www.congress.gov/crs-product/LSB10559, et dispositions de mise en œuvre, voir CFR, Titre 19, Ch. I, 162, sqq (https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-162/subpart-A/section-162.6).
[115] Eighteenth century international trade statistics – Sources and Methods – Loic Charles, Guillaume Daudin, t.140, revue de l’OFCE
[116] Constitution du 16 mars 1871 – art. 36
[117] Signalons ici que le statut fiscal et douanier particulier du port franc de Hambourg ne prendra son terme qu’en 2013.
[118] Ibid. – art. 34
[119] Ibid. – art. 35 et 38.
[120] Heinz-Gerhard Haupt – Die deutsche Zollpolitik 1871–1914 – Vandenhoeck & Ruprecht, 1970.
[121] Pflanze, Otto – Bismarck and the Development of Germany, Volume II: The Period of Consolidation, 1871–1880. – Princeton University Press, 1990.
[122] Alfred Kuert – Dictionnaire historique de la Suisse – Gardes frontières – 23 jan. 2007
[123] Constitution suisse du 12 sept. 1848, art. 23 sqq.
[124] Règlement 2013/952/UE – Art. 42
[125] Règlement (UE) 2017/821 fixant des obligations pour les importateurs d’étain, de tantale et de tungstène, de leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque
[126] Règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937
[127] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
[128] Loi n° 66–1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger
[129] Act no. 842 of 10 May 2021 on the screening of certain foreign direct investments etc. in Denmark (the Investment Screening Act)
[130] Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union
[131] Ibid., art. 6(2) et 7(2)
[132] Ibid., art. 7(7)
[133] Ibid., art. (8)
[134] Couche-Tard et Carrefour: Paris dit « non », le canadien jetterait l’éponge – Challenges, 16 jan. 2021
[135] Executive Order 11858 – 7 mai 1975 – Foreign Investment in the United States
[136] Exon–Florio Amendment 50 U.S.C. app 2170
[137] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721
[138] Foreign Investment Risk Review Modernization Act – 2018 – §1727
[139] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721(a)(4)(B)(i)
[140] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721(a)(4)(B)(ii)
[141] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721(a)(4)(B)(iii)
[142] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721(a)(5)
[143] Defense Production Act – 1950 – Chapter 922; 64 Stat. 798; 50 U.S.C. 4501 et seq. – §721(a)(4)(D)(vi)
[144] Foreign Investment Risk Review Modernization Act – 2018 – §1758
[145] "Legal, political barriers close in on blocked U.S. Steel-Nippon deal". Kim Riley, 15 Janvier 2025, Financial Regulation News.
[146] National Security Creep in Corporate Transactions, K. Eichensehr, C. Hwang, University of Virginia School of Law Public Law and Legal Theory Research Paper Series 2022–64 Law and Economics Research Paper Series 2022–20, Sept. 2022
[147] Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne – art. 64(3)
[148] U.S. Supreme Court – United States v. Alfonso D. Lopez, Jr., 514 U.S. 549 (1995) (http://supreme.justia.com/us/514/549/case.html)
[149] United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des Communautés européennes – Bananes Chiquita – 27/76 – 14 février 1978
[150] Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE
[151] Règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937
[152] Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
[153] Sur les principes de fonctionnement du MACF, voir Perspectives pour le prix du carbone en Europe – P. Jérémie – TerraNova – 17 sept. 2024
[154] Règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942
[155] EU privately talks emissions rules with US gas firms as Trump trade war looms, Politico, 6 mars 2025
[156] Curtailing Fugitive Methane Emissions Amid a Potential US Regulatory Rollback, CGEP – Columbia, T. Boersma, R. Kleinberg, A.-S. Corbeau, 7 janvier 2025
[157] Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
[158] OMC – Panel DS 593 – 10 jan. 2025
[159] Sur ces enjeux, voir Perspectives pour le prix du carbone en Europe – P. Jérémie – TerraNova – 17 sept. 2024
[160] Nous avons vu plus haut le scepticisme avec lequel nous proposons de recevoir l’idée même de « secteurs » ou de « filières stratégiques », tant cette définition échappe à une approche objective et rationnelle.
[161] Communication de la Commission – 26 février 2025 – The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation
[162] Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
[163] SA.54794 – Projet Important d’Intérêt Européen Commun relatif aux batteries.
[164] Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
[165] Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal
[166] Gazprom’s low gas storage levels fuel questions over Russia’s supply to Europe – Financial Times, 27 oct. 2021
[167] How should Beijing intervene to save Chinese firms from vicious competition? – South China Morning Post, 27 déc. 2024
[168] Arnaud Orain, économiste - « Le néolibéralisme s’estompe de plus en plus » – Le Monde, 17 mars 2025
[169] Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
[170] Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie
[171] Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972 - SA Francolor (Matières colorantes), aff. 54–69
[172] Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988 – A. Ahlström Osakeyhtiö et autres contre Commission des Communautés européennes. – Affaires jointes 89, 104, 114, 116, 117 et 125 à 129/85. – C-89/95
[173] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 septembre 2017 – Intel Corp. Inc. contre Commission européenne – Affaire C-413/14 P, §18
[174] Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764 (1993), §813
[175] CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff.C-41/90
[176] . CJCE, 16 juin 1987, Commission c/Italie, aff.C-118/85, CJCE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, aff.C-475/99
[177] conclusions de l’avocat général Trstenjak sous l’arrêt Selex Sistemi c/Commission et Eurocontrol du 26 mars 2009, aff.C-113/07 P, pts 116 à 118.
[178] Réponse à une question écrite, JOCE C 125, 17 août 1963
[179] CJCE, 15 juin 2006, Air liquide Industries Belgium, aff.C-393/04 et C-41/05.
[180] . CJCE, 22 mars 1977, Steinike, aff.78/76
[181] Décision no 2000/513/CE concernant les aides accordées par la France à l’entreprise Stardust Marine, JOCE L 206, 15 août 2000
[182] Conclusions sous l’arrêt CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra, aff.C-379/98
[183] CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! c/Ministre de l’Écologie, aff.C-262/12
[184] SA.39621 (55)
[185] SA.21918 (102)
[186] SA.21918 (103)
[187] SA.21918 (104)
[188] CJCE, 17 septembre 1980, Philip Morris, aff.730/79
[189] CJCE, 14 novembre 1984, Intermills, aff.323/82 et CJCE, 13 mars 1985, Leeuwarder Papierwarenfabrik, aff. 318/82.
[190] CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, aff. C-280/00, pt 79
[191] TPICE, 4 avril 2001, Régione autonoma Friuli Venezia Giulia c/Commission, aff.T-288/97
[192] CJCE, 17 septembre 1980, Philip Morris, aff.730/79; CJUE, 14 janvier 2015, Eventech / Parking Adjudicator, aff. C-518/13
[193] CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans, aff. C-280/00, pt 79
[194] Voir South-Central Timber précité.
[195] U.S. Supreme Court - Reeves, Inc. v. Stake, 447 U.S. 429 (1980)
[196] U.S. Supreme Court - Hughes v. Alexandria Scrap Corp., 426 U.S. 794 (1976)
[197] Voir Guide relatif à l’application aux services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, de « marchés publics » et de « marché intérieur » – 29 avril 2013
[198] CJCE, 27 avril 1994, Commune d’Almelo, aff. C-393/92.
[199] Ibid.
[200] CJCE, 15 juin 2005, Olsen, CJCE, 12 fév. 2008, BUPA §166
[201] CJUE, 17 fév. 2011, Comunidad Autonoma de Galicia c/ Commission européenne (dit Endesa), §90–92
[202] Ibid., §93
[203] Il convient enfin de souligner que le même arrêt Endesa retient une approche large de la sécurité d’approvisionnement, au-delà de celle du mécanisme de capacité, pour englober « le développement de sources indigènes d’énergie primaire » : « le Conseil conclut qu’une diversification des sources énergétiques aussi bien par zones géographiques que par produits permettra de créer des conditions d’approvisionnement plus sûres, en ajoutant qu’une telle stratégie inclut le développement de sources indigènes d’énergie primaire (considérant 3 du règlement nº 1407/2002). Selon le Conseil, la situation politique mondiale donne une dimension entièrement nouvelle à l’évaluation des risques géopolitiques et des risques de sécurité en matière énergétique et un sens plus large au concept de sécurité d’approvisionnement (considérant 4 du règlement nº 1407/2002), de sorte que le renforcement de la sécurité énergétique de l’Union, que sous-tend le principe général de précaution, justifie le maintien de capacités de production houillère soutenues par des aides d’État (considérant 7 du règlement nº 1407/2002). », Ibid., §86
[204] CJUE, 1er mars 2017, SNCM c/ Commission Européenne, §240 sqq
[205]« Troisièmement, force est de constater que certaines contraintes de nature technique ont également limité le nombre de candidats susceptibles de soumissionner à l’appel d’offres. Ainsi, les navires devaient répondre à des exigences techniques précises pour pouvoir manœuvrer dans certains des ports corses. Par exemple, comme cela est indiqué dans la note en bas de page n° 107 de la décision attaquée, en 2007, le port de Bastia ne permettait pas la manœuvre de navires mesurant plus de 180 mètres. Cette contrainte, conjuguée à l’exigence d’un nombre minimal élevé de mètres linéaires prévue par le cahier des charges de la CDSP pour le transport du fret, impliquait la construction de navires presque sur mesure, analogues à certains des navires de la SNCM, tels que le Paglia Orba et le Pascal Paoli. Or, ainsi que cela est relevé dans la note en bas de page n° 109 de la décision attaquée, le coût de navires susceptibles de remplir les conditions de ce cahier des charges était particulièrement élevé. À ces éléments s’ajoute le fait que ledit cahier des charges prévoyait que les navires destinés à assurer le service public ne pouvaient être âgés de plus de 20 ans, avec possibilité d’une dérogation pour les années 2007 et 2008, ce qui bénéficiait directement à la SNCM, tout en ayant pour effet d’exclure cinq navires de la flotte de Corsica Ferries disponible pour l’exploitation de la DSP, comme l’explique de manière très convaincante la Commission dans sa réponse à l’une des questions écrites du Tribunal. » – Ibid., §247
[206] CJCE, 18 nov. 1999, Teckal, C-107/98
[207] CJCE, Stadt Halle, 11 jan. 2005, C-26/03
[208] CJCE, Consorzio Aziende Metane (Coname) / Communa di Cingia de Botti, 21 juillet 2005, C-231/03
[209] CJCE, Stadt Halle, 11 jan. 2005, C-26/03, §49
[210] articles 41 U.S.C. §§ 8301–8305
[211] Federal Acquisition Regulation – FY 2019 – General Services Administration
[212] Accord plurilatéral sur les marchés publics – 1979 – OMC
[213] Corus Staal BV v. U.S., 395 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2005)
[214] Stupeur dans les entreprises françaises après une lettre de l’ambassade américaine à Paris exigeant qu’elles respectent la politique antidiversité de Trump – Le Monde, 29 mars 2025