Habiter dans 20 ans
Comment habiterons-nous dans 20 ans ? Quels seront nos nouveaux usages, comment nos manières d’habiter seront influencées par les évolutions de nos modes de vie ? Comment nous organiser pour préserver nos ressources, garder la ville ouverte à tous et adapter les logements à de nouveaux styles de vie ? Comment favoriser l’inclusion sociale par le logement ? Comment développer l’habitat durable ? Malgré les contraintes qui conditionnent nos choix à vingt ans, plusieurs scénarios d’avenir sont possibles. Terra Nova les décline dans ce rapport, et les grands enjeux de nos territoires demain.


Le logement s’inscrit par nature dans une longue durée : on construit pour durer et ce qu’on construit organise l’espace à long terme. Il est donc courant d’imaginer l’avenir du logement en termes de volumes à construire, de rythme des chantiers, de budgets à mobiliser.
Nous avons voulu mener ici un exercice différent, centré d’abord sur les manières d’habiter plutôt que sur la construction et le bâti. Comment habiterons-nous dans 20 ans ? Formulé de cette manière, le sujet se présente de manière à la fois plus restreinte et plus vaste. Plus restreinte, parce qu’il laisse de côté de nombreux sujets techniques fondamentaux pour le logement, comme le financement, les normes réglementaires, les techniques de construction etc. Mais plus large parce qu’il invite à observer les croisements entre les manières d’habiter et des évolutions de nos modes de vie : la redéfinition de la vie familiale, le vieillissement de la population, le changement du travail, le développement de la mobilité, l’apparition de l’économie du partage etc.
Ces dernières années, ce sont des pratiques nouvelles comme la colocation ou les locations temporaires qui ont changé le marché du logement, plus que des évolutions liées à l’architecture ou à la construction. Mais comment savoir quel impact nos modes de vie auront sur notre manière d’habiter ? Il ne suffit pas de mettre en évidence des tendances déjà engagées comme l’augmentation de la population, le vieillissement, la concentration de la création d’emploi dans les centres métropolitains etc. Il faut encore comprendre comment ces tendances s’inscrivent dans le territoire, provoquent des effets de concentration ou de dispersion de l’habitat, c’est-à-dire créent des situations localement tendues pour l’accès au logement et des zones plus détendues.
Or, en France, le contraste est particulièrement important entre les territoires en développement, qui ne sont pas tous des centres urbains, et les zones moins denses, qui ne manquent pas toutes d’attractivité. Cette géographie de l’habitat met en évidence une contradiction des dynamiques en cours. D’un côté, les métropoles risquent de ne plus être accessibles à une part croissante de la population, en raison du coût d’accès trop élevé au logement en ville-centre. De l’autre, le mouvement d’étalement urbain qui permet de loger les citadins aux alentours des métropoles entraîne des coûts d’infrastructure particulièrement lourds et n’est pas soutenable d’un point de vue environnemental.
Comment nous organiser pour préserver nos ressources, garder la ville ouverte à tous et adapter les logements à de nouveaux styles de vie ? Comment favoriser l’inclusion sociale par le logement ? Comment développer l’habitat durable ? Les habitants chercheront demain à habiter de logements plus adaptables à leurs contraintes et à leur style de vie. Utopie ? Des innovations s’orientent déjà dans cette direction. Un urbanisme favorable à la mixité des usages permet par exemple de mieux valoriser des espaces occupés de manière discontinue ou temporaire. On peut aussi imaginer des mises en commun plus systématiques de certains espaces dans les habitations collectives, grâce aux nouvelles technologies.
Des aspirations et des pratiques nouvelles vont aussi changer les comportements comme le montrent les exemples de projets participatifs : l’habitat partagé peut apporter une réponse au besoin d’espace dans la ville dense. Notre avenir proche n’apparaît donc pas comme un horizon uniforme. Malgré les contraintes qui conditionnent nos choix à vingt ans, plusieurs scénarios d’avenir sont possibles. Nous avons choisi d’en formaliser quatre pour débattre des choix à privilégier : « la concentration métropolitaine », « la saturation urbaine », « la révolution du partage » et « le réseau des métropoles ». Seul le dernier scénario permet d’imaginer un rapport équilibré au territoire, qui prenne en compte la lutte contre les inégalités, les impératifs environnementaux et notre qualité de vie.
Introduction
Vingt ans n’est pas une échelle de temps très longue en matière de logement. Par nature, l’immobilier est un secteur d’évolutions lentes. Au moment où tant de secteurs connaissent de rapides bouleversements économiques, technologiques ou culturels, le logement semble inscrit par nature dans une trajectoire sans surprise.
Le poids de l’acquis est particulièrement fort : sachant que le parc immobilier se renouvelle au rythme de 1 % par an, on peut gager que 80 % du parc immobilier dans lequel nous vivrons dans vingt ans est déjà construit. Les contraintes techniques sont fortes, elles se transforment peu, on ne peut pas changer les modes de construction du jour au lendemain.
Le cadre institutionnel est, lui aussi, peu susceptible d’évoluer rapidement. Des compromis institutionnels anciens engagent des acteurs multiples, qui gèrent des sommes importantes. En raison de la complexité du système, des contraintes budgétaires, des engagements de long terme qu’il implique, il induit une forte inertie des comportements. La stabilité du cadre en ce qui concerne le logement social en France contraste avec les bouleversements qui ont affecté ce secteur à peu près partout en Europe.
La mobilité résidentielle est faible [1] . Dans le parc locatif privé, les locataires restent dans le même logement en moyenne sept ans. Le chiffre est presque doublé pour les locataires du parc social : treize ans en moyenne. Ceci explique un taux de rotation du parc social particulièrement faible : moins de 10 % par an (6 % seulement en Île-de-France), un rythme qui ralentit chaque année depuis quinze ans et qui explique la baisse du nombre d’attributions de logements dans le parc social, malgré le maintien d’un effort public en faveur de la construction (entre 2002 et 2013, 600 000 logements ont été construits dans le parc social, tandis que le nombre d’attributions annuelles a diminué de 70 000 [2] ).
Le logement est le cadre de la vie privée, il fait l’objet d’une appropriation en fonction d’arrangements personnels qui apparaissent stables dans la longue durée. Le plaisir d’être chez soi, d’aménager son intérieur, de jouir de son confort au fil des années explique les chiffres élevés de satisfaction individuelle qui apparaissent dans les enquêtes et qui contraste avec le thème général de la « crise du logement [3] ». Le choix du pavillon individuel, qui contrarie tant de projets d’aménagement ou d’innovation architecturale, est un symbole bien connu de ce conservatisme des modes de vie sur lequel les grandes politiques n’ont guère de prise.
Pourtant, si l’évolution du parc de logements est inscrite dans des trajectoires lentes, l’habitat, c’est-à-dire les manières d’habiter, peut connaître, lui, des évolutions plus rapides dans les vingt ans qui viennent.
Les modes d’habiter évoluent plus vite que le parc immobilier. Dans les années récentes, deux révolutions des usages ont transformé le marché locatif : la colocation des étudiants et des jeunes professionnels d’une part, le développement rapide des locations de très courte durée d’autre part (Airbnb en constitue le cas le plus connu et le symbole).
L’extension des espaces partagés dans les logements collectifs (buanderie, terrasse commune, salle collective, espace de travail à louer…) indiquent un intérêt pour une mise en commun plus ambitieuse des espaces. Facilitées par les nouvelles technologies, ces formes de partage peuvent aller dans certains cas jusqu’à modifier les délimitations habituelles de la vie privée en développant des espaces collectifs comme les salles à manger, les cuisines, les salles de loisirs, etc.
Les temps d’occupation des logements, rythmés par la vie professionnelle, les transports et la vie privée (« métro-boulot-dodo ») se modifient progressivement. On observe une désynchronisation des rythmes de vie (travail en rythme décalé, travail de nuit, travail à temps partiel, travail indépendant, travail à la maison…) qui permet d’imaginer de nouveaux partages des espaces au cours d’une journée. En outre, le vieillissement de la population développe les modes de vie sédentaires et fait apparaître de nouveaux besoins d’équipement et d’accompagnement à domicile.
Le développement des mobilités professionnelles, les contraintes de l’immobilier d’entreprise stimulent des modes de vie plus nomades ou en multi-localisation, favorisant l’apparition d’espaces de travail d’un type nouveau ( coworking ).
Les contraintes environnementales et la lutte contre le réchauffement vont nous obliger à réorienter fermement certaines trajectoires (étalement urbain, mitage, migrations pendulaires, occupation du littoral).
Les dynamiques économiques ont un fort impact géographique, la localisation des activités économiques étant fortement polarisée, ce qui a des conséquences sur les choix résidentiels.
Il existe enfin des modes d’hébergement qu’on ne peut pas laisser aux solutions transitoires ou à l’urgence : la rue, la précarité, les bidonvilles, l’informel. Ils sont déjà présents et, en fonction des aléas économiques ou géopolitiques, peuvent se développer rapidement.
Bien que le secteur du logement soit peu susceptible de connaître une révolution radicale des usages, on observe tout de même des tendances lourdes qui indiquent dès aujourd’hui des transformations profondes de notre rapport à l’habitat à l’horizon 2040. On résume trop souvent cette mutation au développement de la domotique (maison connectée, avec régulation du chauffage, contrôle à distance des éclairages ou systèmes de sécurité) ou à l’introduction de nouveaux objets technologiques dans notre quotidien (assistants personnels connectés, détecteurs de chute pour personnes âgées…). Nous avons voulu aller plus loin et nous interroger sur des évolutions globales dépassant le cadre de la politique du logement. Nous avons ainsi observé les tendances démographiques, familiales, économiques mais aussi l’évolution des styles de vie et des aspirations individuelles.
Un regard sur les vingt années à venir nous place rapidement devant une impasse. Pour savoir comment nous nous logerons dans vingt ans, il faut en effet d’abord savoir où nous chercherons à vivre et avec qui nous cohabiterons. Les dynamiques actuelles de la géographie de l’habitat annoncent une poursuite de la concentration urbaine et du développement des périphéries urbaines. Or, la transition écologique dans laquelle nous entrons (avec ses objectifs de neutralité carbone, de limitation de l’artificialisation des sols…) condamne la tendance actuelle à l’étalement urbain. Et le mouvement complémentaire de concentration dans les métropoles atteint lui aussi des limites, en particulier pour l’accès au logement des ménages les plus modestes, des classes moyennes ou des jeunes actifs. D’où la contradiction qui s’annonce : il nous faut éviter aussi bien la concentration excessive que l’étalement incontrôlé… Peut-on surmonter ce dilemme ? Le développement d’une économie du partage appliquée à l’habitat peut-il ouvrir de nouvelles perspectives ? De nouveaux modes de vie en commun se développent déjà, qui proposent des partages d’espaces, des convivialités de voisinage, des modes d’occupation des logements plus économes en surface, plus adaptés aux contraintes du travail et aux évolutions de la vie familiale. Cela suffira-t-il à équilibrer notre territoire et à satisfaire la demande de logements ?
Nous montrons finalement que quatre scénarios se dégagent, dont un seul nous paraît vraiment favorable. Nous identifions en effet un scénario de « concentration métropolitaine » aux forts effets inégalitaires et un scénario de « saturation urbaine » se traduisant par un clivage culturel fort entre les habitants des métropoles et ceux des espaces peu denses. Nous imaginons également une possible « révolution du partage » qui suppose cependant d’importants changements de modes de vie et de représentations du « chez soi » dans de larges secteurs de la population. Nous identifions finalement un scénario d’équilibre, « le réseau des métropoles », qui permettrait d’harmoniser les aspirations majoritaires des ménages en termes de logement avec un équilibre des territoires et un usage responsable des ressources naturelles. Mais pour arriver à un tel équilibre, qui ne s’imposera pas spontanément, il convient de bien comprendre les tendances à l’œuvre et de repérer les actions publiques prioritaires à mener pour nous engager sur une trajectoire favorable.
1. OÙ allons-nous habiter ?
En 2017, on compte en France 35 millions de logements (pour une population totale de 67 millions d’habitants) dont 29 millions de résidences principales, 3,3 millions de résidences secondaires [4] et 2,9 millions de logements vacants [5] . Avec 4,5 millions de logements, le parc social français est l’un des plus larges d’Europe. La construction est aussi particulièrement dynamique puisque la France est le pays d’Europe où l’on construit le plus. Avec 546 logements pour 1 000 habitants (2015), nous avons déjà le taux le plus élevé d’Europe (après la Grèce et le Portugal), loin devant l’Allemagne (487), la Belgique (457), l’Angleterre (438) ou l’Autriche (436).

Les statuts d’occupation apparaissent relativement équilibrés en France. On compte en effet 58 % des ménages propriétaires de leur résidence principale. La part des ménages locataires dans le parc locatif social atteint 17 % et le parc locatif privé abrite 22 % des résidences principales en 2014 [6] . Si le statut de propriétaire semble enviable à la plupart des Français, nombre d’exemples étrangers nous montrent d’une part que ce n’est pas un gage de qualité des logements (pays du Sud) notamment pour les plus modestes et, d’autre part, que le désir de devenir propriétaire comporte des risques et des inconvénients. Risque de surendettement (qui reste limité en France mais très pénalisant pour les ménages concernés), risque de limiter la mobilité professionnelle et par conséquent les opportunités de carrière, surtout en début de vie active. Par comparaison, le parc social permet à un grand nombre de Français d’être logés confortablement à moindre coût, et le parc locatif privé (sauf dans les zones tendues) répond plus facilement aux besoins d’autonomie des jeunes, favorise l’attractivité des territoires et répond aux contraintes de mobilité.
Pourtant, le thème de la « crise » du logement revient depuis longtemps dans le débat politique. Dans un pays de fort dynamisme démographique, le parc immobilier français a longtemps été trop étroit, vétuste, mal adapté, mal entretenu. Le volontarisme de l’État bâtisseur a permis un important effort de construction dans les années d’après-Seconde Guerre mondiale. Dans la première estimation réalisée en 1950 pour la période 1950–1980, on estime le « besoin » de logements à partir de trois composantes : le rattrapage du retard, le renouvellement du parc et l’accroissement du nombre des ménages [7] . En tout, on estime qu’il faut construire 9,6 millions de logements avant 1980, soit 320 000 par an. De fait, on construit 9 millions de logements entre 1954 et 1975 (la taille du parc augmente de 50 %). Le surpeuplement recule nettement avec une hausse de la taille moyenne des logements et une réduction du nombre de personnes par ménage. Une fois la dynamique lancée, le mouvement s’est poursuivi et, entre 1968 et 2013, le nombre de résidences principales s’accroit de 76 % tandis que le nombre d’habitants ne progresse « que » de 28 %. Parallèlement, le confort entre dans les logements : plus d’un logement sur quatre n’avait pas tout le confort sanitaire [8] en 1978, 98 % des logements en sont dotés en 2017. La satisfaction des ménages est au rendez-vous : 15 % des ménages considéraient leurs conditions de logement comme insuffisantes ou très insuffisantes en 1973, ils ne sont plus que 6 % en 2013. Si le rattrapage a eu lieu, pourquoi ce sentiment persistant d’une « crise du logement » ?
C’est que les moyennes nationales cachent des situations contrastées. Les difficultés d’accès au logement sont réelles mais elles sont très localisées, dans des zones dites « tendues ». Par définition, les zones tendues sont celles où la demande de logements est supérieure à l’offre [9] . Ces zones regroupent un tiers de la population française : 22 millions d’habitants situés dans l’agglomération parisienne (ainsi que Beauvais et Meaux), les principales métropoles (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg…), des villes situées dans les régions attractives de l’Ouest et du Sud méditerranéen (Ajaccio et Bastia, Bayonne, Draguignan, Fréjus, La Rochelle, Arcachon, Toulon, Nice, Menton-Monaco…) ainsi que des villes des Alpes (Annecy, Annemasse, Grenoble, Thonon-les-Bains). Le décalage entre les chiffres d’ensemble qui indiquent un nombre moyen de logements par habitant assez satisfaisant (par comparaison à nos voisins) et le sentiment d’avoir du mal à se loger s’explique ainsi : les logements ne sont pas toujours disponibles là où les ménages souhaitent vivre. En particulier, les logements vacants se trouvent dans les zones les moins actives, où les opportunités de travail sont plus rares, et qui sont en outre peu attractives pour les jeunes retraités.

La question n’est donc pas seulement de savoir combien de logements il faut construire mais où il faut construire. Et quels types de logements, avec quelles normes, pour quels types de ménages ?
1.1. Une croissance continue, avec des tensions locales
Les besoins en logements pour les années à venir découleront en premier lieu des évolutions démographiques, plus précisément de l’évolution du nombre de ménages. Celle-ci dépend de deux facteurs : la croissance de la population et la composition des ménages. La croissance de la population dépend de deux composantes : le solde naturel (naissances moins décès) et le solde migratoire (entrées moins sorties). Le nombre moyen de personnes par ménage varie selon les comportements de cohabitation-décohabitation, notamment l’âge de départ des jeunes du domicile de leurs parents, et selon la déformation de la pyramide des âges sous l’effet de l’augmentation de l’espérance de vie. Celle-ci a un impact important sur l’occupation des logements puisque qu’avec l’âge augmente la proportion de ménages d’une ou deux personnes. La statistique publique produit à intervalles réguliers des projections du nombre de ménages fondées sur différents scénarios. La projection moyenne actuelle de l’Insee pour 2040 est de 72,5 millions d’habitants.

Une évaluation des besoins en logements devrait en outre prendre en compte le rattrapage des besoins actuellement non satisfaits, notamment ceux des sans-abri et des ménages en suroccupation, c’est-à-dire qui vivent dans un logement trop exigu par rapport aux normes admises, et le besoin de renouvellement du parc. Une telle évaluation, forcément grossière, fut effectuée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme on l’a vu : elle se justifiait alors par les conditions de logement déplorables dont souffrait une grande partie de la population française. Elle n’a pas été renouvelée depuis lors, la commission du Plan ayant estimé dès 1976 que le retard quantitatif avait été rattrapé. L’Insee, puis le service statistique du ministère chargé du logement se sont ensuite contentés de produire des projections de la demande potentielle.
Ces projections reposent sur des hypothèses dont la solidité est variable. Le vieillissement de la population et ses conséquences semblent pouvoir être anticipés avec un assez haut degré de certitude. Il s’est accentué à un rythme élevé : l’espérance de vie a augmenté de près de 2 % par an de 2008 à 2013, alors que la population générale n’augmentait que de 0,5 %. En 2040, les plus de 65 ans représenteront un peu plus d’un quart de la population (26,1 %). Cela entraînera des besoins nouveaux, en termes de confort, d’aménagement, d’accompagnement, d’autant plus que la volonté de « rester chez soi » au grand âge est de plus en plus forte. Le niveau des retraites permettra-t-il de faire face à ces dépenses de logement ? Les générations qui sont actuellement à la retraite ont, sauf les plus récentes, connu un marché du travail dynamique, des carrières pleines, des situations familiales encore relativement stables et elles ont profité des progrès de la médecine. Les générations qui arriveront à l’âge de la retraite d’ici 2040 auront traversé des périodes moins fastes et connu des carrières plus discontinues, même si la prise en charge médicale a continué à progresser. Le niveau moyen de revenu des retraités par rapport aux actifs devrait lentement se dégrader d’ici 2040 [10] . En outre, la fréquence des séparations, la réduction de la taille des fratries (on comptait 1,82 enfant par famille en 2008 contre 2,11 en 1975 [11] ) risquent de réduire le nombre ou la disponibilité des aidants familiaux et de multiplier les situations de solitude dans le grand âge. La prise en charge du grand âge, qui est déjà un sujet émergent aujourd’hui, va s’affirmer dans les années à venir et sans doute donner lieu à des innovations techniques et sociales. Le logement se trouvera en tout cas au centre de ces nouveaux besoins.
Les hypothèses portant sur les comportements de cohabitation-décohabitation sont plus fragiles car en partie liées aux conditions économiques et à l’évolution des modes de vie. Si l’indépendance économique n’est pas une condition nécessaire de la décohabitation juvénile, elle en est cependant l’un des déterminants principaux. Il est difficile également de faire un pronostic à long terme sur le taux de séparation des couples, qui impacte la demande de logements : deux logements au lieu d’un sont nécessaires avec, dans chacun d’eux, le cas échéant, des chambres d’enfant chez les deux parents séparés.

Au-delà de l’exercice, assez bien maîtrisé, de projection du nombre de ménages, les évaluations prospectives souffrent de plusieurs faiblesses. La principale est qu’elles considèrent les logements comme interchangeables, quels que soient leur localisation, leur taille et leur prix. Or, on le sait ( cf. infra ), les évolutions démographiques sur le territoire français ne sont pas homogènes et les marchés du logement sont avant tout locaux.
En outre, les statisticiens n’ont guère d’éléments sur lesquels se fonder pour évaluer le renouvellement futur du parc. À cet égard, l’augmentation, depuis une quinzaine d’années, du taux de logements vacants mériterait une analyse fouillée. Interpréter cette augmentation comme la conséquence d’une surproduction semble insuffisant. La vacance résidentielle est moins fréquente dans les aires urbaines des métropoles régionales, là où le marché de l’immobilier est tendu [12] . Elle est plus marquée dans les territoires les moins dynamiques (départements du centre, du Massif central ou du Grand Est), comme les espaces ruraux reculés et surtout dans les centres des villes moyennes ou des petites villes les plus éloignées des métropoles régionales. Pourquoi, dans ces communes, ces logements, le plus souvent anciens et centraux, sont-ils délaissés au profit d’autres, plus récents et plus périphériques ? La réponse à cette question tient manifestement au choix des ménages concernés : choix de la maison individuelle contre l’appartement, du péri-urbain contre le centre, de l’utilisation de la voiture individuelle contre les transports en commun. En d’autres termes, raisonner en termes de besoins ne permet pas d’expliquer des phénomènes liés à la demande : les logements délaissés correspondent peut-être, sur le papier, aux besoins de certains ménages, mais ceux qui ont le choix en préfèrent d’autres.
Enfin, les projections ne prennent pas directement en compte l’évolution des modes de vie. Or la pratique de la double résidence se développe : par exemple, un logement en province et un pied-à-terre à Paris ou en région parisienne. En Allemagne, ces ménages sont dénombrés, mais pas en France où, de ce fait, on se contente d’intégrer dans les projections une demande de résidences secondaires à partir de l’observation du passé récent.
Tout compris, les estimations des besoins de construction à l’horizon 2030 (CGDD/Commissariat général au développement durable) se situent entre 327 000 et 350 000 logements chaque année. Avec une capacité de production située à 335 400 unités en moyenne en 2014–2015, nous sommes dans une échelle de grandeur cohérente avec les capacités actuelles. L’effort de construction, qui est même monté à 428 900 logements en 2017, doit donc être maintenu pour rester capables de répondre au besoin futur de logements [13] .
Ces chiffres concernent néanmoins l’échelle nationale. Or, les tendances démographiques ont une signification différente en fonction de la localisation. Ici, c’est le manque de logements qui domine – c’est le cas des zones en tension. Là, c’est au contraire la vacance qui apparaît comme le problème essentiel – c’est le cas des zones en déprise. Ailleurs encore, le logement n’est pas un enjeu majeur, avec un marché stable, des logements sociaux accessibles, un parc locatif privé convenablement occupé, etc. Mais cet entre-deux est en fait plus rare : ce qui caractérise la dynamique, c’est bien la polarisation entre les zones à faible densité et celles à forte densité [14] . Comment comprendre la géographie qui se dessine et quelles sont les dynamiques qui façonneront la carte de France dans vingt ans ?
1.2. Une concentration en tache d’huile
La dynamique des localisations à l’horizon 2040 dépend de deux tendances fortes qui sont déjà à l’œuvre et qui vont se poursuivre.
1. Un accroissement de la population favorable à une zone en U, allant de Rennes à Lyon en passant par le Sud-Ouest et les façades maritimes atlantique et méditerranéenne, géographie à laquelle il faut naturellement ajouter l’Île-de-France. Ce mouvement poursuit une tendance à la littoralisation du peuplement français qui s’observe depuis longtemps. Symétriquement, on note un moindre dynamisme du quart Nord-Est, ainsi que la permanence de la « diagonale du vide », des Ardennes au Cantal.

Ces mouvements s’observent également dans la carte de l’emploi, qui se développe surtout dans cette zone en U, avec une place singulière de Paris et de l’Île-de-France. La différence entre territoires en développement et territoires en recul est encore plus marquée pour l’emploi que pour le peuplement : les pertes d’emplois sont notamment plus fortes dans les territoires en recul.

2. La dissociation est croissante entre les lieux de résidence et les lieux de travail. Les emplois se développent dans les villes-centres et les cœurs d’agglomération, alors que l’habitat s’installe de plus en plus en périphérie. À l’échelle locale, on voit donc une dynamique différenciée de l’emploi et de la population. Ce qui entraîne une augmentation moyenne des temps de transport entre résidence et travail. Une part croissante de la population fait la navette (un « navetteur » travaille dans une commune différente de sa commune de résidence) entre sa résidence et son lieu de travail : on dénombrait, en 2012, 17 millions de navetteurs sur 26 millions d’actifs [15] . En outre, les distances parcourues s’allongent. Un enjeu majeur de l’habitat dans vingt ans est donc le transport (durée, accessibilité, desserte, etc.). Les zones géographiques qui connaissent une forte croissance des emplois et de la population sont aussi celles où les temps de trajet quotidiens sont les plus importants. L’enjeu principal du transport des personnes aujourd’hui n’est plus dans la connexion de longue distance (par exemple, les voies TGV dans une logique d’aménagement du territoire) mais dans les déplacements quotidiens à l’échelle locale.
Le temps consacré aux déplacements pour aller travailler est en progression : on l’évaluait à 40 minutes en 1998, 50 minutes en 2010 [16] , 60 minutes en 2018 (ce qui correspond à la moyenne de nos voisins européens [17] ). Les habitants des petits pôles urbains et des communes isolées ont des temps de transport très inférieurs (respectivement 35 minutes et 37 minutes) aux habitants des grands pôles urbains (43 minutes), de ceux des couronnes des grands pôles (57 minutes) et des habitants de l’unité urbaine de Paris (68 minutes) [18] .
La distance parcourue entre la résidence et le lieu de travail a également augmenté à mesure que l’offre de transport s’est développée. L’arbitrage entre confort résidentiel et temps de transport a conduit à l’augmentation des distances parcourues dans les première et deuxième couronnes. En d’autres termes, l’amélioration des moyens de transport (y compris de l’efficacité énergétique des voitures individuelles) n’a pas permis de gain de temps mais a favorisé la dispersion spatiale de l’habitat.
La concentration spatiale liée au phénomène de la métropolisation présente donc une double configuration. D’une part, à l’échelle nationale, on voit se dessiner une carte organisée à partir des pôles métropolitains. Ce sont eux qui attirent la population et les emplois. D’autre part, on voit se dessiner une tache autour de chaque pôle : c’est la progression démographique aux environs du cœur de l’agglomération. On observe donc une polarisation en faveur des métropoles mais aussi une diffusion de l’habitat autour des métropoles. Ce mouvement est particulièrement marqué autour de l’Île de France et dans la zone en U déjà évoquée. Ce sont donc les communes situées dans la périphérie des métropoles qui se développent le plus, ce qui correspond à un compromis lié au coût du logement mais aussi à l’aspiration des ménages à un style de vie à la fois urbain, « à taille humaine » et « proche de la nature » : la moitié des Français qui souhaitent déménager aimeraient s’installer dans une ville petite ou moyenne à proximité d’un pôle urbain [19] . Les centres des métropoles, eux, connaissent des progressions moins fortes de leur population résidente, voire une diminution comme c’est le cas à Paris [20] . À proximité des métropoles, la progression est plus forte dans les communes les plus petites (moins de 15 000 habitants). On assiste donc à une concentration de la population dans la périphérie des grandes aires urbaines, notamment en région parisienne et dans l’arc atlantique.
À l’inverse, dans la zone la moins dynamique (le quart Nord-Est, à l’exception de l’Alsace), le déclin démographique peut concerner certains centres urbains (Bar-le-Duc, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges…). Mais ces centres urbains sont en général de taille moyenne et se situent dans une zone qui a déjà perdu beaucoup de population.
En ce qui concerne le logement, les zones qui connaissent le plus de constructions sont les littoraux, la Corse et les Alpes, ce qui correspond aux zones dont la population croît. Ce phénomène héliotropique et de « course vers la mer » va se poursuivre. La façade atlantique, compte tenu de la topographie du relief, reste un espace propice à la construction et connaîtra donc une urbanisation plus forte. En revanche, on ne construit pas assez dans les zones dynamiques de l’Île-de-France et de la région lyonnaise, où le foncier disponible est rare, peu accessible et cher. Le logement est difficile d’accès (calculé en nombre d’années de revenu nécessaires pour acquérir un logement, par exemple) surtout dans le Grand Paris, mais aussi dans les autres métropoles, les littoraux, les zones frontalières et les Alpes. Symétriquement, les logements vacants se trouvent sans surprise surreprésentés dans la diagonale du vide (à l’exception des pôles urbains).
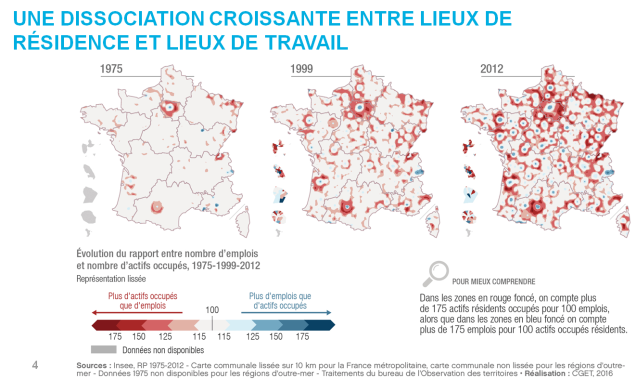
UNE DISSOCIATION CROISSANTE ENTRE LIEUX DE RÉSIDENCE ET LIEUX DE TRAVAIL
Dans un pays attaché à l’aménagement du territoire, les images de dépeuplement de villes moyennes ont un impact symbolique important. Bien qu’il concerne des zones dont le poids démographique est faible, le dépeuplement pose cependant la question de l’avenir de territoires peu denses et peu attractifs, dont les défis sont symétriquement inverses à ceux des métropoles.
Toutes les zones rurales ne sont cependant pas en déclin démographique. Plusieurs phénomènes se conjuguent. Tout d’abord, le développement métropolitain se diffuse dans le territoire alentour, au-delà même de la périphérie urbaine immédiate, et touche des zones rurales plus distantes qui regagnent donc de la population (néoruralisme, étalement urbain) [21] . Mais le gain de population des petites communes se limite à la proximité des métropoles. Les nouveaux actifs des zones rurales sont des navetteurs qui vont travailler dans une aire urbaine. Le nombre croissant des navetteurs exprime une forte dépendance des communes rurales aux aires urbaines, particulièrement aux emplois qu’elles procurent. Mais les communautés de communes situées au-delà de 30 minutes en voiture des métropoles ne gagnent plus de population. Par ailleurs, le regain démographique enregistré entre 2006 et 2011 ne s’est pas confirmé dans la période plus récente (2011–2016) : alors que ces territoires éloignés avaient progressé plus rapidement que la moyenne entre 2006 et 2011 (+ 0,8 % par an), ce rythme a été divisé par deux et s’aligne à présent sur la moyenne nationale (+ 0,4 % par an) [22] . Dans certaines communes rurales, le déficit naturel n’est plus compensé par l’arrivée de nouveaux habitants, sauf dans les communes rurales du Sud. Outre les retraités qui stimulent l’économie résidentielle, les nouveaux arrivants ont parfois un profil d’actifs souhaitant changer de travail et de mode de vie, en général diplômés et tournés vers le développement durable, qui produisent une forme de « gentrification rurale [23] ». Si ce mouvement apparaît encore faible et marginal aujourd’hui, il est peut-être l’amorce d’une nouvelle tendance d’installation, à la recherche d’une qualité de vie opposée au rythme de la métropole, et qui peut se révéler favorable à un rééquilibrage territorial vers les zones les moins denses.
Les territoires vont aussi se différencier en fonction du poids du vieillissement. On peut distinguer de ce point de vue quatre types de situations. Les espaces ruraux (communes isolées situées en dehors de l’influence des pôles urbains) connaissent aujourd’hui déjà le vieillissement (mesuré à la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la population générale de la commune) qui sera celui de la moyenne nationale en 2040 (26 %). Ces espaces connaîtront peu de bouleversements dans la mesure où le nombre de personnes âgées y est déjà élevé et restera dans la moyenne nationale. Il existe en revanche des espaces qui connaissent déjà une forte proportion de personnes âgées et qui en accueilleront encore davantage : les zones littorales attractives du Sud et de l’Ouest qui attirent particulièrement les jeunes retraités. Dans les territoires où la population est plus jeune, en particulier les métropoles, leurs périphéries, les zones frontalières de l’Est et du Nord, le vieillissement représentera un défi d’équipements et de services puisque les ménages fixés par l’activité et les emplois resteront sans doute sur place en grande partie après l’âge de la retraite. Enfin, dans un quatrième cas de figure, certains territoires jeunes ne retiennent pas les personnes arrivées à l’âge de la retraite (essentiellement dans le nord de la France) et garderont par conséquent un taux relativement stable et plutôt faible de personnes âgées [24] .
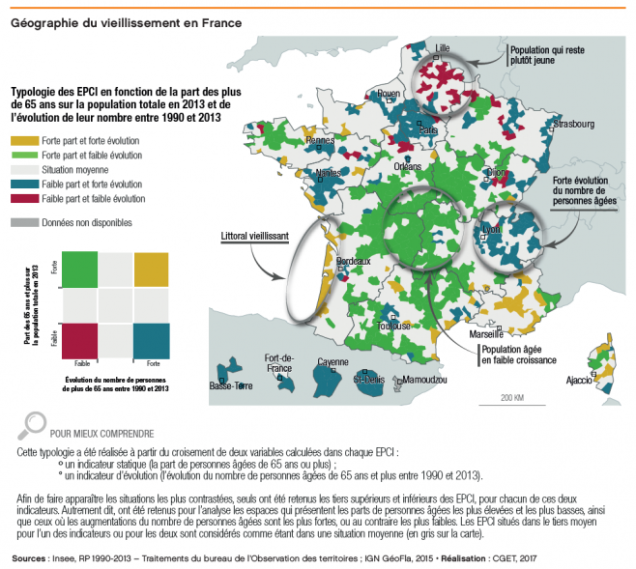
1.3. Les effets inégalitaires du changement
La prospective sur ces grandes tendances qui vont affecter la demande de logement invite à anticiper une importante dynamique inégalitaire en fonction des territoires.
À l’échelle nationale, les tendances déjà évoquées (1.1.) vont maintenir une forte demande de logement qui tirera très probablement les prix à la hausse. On observe déjà que les ménages doivent consentir en moyenne un effort toujours plus important pour se loger : ils consacraient en moyenne 18,3 % de leurs revenus au logement en 2013 contre 16,1 % en 2001. Mais cet accroissement est supporté plus lourdement par les ménages les plus modestes (premier quartile) : 31,3 % en 2013 (24,9 % en 2001). Et parmi ces ménages, ce sont les locataires du secteur libre qui ont subi la plus forte progression puisqu’ils sont passés d’un taux d’effort de 32,8 % à 40,7 % [25] .
Ces chiffres cachent cependant des disparités territoriales importantes. Il faut donc anticiper, outre les inégalités liées au patrimoine et aux revenus (le premier quartile consent un effort plus important que les autres), des inégalités liées à la localisation. Deux facteurs vont en effet accroître le poids de la localisation sur la facilité ou la difficulté d’accès au logement.
D’une part, le développement métropolitain rend l’accès au logement plus coûteux et plus sélectif. Les inégalités risquent donc de se développer à l’échelle métropolitaine, comme on le voit en partie avec le phénomène de « gentrification » par lequel des quartiers populaires voient arriver de nouvelles populations, au revenu plus élevé, qui contribuent à l’augmentation des loyers ou du coût du logement. Si ce mouvement transforme profondément la sociologie de certains quartiers, il n’est cependant pas homogène sur l’ensemble du territoire et correspond localement à un accroissement des inégalités visibles localement. Ces inégalités sélectionnent la population en fonction du revenu mais creusent aussi des limites générationnelles liées au coût d’entrée sur le marché, les jeunes ménages cherchant à se loger supportant l’augmentation des prix alors que les ménages installés ne sont pas directement exposés à leurs variations. Contrairement à une idée de plus en plus répandue, les métropoles ne réunissent pas seulement des ménages aisés : elles abritent de fortes inégalités en leur sein. Ainsi, 77 % des ménages pauvres vivent dans les grands pôles urbains [26] . L’Île-de-France rassemble près d’un tiers des personnes mal logées en France.
D’autre part, à l’échelle nationale, une inégalité se développe entre territoires en croissance et territoires en déclin. Le développement métropolitain est une tendance de long terme, qui s’observe à l’échelle mondiale. Les métropoles sont branchées sur le développement économique lié à la mondialisation. La localisation de l’activité économique à l’âge industriel était tributaire de la localisation des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ce qui signifiait une dispersion de l’activité économique sur le territoire en fonction d’atouts locaux. Dans une économie post-industrielle, ces atouts ont changé de nature. La division du travail se fait à l’échelle internationale et les avantages comparatifs de l’âge industriel sont remis en cause. La connexion aux lieux de décision économique internationaux prévaut sur les ressources locales, ce qui entraîne la concentration de l’activité dans les grandes métropoles. Cependant, les effets territoriaux de cette concentration sur l’atout métropolitain ne sont pas homogènes. Si les métropoles concentrent l’emploi et contribuent largement à la création de richesse, des systèmes de redistribution publics et privés irriguent l’ensemble du territoire. La région Île-de-France, par exemple, contribue pour près d’un tiers à la création de richesse nationale mais ne dispose que d’un peu plus d’un cinquième des revenus des ménages français. Et l’écart se creuse : la contribution de l’Île de France au PIB est passée de 27 % à 31 % entre 1975 et 2010 mais les revenus des Franciliens sont passés dans le même temps de 25 % à 22,5 % des revenus des ménages français [27] . En outre, l’activité et le dynamisme des métropoles régionales débordent sur les territoires proches. Albi ou Rodez bénéficient de la croissance de Toulouse, comme Libourne croît grâce à Bordeaux, Angers grâce à Nantes, Vienne grâce à Lyon, etc. On peut donc décrire des espaces sociaux-productifs interdépendants qui associent les métropoles à leurs périphéries [28] . Mais des morceaux de territoires restent à l’écart de la dynamique métropolitaine et sont confrontés à une perspective de déclin difficile à enrayer (Troyes, Chaumont, Auxerre, Nevers, Montluçon, Aurillac, Carcassonne…). La croissance métropolitaine est donc par nature créatrice d’inégalités territoriales.
Plus précisément, comment peut-on décrire le lien entre les métropoles et leur espace avoisinant ? On a longtemps craint une forme d’ « aspiration » des richesses vers les villes, au détriment des campagnes (« Paris et le désert français »). C’est cette vision qui a longtemps conduit à promouvoir une forme d’aménagement du territoire visant à déplacer des activités des villes prospères vers des zones défavorisées. Une telle vision apparaît aujourd’hui dépassée puisque c’est précisément la concentration des activités qui apparaît comme un atout et un facteur d’attractivité. L’État doit-il chercher à brider le mouvement métropolitain au nom de l’égalité des territoires ? En aurait-il d’ailleurs les moyens ? Sans doute que non. La dynamique a de fortes chances de se poursuivre dans la mesure où elle correspond à des mouvements qui s’observent à l’échelle mondiale. Les raisons de la productivité des métropoles restent discutées par les économistes : les entreprises y bénéficient-elles de coûts inférieurs, d’une plus grande capacité à innover, des bénéfices de l’économie de la connaissance ? Pour la nouvelle géographie économique, l’agglomération permet une meilleure division locale du travail, un meilleur appariement sur le marché du travail et une circulation informelle des connaissances favorable à l’innovation. L’observation est, en tout cas, partagée : les effets de proximité géographique comptent dans la nouvelle économie internationalisée. Au final, c’est dans les métropoles que la croissance de l’emploi est la plus forte. Entre 1975 et 2011, l’emploi a plus progressé dans les métropoles (+ 30,8 %) que dans le reste du territoire (+ 18 %) [29] .
Mais les métropoles se contentent-elles de capter l’activité ou bien ont-elles un effet d’entraînement sur leur voisinage ? Toutes les métropoles n’entretiennent pas les mêmes relations à leur environnement. Dans l’ensemble, on observe un « développement associé » ou un « effet de débordement » entre les métropoles et leur voisinage. Il ne prend cependant pas toujours la même forme. On peut distinguer trois situations. Tout d’abord, des métropoles dont la performance reste relativement isolée au sein de leur territoire. C’est le cas de Lille dont le développement n’est plus lié aux anciennes activités industrielles qui marquent encore le reste de la région (Roubaix) même quand elles se sont renouvelées (Douai, Valenciennes). Toulouse présente aussi, dans un contexte différent, un développement très lié à la filière aéronautique dont l’entraînement est très localisé. Montpellier, dont l’activité relève plutôt de l’économie résidentielle, présente aussi le cas d’une ville plus dynamique que son environnement. Deuxième cas de figure : les métropoles qui partagent leur dynamique, comme Lyon et Rennes qui s’inscrivent dans une logique de codéveloppement avec leur région. Bordeaux, Marseille et Nantes, par exemple, ont un effet dynamisant sur les territoires contigus. Enfin, dans un dernier cas de figure, on relève des villes moins actives que leur environnement : Strasbourg et Grenoble par exemple n’apparaissent pas comme des moteurs régionaux puisque leur activité est moins favorable que celle des régions qui les entourent. Dans une sous-catégorie de ce profil défavorable, Nice et Rouen ont une situation doublement négative, la ville connaissant une atonie partagée par le reste du territoire [30] .
Dans la mesure où l’on observe un écart entre les zones dynamiques et les zones en recul, quelle est la réponse politique à apporter ? Faut-il soutenir les territoires en crise ou aider les habitants à s’installer ailleurs ? Faut-il aménager ou (encourager à) déménager ? La réponse n’est pas évidente pour les pouvoirs publics, qui doivent prendre en compte les représentations des habitants eux-mêmes. On observe sans surprise une corrélation entre l’aspiration à déménager et la perception des difficultés du territoire (ou le sentiment de déclin du soutien public) [31] . Mais le souhait de déménager n’est pas également partagé. Les habitants les plus optimistes sur leur évolution personnelle se disent prêts à bouger. En revanche, plus on se sent en difficulté, moins on est prêt à déménager. Cela montre que le territoire, même en difficulté, est vu comme une ressource, et une ressource d’autant plus précieuse qu’on est plus modeste. Une ressource au sens de la solidarité familiale et de l’aide informelle qui sont liées au territoire local, ainsi que les réseaux de connaissances et d’amitiés qui s’y développent, réseaux par lesquels on a le plus de chances de retrouver un emploi [32] . En outre, une grande partie des jeunes à la recherche d’un premier emploi, des chômeurs ou des personnes en situation de précarité anticipent leur difficulté à déménager, ce qui a toujours un coût (le déménagement lui-même, la caution, le rééquipement…). Ils anticipent également la difficulté à trouver ou retrouver un logement dans le parc social, et déclarent plutôt attendre une aide de l’État pour pouvoir réaliser leur projet dans le territoire où ils vivent. Au final, les gens qui ont le plus besoin de bouger ont le moins la capacité de le faire. Un facteur de plus d’aggravation des inégalités entre les territoires en développement et ceux qui offrent moins d’opportunités.
Finalement, la localisation géographique des logements va compter plus que jamais dans les vingt ans qui viennent. La dynamique en cours conduit à une concentration de l’habitat dans l’espace métropolitain ou à sa proximité, sur les littoraux et dans le Sud. Cette géographie de l’habitat signifie des inégalités territoriales mais elle entraîne également des difficultés dans les modes de vie, pour la santé, l’équilibre de la vie familiale et l’impact environnemental. C’est pourquoi les pouvoirs publics doivent continuer à se préoccuper des effets du développement métropolitain et en particulier garder une vision de l’aménagement du territoire adapté aux nouveaux défis. La politique du logement est, de ce point de vue, un facteur structurel de l’attractivité des territoires et des équilibres territoriaux. Mais jusqu’à quel point la concentration spatiale des activités et des logements est-elle souhaitable ?
2. Avec qui (co)habiter ?
Si l’on se fie à des projections prudentes concernant les deux décennies à venir, il apparaît que le nombre d’habitants à loger est une question moins déterminante que la localisation du besoin de logement. Or, l’observation des dynamiques territoriales en cours nous conduit à un dilemme : les tendances longues du développement économique conduisent à une concentration de l’activité dans le cœur des aires urbaines. Si elle s’accompagnait d’une concentration équivalente de l’habitat dans le cœur des grandes aires urbaines, elle serait difficilement soutenable en raison des inconvénients de la trop forte concentration spatiale. Mais la réponse actuelle à cette tendance excessive à la densité urbaine consiste dans la diffusion spatiale de l’habitat qui présente aussi des inconvénients majeurs. En d’autres termes, il n’existe sans doute pas de réponse uniquement territoriale à la dynamique en cours. La concentration de l’habitat atteint ses limites, parce qu’elle entraîne trop de nuisances. Mais l’étalement urbain pose de redoutables problèmes d’aménagement dans une perspective de développement durable. Une réponse à ce dilemme peut venir d’une meilleur utilisation des espaces en multipliant les usages des espaces ou du territoire en fonction de temporalités variées et compatibles entre elles.
La concentration urbaine peut atteindre un seuil qui risque de multiplier les coûts. Pour construire en ville, il faut tout d’abord accéder au foncier qui sera toujours plus rare et plus coûteux. Les quelques terrains disponibles sont en outre difficiles d’accès (dents creuses) et imposent des contraintes à la construction (accessibilité, emprise des immeubles mitoyens…). L’alternative réside dans la réhabilitation de logements dégradés ou anciens qui est parfois plus coûteuse que la construction neuve, surtout en tenant compte de normes environnementales élevées. La rénovation urbaine se heurte en outre à des problèmes d’échelle : il vaut mieux rénover tout un quartier qu’un bâtiment seul mais cela suppose une bonne anticipation urbaine, c’est-à-dire une continuité de la volonté politique d’aménagement local. Dans certaines métropoles (surtout à Paris), la densité a déjà probablement atteint un plafond. Les perspectives offertes par la reconstruction des immeubles, la conversion de bureaux en logements, la surélévation de quelques étages ou l’occupation plus systématique des sous-sols n’offrent pas une perspective adaptée : soit le nombre de logements ainsi créés reste trop faible, soit le coût de ces logements (surtout dans le cas de la surélévation) est dissuasif [33] .
Pour la plupart des ménages, cette inflation des coûts réduit l’attractivité de la ville. D’autant plus que leurs aspirations ne correspondent pas toujours aux formes architecturales anciennes. Ainsi, à superficie égale, la luminosité des appartements arrive en tête des critères de choix immobiliers, ainsi que le désir de jouir d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia [34] . En outre, les évolutions de la vie de famille (divorce, famille recomposée, vieillissement et allongement de la durée de vie…) suscitent une demande de logements évolutifs et modulables souvent peu compatibles avec les contraintes de la vie en immeuble.
Cependant, l’alternative à la ville dense présente également de nombreux inconvénients liés à l’étalement urbain. L’extension de la ville, surtout telle qu’elle se fait en France, avec des programmes pavillonnaires, prend beaucoup d’espace, qui est en rivalité avec les autres usages : production agricole ou espaces paysagés artificiels ou naturels qui sont aussi des lieux de loisirs, de promenades, etc. Elle entraîne l’artificialisation des sols, le développement onéreux des infrastructures de réseaux, de moindres économies d’échelle sur les équipements, des contraintes de mobilité (éloignement du lieu de travail et des aménités urbaines), un risque d’isolement pour les personnes âgées qui ne peuvent plus utiliser leur voiture… Pour des raisons sociales autant qu’environnementales, l’urbanisation de nouveaux espaces sur les rythmes actuels n’est donc pas une option appréciable.
Pour surmonter cette contradiction et développer la qualité de vie à un coût abordable dans la ville dense, on peut imaginer une réponse par un changement des usages, qui commence d’ailleurs à se développer. La perspective est ici celle de l’optimisation des surfaces habitables en ville par un partage des espaces. La destination collective de certains espaces des immeubles a été recherchée par de nombreux projets architecturaux et parfois de petites utopies urbaines dans le passé (familistère de Guise). Plus modestement, des programmes en cours répondent à cette attente sous la forme d’une conciergerie (ou, sous forme numérique, à travers une e-conciergerie) très développée, qui permet de gérer des espaces partagés comme le parking, une buanderie, etc. C’est déjà le cas par exemple de projets en cours comme Smartseille d’Eiffage à Marseille ou Lil’Seine. Les habitants des logements sociaux demandent fréquemment de disposer de salles libres, au-delà de l’association des locataires, pour d’autres usages (garde partagée des enfants, aide aux devoirs…). Dans des projets participatifs conçus par des habitants eux-mêmes, on voit cette même logique développée de manière plus ambitieuse avec des pièces communes/partagées beaucoup plus nombreuses : pas seulement une buanderie, mais une terrasse (avec potager collectif), une salle à manger, une salle de jeux pour les enfants, une salle de réunion (à louer pour des usagers venant de l’extérieur) [35] . Une transformation des usages qui pourrait nous permettre de vivre mieux avec autant d’espace disponible, ou même moins d’espace.
Ce type de projet a-t-il une chance de se développer ? Il se heurte évidemment à la stabilité des manières d’habiter, qui évoluent lentement et qui dépendent de choix de vie beaucoup plus profonds que le seul aménagement de l’espace, comme le rapport à la vie de famille, à l’intimité, à l’hygiène, etc. Sur la longue durée, la stabilité des usages est remarquable. L’invention de la chambre à coucher, du couloir ou de la salle de bains correspondent à des évolutions lentes des mœurs, à des courants silencieux de l’histoire culturelle, touchant à des phénomènes de longue durée comme le changement du rapport à soi, à travers l’affirmation de l’intimité ou l’adoption de nouvelles normes d’hygiène [36] . Le logement exprime le besoin anthropologique d’un espace protecteur, familier, rassurant [37] , on ne peut pas être indéfiniment mobile ou sans « chez soi ».
2.1. L’habitant multi-situé et poly-actif
Comme nous l’avons vu, la géographie des emplois et la géographie de l’habitat suivent des tendances inverses, qui conduisent en grande partie à concentrer les emplois dans certaines parties des aires urbaines et à diffuser l’habitat dans d’autres, souvent en direction des périphéries. Il en résulte des contraintes de transport pour les urbains, dont les mouvements pendulaires sont en progression. En 2018, les actifs occupés passent en moyenne une heure dans les transports en allant à leur travail [38] . Les ménages doivent arbitrer entre le coût du logement et le coût du transport, qui grèvent leur revenu disponible. Ce modèle « métro-boulot-dodo », dénoncé depuis longtemps, a probablement atteint ses limites. On peut ainsi voir émerger de nouveaux rapports entre habitat et travail, qui cherchent à répondre aux coûts et à la dégradation de la qualité de vie (stress, fatigue…) liée à la concentration urbaine, au temps de transport et à l’inconfort des transports aux heures de pointe. Si 11 % seulement des actifs vont à leur travail en transports en commun, ce chiffre est en forte augmentation, en particulier en Île-de-France [39] . Les projections avancées par le ministère de la Transition écologique et solidaire aux horizons 2030 et 2050 tablent sur une progression de 29 % de la demande de déplacements à courte distance, une moindre motorisation des ménages, une densification des agglomérations et une offre fortement accrue de transports en commun (+ 58 % entre 2012 et 2030) [40] .
Pour limiter les inconvénients des migrations pendulaires, les entreprises développent le télétravail, encouragées par les évolutions législatives récentes [41] . Des accords d’entreprise toujours plus nombreux sont signés pour favoriser et encadrer le travail à domicile et le travail à distance. Des grands groupes signent par exemple ce type d’accord quand un déménagement de siège défait les routines et les arrangements des salariés (Orange, SFR, Aéroports de Paris, Société Générale …). En 2013, 17 % des Français travaillent au moins une fois par semaine en dehors du bureau, le plus souvent chez eux (dans 79 % des cas, le télétravail se fait à domicile). C’est dans la fonction publique que ce type de pratique est le moins développé, souvent en raison des contraintes liées au service des usagers [42] . Un télétravailleur gagne 80 minutes par jour télétravaillé en Île-de-France [43] . Mais les gains collectifs sont encore plus importants : les réseaux de transports sont moins saturés, la pollution de l’air est moindre, les entreprises peuvent économiser des surfaces de bureau et les ménages gagnent du temps personnel ou familial. La personnalisation des agendas quotidiens se développe, comme le montre l’augmentation de la part des actifs qui fixent eux-mêmes leurs horaires (indépendants et cadres). Celle-ci est supérieure en Île-de-France à celle des autres régions et elle augmente, passant de 13 % à 23 % entre 1994 et 2008. Ce chiffre culmine même à 31% à Paris [44] . De ce fait, comme l’observe la sociologue Monique Eleb, le travail prend toujours plus de place dans l’occupation des logements [45] . Les salons deviennent souvent des lieux consacrés au travail ou envahis par le travail (écrans et ordinateurs, dossiers, etc.). Les salariés consultent leurs mails à la maison, poursuivent leur travail à domicile, après leurs heures de bureau. En outre, les loisirs se font aussi plus souvent à domicile avec l’équipement des ménages en matériels hi-fi (musique, télévision, Internet…). Dans l’ensemble, on passe ainsi toujours plus de temps chez soi et on aménage son domicile en fonction de cette occupation beaucoup plus intense et multi-usage, qui n’a souvent pas été anticipée dans les projets architecturaux.
En parallèle, dans les entreprises, une réorganisation des espaces de travail favorise une nouvelle architecture intérieure avec des bureaux très flexibles. Dans beaucoup de nouveaux bureaux, un salarié n’a plus d’espace attribué, il doit partager ou changer de lieu en cours de journée ( flex office ). L’objectif des entreprises est d’optimiser les surfaces pour réaliser des économies sur l’immobilier, surtout en centre-ville. En contrepartie, des espaces de travail beaucoup plus modulables sont proposés (voir les projets architecturaux par exemple de Philippe Chiambaretta).
L’organisation du travail se traduit aussi par des horaires plus fréquemment atypiques, c’est-à-dire en dehors des horaires standard du lundi au vendredi. Ainsi, 44 % des salariés sont soumis à des horaires atypiques le soir (entre 20 h et minuit), la nuit, le samedi ou le dimanche [46] . La désynchronisation des temps sociaux qui en résulte organise autrement l’occupation des lieux. Les grandes séquences collectives rythmées par des déplacements entre les logements et le travail sont moins homogènes que par le passé. On voit dans ces décalages des opportunités pour faciliter une occupation plus continue des espaces, en limitant les moments de pointe dans les transports et les lieux publics de « commuting ».
En outre, on remarque un développement du travail indépendant, ou du style de travail indépendant, qui concerne aussi désormais des salariés poussés par leur management à se multi-localiser. Des actifs nomades et des « slashers » (actifs menant plusieurs activités) travaillent donc dans différents espaces, dans une entreprise quand ils doivent mener une mission, chez eux, ou dans des tiers-lieux qui leur procurent la connexion et l’espace de travail minimal dont ils ont besoin. Le développement de ces tiers-lieux, dans les gares parisiennes par exemple, montre bien le nouveau rapport qui s’installe entre mobilités, lieux de connexion et nouvelle organisation du travail. On observe ainsi le développement rapide de projets de lieux de coworking . L’idée est d’accompagner ce nouveau mode de travail dans le développement d’un style de vie plus nomade, qui pourrait aussi trouver une extension dans le logement, sous la forme du coliving . De manière informelle et peu organisée, la colocation rendue plus facile par les technologies numériques (de nombreux sites sont dédiés aux appariements de colocataires), s’est développée depuis plus d’une décennie pour les étudiants (c’est le cliché « Auberge espagnole ») et touche désormais les jeunes actifs.
Coworking et coliving sont parfois développés par les mêmes opérateurs, ce qui s’explique par le fait que les projets de coliving recouvrent souvent à la fois un projet personnel et professionnel. Par exemple à Paris, la station F développe une résidence pour jeunes professionnels (Flatmates) afin d’attirer des entrepreneurs dans son incubateur, en levant l’obstacle de l’accès au logement [47] . Le coliving peut intéresser tout type de population, même si la majorité des expériences vise de jeunes professionnels urbains qui ont un bon niveau de revenu et ne sont pas encore installés en famille (25–33 ans). Le trait commun de ces lieux de cohabitation est qu’ils proposent des espaces de vie associant espaces privés et espaces communs, des services ajoutés plus ou moins développés et qu’ils promettent une expérience de vie en « communauté », au moins dans un réseau interpersonnel assez dense [48] . « Si l’engouement est réel, c’est que le concept répond à des besoins évidents : le manque d’appartements disponibles pour des colocations, la solitude dans les grandes villes, la montée du célibat, le besoin de flexibilité et, surtout, l’explosion des loyers dans les grandes métropoles [49] . » On recense déjà environ 700 acteurs dans le monde, dont la plus grande partie se trouve encore proche du lieu de naissance de l’idée, à San Francisco (194 projets). Le groupe le plus important, « The Collective », vient de Londres et a levé beaucoup d’argent récemment pour se développer. C’est un des rares acteurs qui atteint une taille suffisante pour développer des projets de grande ampleur.
Avec une trentaine de projets, la France n’est pas à la pointe du mouvement mais elle est tout de même dans le jeu. Voir par exemple « The Babel Community » qui développe un projet à Marseille, rue de la République [50] ; « Colonies » qui gère déjà trois sites (Arsenal, La Défense, Fontainebleau [51] ) ; « WeLive [52] » qui est une filiale de « WeWork »; « Lime » au Pays Basque [53] …
Les acteurs qui viennent du coworking sont bien placés sur le nouveau marché du coliving . Par exemple, WeWork, né en 2012 à New York, compte maintenant 400 implantations dans le monde, avec 200 000 clients (on les appelle coworkers ), et un fichier client prometteur pour une offre de coliving . C’est aujourd’hui l’acteur le mieux valorisé de l’immobilier tertiaire. Bien que cette entreprise ait perdu 1 milliard USD en 2017, sa valorisation boursière est deux fois supérieure à celle d’Accor (35 milliards USD). Toutes ces offres proposent des lieux bien situés, « suréquipés », avec des offres « tout compris », sans engagement, et un préavis limité au maximum. Les tarifs sont bien sûr élevés : à Marseille, à partir de 520 euros par mois pour une chambre dans un appartement partagé. À Paris, Flatmates veut casser les prix en annonçant 400 euros par mois. Ces projets ne se préoccupent pas de mixité sociale ou intergénérationelle, ils s’adressent à un profil très limité de jeunes professionnels urbains aisés, des « millenials » qui risquent de vivre dans une bulle, avec tous les inconvénients de l’entre-soi (voir aussi The Collective Old Oak par exemple à Londres). Les grands groupes comme Bouygues Immobilier commencent à s’intéresser au marché, avec le lancement de « Koumkwat ».
On peut distinguer différents profils de projets cherchant à réduire les coûts du logement, répondre aux attentes des professionnels en mobilité seul ou en groupe projet, proposer un modèle de vie en communauté, apporter une réponse rapide et flexible aux travailleurs nomades internationaux, offrir des services.
Du point de vue des lieux, on a toujours la combinaison d’un espace privatif (chambre à coucher) avec des espaces semi-privatifs (salon, cuisine, salle de bains) et des espaces communs (salle de sport, grande cuisine…). Pas de grande originalité architecturale (mais un grand soin apporté à la décoration…). Ce sont surtout les services (avec des community managers , entre conciergerie et animateurs) et la localisation qui sont remarquables.
Dans quel cadre juridique ces projets peuvent-ils se développer ? Rien ne semble vraiment adapté dans le droit français pour le moment. Or, tant que le risque juridique apparaît important, le marché sera limité. Comment, par exemple, gérer un locataire qui ne paie pas, ou ne respecte pas les codes de conduite de la « communauté » ? Du point de vue juridique, ces projets ressemblent aux résidences services pour seniors, qui ont des contrats ad hoc . C’est la solution adoptée par les acteurs pour le moment. Station F (Flatmates) a choisi un statut inspiré de celui des foyers de jeunes travailleurs. Récemment, un amendement dans la loi Elan a promu l’adaptation du bail mobilité pour des résidences juniors (étudiants et jeunes actifs). Pour les investisseurs, le risque juridique et réputationnel paraît important tant qu’on ne sait pas comment sortir d’un éventuel contentieux. C’est aussi un problème de liquidité : comment fait un investisseur pour se retirer d’un tel projet ? Pourra-t-il revendre ? Il y a peu d’investisseurs qui peuvent immobiliser leur capital plus de sept ou huit ans…
Ce marché se développe actuellement auprès d’un public très limité : jeunes professionnels bien rémunérés (ou envoyés en mission par leur entreprise) ou indépendants avec de bons revenus. Cependant, il est possible que le marché soit beaucoup plus large. En effet, les modes de vie et le marché de l’emploi font que la période de mobilité des jeunes actifs est plus longue qu’auparavant. Les jeunes ménages sont plus mobiles et peuvent être intéressés par une offre en phase avec leur besoin de mobilité. En outre, les séparations nombreuses créent des situations intermédiaires de mobilité, avec des besoins temporaires ou pérennes de logement doublés (demandes des deux anciens partenaires). D’autres situations de périodes transitoires (fin d’études, début d’activité, changement d’activité, reconversion professionnelle…) justifient un intérêt pour des offres de service adaptées. On peut aussi mentionner le cas du salarié qui fait des allers-retours entre différentes villes, qui ne trouve pas de produit adapté à sa situation, à moins de payer cher pour un logement qu’il occupe peu.
Faut-il considérer ce type de projet sous l’angle du logement ou sous celui du travail ? N’est-on pas devant une offre de logement de fonction, relevant du contrat de travail ? Au centre de l’offre se trouve le travail, et un ensemble de services associés favorisant l’implication du salarié dans ses tâches, le logement étant une offre rattachée à l’espace de travail et non un lieu séparé, indépendant de l’employeur. On est donc dans un scénario où le travail apparaît central dans les choix de vie, notamment de localisation, et le logement, secondaire. Dans ce cas, le point de stabilité de l’individu apparaît lié à son activité plus qu’à sa localisation. Il peut être mobile et multi-situé avec une stabilité donnée par son travail dont l’ancrage territorial n’est pas essentiel. Le travail à distance peut, en effet, se développer avec les nouvelles technologies, et de nombreuses tâches peuvent s’effectuer pourvu qu’on ait accès à une bonne connexion. Le logement offre avant tout une gamme de services mais n’engage pas nécessairement un choix de vie sur le long terme.
Une telle offre de logement correspond à un profil professionnel très spécifique, lié souvent aux nouvelles technologies, à une organisation du travail « par projet », à une mobilité caractéristique d’un début de carrière. Ces emplois technologiques qui se développent ne résument cependant pas l’avenir du travail. Au contraire, les travaux sur l’ « économie résidentielle » montrent qu’une partie de l’activité est entraînée localement par les services à la personne ou, plus généralement, les tâches présentielles (dans les métropoles, les créations d’emploi sont à plus de 90 % assurées par les activités présentielles [54] ). En 1975, les emplois se répartissaient à égalité entre les activités productives et les activités présentielles (10 millions d’emplois pour chacune). En 2013, l’économie présentielle s’est développée et représente 66 % de l’emploi total, tandis que les emplois productifs reculaient à 8,8 millions d’emplois. Pour ces emplois présentiels, la localisation est bien sûr essentielle. On se trouve même dans une situation inverse à celle du coworker , dans laquelle la localisation prime et l’activité peut être changeante et temporaire. Le point de stabilité est, dans ce cas, donné par le territoire et les opportunités qu’il procure. Le rapport au logement est donc beaucoup plus stable, au risque même de bloquer les opportunités professionnelles quand le territoire offre peu d’activité. Le type d’emploi occupé dépend donc beaucoup de la localisation géographique.
L’évolution du travail ouvre donc des perspectives contradictoires pour le rapport à l’espace. D’un côté, un allègement de la contrainte spatiale de l’emploi : plus de mobilité, un habitat recherché pour les services et des modes de sociabilité variés. De l’autre, le développement d’emplois, notamment de services à la personne, de soins, d’accompagnement qui sont directement liés aux besoins locaux et par conséquent très dépendants du territoire.
Quelles sont les autres évolutions complémentaires qui vont changer notre rapport à l’habitat ?
2.2. Familles, vieillissement et habitat intergénérationnel
L’habitat évolue aussi en fonction des formes de vie familiale. La famille nucléaire qui était dominante il y a encore trente ans n’apparaît plus comme un modèle majoritaire. Aujourd’hui, seulement 43 % des ménages sont constitués par une famille correspondant au modèle d’un couple avec enfants. Les célibataires représentent 36 % des ménages en France et même 53 % à Paris. Les familles monoparentales (essentiellement des femmes élevant seules leurs enfants) regroupent 22 % des ménages. Mais surtout, la vie familiale évolue dans le temps, la taille de la famille change, on vit des moments de séparation, de rupture, de solitude puis de recomposition… Les temps de la vie ont aussi évolué, la jeunesse est plus longue, le quatrième âge s’installe. Or, les logements répondent mal à cette évolution de la vie familiale. Ils ne sont guère adaptables, et déménager est souvent compliqué et coûte cher. Les habitants préfèrent pouvoir rester dans le même lieu, dans un habitat qui devrait idéalement s’adapter aux transformations de leur vie personnelle.
Or, on conçoit toujours les logements selon un modèle ancien, trop rigide pour les multiples transformations de la vie individuelle et familiale. L’espace est stéréotypé et ne prend pas en compte l’ensemble des transformations en cours, dont la désynchronisation des activités au sein du groupe domestique : repas décalés, emprise du travail sur le temps privé, besoin de s’isoler mais désir de partager des moments ensemble… Les habitants aspirent à un mode de vie qui permettrait d’être « ensemble, mais séparément [55] ». En outre, les logements sont petits, ce qui rend plus difficile le réaménagement intérieur : la taille moyenne des logements en France est de 65 m 2 (7 m 2 de moins à Paris), un chiffre stable depuis vingt-cinq ans.
Pourtant, il existe une longue tradition architecturale qui a essayé de répondre au changement des modes de vie. Le familistère de Guise, par exemple, proposait déjà des logements modulables, avec des pièces qui s’ajoutaient quand la famille s’agrandissait à la naissance des enfants ou diminuaient quand les enfants quittaient le foyer parental. L’architecture haussmanienne permettait une certaine adaptation à la vie familiale, parce qu’elle présentait beaucoup de portes et de circulations intérieures (escaliers de service). Des immeubles associaient un bureau à un appartement familial, avec une entrée indépendante mais une communication par l’intérieur. L’architecture haussmannienne reste prisée pour ses capacités d’adaptation, même minimale ; elle accueillait aussi, en même temps, une certaine diversité sociale. Plusieurs expériences ont cherché à favoriser cette modularité : des cloisons déplaçables (maison Schröder de Rietveld), un système de portes adapté, des pièces aux tailles équivalentes et dont la fonction n’est pas trop prédéterminée (projet de l’agence Boskop à Nantes [56] ). Des projets architecturaux variés proposent de donner plus d’adaptabilité aux logements, avec différentes stratégies : le plan libéré, le plan adaptable, les murs équipés, le plan neutre, une pièce en plus, la mutualisation, la cohabitation, l’habitat participatif [57] . Mais la rigidité continue à marquer particulièrement les logements en France, en raison notamment de la réglementation, qui complique par exemple l’usage mixte habitation/activité professionnelle. La conception dominante du logement opposant pièces de jour/pièces de nuit a une incidence sur la construction (place des pièces humides, c’est-à-dire des gaines techniques, etc.) et rend plus difficile l’adaptation des logements.
L’adaptation au vieillissement représente un autre défi. Aujourd’hui, le parc de logements n’est pas adapté au grand âge. Or, une part croissante de la population devra vivre chez elle avec des besoins spécifiques. En 2014, 27 % des 60 ans et plus (4,1 millions de personnes si l’on extrapole à l’ensemble de la population de cet âge) déclarent avoir au moins une limitation fonctionnelle ; 52 %, une maladie chronique (8 millions de personnes) ; 17 %, au moins, une restriction d’activité comme des difficultés à faire sa toilette (2,6 millions de personnes). Le désir de rester chez soi est le souhait largement dominant des personnes âgées. Pour des raisons de confort personnel autant que de coût. C’est aussi le mouvement favorisé par les pouvoirs publics pour contenir les dépenses liées au vieillissement. Parmi les raisons qui soutiennent cette préférence, 82 % d’entre elles considèrent qu’entrer dans une structure d’accueil signifie « perdre son autonomie de choix ». Cette perception s’explique sans doute par les caractéristiques de la vie quotidienne dans de nombreux établissements, où les résidents sont soumis aux contraintes de la vie collective (horaires, repas, etc.) et pour qui la prise en charge par des professionnels peut s’accompagner d’un déclin de la capacité à accomplir soi-même un certain nombre de tâches ou gestes [58] .
On peut développer les services (portage de repas, télémédecine, télésurveillance…) qui aident d’ores et déjà au maintien à domicile. Et c’est un coût moins important au niveau collectif. Mais cela suppose un état de santé, notamment de santé mentale, qui permette de maintenir un minimum d’autonomie. Des habitats transgénérationnels peuvent aider des personnes âgées à rester chez elles si elles ont l’aide d’un gardien ou d’une gardienne d’immeuble, la visite quotidienne du voisinage ou un étudiant par exemple à domicile dans une chambre libre (c’est ce qui existe déjà avec le « Pari solidaire », du logement intergénérationnel en cours de développement à Paris et en région parisienne).
2.3. Nomadisme numérique et nouveaux services
Un habitat accueillant, modulable et évolutif mobilisera de nouvelles technologies. Il suppose des choix techniques dès la conception des bâtiments, en ce qui concerne l’infrastructure mais aussi un usage des nouvelles technologies tourné vers des utilisations variées et souples des lieux. L’arrivée des outils numériques dans l’espace physique va modifier notre relation aux lieux et à l’habitat, notamment à travers les objets et les bâtiments connectés.
Le logement connecté se développe à une nouvelle échelle. Il permet, grâce à des capteurs centralisant des données, d’apporter des services aux résidents et aux gestionnaires, à l’échelle du logement, de l’immeuble, voire du quartier. On parle de la domotique ou de la GTB (Gestion technique du bâtiment) depuis les années 1980 mais l’expression désignait jusqu’à récemment des solutions connectées cantonnées aux maisons de luxe et aux grands bâtiments tertiaires. Pendant longtemps, la domotique est apparue à une majorité de personnes comme un gadget cher et compliqué. Depuis quelques années, on relève une adhésion beaucoup plus large. Cette évolution s’explique par la généralisation des objets connectés (plus de 50 milliards de produits connectés d’ici 2020 [59] ) et la commercialisation grand public des assistants personnels domestiques (Siri, Google Home, Echo, Alexa…).
L’accès à l’Internet et l’aptitude à mettre en relation localement des habitants entre eux mais aussi avec des services pourraient améliorer la gestion de l’énergie, l’entretien des bâtiments, la sûreté (alerte à distance, sécurisation des accès), la qualité de vie des seniors (détecter les défaillances physiques et les accidents), la santé (télémédecine), l’accès aux informations contextuelles (transport, commerce, culture, etc.), le partage et les échanges à l’échelle locale…
Le logement connecté entre dans une phase d’évolution majeure, tant sur le plan de la technologie que des services, même si la protection, le stockage et les modalités d’utilisation des données demeurent une préoccupation légitime.
On relève aussi une appropriation de la domotique par les acteurs de l’immobilier. Les bailleurs sociaux commencent à s’intéresser au logement connecté : d’abord dans le but de mieux gérer leur parc, de respecter la réglementation, d’accompagner les locataires dans la lutte contre la précarité énergétique (et contre les impayés…), d’optimiser la gestion technique de la résidence, de communiquer avec les locataires et de favoriser le lien social. Les outils numériques procurent des avantages de gestion incontestables.
Les promoteurs ont d’autres motivations. Soucieux de se différencier, de proposer des logements innovants, d’améliorer leur image auprès des collectivités et de monter en gamme, ils ont intégré la domotique dans leurs perspectives de développement, comme en témoigne l’annonce de Bouygues d’équiper de solutions connectées (SmartHome) 70 % de ses logements (solution connectée intégrée, baptisée Flexom). Il s’agira de 100 % des logements produits par Nexity dès 2018 (avec Eugénie, une application mobile pour logement connecté). Les services apportés par ces nouveaux outils concernent la gestion de l’éclairage et du chauffage, le suivi des consommations, la télésurveillance, l’éclairage, la commande des volets roulants, le chauffage, les détecteurs de fumée. La e-conciergerie permet aussi de faciliter les relations avec le syndic ou avec le gardien, de diffuser les actualités de la résidence, d’échanger des petites annonces entre voisins, voire d’ouvrir aux actualités du quartier. Et l’intelligence artificielle permet de trier beaucoup plus rapidement les informations utiles.
2.4. L’habitat partagé
Ce que nous ne pouvons pas gagner directement en occupant de nouveaux espaces, nous pouvons le gagner en utilisant mieux l’espace dans le temps. En travaillant sur des espaces partagés, on peut augmenter la taille et le nombre d’espaces de vie. On peut imaginer des usages démultipliés des habitats en repensant la répartition de l’occupation de manière plus complémentaire qu’aujourd’hui. Cette démarche s’inscrit dans la perspective de l’économie de la fonctionnalité , qui vise à développer la facilité des usages et non la simple possession de biens. Un bâtiment mieux utilisé, dans une logique de multifonctionnalité, s’inscrit dans cette vision de performance d’usage [60] .
Cela suppose d’une part de penser des habitats flexibles, dont on trouve déjà la trace dans de nombreuses traditions architecturales. La possibilité de moduler les espaces correspond aussi à un mode de vie plus proche du pavillonnaire, qui est justement apprécié pour ses facultés d’adaptation : on s’approprie le garage, on aménage le grenier, on change l’affectation des pièces, on crée une chambre pour enfant… Même les promoteurs s’y mettent, sous la forme, certes, minimale d’une pièce en plus à usage variable (annexe, bureau, chambre d’étudiant, chambre d’amis, chambre pour personne âgée), comme dans le projet « bi-home » d’Icade, qui témoigne de la nécessité de répondre à une attente des habitants mais qui reste difficile à commercialiser malgré tout. D’autres types de projet misent sur la modularité des espaces et leur appropriation progressive par les habitants : à Bordeaux, des projets visent à limiter les coûts d’accès au logement en proposant à de jeunes ménages un volume architectural équipé au minimum à aménager progressivement et à finir par leurs occupants (« volumes capables [61] »).
Pour développer une architecture plus modulable, on peut imaginer des projets à l’échelle d’un îlot, qui puissent réunir ce que le modernisme a séparé en fonctions différentes (travail, habitat, loisirs…). À l’échelle d’un îlot d’environ 600 habitants, on peut mélanger la vie en commun de générations différentes, de styles familiaux différents (famille monoparentale, recomposée…) combinés avec des espaces de bureaux mono-utilisateur (siège social) ou pour des travailleurs nomades ou indépendants. Des partages nouveaux peuvent se dessiner en prenant en compte la désynchronisation des temps. Celle-ci peut représenter une richesse dans la mesure où elle rend possible des usages successifs et plus intenses des espaces et permet de mutualiser des charges (conciergerie, entretien…).
Les habitats participatifs, qui se développent en France, en Suisse (Kraftwerk) et en Allemagne (où ils représenteraient de 15 % à 20 % des logements neufs) se caractérisent par une démarche de décision commune dans la construction et l’aménagement, mais pas forcément de partage des espaces [62] . Il existe différents modèles, l’autopromotion ou la coopérative d’habitants. Ces différents projets s’inscrivent dans la tradition utopiste de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, qui mélangent les âges et les fonctions.
Il devient concevable de développer des espaces partagés qui se situent tout au long d’un continuum, qui va du privé (qui reste centré sur quelques pièces) au public (qui est hors du bâtiment) [63] . Dès lors, il ne s’agit plus de réfléchir au logement en partant du nombre de mètres carrés mais en pensant à l’habiter (et aux services associés). Il s’agit de produire une forme d’habitat élastique composé d’un noyau continuellement privé et de toute une série d’espaces partagés hiérarchisés dont la gestion des accès et la réservation sont facilitées par les outils numériques. Les espaces partagés combinent deux types : ceux qu’on partage simultanément et ceux qu’on partage de manière successive. La mise en commun d’espaces peut permettre d’économiser 10 % des espaces dans l’îlot.
Les espaces partagés sont à louer avec des modulations de prix selon les horaires (bénéfice pour la collectivité) pour des durées variables (1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an…) et des fonctions ouvertes (et en partie à inventer). L’outil de gestion est le smartphone (et tout le monde est connecté), ce qui permet à chacun de voir les taux d’occupation, de réserver, de payer (éventuellement avec une monnaie locale)… Tout ceci suppose, comme dans le cas d’Uber ou d’Airbnb, une forme de contrôle collectif décentralisé sur les usages (propreté, respect des horaires, respect des attributions…) et la collecte de données sur les utilisations des espaces (ce qui suppose des garanties sur le respect de la vie privée). En complément, le rôle du gardien se revalorise, il devient une sorte de community manager . La collectivité (la copropriété ou le bailleur) peut définir des priorités dans l’affectation des usages pour arbitrer les éventuelles rivalités d’usage (les espaces peuvent être ouverts à des personnes extérieures, pour du télétravail par exemple). Ceci permet de ne pas s’adresser uniquement aux nouveaux habitants, mais d’offrir aussi de nouveaux services aux habitants du quartier.
La mixité (sociale, générationnelle…) doit être privilégiée car elle est une condition pour accroitre le taux d’usage des espaces partagés. Les ménages qui ont de forts revenus manquent souvent de temps, ce qui équilibre avec ceux qui ont du temps disponible (ou des temps décalés), mais moins de revenus (comme les retraités ou les étudiants). Les actifs peuvent assumer un surcoût pour des fonctionnalités rares aux horaires qui les arrangent, tandis que ceux qui peuvent décaler leurs usages parce qu’ils sont plus libres de leur temps jouissent des commodités communes dans les heures creuses. Des personnes à la recherche de modes de vie différents peuvent également être intéressés par une architecture ouverte à de nouveaux usages et à de nouveaux services, qui démultiplient les superficies accessibles (grande cuisine pour recevoir, terrasse, jardin, salle de sport…). Des familles séparées avec une garde alternée, qui ont les enfants à leur charge une semaine sur deux, peuvent aussi trouver des avantages aux espaces modulables. En outre, ce modèle est plus écologique car il optimise l’utilisation des ressources spatiales et parce qu’il accompagne une bonne gestion des dépenses énergétiques (fournir la bonne énergie au bon endroit au bon moment).
Mais pour imaginer et développer de nouveaux programmes immobiliers, inventifs et adaptés aux défis des vingt ans qui viennent, de nombreux obstacles devraient être levés.
Un obstacle financier tout d’abord, puisqu’on est loin des produits standard conçus par les promoteurs. Les prototypes coûtent un peu plus cher à réaliser, même si ces surcoûts peuvent être amortis par l’usage. Surtout, ils introduisent une part accrue d’incertitude. Il n y a pas encore de business model éprouvé. En supposant un bon taux d’occupation des espaces, l’analyse montre une grande efficacité quand elle est faite à l’échelle de la durée de vie de l’immeuble, c’est-à-dire au niveau du coût global du bâtiment et sur une durée qui va parfois au-delà de celle attendue par des investisseurs particuliers, voire des entreprises privées. Le modèle qui inclut des services ne peut pas être comparé à un modèle traditionnel.
Un obstacle juridique et réglementaire, ensuite, car les règlements et les normes actuelles ne sont souvent pas adaptés. Ils sont en effet aujourd’hui liés au schéma de l’appartement : règlementation incendie, accessibilité, chauffage et isolation, ventilation, lumière naturelle, quantité de vitrage, etc. En outre, la définition des typologies de programmes (logement, foyer, hébergement hôtelier, hôtel) limite la possibilité de développer des espaces comprenant une mixité des usages. Il faudrait pouvoir, sous certaines conditions, les lever pour favoriser l’innovation et l’expérimentation.
Il convient principalement de reconsidérer ce que l’on nomme logement individuel ou appartement car, dans les cas d’habitats partagés, l’habitat n’est plus constitué uniquement d’une sphère privée permanente (un appartement), mais d’un ensemble déployé dans l’espace incluant des espaces partagés (sphères intimes temporaires). Cette nouvelle définition du logement ou de l’habitat permettrait de concevoir des sphères intimes plus petites que ne l’autorise la réglementation, qui fixe des surfaces minimales pour un appartement ou pour une chambre. Cela aurait également comme conséquence de produire des formes urbaines plus écologiques et plus denses que les « écoquartiers » actuels, à l’image des centres-villes historiques, et donc plus rentables pour les métropoles, où le foncier est cher. Considérer une forme d’habitat élastique permet de « déconcentrer » des normes de confort (par exemple, la nécessité pour tous les habitats de recevoir plusieurs heures de lumière directe par jour). Ces contraintes se résolvent différemment, chaque habitant pouvant en bénéficier aussi grâce aux espaces partagés. De manière plus générale, cela invite à reconsidérer les manières de concevoir et de construire (épaisseur de bâti, surface de vitrage, rôle des circulations, etc.) qui n’ont pas cessé de s’uniformiser.
Enfin, de même qu’on pense à la mutualisation des espaces, on devrait aussi pouvoir introduire la mutualisation des tâches. Si le rôle du gardien est revalorisé par la gestion de nouvelles tâches organisationnelles ( community manager , relation avec les habitants, conciergerie), des rôles plus réglementaires comme par exemple la présence obligatoire de pompiers dans un immeuble de grande hauteur (IGH) pourraient être combinés avec des tâches annexes, au bénéfice à la fois des habitants et du personnel dont l’activité revalorisée est plus rémunératrice.
3. Nouveaux besoins, nouvelles inégalités
Les tendances longues identifiées jusqu’ici concernent des changements dans les modes de vie et les attitudes des habitants. Elles apparaissent largement indépendantes des politiques publiques, dont nous ne traitons pas ici et que nous supposons stables [64] . Nous avons montré que l’occupation de l’espace suit une tendance à la métropolisation et à l’étalement urbain difficilement soutenables (1 re partie). Mais nous avons également identifié des transformations de nos modes de vie qui peuvent redonner une perspective à la ville dense. Les évolutions rapides de notre rapport au travail, à la vie familiale, et l’entrée massive des nouvelles technologies dans les logements peuvent transformer notre occupation des lieux au point de proposer de nouvelles perspectives sur les manières mêmes d’habiter (2 e partie). Dès lors, il apparaît que nous ne sommes pas limités à un seul scénario d’évolution. Si des tendances de fond se dégagent, elles ne convergent pas vers un seul style d’habitat possible.
Avant de répertorier ces différents scénarios, il faut identifier les défis nouveaux posés à une politique progressiste du logement. Tous les scénarios d’avenir ne sont pas propices à une occupation durable des espaces, au développement des opportunités économiques, à la participation à la vie sociale. Au contraire, le logement devient un déterminant important des inégalités. D’une part, la densité urbaine rend l’accès au logement plus coûteux et difficile dans les centres pour nombre de ménages, surtout jeunes, même parmi les classes moyennes ; d’autre part, le logement est une composante majeure du patrimoine des ménages. Pour les ménages qui possèdent un logement dans les zones urbaines denses, la perspective est que leur bien prendra de la valeur. Mais, en dehors de Paris, de la région parisienne et des principales métropoles, la valeur des biens immobiliers stagne, voire baisse légèrement [65] . Certains logements qui ne sont plus aux normes ne pourront pas faire l’objet de rénovation, au risque donc pour une partie des ménages de perdre leur capital. L’écart pourrait donc se creuser de manière importante entre les ménages en fonction de leur localisation géographique et de leur statut d’occupation.
Comment traiter ces inégalités ? Une approche uniquement spatiale ne suffira pas à répondre aux nouvelles dynamiques, à partir d’une volonté d’équipement ou d’équilibrage territorial. Il faut aussi comprendre le changement des modes de vie, qui entraîne des usages multiples et différenciés de l’habitat alors même que les modèles existants ne proposent que des réponses uniformes.
3.1. Le traitement des inégalités
Pour loger les classes modestes et moyennes dans les métropoles, le secteur social reste un moyen privilégié. Pourtant, dans de nombreux pays européens, la construction de logement social a reculé, et le financement public a été contesté. En France, les choix stratégiques du logement social doivent répondre à deux grandes interrogations. La première porte sur la population à qui le logement social est destiné. La seconde, sur les évolutions du secteur, en particulier sous l’influence des règles européennes.
Le logement social est un secteur important du marché du logement, mobilise des sommes publiques importantes et contribue à loger plus de 10 millions de personnes et accueillent 500 000 nouveaux locataires chaque année. Avec 4,5 millions de logements en 2017, il représente près de la moitié du parc locatif. Les aides publiques qui lui sont consacrées sont également importantes (17,5 milliards d’euros en 2014). Le logement social se fixe un objectif bien délimité dans les textes : « améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées [66] ». La mise en œuvre de cette politique, qui relève d’un long mouvement historique, est néanmoins plus riche et plus complexe puisque le seuil d’éligibilité au logement social est particulièrement peu sélectif (près des deux tiers de la population se situent en dessous du plafond de ressources fixé pour y accéder). De ce fait, le logement social assure une mission qui est également fixée dans les textes de « mixité sociale des villes et des quartiers ». La faible spécialisation de la politique du logement social explique sans doute en grande partie le large consensus dont elle a longtemps fait l’objet. Elle soulève néanmoins également des difficultés dans la mesure où l’on observe au fil des années qu’une partie importante des publics les plus modestes n’a pas accès au logement social. En effet, la moitié seulement des ménages vivant sous le seuil de pauvreté en bénéficient. C’est pourquoi une pression croissante s’exerce sur les bailleurs sociaux pour accueillir plus largement ces populations. Mais, à mesure que les bailleurs sociaux intègrent cette demande, ils déséquilibrent le profil de leurs locataires, parmi lesquels les ménages aux plus faibles revenus représentent désormais la moitié des habitants (contre 21 % en 1973).
Spécialisation du parc social de 1973 à 2013
(répartition des locataires par quartile de niveau de vie)

Cette spécialisation répond à la destination de cette dépense publique, mais elle présente aussi des inconvénients. Elle fragilise parfois l’équilibre financier des bailleurs sociaux, confrontés à des ménages moins solvables. Elle ralentit aussi le taux de rotation des locataires puisque les ménages plus pauvres sont moins susceptibles de déménager que les autres. De fait, à mesure que le logement social se spécialise d’un point de vue social, le taux de rotation diminue (9,6 % actuellement). L’effort de construction réel qui s’est maintenu ces dernières années n’a donc pas un impact très visible sur le nombre d’attributions nouvelles : « Entre 2002 et 2013, 11 années d’effort de construction ont augmenté le parc social de plus de 600 000 logements, et pourtant le nombre d’attributions annuelles a diminué de 70 000 [67] . » Un choix stratégique s’impose donc, même en supposant que l’effort de construction se maintienne. Soit augmenter le taux de rotation, en poussant notamment les locataires dépassant les plafonds de ressources à quitter le parc social (10 % des locataires dépassent aujourd’hui les plafonds de ressources, qui sont pourtant élevés), mais au risque de réduire la mixité sociale des immeubles et de fragiliser le consensus entourant cette dépense publique en spécialisant plus nettement son public. Soit limiter la demande en réduisant le public éligible, mais cela signifie de renoncer à la vocation généraliste du logement social, qui constitue une force de ce secteur.
Un équilibre est, en outre, à trouver entre la vocation généraliste et la contribution à la lutte contre l’exclusion. Si le logement social ne peut pas accueillir les publics en grande exclusion, vers quels dispositifs ceux-ci peuvent-ils se tourner ? Ils dépendent de dispositifs d’insertion qui, par définition, ne peuvent constituer qu’une solution de transition. Or, ces dispositifs sont aujourd’hui peu accessibles parce que leurs places sont saturées par un public qui ne trouve pas sa place dans le logement social classique. Le passage d’un mode d’hébergement à un autre, vers le logement social puis vers le parc locatif privé, manque de fluidité. L’accès au logement social doit, aussi, favoriser la mobilité des ménages, notamment des jeunes ménages confrontés à un marché du travail plus instable et plus exigeant. Des bourses d’échange de logements sociaux, qui sont déjà expérimentées, pourraient à ce titre faciliter une plus grande mobilité au sein du parc social et ne pas fixer durablement des salariés dans des territoires offrant de faibles perspectives. Comme on l’a vu, une meilleure prise en compte des différences territoriales est capitale. On peut dès lors imaginer de territorialiser plus qu’ils ne le sont les plafonds de ressources, en permettant aux collectivités locales de les déterminer en fonction de leur population et de leur parc de logements, la problématique du logement social n’étant pas uniforme sur l’ensemble du territoire. Le taux de rotation est plus faible dans les zones tendues. Avec le vieillissement de la population, des programmes spécifiques pourraient également être proposés pour les personnes arrivant à la retraite, qui sont plus susceptibles de déménager au moment où elles liquident leurs droits.
Le choix d’une politique universaliste s’oppose à la tendance européenne, qui favorise plutôt la politique du logement social résiduelle, c’est-à-dire concentrée sur les ménages aux revenus les plus faibles, dans une perspective de compensation des défaillances du marché. Le risque d’une telle politique pour le logement social en France est de contredire l’objectif de la mixité sociale, dans un contexte où, comme on l’a vu, la concentration spatiale provoque déjà des tendances à la séparation sociale.
Si la tendance européenne n’est pas uniforme, le secteur connaît à peu près partout de fortes évolutions. En Grande-Bretagne, 2 millions de logement sociaux ont été vendus à leurs occupants ; 200 000 aux Pays-Bas depuis 2012. En Allemagne, les logements publics ont été pour l’essentiel vendus en bloc à des investisseurs. En Suède, où l’accès aux logements sociaux gérés par les municipalités ne connaissait pas de condition de revenus, le soutien financier au parc public a cessé, et les municipalités ont vendu un grand nombre de bâtiments.
Des pays comme la Suède, les Pays-Bas, l’Autriche ont longtemps eu un système universel, ouvert à un grand nombre de candidats, parfois même sans conditions de ressources. La part de la population accédant au logement social y est par conséquent élevée : celui-ci représente 30 % des logements aux Pays-Bas, 24 % en Autriche, 20 % au Danemark [68] . D’autres pays, ont plutôt un système résiduel : 8,7 % des logements sont gérés par le secteur social en Irlande, 4 % en Italie, 2 % au Portugal. On est dans la même fourchette de taux dans les nouveaux pays membres de l’Union européenne. C’est le modèle privilégié par les institutions européennes, qui définissent ainsi le logement social en 2005 : « Logement destiné aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables qui pour des raisons de solvabilité ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché. » Mais, dans la définition du socle des droits sociaux, l’Union européenne affirme aussi : « Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un accès au logement social ou d’une aide au logement de qualité. »
La France se situe dans une situation intermédiaire (le logement social y représente 16,8 % des logements). Elle a pour caractéristique un taux d’éligibilité au logement social assez élevé. Elle a aussi connu une grande stabilité du secteur, qui contraste avec les réorganisations observées presque partout ailleurs (ventes massives aux occupants, fusions des organismes sociaux, transfert des compétences). La France va-t-elle évoluer vers un système résiduel, sous la pression des recommandations européennes ? Cela n’a rien d’évident, pour deux raisons. La première est que les textes européens ne vont pas strictement dans la même direction. En effet, si les aides publiques au logement ont été attaquées par le passé au nom de la politique de la concurrence, la nécessité d’une action publique en matière de logement est reconnue dans les textes européens consacrés à l’action sociale… Ainsi, les textes concernant les droits fondamentaux ou la cohésion sociale reconnaissent l’importance de l’accès à un toit. La seconde est que l’Europe n’a pas défini un modèle exclusif pour le logement social. Il est vrai que la comparaison européenne des systèmes est difficile, que la définition du « bon modèle » ne va pas de soi et que l’évaluation des situations ne débouche pas sur des conclusions univoques.
Il apparaît néanmoins que les textes européens mettent beaucoup l’accent sur l’accès au logement des plus défavorisés. Dans ce contexte, le dispositif français est ambigu puisqu’il se donne notamment pour objectif la mixité sociale, ce qui signifie souvent, avec des variations locales, le maintien de ménages de classes moyennes dans les HLM. Or, cette visée généraliste, qui fait la solidité du secteur, ne doit pas se faire au détriment des plus pauvres.
À l’encontre du modèle résiduel promu par les textes européens, une extension du rôle des HLM reste pertinente pour répondre aux besoins de l’habitat. Le développement d’une offre de logements locatifs pour tous dans les métropoles peut ainsi favoriser la mobilité et la mixité sociale [69] .
3.2. De l’urgence à l’insertion
Comme on l’a vu, le logement social tient un rôle important de la chaîne de l’insertion mais il ne constitue pas le premier niveau de prise en charge. Comment celle-ci se fait-elle pour les personnes en situation d’urgence ? Et comment améliorer le passage d’un dispositif à l’autre, au-delà du premier accueil ? Les chiffres donnent une idée de l’ampleur du problème. On compte en France 141 000 personnes sans domicile (c’est-à-dire une personne qui dort dans un lieu qui n’est pas prévu pour l’habitation ou qui est prise en charge par un organisme fournissant un hébergement gratuit ou à faible participation) [70] . Parmi ces personnes,
33 % trouvent une place en hébergement collectif (jour et nuit),
12 % dans un hébergement collectif limité à la nuit,
29 % dans un logement fourni par une association ou un organisme d’aide,
16 % sont à l’hôtel,
10 % sont sans abri (à la rue ou dans un hébergement d’urgence).
Le système actuel repose sur un dispositif « en escalier » : on fait passer les personnes d’un dispositif à l’autre, de la rue à l’hébergement d’urgence jusqu’au logement accompagné et au logement autonome. À chaque étape, il s’agit de vérifier que la personne est apte à se conformer aux contraintes et aux réalités de chaque mode d’hébergement. Pour la personne bénéficiaire, il s’agit de faire la preuve qu’elle est prête à passer à l’étape suivante. Ce système date des années 1970 et porte la marque de l’idée de « réadaptation sociale » liée aux hébergements. Il n’apparaît plus adapté à la situation actuelle.
Du point de vue quantitatif, il ne permet plus de faire face aux besoins :
les durées de séjour augmentent continuellement malgré le caractère temporaire de chaque dispositif ;
les taux de rotation sont faibles (sauf dans l’hébergement d’urgence) ;
l’arrivée continue de nouveaux publics accroît la pression sur le système.
Mais des dysfonctionnements apparaissent aussi du point de vue qualitatif :
toutes les formes d’hébergement ne sont pas appropriées pour les différents types de public (par exemple, l’urgence devrait être réservée à des personnes seules mais sert aussi maintenant à accueillir des familles) ;
la sélection des publics qui peuvent accéder à chaque marche de l’escalier est contestable à chacune des étapes ;
si le système en escalier marche correctement pour les publics proches du logement autonome, il ne permet pas de faire avancer les personnes qui viennent de la rue, qui y restent trop longtemps et n’en sortent pas assez vite (sur une période de cinq ans, 20 % des personnes à la rue n’en sortent pas).
Les publics les plus fragiles font des allers-retours entre la rue et l’urgence et n’accèdent pas assez vite ni assez facilement à des logements accompagnés. En outre, les parcours dépendent moins du degré d’autonomie des personnes que de la disponibilité d’une place dans une structure adaptée.
C’est pourquoi, un système alternatif se développe, appelé « Le logement d’abord », inspiré par « Housing first », inventé en Californie en 1980, qui visait les personnes exclues du logement (à la rue depuis une longue durée, etc.). Il s’agit d’un accès direct et inconditionnel à un logement. On ne demande pas aux services sociaux une évaluation sur la capacité à vivre de manière autonome dans un logement. On donne accès à un logement stable et pérenne, relevant du droit commun. Un accompagnement est proposé : accès aux droits et aux soins psychiatriques notamment. Cela veut dire que l’accompagnement n’est plus dépendant du type de structure d’hébergement. L’évaluation de ce dispositif est favorable puisque 80 % des personnes restent dans le logement au bout de deux ans. En France, les quatre premières expériences qui ont été menées, sous le label « Un chez soi d’abord » (Paris, Marseille, Toulouse, Lyon) ont touché 350 personnes et ont montré que 85 % d’entre elles se maintiennent dans le logement plusieurs années après leur entrée dans le dispositif, avec des indices d’amélioration de la qualité de vie, de la santé, de l’inclusion sociale et professionnelle, etc. Les évaluations proposent des calculs de coûts évités : les séjours à l’hôpital, passages devant la justice, hébergements…
Les difficultés en matière de logement concerneront aussi l’hébergement d’urgence pour les migrants (notamment les mineurs isolés) et un phénomène qui n’avait pas été anticipé, le retour des bidonvilles.
On a vécu avec l’arrivée massive de demandeurs d’asile en Allemagne à partir de 2015 un cas particulièrement intéressant de la manière dont les villes peuvent faire face à une demande d’hébergement d’urgence soudaine. Une telle situation risque fort de se reproduire à l’avenir, que ce soit à la faveur d’événements géopolitiques aux abords de l’Europe ou de migrations climatiques. L’étude de la réaction des villes allemandes donne donc une idée des défis qui attendent les villes à l’avenir, en particulier l’acceptabilité sociale des programmes temporaires mis en place pour l’accueil des migrants, si toutefois l’Europe reste un continent ouvert.
Au moment de l’arrivée de 890 000 demandeurs d’asile en Allemagne, les grandes villes du pays (Hambourg, Berlin, Stuttgart, Munich, Dresde) se sont trouvées en première ligne et ont été confrontées à des difficultés communes : le manque de foncier disponible et la pénurie de logements abordables. Elles ont dû trouver des solutions pour des migrants qui, au-delà de la crise conjoncturelle de cette année-là, resteront présents de manière durable pour une large part sur le territoire allemand.
Une action en trois temps s’est mise en place. À court terme, pour faire face à l’urgence, on a occupé des bâtiments à usage non résidentiel (les hangars de l’aéroport désaffecté de Tempelhof, en plein Berlin, ou des gymnases). Le risque dans ce cas était d’installer les réfugiés dans du provisoire appelé à durer puisque, un an après les arrivées massives de demandeurs d’asile, deux tiers des réfugiés étaient encore logés dans des hébergements d’urgence. Une autre stratégie a consisté à installer des structures ad hoc sur des terrains vacants. Peu de réflexion architecturale a été mobilisée dans ces opérations, qui ont procuré des hébergements au confort limité.
Dans le moyen terme, les pouvoirs publics ont organisé une transition vers le logement et commencé à traiter les demandes administratives. Pour cela, ils devaient trouver du foncier disponible, une information que les villes ont du mal à maîtriser. Les villes ont souvent travaillé sur les contraintes réglementaires et obtenu un assouplissement temporaire de certaines normes. Des logements ont été construits pour accueillir des demandeurs d’asile, avec un objectif, à terme, de transformation en logement social, en résidence pour personnes âgées ou en résidence étudiante. Les villes devront revoir leur politique du logement, en imaginant de nouveaux usages ou en diversifiant des offres trop concentrées sur des logements pour des ménages standard (deux adultes, deux enfants) alors qu’apparaît un besoin nouveau pour des familles nombreuses ou des personnes seules souhaitant vivre en collectif.
L’augmentation des populations en besoin d’hébergement d’urgence est un phénomène général, qui ne concerne pas seulement la France [71] . Différents facteurs se recoupent dans la conjoncture présente : la rencontre d’une conjoncture économique morose et la célèbre « crise » du logement de plus longue durée, l’arrivée des migrants et leur circulation d’un pays européen à l’autre… D’autre part, l’épuisement des dispositifs d’urgence est visible. On tente d’ailleurs de sortir des placements en hôtel, qui coûtent très cher sans procurer la sécurité nécessaire à la vie de famille et à la réinsertion. On a recours à des pensions de famille, qui procurent un cadre plus sécurisant par exemple pour des personnes seules. En outre, le mécanisme de l’escalier repose sur une vision probatoire du parcours d’insertion qui complique beaucoup la vie de personnes fragilisées. Dans les zones tendues, l’accès à un logement d’abord est néanmoins un choix plus difficile que dans des zones peu tendues. Au-delà des solutions d’hébergement d’urgence, il reste indispensable de disposer d’un parc de logements à loyer très faible.
3.3. L’habitat durable
D’ici 2050, l’urbanisme et l’architecture devront prendre leur part à l’objectif de « neutralité carbone ». Cela signifie que le bâtiment doit atteindre une décarbonation complète ou quasi complète à cet horizon de temps [72] . Il faut ainsi construire des logements plus économes en énergie, voire des logements passifs ou même à énergie positive. C’est la contribution du secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), qui représente 20 % des émissions nationales, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’effort colossal de rénovation afin de décarboner entièrement le secteur du bâtiment, il faudra simultanément adapter les logements aux effets du changement climatique, qui a déjà commencé.
Les impacts du changement climatique sur les habitations commencent à être répertoriés. Les effets locaux du réchauffement global sont difficiles à décrire avec précision. Là encore, les disparités des situations en fonction de l’emplacement géographique prédomineront. Selon les régions, le changement climatique pourra se traduire par une augmentation de l’ensoleillement ou, à l’inverse, par une augmentation de la couverture nuageuse. Dans l’ensemble, l’augmentation des températures moyennes aura un impact significatif sur la consommation d’énergie, dans des proportions encore difficiles à anticiper (baisse de la consommation de chauffage mais hausse, sans doute supérieure, de la consommation de climatisation). Sur les côtes, 80 000 à 100 000 personnes sont situées en zone de submersion, directement menacées par l’érosion côtière, surtout en Languedoc-Roussillon. Les régions forestières sont également exposées puisqu’un tiers des surfaces forestières sont sensibles au risque de sécheresse et d’incendie (en particulier les Landes).
En volume de dommages, le premier aléa est celui des inondations, surtout celles provoquées par des crues plus intenses dans les régions montagneuses (Pyrénées, Cévennes, Alpes, Jura) et pour certains fleuves (Garonne, Seine, Marne, Meuse…). Le deuxième aléa le plus important mais peu visible concerne le retrait des argiles en raison des sécheresses. Dans les régions argileuses, des mouvements de terrain fragiliseront les fondations des maisons. Enfin, les mouvements de terrain seront provoqués par l’alternance de périodes sèches et de précipitations plus intenses [73] .
En ville, l’effet spécifique de l’augmentation des températures se traduit par un impact plus marqué des vagues de chaleur (îlot de chaleur urbain). Les températures de l’air sont plus élevées en ville que dans les zones rurales : lors de la canicule de 2003, la différence de température entre le centre de Paris et les zones rurales environnantes a atteint 8 °C. Pour limiter cet effet, les villes doivent travailler sur les propriétés radiatives des surfaces : choisir des matériaux qui absorbent la chaleur, verdir la ville (en particulier les toits mais aussi les cours intérieures, comme le fait Paris en gazonnant les cours de récréation des écoles primaires) ou prévoir des méthodes d’humidification des chaussées. La mise en œuvre cumulée de toutes ces modifications conduit à une diminution très limitée de l’intensité de l’îlot de chaleur urbain : 1 °C à 2 °C en moyenne pendant toute la durée de l’épisode, avec un maximum de 6 °C en fin de matinée ou en fin d’après-midi [74] .
Mais le besoin d’adaptation des logements ne signifie pas seulement adapter les logements à la nouvelle donne climatique, ce qui se décline différemment en fonction des situations géographiques. Il faut aussi construire des logements plus économes en énergie, voire des logements passifs ou même à énergie positive. C’est la contribution du secteur du bâtiment à la limitation puis à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (avec 30 % de la consommation finale énergétique et 17 % des émissions de GES, le secteur résidentiel apparaît comme le principal consommateur d’énergie après les transports, qui représentent 29 % des émissions de GES [75] ).
En ce qui concerne la rénovation, celle-ci ne peut se faire sans une incitation forte des pouvoirs publics. En effet, le calcul du gain économique de l’investissement dans l’isolation thermique n’est pas évident dans la mesure où le temps de retour de l’investissement va de moins d’un an (régulation, isolation des combles perdus) à plusieurs dizaines d’années pour les doubles vitrages. Pour les bailleurs privés qui supportent la dépense sans pouvoir bénéficier directement des économies de charges, il l’est encore moins. Qui plus est, environ le tiers des logements « passoires », classés en étiquette F et G, sont situés dans des copropriétés où la coexistence de différents statuts ne facilite pas la prise de décision. Pour une partie des « passoires thermiques » de faible valeur, en particulier dans les zones détendues, la meilleure solution sera sans doute la destruction. Pour respecter ses engagements légaux et internationaux, l’État doit donc s’engager clairement à accompagner les efforts des ménages, surtout pour les biens de faible qualité thermique occupés par des ménages modestes (dits « en précarité énergétique »). Le plan de rénovation énergétique de l’habitat vise 500 000 logements par an [76] à partir de 2017, traduits par le projet de Stratégie nationale bas carbone (SNBC) 2018 en 300 000 « rénovations complètes équivalentes » sur la période 2015–2030, puis 700 000 rénovations complètes équivalentes sur la période 2030–2050.
Il convient aussi de hiérarchiser les priorités et de mieux structurer l’offre de conseil et d’aide qui aujourd’hui répond à des logiques institutionnelles plus qu’à la demande sociale. Les outils (CITE [77] , CEE [78] , Anah, TVA à taux réduit, déduction fiscale pour les bailleurs) mobilisent des moyens considérables mais de manière peu lisible, peu cohérente et mal adaptée au cas épineux de la copropriété.
Un peu plus de la moitié du parc des logements est classée dans les catégories de faible performance énergétique (D ou E), 30 % dans les moins bonnes classes (F ou G) contre 14 % seulement dans les plus performants (A, B ou C) [79] . Ces indicateurs mesurent des conditions d’usage conventionnelles qui ne reflètent pas toujours le comportement des habitants. Ce qui signifie que la performance réelle est sans doute plus faible que la performance mesurée (effet « rebond » observé à l’occasion de travaux conduisant à une amélioration de confort et à une économie constatée inférieure à celle projetée). La performance thermique des maisons individuelles est en moyenne meilleure que celle des appartements. Les réductions de consommation ne couvrent l’effort investi (près de 7 000 euros en moyenne) qu’au bout de dix années, aussi bien pour les maisons individuelles que pour les appartements [80] . Pour les ménages, ces retours ne sont ni assez rapides, ni assez directs, ni assez individualisés (en copropriété), ce qui limite leur motivation. Certains logements ne pourront sans doute pas être réhabilités et resteront inhabitables, car la rénovation, dans des zones peu denses et peu dynamiques, serait hors de prix par rapport à la valeur du bien, surtout dans un contexte de faible coût de l’énergie.
Enfin, en particulier dans les zones où le marché de l’immobilier est sous tension, les propriétaires ne sont pas forcément incités à réaliser des travaux de rénovation dans la mesure où ce sont leurs locataires qui supportent le poids des factures énergétiques. L’ensemble de ces freins plaide pour un recours à la fois aux aides à la rénovation, en particulier à destination des ménages les plus modestes, et aux normes, y compris en interdisant progressivement à la location les passoires énergétiques (d’autant plus dans les zones où le marché de l’immobilier est tendu, où la valorisation du prix des biens doit permettre de financer la rénovation énergétique).
Les logements neufs consomment quant à eux deux fois moins d’énergie (en ce qui concerne le chauffage et l’eau chaude sanitaire) que les logements existants et les techniques de construction permettent d’ores et déjà d’atteindre des objectifs de très basses émissions. Les techniques de construction permettent d’atteindre ces objectifs de réduction d’émissions de GES. Mais, pour construire du neuf, il faut avoir accès à de nouveaux terrains, c’est-à-dire le plus souvent construire en périphérie des villes. Ce qui alimente l’étalement urbain, contradictoire avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergie. En outre, les distances à parcourir le plus souvent en voiture individuelle pour se rendre au travail et, plus généralement, pour la plupart des activités (courses, loisirs…) ont aussi un impact en dépenses d’énergie, qu’il faut ajouter à celui de l’habitat.
Un changement de style architectural dominant dans ces constructions en neuf permettrait de limiter la consommation d’espace. Au lieu de pavillons individuels, on pourrait construire de petits collectifs (maisons en bande, immeubles à un ou deux étages…) malgré la résistance culturelle française à ce modèle, qui existe en revanche largement dans l’Europe du Nord.
Conclusion : 4 scénarios
Les évolutions de nos manières d’habiter dans vingt ans vont dépendre d’une série de variables clés dont les diverses pondérations nous orientent vers des trajectoires bien différentes. Nous avons identifié ces variables au cours de ce travail : la métropolisation et son impact sur le reste du territoire ; l’occupation du territoire entre densité et desserrement ; les évolutions du travail et l’individualisation des horaires ; la localisation de l’activité économique et son impact sur les mobilités ; le vieillissement de la population ; les changements de la vie familiale ; l’affirmation dans la vie quotidienne d’un paradigme du partage et de la coopération ; la transition écologique dans les transports, la construction et l’occupation des logements ; l’entrée de la révolution numérique dans les logements. En pondérant diversement chacune de ces variables, on parvient à des scénarios assez contrastés, dont le dernier, « l’équilibre des métropoles », montre qu’il est possible de corriger les déséquilibres de notre rapport au territoire national.
4.1. Scénario 1 : la concentration métropolitaine
Les métropoles se renforcent et s’étalent, imposant leur logique aux espaces avoisinants. Du point de vue économique, ce mouvement entraîne des effets bénéfiques pour les territoires proches mais rarement au-delà. La fracture territoriale s’affirme : les inégalités s’amplifient entre les cœurs de ville dynamiques et les espaces plus reculés. Ce n’est pas le cas seulement de Paris et de la région parisienne mais aussi des métropoles de province, qui absorbent la majorité de l’accroissement démographique. Dès lors, des parties du territoire restent à l’abandon, et les populations les moins mobiles, isolées, subissent une dégradation de leur qualité de vie. Le mouvement d’extension mal contrôlé des métropoles appelle des investissements massifs mais l’infrastructure de transport public reste en deçà des besoins en raison de la difficulté à mobiliser les investissements nécessaires. Le modèle pavillonnaire poursuit son extension, avec quelques nouveautés technologiques dans la gestion domestique mais qui restent limitées au confort intérieur des habitations. Le style d’occupation des logements connaît peu d’évolution… Le mitage du paysage, l’artificialisation des sols, la construction de pavillons à prix abordables mais qui gagnent peu de valeur au fil des années, le recours à la voiture individuelle installent les habitants dans un mode de vie peu soutenable. Les coûts collectifs (équipements, infrastructures, pollutions…) pèsent sur les collectivités locales et limitent leur action à la compensation des impacts négatifs de leur extension spatiale. L’arrivée de la voiture autonome incite les particuliers à allonger leur temps de transport. Les coûts indirects pour les ménages s’accroissent (garde d’enfants, etc.). La sociabilité des espaces pavillonnaires reste faible et entraîne peu de modifications des modes de vie ou des modes de consommation. Dans la ville dense, l’accès au logement devient plus difficile, les écarts se creusent entre ménages propriétaires accumulant du capital (et des rentes) et les autres. La métropole attire une population jeune et les actifs, mais la compétition pour l’usage de la ville est plus intense, notamment pour le partage entre espaces de bureaux, locations temporaires et habitations.
4.2. Scénario 2 : la saturation urbaine
Les métropoles arrivent à un point de saturation. Le manque de place, le prix des logements et de la vie quotidienne, le bruit, la pollution, les pics de chaleur, les risques d’inondation, les transports saturés… détériorent la qualité de vie en ville. Avec une série de chocs environnementaux et sanitaires, la qualité de vie en ville n’est plus attractive. La ville dense n’offre plus les aménités attendues par les habitants, pour un coût devenu excessif. Le temps de transport et son coût entretiennent un stress quotidien qui use les habitants. Les logements sont trop petits, mal adaptés à la vie familiale ou au vieillissement. On fuit la ville, à la recherche d’emplois et de lieux d’habitation éloignés des grands centres urbains. Le travail se délocalise vers l’arrière-pays, on favorise le travail à la maison, des petites structures de bureau, on construit dans les petites villes qui retrouvent de l’attractivité : il y a de la place, les coûts sont moindres, on vit et on travaille chez soi. Des styles de vie alternatifs, notamment néoruraux, changent les habitudes de consommations et les priorités culturelles dans les communes rurales des zones les moins denses. Des installations néorurales favorisent une évolution de l’agriculture, de l’autoconsommation et des circuits courts. Cela ne se traduit pas par une grande innovation architecturale mais par la réoccupation de logements laissés vides qu’il faut rénover en grand nombre. Des styles de vie « low-tech », peu mobiles, en « circuits courts », valorisant l’autosuffisance, s’inventent loin des métropoles. Un clivage culturel, voire une incompréhension, se développe entre les habitants restés dans les métropoles et les conquérants des zones peu denses, aux logiques et aux priorités bien différentes.
4.3. Scénario 3 : la révolution du partage
La dynamique principale vient de l’évolution des modes de vie. On passe un seuil dans la ville dense qui devient encore plus dense mais moins rythmée par l’alternance des déplacements entre le domicile et le travail. La voiture autonome se développe et change la place de la voiture dans la ville. Elle est en effet susceptible de décongestionner les agglomérations (moins de voitures mais qui tournent en permanence, sans mobiliser des places de stationnement). La ville redevient plus attractive en raison de la baisse des nuisances liées à la circulation automobile, avec des espaces regagnés pour le logement sur les lieux mobilisés aujourd’hui par les véhicules individuels (reconquête des rues, des sous-sols, parkings situés en périphérie…). La métropole est plus active mais plus vivable, avec une souplesse des usages et une mobilité accrue. Les modes de vie entraînent un changement des conceptions et de l’architecture des logements. Les habitants ne sont plus installés uniquement en ville : ils acceptent des habitats de petite taille dans les métropoles et vivent une grande partie du temps ailleurs, à l’écart, dans un habitat plus diffus sur le territoire. L’habitation est dispersée en plusieurs lieux. L’économie du partage se développe, les échanges de biens et de services améliorent la qualité de vie indépendamment des niveaux de consommation. Les relations familiales et de voisinage permettent plus de solidarité de proximité, tout en conservant la créativité et l’énergie des grandes villes.
4.4. Scénario 4 : le réseau des métropoles
Le dynamisme métropolitain se diffuse et irrigue une vaste partie du territoire. Même les zones rurales éloignées ont des avantages comparatifs dont elles tirent parti, en termes de tranquillité, de coût de la vie, de paysage naturel. Mais elles accueillent d’abord une population en transit (en vacances, en année sabbatique, en début de retraite…). Le télétravail se développe vraiment, les salariés peuvent réduire leurs déplacements professionnels contraints, le logement présente une fonction mixte en dédiant certains espaces à l’activité professionnelle, au moins une partie du temps. Les villes moyennes à la périphérie des métropoles se développent. On peut arriver à une situation d’équilibre, voire au réseau urbain hexagonal prédit par Pierre Veltz, c’est-à-dire un système bien vascularisé, où l’ensemble du territoire est mobilisé. Les activités économiques ne se concentrent pas exclusivement dans quelques pôles métropolitains. À la recherche d’espace et de main-d’œuvre et en rupture avec la tendance à rallonger les chaînes de fabrication, des petites industries, tirant parti de savoir-faire locaux, de micromarchés et des nouvelles technologies industrielles (comme l’impression en trois dimensions, 3D), s’installent en dehors des métropoles. Les villes moyennes et intermédiaires se développent en prenant le relais des métropoles. Même dans les territoires plus isolés, le dynamisme tire parti des atouts locaux. Chaque territoire peut jouer sur ses atouts, ses traditions industrielles ou économiques, ses facteurs d’attractivité et le fait d’avoir de la place, de ne pas être saturé, font certainement partie des facteurs d’attractivité, par rapport à une région parisienne, par exemple, presque saturée. Les petites villes et mêmes les petites communes gagnent de la population. Elles ont les moyens de revaloriser et de réhabiliter leur centre-ville ou village (par opposition à la propagation des extensions).
Annexes
Annexe 1 : Composition du groupe de travail
Cyril Aulagnon, Stonup’
Jean Bosvieux, économiste, animateur du site « Politique du logement »
Estelle Brun, étudiante à Sciences Po Paris
Éric Cassar, fondateur et architecte principal, Arkhenspaces
Jean Duchâtelet, co-coordonnateur du pôle logement de Terra Nova
Guillaume Ginebre, Action Tank Entreprise et Pauvreté
Alexandre Guyader, co-coordonnateur du pôle logement de Terra Nova
Florian Guyot, directeur des opérations chez Aurore
Frédérique Lahaye de Freminville, co-coordonnatrice du pôle logement de Terra Nova
Cécile Maisonneuve, la Fabrique de la Cité
Sandra Moatti, directrice de l’Institut des hautes études en développement et aménagement des territoires en Europe (IHEDATE) et directrice de la revue l’Économie politique
Xavier Ousset, membre du pôle logement de Terra Nova
Nathalie Reuland, juriste
Bernard Vorms, économiste
Annexe 2 : Auditions
Éric Cassar, fondateur et architecte principal, Arkhenspaces, 6 décembre 2017
Pierre-Yves Cusset, France Stratégie, 17 janvier 2018
Hervé Le Bras, démographe, 17 janvier 2018
Hugo Bevort, Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 6 février 2018
Pierre Veltz, économiste, 6 février 2018
Jean Bosvieux, animateur du site « Politique du logement », 28 février 2018
Bernard Coloos, économiste, Fédération française du bâtiment, 28 février 2018
Laurent Ghekiere, Union sociale pour l’habitat, 26 mars 2018
Nathalie Reuland, juriste, 4 avril 2018
Bernard Vorms, économiste, auteur du rapport « La révolution numérique et le marché du logement », 17 avril 2018
Monique Eleb, sociologue de l’habitat, 16 mai 2018
François Corrèze, Directeur du service Habitat connecté (Engie), 16 mai 2018
Maurice Sissoko, ICADE, 31 mai 2018
Marie Baleo, présentation du rapport de la Fabrique de la Cité, « Villes européennes et réfugiés »
Guillaume Ginebre, Action Tank Entreprise et Pauvreté, 6 juin 2018
Cyril Aulagnon et Virginia Scapinelli, Stonup’, 25 juin 2018
Entretien avec Valérie Cohen, directrice IARD (incendie, accidents et risques divers), Covea, Lundi 2 juillet 2018
Arnaud Bouteille, 6 septembre 2018
http://tnova.fr/notes/politique-du-logement-comment-faciliter-la-mobilite-professionnelle ↑
Cour des comptes, « Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés », synthèse, février 2017, p. 11. ↑
Moins de 6 % des ménages se déclarent insatisfaits de leur logement en 2013, voir « Politique du logement : mauvais procès, vrais enjeux », Terra Nova, 23 juillet 2018, p. 4. ↑
Évolution : 225 000 résidences secondaires en 1946, 1 255 000 en 1968, voir Jean Bosvieux, « Besoins et demande de logements », in Marion Segaud, Catherine Bonvalet, Jacques Brun (dir.), Logement et habitat, l’état des savoirs , Paris, Éditions La Découverte, 1998, p. 87. ↑
Un logement vacant pour l’Insee est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : proposé à la vente, à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation; en attente de règlement de succession ; conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste…). Par comparaison, on dénombrait 535 000 logements vacants en 1954, 1 223 000 en 1968, voir Jean Bosvieux, article cité. ↑
Une petite partie de la population (3 %) est hébergée chez d’autres habitants. ↑
Cet accroissement est calculé en prenant en compte la croissance démographique et la décohabitation. Les calculs n’intègrent pas les migrations internes ni l’immigration. Voir Jean Bosvieux, « Besoins et demande de logements », article cité. ↑
Le confort sanitaire est défini à partir de trois éléments : l’eau courante, un WC à l’intérieur du logement, une douche ou une baignoire. ↑
Les zones tendues sont définies par un décret du 10 mai 2013 : il s’agit de 28 agglomérations où l’on reconnaît un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entrainant des difficultés sérieuses d’accès au logement. ↑
D’après les travaux du Conseil d’orientation des retraites, le niveau de vie moyen des retraités par rapport aux actifs, qui est de 103 % en 2018 devrait progressivement diminuer et se situerait à 90 % en 2040 (à législation inchangée). http://www.cor-retraites.fr/simulateur/ ↑
France métropolitaine, familles avec au moins un enfant de 0 à 24 ans (en âge révolu). Source : Insee, recensement 2008. ↑
« La vacance résidentielle s’accentue », Insee Première , n° 1700, août 2018. Voir les cartes : https://oqp.io/carte-localisation-logements-vacants ↑
Voir Jean Bosvieux, « Faut-il construire plus de logements ? », février 2019, sur politiquedulogement.com http://politiquedulogement.com/PDF/Q&C/Besoins-JB.pdf ↑
Les communes densément peuplées sont les communes au sein desquelles au moins 50 % de la population vit dans des zones de densité supérieure à 1 500 habitants au km 2 ; les communes les moins denses comptent moins de 300 habitants au km 2 . En 2013, 35,5 % de la population vivait dans des zones densément peuplées et une proportion équivalente dans les zones faiblement (31,3 %) ou très faiblement (4,1 %) peuplées. ↑
Au-delà des limites et des frontières. Les grandes questions métropolitaines aujourd’hui , La Fabrique de la Cité, 2017, p. 13. ↑
Dares analyses , « Les temps de déplacement entre domicile et travail », novembre 2015. Il s’agit du temps consacré en moyenne par jour travaillé pour aller du domicile au lieu de travail et revenir. ↑
La dernière enquête Insee « emploi du temps » date de 2010. Pour 2018, les chiffres viennent d’évaluations privées : https://daliaresearch.com/the-countries-with-the-longest-and-shortest-commutes/ ↑
Dares analyses , « Les temps de déplacement entre domicile et travail », novembre 2015. ↑
Enquête de L’Observatoire société et consommation (Obosco), 2017, cité par Le Monde , 15 novembre 2017. ↑
Paris intramuros a perdu en moyenne 0,3 % de sa population par an entre 2010 et 2015. Source : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017. ↑
Voir par exemple la note de Terra Nova : Laurent Davezies, « Le Monde rural en mutation », 7 juillet 2017, http://tnova.fr/notes/le-monde-rural-en-mutation ↑
« Démographie des EPCI : la croissance se concentre dans et au plus près des métropoles », Insee Première , n° 1729, janvier 2019. ↑
Olivier Bouba-Olga, Dynamiques territoriales. Éloge de la diversité , Atlantique, 2018, p. 44. ↑
Sur la géographie actuelle du vieillissement, voir « Le vieillissement de la population et ses enjeux », Observatoire des territoires 2017, Commissariat général à l’égalité des territoires. ↑
Insee, enquêtes Logement 2001, 2006 et 2013, présentation de Pierre-Yves Cusset à Terra Nova, 9 novembre 2017. Le taux d’effort est le rapport entre la somme des dépenses liées à l’habitation principale et les revenus des ménages. ↑
Conférence nationale des Territoires, « Rapport sur la cohésion des territoires », Commissariat général à l’égalité des territoires, juillet 2018, p. 9. ↑
Laurent Davezies, Thierry Pech, « La nouvelle question territoriale », Terra Nova, septembre 2014, p. 4. ↑
Laurent Davezies, Thierry Pech, article cité. ↑
Marc Brunetto, Denis Carré, Nadine Levratto, Luc Tessier, « Analyse du lien entre les métropoles et les territoires avoisinnants », Economix , 2018. ↑
Cette typologie est développée par M. Brunetto D. Carré, N. Levratto, L. Tessier, article cité, p. 39–44. ↑
« Soutenir les territoires en crise ou aider leurs habitants à s’installer ailleurs ? », CGET, juin 2017. ↑
Jean-Benoît Eyméoud, Etienne Wasmer, Vers une société de mobilité. Les jeunes, l’emploi et le logement , Presses de Sciences Po, 2016. ↑
« Paris, la densification au secours du logement abordable ? », in La Fabrique de la Cité, « Logement abordable et métropoles européennes en croissance », octobre 2018. ↑
Étude Century 21, 2016, cité dans l’exposition « Habiter mieux, habiter plus » au Pavillon de l’Arsenal, 2018. ↑
Voir le projet d’immeuble participatif « Wohnprojekt » à Vienne, Le Monde , 25 avril 2018. ↑
Voir Georges Vigarello, Le Propre et le sale , Seuil, 1987 et les contributions de Michelle Perrot dans Philippe Ariès et Georges Duby, Histoire de la vie privée , vol. 4., « De la Révolution à la Grande Guerre », Seuil, 1987. ↑
Françoise Choay, Pour une anthropologie de l’espace , Seuil, 2006. ↑
Dares analyses , « Les temps de déplacement entre domicile et travail », novembre 2015 et https://daliaresearch.com/the-countries-with-the-longest-and-shortest-commutes/. ↑
« Chiffres clés du transport », édition 2017, présentés dans le cadre des Assises de la mobilité : https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/comprendre/documentation.html ↑
« Projections de la demande de transport en France », Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, ministère chargé des Transports, mai 2017, présenté dans le cadre des Assises nationales de la mobilité. ↑
Parmi les dispositions de la réforme du code du travail votée en 2017 (loi « travail 2 »), le télétravail voit son cadre légal clarifié. ↑
« Nouveaux modes de travail et enjeux de mobilité », IAU IDF, novembre 2016, p. 29. ↑
Selon une estimation de la Caisse des Dépôts en 2014, citée dans « Nouveaux modes de travail et enjeux de mobilité », IAU IDF, novembre 2016, p. 31. ↑
« Nouveaux modes de travail et enjeux de mobilité », IAU IDF, novembre 2016. ↑
Monique Eleb, Philippe Simon, Le Logement contemporain. Entre confort, désir et normes , Mardaga, 2013. ↑
« Le travail en horaires atypiques : quels salariés pour quelle organisation du temps de travail ? » Dares analyses , juin 2018, n° 30. ↑
« Le « coliving », nouvel habitat des grandes villes », Le Monde , 23 novembre 2018 : « Dans chacun des cent appartements meublés, on trouve six chambres, trois salles de bains et un salon-cuisine à partager. Divers services sont compris dans le loyer : un spa, une salle de fitness, le ménage, des événements le soir, un café épicerie… » ↑
Présentation à Terra Nova de Cyril Aulagnon et Virginia Scapinelli, (Stonup’) : « Business model des acteurs du co-living. Un marché émergent », le 25 juin 2018. ↑
« Le « coliving », nouvel habitat des grandes villes », article cité . ↑
http://www.thebabelcommunity.com ↑
https://livecolonies.com ↑
https://www.welive.com/fr-CA ↑
http://limelivingspaces.com/living-spaces ↑
Marc Brunetto, Denis Carré, Nadine Levratto, Luc Tessier, article cité, p. 5. Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. ↑
Voir Monique Eleb, Urbanité, sociabilité, intimité. Des logements d’aujourd’hui, Éditions de l’Épure, 1997 (avec A.‑M. Châtelet). ↑
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_448 ↑
Monique Eleb a répertorié ces différentes stratégies dans le cadre de sa réponse au concours du Grand Paris. ↑
Voir les résultats de l’enquête menée par le Credoc, pour Terra Nova, le groupe Caisse des Dépôts et AG2R LA MONDIALE sur l’entrée en institution : « L’heure du choix. L’entrée des personnes âgées en maison de retraite », 28 septembre 2018, http://tnova.fr/notes/l-heure-du-choix-l-entree-des-personnes-agees-en-maison-de-retraite ↑
Focus-group réalisé par Bouygues en 2011 et 2015, audition de François Corrèze, directeur du service Habitat connecté (Engie), le 16 mai 2018. ↑
Ademe, ATEMIS, Patrice Vuidel, Brigitte Pasquelin, « Vers une économie de la fonctionnalité à haute valeur environnementale et sociale en 2050 », 2017, www.ademe.fr/mediatheque ↑
http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-demain/bordeaux-brazza ↑
La loi ALUR a modifié le Code de la construction et de l’habitation pour permettre le développement de l’habitat participatif, décrit comme « un regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment collectif ». ↑
Voir le projet « Habiter l’infini » par Arkhenspaces. ↑
La seule question du financement de l’accès au logement mériterait à elle seule une étude mais nous ne connaissons pas de prévisions à vingt ans sur ce sujet. ↑
Selon une étude récente de la Banque des territoires réalisée, la valeur des biens immobiliers situés dans les grandes villes a progressé de 8 % dans les métropoles et décliné de 14 % dans un échantillon de villes moyennes entre 2011 et 2018, un chiffre d’autant plus remarquable que l’échantillon ne comprend pas des cas critiques comme ceux de Saint-Etienne (- 36 %) ou Bourges (- 23 %), « Logement - Marché de l’immobilier : les inégalités territoriales se creusent depuis la crise de 2008 », 4 septembre 2018, https://www.banquedesterritoires.fr/marche-de-limmobilier-les-inegalites-territoriales-se-creusent-depuis-la-crise-de-2008 ↑
Cour des comptes, op. cit., p. 5. ↑
Cour des comptes, op. cit., p. 11. ↑
Voir « The state of the housing in the EU 2017 », www.housingeurope.eu. ↑
Les dispositions récentes de la loi ELAN ne modifient pas ces orientations de long terme. Les conditions d’accès au logement social n’ont pas été modifiées. Le droit au maintien dans les lieux n’est pas remis en cause même si les modalités d’occupation des logements seront examinées régulièrement (en fonction notamment de l’évolution des ressources et de la composition de la famille). Le regroupement des organismes gérant moins de 15 000 logements peut renforcer à terme leur capacité d’action. Les incitations à augmenter les ventes d’appartements du parc social (les ventes représentent moins de 1 % du parc chaque année actuellement) afin de dégager davantage de fonds propres resteront probablement d’une ampleur limitée, cf. Bernard Coloos et Bernard Vorms, « Vendre les HLM, bonnes et mauvaises raisons », politiquedulogement.com, 21 juin 2018. ↑
Guillaume Ginèbre, Action Tank Entreprise & Pauvreté, « Un logement d’abord », présentation à Terra Nova le 6 juin 2018. ↑
Voir le livre de Julien Damon, Un monde de bidonville. Migrations et urbanisme informel , La République des Idées/Le Seuil, 2018, qui montre que c’est général dans les pays développés, ainsi que le travail un peu antérieur de Pascal Noblet, Pourquoi les SDF restent dans la rue , Éditions de l’Aube, 2014, dans lequel l’auteur plaide pour une politique de « stabilisation » qui dépasse la coupure entre urgence et insertion, en proposant un dispositif continu et complet (suivi psychologique, emploi aidé, accompagnement social, hébergement pérenne). ↑
Projet de Stratégie nationale bas carbone, 2018 :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf ↑
Ademe, « Étude prospective sur les impacts du changement climatique pour le bâtiment à l’horizon 2030 à 2050 », janvier 2015, p. 16–17. ↑
Mairie de Paris, « Étude pluridisciplinaire des impacts du changement climatique à l’échelle de l’agglomération parisienne », octobre 2012. ↑
Voir les chiffres clés du climat https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018–12/datalab-46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018_1.pdf ↑
Y compris rénovations partielles ↑
Et sa transformation annoncée mais non réalisée en prime, en cohérence avec le prélèvement à la source. ↑
Cf. notamment programmes « coup de pouce » générant les opérations de type « combles à 1 € ». ↑
En 2012, 53,6 % du parc des logements est en classe D ou E, voir Commissariat général au développement durable, « Le parc des logements en France métropolitaine en 2012 », Chiffres et statistiques , n° 534, juillet 2014, p. 2. ↑
Enquête Phebus, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2013, voir Commissariat général au développement durable, « Le parc des logements en France métropolitaine en 2012 », Chiffres et statistiques , n° 534, juillet 2014, p. 7. ↑