Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 5 chantiers prioritaires pour aller plus loin
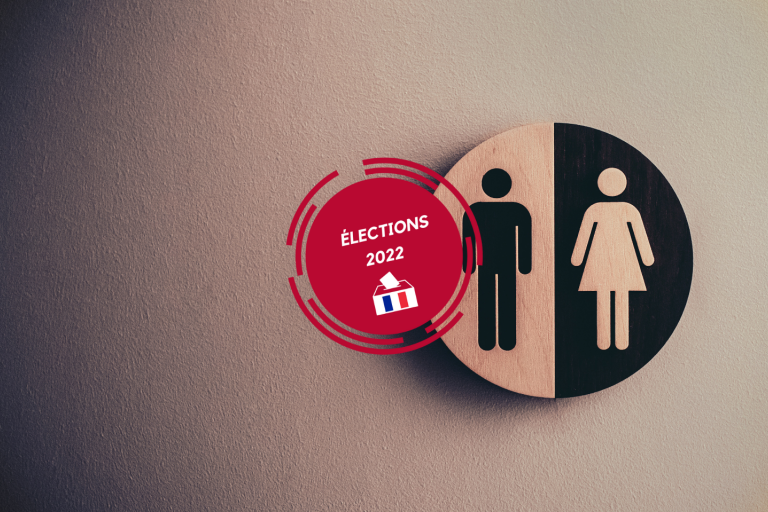
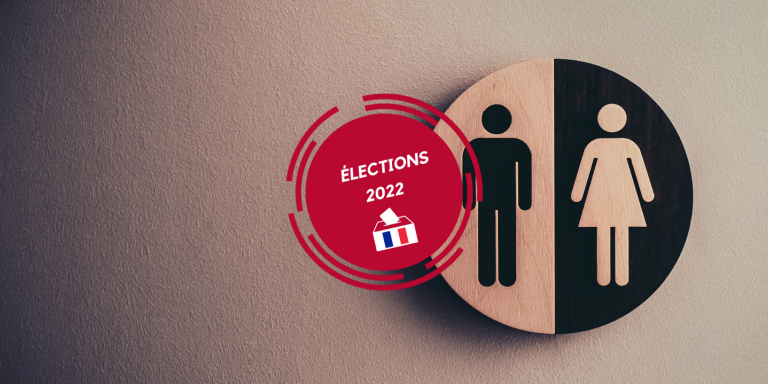
Durant les cinq dernières années, Terra Nova a formulé un certain nombre d’analyses et de recommandations pour accélérer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Si la question a connu quelques avancées notables, avec notamment la mise en place de l’index de l’égalité professionnelle, l’allongement du congé paternité et, plus récemment, l’imposition de quotas de femmes dans les comités de direction des plus grandes entreprises, nous avons souhaité, à l’aube de l’élection présidentielle, remettre en perspective nos travaux afin de proposer, à la lumière des dernières avancées, des pistes de réflexion pour aller plus loin.
Convaincus que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne pourra advenir que par la mise en oeuvre d’une politique globale, au carrefour des politiques familiales, éducatives, liées à l’emploi et à la fiscalité, nous invitons ici à une réflexion plus générale que celles relatives au seul marché du travail et de la hiérarchisation de l’utilité des métiers.
Il est en effet indispensable, pour aller vers plus d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de tenir compte de la complexité des différents facteurs qui influencent l’organisation genrée de la société. Nous interrogeons ici tour à tour : la place de l’école dans la construction de trajectoires professionnelles différenciées entre les femmes et les hommes, les mécanismes à l’oeuvre sur le marché du travail qui maintiennent les femmes dans les professions les moins rémunérées, la place de la parentalité dans la fabrique des inégalités, les fondements de notre système fiscal et enfin le système de versement et de recouvrement des pensions alimentaires.
5 propositions ont été élaborées en ce sens :
- Instaurer une culture commune de l’égalité dès l’école :
- Définir un cadre clair et harmonisé pour la formation initiale et continue de l’ensemble des personnels d’éducation pour que l’égalité filles/garçons soit désormais intégrée de manière effective aux enseignements et aux pratiques pédagogiques
- Impulser une politique globale mobilisant l’ensemble des parties prenantes (Etat, collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur entreprises, et parents d’élèves) destinée à favoriser la mixité entre les filles et les garçons tout au long de la scolarité
- Réformer le congé parental pour renforcer l’implication des pères dans l’éducation des enfants : rendre attractif un congé parental plus court et mieux rémunéré, en conservant pour les couples qui le souhaitent la possibilité d’opter pour le congé classique plus long
- Revaloriser les métiers féminisés en lançant une expérimentation inspirée de la méthode d’évaluation des emplois pilotée par le Ministère du Travail mobilisant les branches professionnelles prioritaires (nettoyage, aide à la personne)
- D’un point de vue fiscal, lever les freins à l’indépendance économique des femmes :
- Etudier l’hypothèse de l’individualisation de l’impôt sur le revenu et plafonner le quotient conjugal pour ne pas décourager le travail des femmes
- Défiscaliser les pensions alimentaires pour les parents ayant la garde des enfants
En finir avec les impayés de pensions alimentaires grâce à la mise en place d’une agence chargée de percevoir toutes les pensions alimentaires et de les verser aux parents créanciers.
Introduction
Les dispositifs mis en œuvre ont notamment permis de faciliter l’accès de plus de femmes à de hautes fonctions. On a en outre pu se réjouir d’une série de nominations de femmes à la tête de grandes institutions publiques ou privées : Laurence des Cars au Louvre, Delphine d’Amarzit à la Bourse de Paris, et Chrystel Hedeyman chez Orange qui devient ainsi la seconde femme à la tête d’une entreprise du CAC40.
En dix ans, la loi Copé-Zimmermann (2011) a permis de passer de 15% à 45% de femmes dans les Conseils d’Administration des plus grandes entreprises grâce à l’imposition de quotas. Toutefois, le “ruissellement” espéré aux autres niveaux de responsabilités ne s’est pas concrétisé : dans les comités de direction et parmi les cadres dirigeants, les femmes représentent aujourd’hui à peine 22% des effectifs dans les entreprises du SBF120[1]. Un chiffre que feront sans doute augmenter progressivement les dispositions prévues par la loi Rixain qui instaurera à son tour, un quota de 30% puis 40% de femmes dans les comités exécutifs et parmi les cadres dirigeants des grandes entreprises à partir de 2026. En effet, les précédents travaux de Terra Nova ont montré à quel point l’instauration de quotas s’était révélée être un puissant levier d’incitation[2]. Il y a donc de bonnes raisons d’espérer que cette nouvelle obligation permette de promouvoir des femmes à ces postes haut placés, à condition toutefois que les entreprises s’organisent dès à présent pour constituer des “réservoirs” de futures femmes dirigeantes parmi leurs équipes. On sait en effet que les principales organisations patronales avaient souligné la difficulté pour certaines entreprises, en particulier dans les secteurs les moins féminisés, à constituer des “viviers” de femmes dirigeantes. Il faudra donc que les entreprises soumises à cette obligation s’emploient, dès le recrutement, à créer des parcours ascendants pour les femmes, afin de leur permettre, par le jeu des promotions successives, d’accéder à ces postes de direction. Autre avancée significative permise par l’adoption de la loi Rixain : BPI France devra viser progressivement la parité dans le soutien aux entreprises et instaurer un seuil de 30% de femmes dans les comités de sélection des projets. C’est un premier pas bienvenu pour faciliter le financement des entreprises créées par des femmes.[3]
En effet, selon une étude réalisée par le Boston Consulting Group pour le collectif Sista en 2019[4], à peine 5,4% des startups fondées en France depuis 2018 l’ont été par une équipe 100% féminine. Lorsqu’elles sont financées par les principaux investisseurs, ces dernières reçoivent 2,5 fois moins de fonds que les entreprises dont l’effectif est 100% masculin. Ailleurs en Europe, l’écart est supérieur en Allemagne (3 fois moins) mais inférieur au Royaume-Uni (1,3 fois moins). L’instauration de ces dispositions nouvelles pourrait permettre de rééquilibrer la donne.
Si ces avancées sont significatives et importantes, les travaux de Terra Nova ont souligné à plusieurs reprises que l’objectif de contribuer à briser le “plafond de verre” ne doit pas faire perdre de vue un enjeu tout aussi fondamental pour l’égalité professionnelle, et qui résiste : au-delà d’accéder difficilement aux plus hautes fonctions, les femmes restent concentrées dans les métiers les plus faiblement rémunérés. En effet, comme le rappelle un récent rapport d’Oxfam[5] publié fin 2021 “l’immense majorité de l’écart est ailleurs, c’est le fruit d’une ségrégation professionnelle qui assigne aux femmes une surreprésentation dans les métiers les moins bien rémunérés et dans les emplois à temps partiels subis”. C’est “l’ordre sexué” du travail déjà analysé dans nos précédents travaux sur l’index de l’égalité professionnelle et sur la mixité des métiers qui avaient d’ailleurs insisté sur la nécessité de briser à la fois le “plafond de verre” et le “plancher collant”. Car on le sait : l’entrée des femmes sur le marché du travail, concomitante avec la croissance du secteur tertiaire, « a conduit beaucoup de femmes à effectuer sur le registre salarié des tâches auparavant réalisées dans la sphère familiale », mettant ainsi en œuvre des qualités ou capacités considérées comme « féminines » : nourrir, prendre soin et éduquer (dans le prolongement de leur rôle de mère et d’épouse). Ainsi, en 2018, les secteurs de la santé, de l’hébergement, du médico-social, de l’action sociale et les services aux ménages emploient, à eux seuls, 41,8% des femmes actives françaises. Elles représentent 90 % des salariés des services à la personne et 90 % des aides-soignants et agents de services hospitaliers. A contrario, les hommes représentent près de 70 % des ingénieurs de l’informatique et des professionnels de la R&D. [6]
Ces compétences présumées “naturelles” influencent les choix d’orientation en amont du marché du travail qui conditionnent eux-mêmes les positions respectives des femmes et des hommes sur le marché du travail. Elles conditionnent également la répartition des tâches parentales et domestiques au sein du foyer. Selon un sondage Harris Interactive[7] réalisé en avril 2020, 58% des femmes estiment assurer la majorité des tâches domestiques et éducatives. Les résultats du sondage rapportent également que, durant le premier confinement, une majorité de femmes a continué de dédier entre 2 et 3h de leur temps au travail domestique (28%) contre 18% des hommes. Dans le détail, la majorité des femmes interrogées déclare être celles qui préparent les repas (63% contre 28% des hommes) et celles qui aident le plus les enfants pour leurs devoirs (56% contre 27% des hommes). A noter que ces chiffres correspondent du reste aux résultats des enquêtes menées hors période de confinement.[8] Or, il est évident que ces disparités dans la répartition des tâches au sein du foyer impacte la sphère professionnelle. L’économiste Hélène Périvier interrogée lors d’une audition parlementaire au Sénat dans le cadre d’une mission d’information en 2012[9] soulignait, que “même lorsque les femmes sortent d’une école d’ingénieur, elles auront tendance à aller vers des “métiers parallèles” et non vers des “métiers coeur” car elles “anticipent le poids des futures responsabilités familiales’ soulignant du même coup l’ambiguïté du rôle du marché du travail, “à la fois porteur d’émancipation pour les femmes puisqu’il permet l’accès à l’autonomie, tout en entretenant les rapports inégalitaires qui existent dans le reste de la société”[10].
A la lumière des différents travaux réalisés par Terra Nova et en tenant compte des avancées significatives des dernières années en matière d’égalité professionnelle, nous invitons ici à une réflexion plus générale que celles relatives au seul marché du travail et de la hiérarchisation de l’utilité des métiers. Il est en effet nécessaire, pour atteindre plus d’égalité professionnelle, d’entamer une réflexion sur la place de l’école dans la résorption des inégalités liées au genre dont on sait qu’elles se forgent dès l’enfance et conditionnent les trajectoires professionnelles des hommes comme celles des femmes. Nous sommes également convaincus que l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ne pourra advenir sans une meilleure répartition des tâches domestiques et éducatives. C’est la raison pour laquelle nous proposons des pistes de réflexion pour réviser les congés de naissance et favoriser ainsi une plus grande implication des pères dans l’éducation des enfants. Enfin, il nous est également apparu nécessaire d’interroger les fondements de notre système fiscal et ses effets sur l’émancipation économique des femmes, notamment dans l’accès au travail.
1. Instaurer une culture commune de l’égalité dès l’école :
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place à compter de mars 2022 d’une “semaine de l’égalité entre les filles et les garçons à l’école” durant laquelle élèves et enseignants pourront se mobiliser autour de projets divers. Si les modalités et le contenu n’en n’ont pas encore été précisés, cette initiative, qui traduit la volonté d’instaurer à l’école les prémices d’une culture commune de l’égalité entre les filles et les garçons, est un premier pas intéressant, bien que loin d’être suffisant. D’autres mesures ont été mises en place à l’école sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, dans le prolongement de ce qui avait été initié sous le quinquennat précédent : référents égalité et formation obligatoire des personnels d’éducation, mais cette obligation de formation reste à ce jour non formalisée. Un cadre doit désormais être posé pour enclencher la dynamique.
Ce point est crucial : car si les hommes et les femmes continuent de se répartir de façon différenciée dans les différents métiers et secteurs d’activité, c’est que les choix d’orientation en amont du marché du travail restent eux-aussi fortement différenciés entre les filles et les garçons, et ce quel que soit le niveau de qualification. Les précédents travaux de Terra Nova sur la mixité des métiers avaient déjà pointé le rôle structurant de l’école de ce point de vue. Un rôle crucial tant dans la fabrique de trajectoires professionnelles différenciées et des processus de socialisation fondés sur le genre que dans sa responsabilité (et son potentiel) à contribuer dès aujourd’hui à la construction de la société égalitaire de demain.
Nous notions dans nos travaux qu’en dépit des conventions ministérielles successives, les écarts entre les intentions affichées et les résultats obtenus demeurent importants, alors même que la formation des enseignants aux enjeux d’égalité filles/garçons est en théorie devenue obligatoire. Les effets se font toujours attendre alors qu’il semble acquis aujourd’hui que les politiques publiques ne peuvent plus se borner à l’affirmation du principe d’égalité républicaine entre les filles et garçons. Elles doivent aussi veiller à la neutralité effective des institutions de ce point de vue[11].
Pourtant, si le principe est acquis, dans les faits, il n’y a pas, actuellement, d’heures spécifiquement dédiées à la question dans les programmes scolaires. Ils n’imposent rien de précis à ce sujet, excepté dans l’enseignement moral et civique devant permettre aux élèves d’acquérir “les valeurs de la République” dont “l’égalité entre les filles et les garçons” fait partie. Même chose dans la formation du personnel éducatif même si elle est en théorie devenue obligatoire. Un article du journal Le Parisien[12] datant de novembre 2021 interrogeant des enseignants et enseignantes sur le sujet rapporte les témoignages suivants : « il y a une différence entre ce qui doit se faire en principe et la réalité » rapporte une enseignante de la Sarthe. “C’est la formation qui pêche”, “on n’interroge pas nos pratiques, qui peuvent être inégales”, “ce qu’il faudrait, c’est une formation d’ampleur sur la question des préjugés, parce que les enseignants, même inconsciemment, véhiculent les stéréotypes de sexe”. Pour l’heure donc, des ambitions allant dans le bon sens, mais pas de modules de formation unifiés, ni de volume d’heures d’enseignement requis dans la formation des personnels éducatifs. C’est pourtant un premier pas essentiel : il est crucial d’apprendre aux enfants à comprendre les stéréotypes de genre, à développer leur regard critique afin que les stéréotypes ne limitent pas leurs champs d’exploration. Cela pose aussi la question de la mobilisation de l’ensemble des personnels éducatifs (et pas seulement les enseignants) ainsi que les parents d’élèves. Nous pensons en effet qu’associer les parents d’élèves à la démarche est en effet un facteur clé de succès, qui permettrait de renforcer l’efficacité des politiques déployées : pour les sensibiliser à la démarche, les aider à réviser leurs propres biais, leur permettre de mieux soutenir leurs enfants dans leurs choix d’orientation, etc.
Propositions :
Définir un cadre clair et harmonisé pour la formation initiale et continue des enseignants et de l’ensemble des personnels d’éducation[13] pour que l’égalité soit intégrée à la fois aux enseignements et aux pratiques pédagogiques :
- définition d’un volume d’heures précis obligatoire dédié aux enjeux d’égalité filles/garçons dans la formation initiale et continue des enseignants (le volume d’heures oscille aujourd’hui entre 2 et 57 heures annuelles). Ce volume d’heures pourrait être calqué sur celui prévu dans le cadre des formations aux enjeux de la laïcité qui font aujourd’hui l’objet de 36 heures réparties sur deux ans dans le cadre de la formation initiale des enseignants
- homogénéisation de l’offre de formation, aujourd’hui disparate d’un territoire à l’autre (seule la moitié des ESPE propose un module dédié à l’égalité filles/garçons)
- Impulser une politique globale destinée à favoriser la mixité en impliquant fortement les parents d’élèves : mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (État, collectivités territoriales, établissements d’enseignement supérieur, entreprises, monde académique et parents d’élèves) et organisation de rencontres durant toute la durée de la scolarité avec : le monde professionnel, le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, etc pour permettre concrètement aux élèves et à leurs parents de se projeter dans la suite de leur parcours et d’élargir leur champ des possibles.
2. Unifier les congés familiaux
Il va de soi que toutes les mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle n’auront qu’un effet limité si d’autres mesures ne sont pas prises en complément pour renforcer l’implication des pères dans l’éducation des enfants. Nous pensons que celle-ci peut être renforcée dès les premiers mois de la vie des enfants, notamment dans le cadre des congés de naissance, dont nous proposons de revoir le cadre.
Depuis le 1er juillet 2021, le congé paternité a été allongé à 28 jours, contre 11 jours auparavant (mais avec seulement 7 jours obligatoires). Comme précédemment, c’est toujours l’employeur qui prend en charge les trois premiers jours suivant la naissance, le reste du congé étant ensuite indemnisé par la sécurité sociale, tout comme le congé maternité. Les indemnités versées varient toujours selon le salaire du père (entre 9,66 euros et 89,03 euros par jour). Cette mesure, dont le coût total est estimé à 520 millions d’euros par an (estimation chiffrée par nos travaux sur la petite enfance) est un premier pas bienvenu pour encourager les pères à rester auprès de leur nouveau-né, même s’il convient de rappeler que le rapport sur les 1000 premiers jours de l’enfant recommandait d’allonger cette durée à 9 semaines. Le même rapport rappelait du reste que ce congé était relativement court en France, comparé à d’autres pays européens (15 semaines en Norvège; 16 semaines en Espagne, dans les deux cas rémunérés à hauteur de 100% du salaire; 7 mois en Finlande soit équivalent à la durée du congé maternité).
En parallèle, le congé parental, déjà réformé en 2015, fait actuellement l’objet d’un projet de révision, selon les annonces du Secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet.[14] Ce congé, rappelons-le, est rémunéré sur la base d’une allocation forfaitaire (398 euros par mois en cas de cessation totale d’activité, 257 euros pour une durée de travail inférieure ou égale à un mi-temps), incitant donc le membre du couple touchant la rémunération la plus faible à interrompre sa carrière, donc dans l’immense majorité des cas, les femmes. Il est d’une durée d’un an, renouvelable deux fois. Sa révision en 2015 avait vocation à rendre ce congé plus égalitaire : depuis, pour impliquer davantage les pères (qui ne sont que 0,8% à y recourir -contre 0,5% avant la réforme-), il ne dure plus trois ans, mais deux pour les familles de plus de deux enfants, sauf si les parents se le partagent. Sa révision n’aura donc pas permis une plus grande implication des pères et elle a, de plus, provoqué une baisse importante du nombre de bénéficiaires (272 000 pères et mères fin 2018, soit 43% de moins qu’avant la réforme).[15] En 2018, les mères ne sont d’ailleurs que 14% à y recourir. [16]
Une proposition de loi visant à le réformer a été déposée récemment.[17] S’il est peu probable que l’examen du texte se fasse avant la fin du quinquennat, il est intéressant de relever l’analyse qu’il développe.
Le texte rapporte les raisons de l’échec de la précédente réforme, notamment : “trop faible rémunération de ce congé maintenu à environ un tiers du smic pour un taux plein”; “aux deux ans de l’enfant, les familles se trouvent dans l’obligation de trouver un mode de garde, ce qui n’est pas aisé et coûteux”; “les mères ayant gardé leurs enfants pendant deux ans se retrouvent souvent au chômage n’obtenant pas d’emploi leur permettant d’assumer ce coût”.
Dans un rapport publié en 2012, intitulé “Les défis du care : renforcer les solidarités”, nous suggérions de réformer ce congé parental d’éducation en rendant attractif un congé plus court (d’un an au maximum) afin de maintenir dans de meilleures conditions le lien entre la vie familiale du parent en congé et sa vie professionnelle, et afin de mieux impliquer le père dans les soins aux enfants et ce dès le plus jeune âge. Nous proposions toutefois de conserver en parallèle la possibilité pour les parents d’opter pour un congé long de trois ans car sa suppression totale serait préjudiciable aux couples qui souhaiteraient et auraient la possibilité d’y recourir.
C’est l’orientation donnée à la proposition de loi visant à réformer le congé parental déjà évoquée (laisser le choix aux parents entre un congé parental plus court et mieux rémunéré et le congé parental existant). Comme le soulignait le rapport Damon-Heydemann remis au Gouvernement en septembre 2021 et qui formulait diverses recommandations allant dans le sens d’un congé parental plus court et mieux rémunéré “pour les enfants, pour les parents, comme pour les entreprises, concilier vie familiale et vie professionnelle, c’est permettre aux parents qui y aspirent de travailler. Il s’agit aussi de limiter un non-recours de certains parents qui, désincités par le faible montant de l’indemnisation, ne passent pas par ce congé parental alors que cette présence auprès de leurs jeunes enfants a leur préférence. ”Dans nos précédents travaux, nous proposions ainsi de réformer l’ensemble du dispositif par la fusion du congé maternité, du congé de paternité et du congé parental d’éducation. Sa durée serait d’un an. Ce congé serait ainsi un dispositif unique, flexible, compréhensible par tous et afficherait clairement son objectif : permettre aux deux parents de prendre soin de leurs enfants et de passer du temps avec eux sans que leur investissement professionnel en soit affecté
Proposition : rendre attractif un congé parental plus court et mieux rémunéré, en conservant pour les couples qui le souhaitent la possibilité d’opter pour le congé classique plus long
Dans le détail, nous suggérons que ce congé parental réformé réponde aux caractéristiques suivantes :
- Ce congé correspondrait à un total de 12 mois à répartir à égalité entre les deux parents (6 mois chacun) jusqu’aux huit ans de l’enfant (sorte de capital-temps).
- La rémunération équivaudrait à 80% du dernier salaire
- Un indépendant bénéficierait d’un crédit d’impôt équivalant à ⅙ de ses revenus professionnels déclarés (avec la possibilité d’étaler ce crédit sur deux années fiscales). Dans les deux cas, un montant “plancher” et un montant “plafond” seraient à déterminer. Bien entendu, les entreprises et les employeurs pourraient compléter.
- La mère devrait obligatoirement prendre a minima 4 mois de congé (à repartir avant et après la naissance) et pas plus de six mois (rémunérés) au total, les deux mois supplémentaires étant à répartir à sa convenance, suivant ses obligations professionnelles, jusqu’aux huit ans de l’enfant.
- Le père devrait prendre 6 mois (à répartir à sa convenance suivant ses obligations professionnelles jusqu’aux huit ans de l’enfant). A défaut, ces six mois seraient perdus.
- Enfin, ce congé pourrait être pris en le cumulant avec un emploi à temps partiel, mais avec une prestation réduite (comme en Allemagne).
Ce congé tel que proposé vise un double objectif :
- Répondre à une forte demande de meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, notamment dans la période qui suit la naissance
- Lutter contre les inégalités de genre et impliquer plus fortement les pères dans les soins et l’éducation des jeunes enfants.
- En effet, sur ce dernier point, ce congé rémunéré à 80 % du dernier salaire suit un quadruple objectif :
- Permettre à tous les salariés de recourir à ce congé sans subir un trop grand préjudice financier : le remplacement d’une allocation forfaitaire par une pension calculée sur la base du dernier salaire devrait rendre plus attractif ce congé d’une année pour les personnes bénéficiant de salaires moyens ou élevés, notamment pour les pères ;
- inciter les pères à mieux s’impliquer dans l’éducation des enfants, notamment des jeunes enfants ;
- rendre socialement acceptable, puis « comme allant de soi », cette implication ;
– rendre à terme tout aussi « risqué » pour un employeur d’embaucher un homme qu’une femme (« risque » d’absence lié à la maternité) : c’est à ce prix que nous lutterons efficacement contre les discriminations à l’embauche envers les femmes.
Toutefois, nous avions noté en préalable que cette politique implique la création massive de places d’accueil, et notamment de structures collectives. En effet, si les parents choisissent un congé plus court, il est nécessaire que les enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle soient accueillis. Ce point rejoint l’une des conclusions du rapport Damon-Heydemann : il est en effet important que le recours au congé parental et à son indemnisation “ne dépende plus, comme c’est parfois le cas aujourd’hui, d’une offre parfois insuffisante du côté des services d’accueil (notamment dans certains territoires et pour certains publics”. En effet, nous avions alors souligné que toute réforme du congé parental d’éducation qui ne serait pas précédée, ou tout du moins accompagnée, par une vigoureuse politique de création de places d’accueil en collectif (crèches essentiellement) serait non seulement vouée à l’échec, mais aussi, dans son essence même, contre-productive : du libre choix réel, de la recherche de justice, etc. Nous nous engagerions dans une politique contraignante, voire fortement inégalitaire au détriment des femmes mais aussi et surtout in fine, des enfants.
Or, dans une note sur la petite enfance[18] publiée plus récemment, à la rentrée 2021, nous mettions en avant les résultats décevants en matière de création de nouvelles places en crèche. Alors que 50 000 places supplémentaires avaient été créées entre 2007 et 2012, puis 60 000 places supplémentaires entre 2012 et 2017, dès le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, le Gouvernement n’avait prévu de créer que 30 000 nouvelles places en cinq ans. Au printemps dernier, le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles annonçait que cet objectif peinerait à être atteint, en raison de la crise sanitaire. Nous avions du reste souligné que les créations de nouvelles places apparaissent d’ailleurs tirées surtout par les micro-crèches, généralement plus coûteuses que les crèches municipales et donc encore moins accessibles aux familles modestes. Toutefois, nous rapportions dans le cadre de ce rapport que d’après une récente étude de l’INSEE datant de 2020, les ouvertures de crèches avaient eu, depuis 20 ans, un effet quasi-nul sur l’emploi des mères. Cela peut sembler surprenant à première vue, mais pourrait s’expliquer par le fait que les places en crèche sont destinées en priorité aux couples bi-actifs. Difficile dans ce cadre pour une femme sans emploi d’obtenir une place en crèche quand bien même elle souhaiterait mettre ce temps à profit pour chercher un emploi. Cela pose également la question des mécanismes d’allocation des places en crèche, dont on a montré qu’ils restaient très opaque (critères d’attribution peu clairs, manque d’information disponible sur les procédures et les chances d’avoir une place, etc). Il serait souhaitable que ces mécanismes d’allocation soient clarifiés et unifiés par l’Etat, en lien avec les collectivités. Nous proposions en ce sens dans ce même rapport “une première réforme impérative et urgente” : rendre obligatoire la transparence complète sur les procédures d’attribution, c’est-à-dire le calendrier, et la composition des commissions d’attribution, les critères permettant de départager les familles candidates, la proportion des candidats qui obtiennent une réponse favorable. Nous proposons également que les financements nationaux versés par la CAF aux crèches soient conditionnés à une transparence complète. Ensuite, l’harmonisation des règles est un pré-requis nécessaire au bon fonctionnement de la démarche : fixer des critères d’attribution équitables qui ne bénéficieront pas [19]seulement aux couples ou les deux parents travaillent.
Enfin, de telles mesures supposent également que les métiers des professionnels de la petite enfance (en majorité des femmes) fassent l’objet d’une revalorisation : pour reconnaître l’importance de ces métiers pour l’avenir des enfants, lutter contre la forte pénurie de main-d’oeuvre dans ce secteur et renforcer l’attractivité de ces métiers très féminisés (et espérer ainsi y attirer plus d’hommes).
3. Revaloriser les métiers féminisés
Le scandale ORPEA accusé de maltraitances envers les résidents de ses EHPAD nous invite à une réflexion globale urgente sur la prise en charge de nos aînés, et questionne le modèle économique de ces établissements. Il pose aussi la question des conditions de travail des personnels de secteur et de leur juste reconnaissance. Ces emplois sont faiblement rémunérés, on le sait, et ils sont aussi très féminisés. Ils sont également peu valorisés, alors qu’il s’agit pourtant de métiers fortement en tension. Cette question avait déjà été évoquée dans notre précédent travail sur l’index de l’égalité professionnelle : nous expliquions, en prenant notamment appui sur les travaux de l’économiste Rachel Silvera que la non-reconnaissance de la qualification des femmes dans les métiers qu’elles occupent en majorité (parce que les compétences mises en œuvre dans l’éducation, la santé, l’aide à domicile, le nettoyage, l’assistanat ou la vente sont des compétences acquises dans la sphère privée et donc présumées naturelles) est un facteur de sous-valorisation. Ce point traduit un biais dans les méthodes d’évaluation et de classification des emplois aujourd’hui utilisées. Nos travaux avaient là aussi déjà suggéré l’intérêt de chausser de nouvelles lunettes en interrogeant la possible sous-valorisation de ces métiers (en termes de compétences requises, de niveau de responsabilités et de pénibilité notamment). C’est une piste qui nous semble être à privilégier pour agir efficacement en faveur de la mixité des métiers. Revaloriser ces métiers permettrait en outre d’y attirer plus d’hommes. Il est aussi plausible que renforcer la part d’hommes parmi les professionnels du care ou de l’éducation des enfants permettrait, in fine, de faire en sorte qu’ils s’investissent plus “naturellement” dans la sphère domestique et familiale. Cela aurait en tout cas le mérite d’imposer de nouvelles pratiques qui seront capables de faire bouger les représentations. Nous regrettons en ce sens l’abandon dans la loi Rixain de l’article qui prévoyait la remise d’un rapport au parlement évoquant notamment la piste des méthodes d’évaluation des emplois[20]. Ce point est en effet essentiel, et certains pays ont entamé des démarches de revalorisation des emplois à prédominance féminine, en s’appuyant sur la notion de travail de “valeur” égale dont nous pourrions nous inspirer.
Encadré : au Québec, des “job evaluations” Contrairement à la France, l’égalité de rémunération n’est pas, au Québec, tributaire de la négociation collective. C’est l’adoption en 1996 d’une loi “proactive” en matière d’égalité salariale fondée sur le principe du travail de “valeur égale” qui a permis de modifier en profondeur les pratiques des entreprises. (Notons que le terme utilisé en anglais est celui de « pay equity »). Cette loi repose sur un exercice d’évaluation et de comparaison des emplois (et non des personnes qui les occupent) : ce sont les « job evaluations » qui comparent, dans le respect d’un cadre méthodologique précis dépourvu de biais de genre, les emplois à prédominance féminine (occupés à plus de 60% par des femmes) et les emplois à prédominance masculine. Retenons ici que la loi québécoise s’applique à toutes les entreprises de plus de 10 salariés, soumises dans ce cadre à des contrôles forts par un organisme indépendant chargé d’en vérifier la mise en œuvre : la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). cas de non-application de la loi, les entreprises sont sanctionnées par des pénalités financières pouvant aller jusqu’à 45 000 dollars (soit 31 000 euros). Notons également que la création de « Comités d’éthique salariale » permettant d’associer les salariés au processus est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés et doivent être composés, au moins pour moitié, de femmes. Le cadre méthodologique préconisé -s’il n’est pas formellement imposé, en ce qu’il doit conserver une certaine souplesse pour s’adapter aux spécificités des entreprises, notamment sectorielles – est décrit dans le Guide de mise en œuvre de l’évaluation non sexiste des emplois du Bureau International du Travail (BIT), et fortement inspiré des travaux de l’économiste canadienne, Marie-Thérèse Chicha. Le guide suggère quatre facteurs de base pour évaluer les emplois dans les entreprises (quel qu’en soit le secteur) :
Ces facteurs doivent être ensuite décomposés en « sous-facteurs » permettant d’affiner l’analyse et seront adaptés à chaque entreprise. Par exemple, le critère « efforts » pourra être décomposé en plusieurs sous-critères : efforts physiques, efforts émotionnels et efforts mentaux. L’ensemble des critères sera ensuite affecté d’une pondération et relié à des tâches précises qui seront décomposées. Le guide précise que le choix des sous-facteurs – et bien entendu, le nombre de points attribué à chacun d’entre eux, est crucial dans la suppression des biais sexistes puisque « jusqu’à très récemment, les emplois à prédominance féminine étaient évalués par des méthodes conçues principalement pour les emplois à prédominance masculine ». Par exemple, le critère de l’effort dans les méthodes d’évaluation traditionnelles est axé sur la notion d’effort physique et tend à négliger d’autres aspects (efforts émotionnels, efforts mentaux), ce qui conduit à sous-évaluer les qualifications requises dans les emplois à prédominance féminine. Ainsi, considérer dans le cas du personnel soignant que l’accompagnement de personnes malades en phase terminale implique des efforts d’ordre émotionnel permettra de mieux reconnaître et de valoriser les compétences mises en œuvre dans ces situations professionnelles. Bien entendu, une telle méthode suppose de se prémunir contre tout préjugé ou stéréotype : Il n’est pas question de considérer ici que certaines compétences seraient « innées » chez les hommes ou chez les femmes et relèveraient en ce sens de qualités personnelles plus que de compétences professionnelles. Le guide précise donc que « ce qui est important n’est pas la façon dont les qualifications ont été obtenues mais la correspondance entre leur contenu et les exigences de l’emploi ». Sur cette base méthodologique, il faudra collecter les informations relatives aux emplois grâce à des outils exempts de biais discriminatoires. L’outil préconisé est un questionnaire adressé aux salariés avec une description précise de leurs tâches et responsabilités, adapté aux emplois à prédominance féminine comme aux emplois à prédominance masculine. Pour ce faire, chaque question doit être illustrée par un exemple familier à chaque type d’emploi. Ainsi, dans cette méthode, et contrairement au cas français, il ne s’agit pas de sanctionner les employeurs pour leurs pratiques, mais d’abord de les obliger, ex ante, à comparer les emplois et à revaloriser les métiers majoritairement occupés par des femmes. |
Si cette démarche nous semble intéressante, c’est parce que, jusqu’à présent, les politiques publiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont consisté, -nous l’analysions dans nos précédents travaux – à tenter d’attirer les femmes dans des métiers exercés en majorité par des hommes, avec un succès limité. Peu d’actions sont menées en revanche pour attirer les hommes dans les métiers féminisés, que l’on sait moins rémunérés et plus précaires. Pourtant, les parcours d’orientation différenciés et la répartition sexuée des métiers sont autant le fait des hommes que des femmes, et à l’école comme dans l’enseignement supérieur, ce sont à la fois les filles et les garçons qui “désertent de manière spécifique, des champs entiers de connaissances et de compétences”. Aucun des deux sexes ne semble échapper à ce déterminisme, donc le choix de chercher uniquement à orienter les jeunes filles vers des filières à prédominance masculine (il est vrai souvent plus prestigieuses, ou plus rémunératrices in fine) interroge. Ce débat est pourtant crucial, a fortiori dans un contexte de vieillissement de la population et de fortes perspectives de recrutement dans les métiers du service à la personne (+400 000 emplois ont été créés dans la dernière décennie selon les chiffres de l’INSEE), et à l’évidence, les besoins ne cesseront de croître compte-tenu du contexte de vieillissement de la population.
Proposition : Lancement d’une expérimentation pilotée par le Ministère du Travail mobilisant les branches professionnelles prioritaires (nettoyage, aide à la personne) :
- Définition d’une méthode d’évaluation des emplois pour les métiers les plus féminisés (+60% de femmes) inspirée des travaux du Bureau International du Travail
- Mise en place de commissions paritaires d’évaluation des emplois au niveau des branches professionnelles
- Lancement de méthodes d’évaluation dans l’ensemble des branches professionnelles les plus féminisées pour aboutir à une révision des classifications professionnelles d’ici 5 ans
4. Etudier l’hypothèse de l’individualisation de l’impôt sur le revenu et plafonner le quotient conjugal
Nous le disions en introduction, agir en faveur de l’égalité salariale ne peut se limiter à des réformes uniquement ciblées sur le monde du travail si l’objectif est de produire un effet d’ordre “systémique”. Nous invitons ici à interroger les fondements de notre système fiscal et les choix redistributifs qui y sont liés en portant notre attention sur le quotient conjugal, la question de l’individualisation de l’IR et la fiscalité afférente aux pensions alimentaires. Le mode de recouvrement de celles-ci sera également discuté à l’aune des avancées récentes.
Le quotient conjugal a déjà fait l’objet de nombreux questionnements, voire de controverses. Les travaux de l’OFCE[21] l’ont rappelé en 2019: “Ce système, qui date de 1945 a été conçu afin de tenir compte des solidarités familiales entre conjoints mariés dans un contexte où les couples monoactifs, avec Monsieur ayant un travail et Madame étant en charge du travail domestique et familial, représentaient le modèle dominant et la norme portée par les politiques publiques. Il s’agissait également d’inciter les couples à se marier. Lorsque les deux conjoints ont des revenus proches, le quotient conjugal et l’imposition séparée conduisent à un niveau d’impôt égal. En revanche, dès lors que les deux revenus sont très différents, l’imposition conjointe est plus avantageuse que l’imposition séparée”. Un rapport d’Oxfam explique avec pégadogie les effets de la conjugalisation de l’impôt : “La conjugalisation des revenus (le fait de payer ses impôts au niveau du ménage) a ainsi été pointée du doigt par plusieurs experts comme un facteur de spécialisation au sein du couple, autrement dit une politique qui incite plus la personne la mieux payée d’un couple (le plus souvent un homme) à développer sa carrière et réduire son implication dans les tâches domestiques tandis que la personne la moins bien payée d’un couple (le plus souvent une femme) faisait l’opposé, renforçant les inégalités entre les femmes et les hommes.”(…) “Dit autrement, il sera fiscalement plus avantageux pour le couple que le soutien primaire (dans la majorité des cas, un homme) travaille plus que le soutien secondaire (dans la majorité des cas, une femme).” Ce dispositif bénéficie du reste aux ménages les plus aisés puisque plus l’écart entre les deux revenus est élevé, plus l’avantage fiscal est important.
Rappelons au passage que cette conjugalisation de l’impôt concerne les couples mariés et pacsés, mais pas les couples en union libre, ce qui pose évidemment la question de la neutralité de l’administration fiscale, et de l’Etat face aux choix des individus de ce point de vue. Plus encore, comme l’ont rappelé les travaux de Clément Carbonnier en 2014[22], ce système a plusieurs conséquences pour les femmes. D’abord, l’effet du quotient conjugal peut être important en termes de progression salariale et de droits propres à la retraite. Aussi, cela rend les femmes économiquement plus dépendantes envers leurs conjoints, et donc plus vulnérables en cas de séparation. C’est ce que rappelait d’ailleurs un rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge en 2020 “ leur plus faible niveau de revenus individuels les conduit à une perte de niveau de vie plus importante que celle de leur conjoint lors d’une séparation”[23]. Les chiffres de l’INSEE rappellent en outre que si le mode de garde alterné entre les deux parents après une séparation ou un divorce progresse, plus de 75% des enfants mineurs sont gardés principalement par leur mère.[24] En conséquence, dans la mesure où elles ont le plus souvent à leur charge leurs enfants la plus grande partie du temps, le niveau de vie des mères s’avère davantage affecté que celui des pères. C’est particulièrement préoccupant lorsque l’on sait qu’un quart des parents n’ayant pas la garde principale de leurs enfants et considérés comme solvables ne renseignent pas de pension alimentaire dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, soit parce qu’aucune pension n’est fixée, ni par décision des parents ni par le juge aux affaires familiales, soit en raison d’un défaut de paiement. C’est ce que révèle une récente étude de la DREES[25] publiée en janvier 2021. L’étude montre également que le montant moyen de la pension alimentaire versée par les parents “non gardiens” s’élève à moins de 200 euros mensuels en moyenne par enfant (190 euros).
Deux réflexions découlent de ces constats : la première concerne une potentielle réforme du quotient conjugal et avec elle l’individualisation de l’impôt sur le revenu, dont on sait qu’elle peut être sensible politiquement, et la seconde concerne la défiscalisation des pensions alimentaires.
Le mémoire de Léa Yahiel “Quotient conjugal : l’impossible réforme ?” (2021) sous la direction de l’économiste Hélène Périvier explique que la suppression du quotient conjugal pour le remplacer par une imposition individuelle augmenterait considérablement la pression fiscale pour une partie de la population (entre 5 et 10 milliards d’euros). Les conclusions du rapport suggèrent d’ailleurs d’opter pour une mesure progressive n’incluant pas, à court-terme, la suppression du quotient conjugal mais plutôt le plafonnement du quotient conjugal qui n’est pas aujourd’hui légalement fixé ainsi que l’ouverture d’un droit d’option pour l’ensemble des couples qu’ils soient mariés, pacsés ou en union libre (depuis le passage au prélèvement à la source, tous les couples peuvent choisir d’individualiser leurs prélèvements, mais le quotient conjugal n’avait pas été supprimé à l’occasion de cette réforme) et le plafonnement de l’avantage fiscal lié au quotient conjugal, dont on rappelle qu’il bénéficie surtout aux ménages les plus aisés, pour absorber le coût fiscal du droit d’option. Plus précisément, le quotient conjugal pourrait être plafonné au même niveau que le quotient familial. Concrètement, l’unité fiscale reste le couple (marié, pacsé ou en union libre donc) et le système de part reste le même (2 parts pour un couple quelle que soit leur forme d’union) et l’avantage fiscal lié au quotient conjugal est plafonné suivant les mêmes modalités que le quotient familial (1500 euros par demi-part pour 2022, donc 3000 euros pour une part). Ce scénario a fait l’objet d’une simulation dans les travaux de Guillaume Allègre, Hélène Périvier et Muriel Pucci[26]. A noter que dans l’hypothèse simulée, les calculs n’intègrent pas le coût afférent à l’ouverture d’un droit d’option pour les couples (choix entre une imposition jointe ou commune quel que soit leur mode d’union), mais cela permet de donner une idée de l’impact de la réforme. D’après les calculs des auteurs, le plafonnement du quotient conjugal au même niveau que le quotient familial induit un gain en recettes fiscales d’environ 3 milliards d’euros. : les auteurs rapportent que “les couples les plus modestes voient leur situation inchangée” et que “seuls les couples les plus aisés seraient affectés”. Dans le détail, “12 millions de ménages seraient indifférents à la réforme”, “7% des couples seraient perdants” (soit moins d’1 million de ménages pour lesquels l’impôt augmenterait en moyenne de 3232 euros par an). La réforme ne fait en revanche “aucun gagnant”. Les ménages appartenant aux quatre premiers déciles ne sont pas impactés et la perte la plus importante est concentrée sur les ménages les plus aisés (la perte la plus importante est pour le 10e décile, avec une perte médiane de 3 024 € par an, soit 3.3 % du revenu disponible).
Si cette réforme ne permet pas de remettre totalement en question le principe de division sexuée du travail au sein des couples comme pourrait le faire une individualisation totale de l’impôt sur le revenu, il nous semble qu’une telle mesure permettrait de poser la première pierre de l’édifice d’une réforme permettant de tenir compte des effets du quotient conjugal sur l’emploi des femmes. Cela permettrait en tout cas de ne pas décourager la poursuite ou la reprise d’activité pour les femmes (en particulier au sein des couples ou l’écart est important). En ayant la possibilité d’opter pour une individualisation de l’imposition sur le revenu, et grâce au plafonnement des avantages liés au quotient conjugal, elles verraient ainsi les fruits de leur travail récompensé puisque leur salaire serait en proportion moins lourdement taxé que dans le cadre d’une imposition commune. Les couples les moins aisés verraient leur situation inchangée.
De même que le quotient conjugal, fondé sur une vision datée de la famille, la fiscalisation de la pension alimentaire traduit là encore une vision archaïque : l’ex-conjoint (à 97% le père) a la possibilité de déduire de son revenu fiscal de référence les pensions alimentaires versées (et donc de baisser ses impôt). Les versements sont, de fait, intégrés dans le revenu fiscal de référence du conjoint bénéficiaire (le plus souvent, la mère). Cela a une conséquence directe qui désavantage les femmes dans l’accès aux droits : cela peut leur faire perdre le bénéfice de minima sociaux alors même que la pension alimentaire ne couvre pas la perte supplémentaire de niveau de vie liée aux enfants, ce que permettraient pourtant de compenser en partie les prestations sociales.
Le régime fiscal de la pension alimentaire interroge : pourquoi le versement de la pension alimentaire censé couvrir une partie des besoins des enfants bénéficierait-il, d’un point de vue fiscal, aux parents qui n’en n’ont pas la garde ? Le rapport d’Oxfam déjà cité rapporte que plus le père est aisé, plus il peut profiter d’une réduction importante : “un père versant une pension de 12 000 euros par an et se situant dans la tranche marginale de 30% d’impôt sur le revenu (comme la majorité des foyers fiscaux) pourra ainsi économiser plus de 3500 euros d’impôts. S’il se trouve dans la tranche marginale de 45%, l’économie peut atteindre 4500 euros”. A contrario, le rapport explique que pour les femmes, c’est la double peine : elles doivent intégrer les montants perçus par le versement de la pension alimentaire dans leur revenu imposable, et payer plus d’impôts alors qu’il s’agit en théorie d’une contribution de l’ex conjoint destinée à l’éducation de leurs enfants; et elles peuvent du même coup perdre le bénéfices de certaines prestations sociales, comme l’aide au logement, alors que ce sont elles qui ont à plus de 75% la garde de leurs enfants. Nous considérons en ce sens que les pensions alimentaires versées doivent faire l’objet d’une défiscalisation et ce, jusqu’à un certain seuil, ou a minima l’objet d’un crédit d’impôt.
5. Garantir le versement effectif des pensions alimentaires par le recours à une agence dédiée
Bien entendu, le préalable aux réformes fiscales sus-évoquées suppose de s’assurer que les pensions alimentaires soient effectivement versées par les parents n’ayant pas la garde de leurs enfants (et que les montants soient convenables). Notre rapport “Pensions alimentaires, en finir avec les impayés”[27] publié en 2019 insistait sur la nécessité d’améliorer le système de paiement des pensions alimentaires, tout en reconnaissant les effets positifs de la réforme menée sous le quinquennat précédent.
Nous rapportions en effet dans ces travaux que la création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) à initiative de Najat Vallaud-Belkacem et de Laurence Rossignol sous le précédent quinquennat avait produit des effets incontestablement positifs : elle a permis de faire passer le taux de recouvrement des pensions non versées de 56% en 2016 à 63% en 2018. De plus, en juin 2018, 33 500 familles (et plus de 60 000 enfants) bénéficiaient de l’allocation de soutien familial (ASF) complémentaire et donc d’une pension alimentaire minimale fixée au 1er avril 2018 à 115,30 €, contre 22 000 en 2017 et 12 000 en 2016.
En janvier 2021, le système a été de nouveau réformé à l’initiative du Président de la République Emmanuel Macron dans un souci de simplification de la procédure. Désormais, le parent ayant la garde des enfants peut à la condition de bénéficier d’un titre exécutoire pour la pension délivré par un juge demander que la Caisse d’allocations familiales (CAF) devienne l’intermédiaire dans le versement de sa pension. Concrètement, c’est la CAF qui perçoit le versement de la pension pour la reverser au parent bénéficiaire et se charge du recouvrement en cas d’impayé (versement d’une allocation de soutien familial d’un montant de 116 euros). Ce que soulevons ici, c’est que pour être réellement efficace, le recours à ce mode de fonctionnement devrait en réalité être automatique. Pourquoi les femmes devraient-elles se lancer dans une démarche administrative auprès des CAF ? Les critiques que nous formulions à l’encontre du dispositif de recouvrement restent d’actualité : le risque ici est là encore que le taux de recours à ce dispositif reste faible. En 2019, le nombre de procédures de recouvrement concernait 37 000 familles, soit probablement nettement moins de 20 % des pensions alimentaires non versées. En cause : une mauvaise connaissance du dispositif, un manque d’information, une complexité administrative, mais aussi des difficultés particulières liées aux situations de séparation. Si le chiffre est difficile à estimer, il arrive en effet bien souvent que les parents créanciers (en grande majorité, les femmes) hésitent à recourir au dispositif de recouvrement qui peut être difficile à assumer psychologiquement, par peur de s’engager dans un conflit avec l’autre parent, ou pour éviter de dégrader les relations entre l’enfant et l’ex conjoint débiteur. Pour les mêmes raisons, le recours à ce dispositif de versement des pensions alimentaires par la CAF risquerait d’être dans les faits, peu utilisé.
Ce point est particulièrement préoccupant à l’heure ou le nombre de familles monoparentales a considérablement augmenté (passant de 950 000 en 1990 à 2 millions en 2020 selon les chiffres de l’INSEE). Une famille sur 4 est donc une famille monoparentale, et ces familles sont particulièrement exposées au risque de pauvreté. En 2018, 41% des enfants mineurs en famille monoparentale vivent en-dessous du seuil de pauvreté (contre 21% pour l’ensemble des enfants)[28] Dans ce cadre, le versement de la pension alimentaire par le parent n’ayant pas la garde des enfants revêt une importance cruciale. Nous rapportions dans nos précédents travaux que la pension alimentaire versée par l’autre parent représentait en moyenne 18% des revenus du parent ayant la garde des enfants. Mieux garantir le versement effectif des pensions est donc indispensable. Pour y parvenir, nous proposons qu’une agence soit chargée de percevoir toutes les pensions alimentaires et de les verser aux parents créanciers et ce, de manière automatique, et en toutes circonstances.
Propositions : garantir le versement effectif des pensions alimentaire grâce au recours automatique à une agence dédiée
Pour résoudre les difficultés évoquées, nous proposons que :
- Les pensions alimentaires soient automatiquement payées à l’Agence qui la reverse immédiatement au parent créancier. En cas de retard ou de défaut de paiement, l’Agence verserait sans tarder l’intégralité de la pension minimale et se retournerait immédiatement vers le créancier pour récupérer la part qui lui incombe. De cette façon, le parent créancier n’aurait plus à se poser la question d’un recours contre le parent débiteur : l’Agence, et à travers elle la puissance publique, jouerait automatiquement le rôle de tiers et assurerait la continuité des versements au parent créancier en portant le risque d’impayés.
Ce mécanisme ne concernerait toutefois que les pensions alimentaires inférieures ou égales au minimum (116 € pour l’année 2022), c’est-à-dire les créanciers les plus modestes et les plus exposés au risque de pauvreté. Il suffit, pour organiser un tel circuit de paiement, que le montant de la pension soit notifié à l’Agence dès qu’il est fixé, par accord issu de médiation ou par le juge, accompagné des coordonnées bancaires des deux parents. Évidemment, cela mettrait fin aux arrangements informels qui peuvent exister entre les parents, mais il s’agit, après tout, de préserver les intérêts de l’enfant. Nous rappelions en outre que cette solution avait été envisagée au moment de la création de l’Agence mais qu’elle avait été exclue (sauf dans le cas d’un ex conjoint débiteur violent). Le motif de ce refus était que « l’intermédiation [risquait] d’engendrer une perte de liens entre les parents, alors que le développement de la coparentalité, qui fait aujourd’hui l’objet de la part des pouvoirs publics d’efforts importants, est prôné par le juge et la branche famille ». Mais comme nous l’avions souligné alors : le raisonnement peut s’inverser. Car en effet, le sujet n’est ni seulement ni même prioritairement celui de la relation entre les deux parents, mais celui de la relation qu’entretient chacun d’eux avec son ou ses enfant(s). Et rien ne justifie que la relation financière entre les deux parents vienne polluer leur relation avec l’enfant et encore moins les intérêts matériels de ce dernier. De ce point de vue, le passage systématique par l’Agence permettrait aussi de rappeler à chacun des deux parents que la pension alimentaire est là pour couvrir une partie des dépenses courantes consacrées aux enfants et lui assurer les meilleures conditions d’existence possibles. En outre, la communication du montant de la pension à l’Agence permettrait aussi à la CAF d’attribuer automatiquement le complément (allocation de soutien familial complémentaire) de façon à atteindre le minimum quand elle est inférieure à celui-ci et donc de garantir un accès automatique à ce droit.
L’autre argument opposé à ce dispositif portait sur le risque financier assumé par les finances publiques en cas de non-paiement et de non-recouvrement. Pourtant, l’expérience du Québec, qui a mis en place un système très voisin depuis 1995, montre que ce risque est considérablement diminué avec l’institution d’un tiers automatique, qui intervient dès les premiers retards de paiement, sans forcément mettre en œuvre tout de suite une procédure de recouvrement forcé : dans cette province canadienne, 80 % des créanciers touchent aujourd’hui leur pension en temps voulu et en entier, et surtout le taux de perception des pensions auprès des débiteurs est supérieur à 95 % (96,9 % en 2017– 2018). Cela s’explique facilement : le paiement à un tiers a un effet dissuasif sur les « mauvais payeurs » et évite l’accumulation d’arriérés importants, toujours plus difficiles à recouvrer.
En conclusion, différents leviers peuvent être activés pour faire advenir davantage d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ils doivent l’être en tenant compte de la complexité des différents facteurs qui influencent l’organisation genrée de la société. Ils ne peuvent en cela se borner aux seuls mécanismes d’ajustement portant sur le marché du travail. Bien que ceux-ci soient évidemment nécessaires, ils ne sont pas suffisants. Une politique globale est donc à impulser, qui doit se situer au carrefour des politiques familiales, éducatives, liées à l’emploi et à la fiscalité.
[1] “Les députés vont imposer des quotas de femmes dans les directions des grandes entreprises”, Les Echos, 11 mai 2021
[2] Viviane Beaufort et Martin Richer, Pour un quota de femmes dans les instances de direction des entreprises, Terra Nova, mars 2021
[3]LOI n° 2021–1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, Article 16
[4] https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0602040703611-les-femmes-entrepreneurs-toujours-moins-bien-financees-que-les-hommes-332363.php
[5] Manifeste fiscal juste, vert et féministe, Oxfam, 2021
[6] Kenza Tahri, Mixité des métiers : une condition de l’égalité femmes-hommes, Terra Nova, 2021
[7] L’impact du confinement sur les inégalités femmes-hommes, Enquête Harris Interactive pour le Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes
[8] https://www.inegalites.fr/Le-partage-des-taches-domestiques-et-familiales-ne-progresse-pas
[9] “Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de l’émancipation”, mission d’information menée par la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en 2012
[10] Idem
[11] La formulation est empruntée à Marie-Cécile Naves, rapport “Lutter contre les stéréotypes filles-garçons”, Commissariat général à la stratégie et à la perspective, 2014
[12]Le Parisien, “Comment l’égalité entre les filles et les garçons est-elle enseignée à l’école” ?, 26 novembre 2021
[13] PERSONNELS DE DIRECTION, CONSEILLERS PRINCIPAUX D’EDUCATION, CONSEILLERS D’ORIENTATION, PERSONNELS D’INSPECTION
[14] https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-adrien-taquet-annonces-des-mesures-en-faveur-des-1000-premiers-jours
[15] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4162_proposition-loi
[16] “Moins de 1 % des pères prennent un congé parental, malgré une réforme en 2015”, Le Monde, 7 avril 2021.
[17] Proposition de loi visant à réformer le congé parental, n° 4162 déposé(e) le 18 mai 2021, et renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales. / Auteur de la proposition : Monsieur Thibault Bazin (député LR)
[18] Florent de Bodman, Petite-enfance : que devrait-faire le prochain président de la République ?, Terra Nova, 2021
[19] Kenza Tahri, L’Index Egalité Professionnelle : occasion manquée ou outil prometteur ?, Terra Nova, 21 janvier 2021.
[20] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b2396_rapport-information
[21] https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/OFCEWP2019–05.pdf
[22] Clément Carbonnier, « Imposition jointe des revenus et emploi des femmes mariées : estimation à partir du cas français”, Revue Economique vol. 72, n°2, p. 215–244 2021
[23] Rapport Les ruptures de couples avec enfants mineurs, Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, 2020
[24] Rapport Les conditions de vie des enfants après le divorce, INSEE Première, 2015
[25]https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021–04/ER%201190.pdf
[26] Imposition des couples en France et statut marital : simulation de trois réformes du quotient conjugal, Sciences Po, OFCE, Guillaume Allègre, Hélène Périvier et Muriel Pucci, 2020
[27] Daniel Lenoir, « Pensions alimentaires : en finir avec les impayés », Terra Nova, 2019 https://tnova.fr/economie-social/protection-sociale-solidarites/pensions-alimentaires-en-finir-avec-les-impayes/
[28] Elisabeth Alvaga, Kilian Bloch, Isabelle Robert-Bobbé “Les familles monoparentales en 2020 : 25% de familles monoparentales, 21% de familles nombreuses”, Rapport INSEE, 2020.