Les enfants à table : accélérer la transition alimentaire dans les cantines scolaires


La transition alimentaire est une formidable opportunité pour associer tous les acteurs de nos territoires à un défi commun ambitieux : promouvoir une alimentation à la fois plus conforme aux impératifs de santé publique, plus respectueuse des équilibres écologiques, plus cohérente avec des modèles agricoles soutenables (pour les agriculteurs comme pour les sols qu’ils cultivent) et plus accessible pour les catégories modestes.

La loi Egalim votée en 2018 a permis plusieurs avancées en la matière, en ciblant particulièrement la restauration collective qui devra atteindre les objectifs suivants : servir 50% de produits de qualité (dont 20% bio), limiter le gaspillage alimentaire, se passer du plastique, introduire un menu végétarien par semaine et diversifier les sources de protéines. Mais pour accélérer cette transition et aller plus loin, il est impératif d’avoir une vision globale de l’ensemble des enjeux et des acteurs de l’alimentation, que ce soit à l’échelle des territoires ou à l’échelle plus fine du restaurant scolaire.

Ce rapport propose des pistes pour une refonte profonde de notre modèle de restauration scolaire afin de permettre un approvisionnement plus durable des cantines sans augmenter la facture des repas, de diminuer l’empreinte environnementale des menus sans sacrifier leur qualité gustative ou l’équilibre nutritionnel des enfants, et d’impliquer largement les personnels de cantines qui sont des acteurs clés de cette transition.

Laurent Bernardi , directeur d’école dans les Alpes-Maritimes (06), enseignant spécialisé et militant au SNUipp-FSU (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC)
Introduction
Notre alimentation est aujourd’hui à la croisée de plusieurs défis.
Un défi nutritionnel et sanitaire, pour commencer : nous mangeons trop, trop gras, trop salé, trop sucré… Selon les autorités sanitaires, nous ingérons également trop de produits transformés, trop de charcuterie et trop de viande de manière générale. Ces excès et déséquilibres, couplés à une exposition croissante à une vaste gamme de perturbateurs endocriniens, contribuent à de nombreux maux et pathologies : obésité, affections de longue durée (diabète de type 2, hypertension…), maladies cardiovasculaires, etc.
Un défi environnemental, ensuite : notre alimentation repose sur un modèle agricole fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES) et insuffisamment soucieux de la biodiversité et de la santé des sols à long terme. C’est le cas des pratiques agricoles, qui recourent de façon intensive aux intrants chimiques, et de l’élevage, qui contribue particulièrement aux émissions agricoles de GES et au recul de la biodiversité.
Un défi économique et social, enfin : parce que toute réorientation de nos pratiques alimentaires peut avoir des conséquences significatives sur le niveau de vie des producteurs, il faut veiller à préserver des équilibres économiques et sociaux qui garantissent à la fois notre autonomie alimentaire et des revenus décents pour les agriculteurs. Et il faut, dans le même temps, veiller à ce qu’une alimentation équilibrée et de qualité soit accessible (notamment financièrement) aux plus modestes.
Pour relever ces trois défis, nous devons nous engager dans une large transition alimentaire qui s’efforce de combiner au mieux un haut niveau de qualité nutritionnelle et sanitaire, une moindre empreinte environnementale et une meilleure soutenabilité économique et sociale. Ce mouvement doit en outre s’inscrire dans des traditions et des formes de sociabilité qui font de l’alimentation à la fois une source de plaisir et de partage et l’une des manifestations de notre modèle de société.
C’est dans cet esprit que Terra Nova s’était intéressé aux enjeux liés à la production et à la consommation de viande il y a deux ans [1] . C’est dans ce même esprit que nous nous intéressons ici à la restauration scolaire dans les écoles publiques du premier degré [2] . Nous estimons en effet que les cantines scolaires sont un lieu stratégique pour accélérer cette transition et la déployer largement dans la société, et ce pour au moins quatre raisons.
1) La qualité de l’alimentation servie aux enfants peut avoir un fort impact sur leur santé et leurs habitudes alimentaires. Servir une alimentation équilibrée et de qualité aux plus jeunes enfants permet de prévenir de nombreuses complications ultérieures, de réduire les inégalités de santé et, comme on le verra, de mettre les enfants dans une meilleure disposition pour apprendre.
2) Par le volume de repas qu’elle sert chaque année, la restauration scolaire a un fort impact sur l’environnement. Songeons que, à l’échelle nationale, la restauration collective représente 3,8 milliards de repas par an (une ville comme Paris servant à elle seule près de 30 millions de repas chaque année), dont une bonne partie dans les restaurants scolaires… Dans ce contexte, privilégier des produits issus d’une agriculture moins émettrice de GES et moins consommatrice d’intrants chimiques, c’est œuvrer de façon significative à la transition écologique.
3) Compte tenu des volumes concernés, les commandes publiques liées à la restauration scolaire forment un puissant levier économique. Elles peuvent notamment être utilisées pour stimuler un tissu productif plus responsable et favoriser des coopérations économiques vertueuses entre une commune et ses territoires voisins.
4) Enfin, les cantines sont aussi – ou devraient être – un lieu d’éducation au goût comme aux équilibres qui dépendent de nos choix alimentaires. Le jeune âge des publics concernés est une chance collective : c’est l’occasion d’installer des habitudes vertueuses, en réduisant notamment la consommation de protéines animales et en augmentant celle de protéines végétales. Transmettre aux enfants non seulement ces habitudes, mais aussi les compétences qui les sous-tendent, c’est en faire des agents actifs de la transition alimentaire à la fois dans leur famille et, plus tard, dans la société.
Le législateur a commencé à prendre conscience de ces enjeux. Les discussions lors des États généraux de l’alimentation l’ont montré, même si la focale principale de ces échanges a été mise sur le partage de la valeur entre les différents acteurs de la filière. Elles ont notamment débouché sur une loi connue sous le nom de « loi Egalim [3] ».
Dans son article 24, celle-ci prévoit que les structures chargées de la restauration collective devront atteindre au 1 er janvier 2022 [4] 50 % de leurs achats en alimentation durable, définie par la loi comme devant regrouper 20 % de bio et 30 % d’alimentation sous signes de qualité, étant inclus ici des labels de qualité dont le cahier des charges ne comprend pas nécessairement de normes environnementales. Elle a également introduit à titre expérimental, et pour une durée de deux ans, l’obligation pour les cantines scolaires d’organiser un repas végétarien par semaine à compter du 1 er novembre 2019 [5] (on sait en effet que la baisse de la consommation de viande contribue à réduire à la fois l’empreinte carbone de notre régime alimentaire et l’exposition à un certain nombre de risques sanitaires). Ce texte invite en outre à lutter activement contre le gaspillage et à limiter l’usage du plastique (contenants alimentaires, bouteille d’eau, etc.) qui feront l’objet d’interdictions formelles à partir de 2025.
Au total, les acteurs de la restauration collective en général et de la restauration scolaire en particulier ont désormais un cadre directeur pour avancer sur le chemin de la transition alimentaire. Toutefois, les orientations de la loi Egalim se heurtent en pratique à de nombreuses difficultés d’application. C’est pourquoi nous avons voulu nous rapprocher du terrain pour mieux comprendre les freins et obstacles rencontrés par les décideurs publics dans les collectivités locales quand ils veulent mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, voire aller au-delà.
En effet, il ne suffit pas de vouloir mettre davantage de bio dans les assiettes, encore faut-il trouver les quantités disponibles sur le marché à des prix abordables. Il ne suffit pas de vouloir favoriser les producteurs locaux, encore faut-il les identifier, leur assurer des volumes de commande réguliers et suffisants, et cela en respectant le code des marchés publics. Il ne suffit pas de vouloir proposer aux enfants une alternative végétarienne, encore faut-il que les cuisiniers et préparateurs soient formés à ce type de cuisine et en connaissent les contraintes et les équilibres. Il ne suffit pas de trouver un prestataire extérieur en délégation de service public qui assure le niveau de qualité requis, encore faut-il être de capable de construire un cahier des charges pertinent et de suivre précisément l’exécution du contrat. Il ne suffit pas de vouloir lutter contre le gaspillage pour protéger l’environnement et dégager les marges budgétaires nécessaires à l’achat de produits de meilleure qualité, encore faut-il connaître les techniques permettant de le faire et mettre en place des indicateurs de suivi précis. Il ne suffit pas de vouloir sensibiliser les enfants, encore faut-il les accompagner et, pour cela, pouvoir compter sur des personnels formés et reconnus. Bref, dans la réalité, ici comme ailleurs, il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions…
Ce sont ces difficultés que nous avons voulu investiguer afin de formuler des propositions qui permettent de les surmonter. Pour cela, nous avons rencontré un grand nombre d’acteurs des différents secteurs concernés et nous avons tâché de repérer à la fois les bonnes pratiques et les initiatives (organisationnelles, économiques, réglementaires, législatives…) qu’il faudrait prendre pour accélérer la transition alimentaire.
Ce regard au plus près du terrain nous a conduits à nous intéresser autant à l’empreinte carbone des repas qu’à leur équilibre nutritionnel, aux conditions de travail de celles et ceux qui les préparent, aux conditions dans lesquelles les enfants peuvent devenir acteurs de cette transition, ou aux instruments dont peuvent se doter les pouvoirs publics à l’échelle locale pour garantir des repas sains, durables et accessibles pour toutes les familles. Ce sont toutes les pièces de ce puzzle qui, correctement agencées, permettent d’appréhender les leviers de changements alimentaires véritables.
De même, ces aspects ne peuvent évidemment pas être dissociés d’une appréhension plus systémique et plus générale des problèmes. Ainsi, il est clair que, pour avoir davantage de bio dans les assiettes des enfants, la stimulation par la commande publique d’un tissu agricole local plus respectueux de l’environnement et des objectifs climatiques ne peut suffire si, par ailleurs, les politiques publiques nationales ne créent pas les bonnes incitations et les bons dispositifs d’accompagnement à la conversion et si, de manière plus globale, la Politique agricole commune (PAC) au niveau européen n’est pas rapidement réorientée vers la transition agro-écologique. De même, diminuer l’empreinte environnementale de nos repas et végétaliser ceux-ci ne pourra se faire qu’en assurant une plus grande autonomie de l’élevage en protéines végétales et qu’en produisant davantage de protéines végétales pour l’alimentation humaine.
Petits et grands choix vont donc main dans la main en matière alimentaire. C’est ce pari d’une approche systémique que nous avons voulu essayer de relever ici, en tenant compte de l’ensemble des facteurs et des acteurs qui se conjuguent dans la restauration scolaire. Le seul plaidoyer environnemental, si légitime soit-il, ne fera guère avancer les pratiques si l’on ne s’occupe pas en même temps de l’avenir des producteurs. De la même façon, le seul plaidoyer sanitaire ne saurait ignorer la question des impacts environnementaux et sociaux des préconisations qu’il porte.
1. Enjeux
1.1. Les enjeux de la transition alimentaire
Nous partageons la conviction que nos sociétés doivent s’engager dans une transition en faveur d’une alimentation durable. Une telle alimentation se définit par un haut niveau de qualité nutritionnelle et sanitaire (1.1.1.), de qualité environnementale (1.1.2.) et de soutenabilité économique et sociale (1.1.3.). Elle doit aussi s’inscrire dans des traditions et des formes de sociabilité qui font de l’alimentation à la fois un plaisir et l’une des manifestations de notre modèle de société.
1.1.1. Les enjeux nutritionnels et sanitaires
Une alimentation de qualité doit d’abord apporter à chacun un bon équilibre nutritionnel et lui permettre de préserver son capital santé. Dans les sociétés développées, elle doit en particulier être pensée au regard des pathologies liées à une suralimentation et à un régime alimentaire déséquilibré, surchargé en graisses saturées, en sucre, en sel, en protéines animales et en aliments transformés ou « ultra-transformés » (AUT [6] ).
Les aliments ultra-transformés (AUT) Les AUT appartiennent au quatrième groupe de la classification Nova [7] . Ce sont des produits industriels composés de plusieurs ingrédients et/ou additifs à visée industrielle ou cosmétiques (colorants, exhausteurs de goût, épaississants…) : ce sont de nouvelles matrices alimentaires artificielles riches en sucres, en sel et/ou en matières grasses, facilement digestibles et absorbables du fait de leur texture déstructurée. Ils sont souvent riches en calories « vides » : leur densité énergétique est élevée mais avec une faible teneur en composés bioactifs protecteurs, telles que les fibres, les vitamines, les minéraux et autres antioxydants. Les chercheurs se sont intéressés à l’impact sur notre santé de ces procédés de transformation et de nombreuses études suggèrent une corrélation positive entre la consommation régulière d’aliments ultra-transformés et l’augmentation du risque d’obésité, d’hypertension, de diabète de type 2, de certains cancers [8] …
Les principales pathologies liées à ce type d’alimentation sont des maladies chroniques et des affections de longue durée : l’obésité, le diabète de type 2, les complications cardiovasculaires ainsi que différents types de cancer (comme le cancer colorectal dont une surconsommation de viande animale peut être la cause, par exemple). Les effets de cette mauvaise alimentation sont aggravés par le sédentarisme et le manque d’activité physique [9] .
Selon une étude menée par 130 chercheurs réunis au sein du Global Burden of Disease (GBD) par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) de Seattle et publiée par The Lancet [10] en 2017, 11 millions de décès dans le monde (près de 20 %) seraient imputables à un mauvais régime alimentaire, soit davantage que le tabac (8 millions de morts par an). Parmi les principaux facteurs de risque figurent le sel (environ 3 millions de décès), un apport insuffisant en céréales complètes (3 millions), une ration quotidienne trop basse en fruits (2,4 millions) ou en noix et graines (2 millions). Il est toutefois à noter que, sur les 195 pays étudiés, la France fait partie, avec Israël, l’Espagne et le Japon, des cinq pays les moins touchés par la mortalité liée à une mauvaise alimentation.
À l’opposé des déséquilibres qui caractérisent les régimes alimentaires problématiques, il convient donc de promouvoir, conformément aux recommandations récurrentes de nombreuses autorités sanitaires, une alimentation en quantité plus ajustée à nos besoins physiologiques, contenant moins de sel, de sucre, de graisses saturées, de protéines animales et de produits transformés, et davantage de légumes, fruits, acides gras essentiels, protéines végétales (légumineuses, soja, oléagineux) et céréales complètes. Ce régime alimentaire doit également privilégier une alimentation d’origine biologique, une orientation qui fait désormais partie des recommandations du Plan national nutrition santé (PNNS), au côté de la nécessité d’introduire davantage de légumineuses et de ne pas consommer trop de viande [11] .
En même temps qu’elle préserve la santé des sols et le capital naturel, l’alimentation d’origine biologique garantit en effet une moindre exposition à un certain nombre de substances nocives (pesticides, antibiotiques, divers perturbateurs endocriniens…) et aux « effets cocktail » liés à la combinaison de ces différentes substances. Ces questions sont particulièrement déterminantes concernant les enfants et les jeunes publics, car leur développement peut en être durablement affecté et les inégalités de santé augmentées [12] . Comme l’ont montré plusieurs scientifiques dans une récente étude, « un régime biologique est associé à une réduction significative de l’excrétion urinaire de plusieurs métabolites de pesticides et de composés parents [13] ». Cette étude s’ajoute à un nombre croissant de publications indiquant qu’un régime biologique peut réduire l’exposition à toute une gamme de pesticides chez les enfants et les adultes. Les dernières enquêtes épidémiologiques conduites dans le cadre du projet BioNutriNet, par exemple, arrivent à des conclusions convergentes [14] : elles montrent que le régime alimentaire des grands consommateurs de bio est non seulement plus sain au plan nutritionnel, mais qu’il réduit aussi l’exposition aux pesticides de synthèse et aux contaminants chimiques.
C’est par l’éducation à l’alimentation que l’on permettra aux citoyens des générations futures de devenir des consommateurs informés et éclairés. Cette éducation ne doit pas se penser uniquement en classe. Elle passe aussi par un dialogue constant entre l’apprentissage théorique et la pratique quotidienne des repas, notamment dans le cadre de la restauration scolaire.
Les difficultés rencontrées pour aller vers le Zéro plastique en 2025 Le plastique inonde notre quotidien [15] , et les cantines ne font pas exception. Peu cher, léger à transporter, ergonomique pour les personnels, conservant bien les aliments, il est fréquemment utilisé aux étapes de conditionnement, de transport et de remise en température des aliments [16] . Les étapes où la marge de manœuvre est la plus grande pour le remplacer sont le service et la vaisselle ; mais il est beaucoup plus difficile de le supprimer en amont, en particulier dans le cas d’une liaison froide.Pour sensibiliser les cantines, une forte mobilisation de parents d’élèves a eu lieu ces dernières années, en particulier via le collectif Cantine sans plastique [17] , autour des risques écologiques et surtout sanitaires liés à ce matériau. Écologiques, car le plastique entraîne des pollutions environnementales lors de sa production (à base de pétrole), de son utilisation, ou de son élimination (incinération ou enfouissement). À chacune de ces étapes, il se fragmente en microplastiques et nanoplastiques, qui sont dangereux à la fois pour les êtres humains et pour les écosystèmes (notamment marins [18] ). Concernant les risques sanitaires, les dangers liés aux perturbateurs endocriniens (PE [19] ) sont au cœur des préoccupations scientifiques, en particulier pour les enfants. Le plastique est en effet accusé de contenir des PE susceptibles de migrer vers l’alimentation, notamment en cas de remise en température mal maîtrisée ou d’usure. Ces PE peuvent aussi absorber des contaminants, qui seront ensuite ingérés, ce qui aggrave leur profil toxicologique. Les conditionnements en plastique peuvent donc être responsables d’une exposition majeure et régulière des usagers à ce type de risques.S’il est difficile de prouver formellement le lien de cause à effet entre plastique, PE et développement de certaines maladies, c’est parce que les PE ont mis à l’épreuve la manière classique de faire de la toxicologie et de l’épidémiologie. En effet, avec les PE, « la dose ne fait plus le poison ». Ce qui fait le poison, ce sont l’exposition régulière et l’effet cocktail [20] . Malheureusement, la pratique des tests de migration est très minoritaire, tout comme les connaissances techniques et scientifiques sur ces questions au sein des collectivités. Les cuisines sont certes juridiquement responsables de leurs achats, mais les risques sanitaires liés aux expositions chimiques sont très dépendants des conditions de leur utilisation, et le personnel en cuisine souvent très peu formé à ces enjeux.Cette situation devrait changer, grâce à la loi Egalim. Son article 28 stipule qu’en « 2025, il sera mis fin à l’utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires ainsi que les établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ». Et, dès 2020, sont interdits bouteilles en plastique, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs en plastique. Mais cette interdiction risque d’être difficile à appliquer pour les restaurants collectifs, d’après l’étude menée par la Fondation pour la Nature et l’Homme [21] (FNH), que ce soit en termes organisationnels, techniques ou financiers.Des cuisines mettent néanmoins déjà des alternatives en place [22] , au premier rang desquelles l’inox, le verre ou la porcelaine semblent plus appropriés d’un point de vue sanitaire et environnemental. Agores (l’association nationale des directeurs de la restauration collective) avertit néanmoins qu’il n’existe aucune solution « clé en main », à la fois parce qu’il y a des arbitrages à faire entre conséquences organisationnelles, humaines ou financières, et parce qu’il faudrait garder un « regard critique sur toutes les alternatives et les conditionnements en interrogeant les certificats d’alimentarité des produits de substitution ». Ils précisent notamment que « les barquettes “nouvelle génération” dites “biosourcées” peuvent ainsi, en fonction de l’origine de leurs matières premières, présenter un risque lié aux pesticides présents dans le produit. Ces matériaux ne sont par ailleurs pas encore au point sur le plan technique ».Pour se conformer à l’objectif de la loi Egalim, Agores fait plusieurs recommandations aux gérants des restaurants collectifs. D’abord de s’y prendre avec méthode, en anticipant 2025. Agores préconise ainsi de procéder sans attendre à un diagnostic local, puis de mettre en réseau les expertises existantes pour accompagner les changements sur le terrain et enfin de faire monter progressivement en compétences les services de restauration en la matière [23] , notamment en institutionnalisant des veilles techniques, scientifiques et juridiques [24] , et des tests de migration fréquents. Agores recommande également de mettre en place un « principe de prévention » en tenant compte systématiquement du risque chimique, de construire un guide de bonnes pratiques internes et de supprimer l’usage du micro-ondes avec des conditionnements en plastique.
1.1.2. Les enjeux environnementaux
L’alimentation « de la fourche à la fourchette » (c’est-à-dire en comptant la production agricole, mais aussi les étapes de transformation, de distribution et de consommation, ainsi que le gaspillage) représenterait près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial (28 % exactement), selon le think tank Institute for Climate Economics (I4CE) [25] .

L’agriculture qui fournit les denrées nécessaires à notre alimentation contribue pour près d’un cinquième aux émissions françaises, soit le second poste après les transports (31 %) et à quasi-égalité avec l’industrie (18 %) et le bâtiment (19 %).

Source : ministère de la Transition écologique et solidaire
Les GES d’origine agricole sont pour moitié (48 %) liés à l’élevage – qui est responsable de 40 % du méthane émis en France (CH 4 ), auxquels il faut ajouter la partie des émissions de protoxyde d’azote liées aux effluents d’élevage – et à l’usage d’engrais azotés (N 2 0) dont une partie peut être imputée à l’élevage, notamment via la production de végétaux destinés à l’alimentation animale [26] . Ceci sans compter les « GES importés [27] » et plus largement les effets de certaines cultures d’exportation sur l’environnement, comme c’est le cas avec le soja, principal ingrédient de l’alimentation animale dans de nombreuses exploitations industrielles, qui est l’une des premières causes de la déforestation en Amazonie au profit des monocultures de soja [28] . L’Union européenne est en effet très loin de l’autosuffisance en matière de protéines végétales : en 2016–2017, elle importait environ 17 millions de tonnes de protéines brutes, dont 13 millions à base de soja [29] . Raison pour laquelle la France développe depuis 2014 un « Plan protéines végétales ».
L’agriculture, l’élevage et la surpêche font également partie des premières causes de perte de biodiversité dans le monde (1 million d’espèces menacées de disparition [30] ). En particulier, la déforestation liée au changement d’utilisation des terres (un tiers de la surface terrestre est aujourd’hui consacrée à l’agriculture ou à l’élevage), l’utilisation de produits phytosanitaires et l’industrialisation des méthodes de pêche, conjuguées aux émissions de GES (qui mettent eux aussi en péril certaines espèces) font de la production alimentaire l’un des grands vecteurs de l’effondrement de la biodiversité. Pour les mêmes raisons, la transformation de notre régime alimentaire et de nos modes de production agricole est l’un des principaux leviers de la lutte contre ce phénomène. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que les rendements agricoles sont tributaires de la bonne santé des écosystèmes. À titre d’exemple, 75 % des cultures vivrières mondiales dépendent de la pollinisation des animaux et 23 % des terres ont déjà connu une réduction de leurs rendements en raison de la dégradation, voire de l’épuisement des sols [31] . Là où des monocultures gourmandes en intrants menacent la biodiversité locale, des pratiques agro-écologiques permettent au contraire de favoriser sa résilience et de stocker du carbone. La mise en œuvre à grande échelle de ces pratiques (basées notamment sur la diversification et la rotation des cultures, l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture et la baisse de l’élevage intensif au profit d’un modèle de polyculture-élevage) nécessite un changement de régimes alimentaires pour que cette nouvelle manière de produire rencontre des débouchés [32] .
Parce qu’elle sollicite moins les produits de l’élevage, une alimentation moins riche en protéines animales induirait donc une réduction substantielle des émissions de GES et permettrait de limiter le déclin très inquiétant de la biodiversité. De la même façon, les produits issus de l’agriculture biologique ont à la fois des vertus sanitaires et environnementales (moins d’intrants utilisés, préservation de la santé des sols, voire augmentation de la biodiversité…). Pour les mêmes raisons, privilégier des circuits d’approvisionnement plus courts et plus locaux [33] (diminuer les transports et les étapes de transformation permet de réduire les émissions de CO 2 dans le cadre d’un mode de production raisonné, à condition d’optimiser le chargement des véhicules utilisés pour la distribution), respecter la saisonnalité des productions et lutter contre le gaspillage sont des moyens de mettre la transition alimentaire au service de la transition écologique et de réduire considérablement notre empreinte carbone. La transition alimentaire peut être ainsi un puissant levier de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences.
Et il y a urgence. En 2009, des chercheurs néerlandais [34] ont montré, à partir de données prospectives de la FAO, de l’OCDE et de l’Agence internationale de l’énergie, qu’après avoir augmenté de 300 % depuis 1970, la production agricole mondiale devrait augmenter encore de 70 % d’ici 2050 pour répondre aux besoins de 9 milliards d’habitants si l’on prolonge les tendances et habitudes alimentaires actuelles ainsi que la propension au gaspillage [35] (qui représente près d’un tiers de ce qui est produit [36] ). Ce scénario aboutirait à une augmentation de 78 % des émissions de GES… Bref, le système alimentaire actuel n’est pas soutenable et doit être repensé pour relever le double défi climatique et démographique.
À l’inverse, le scénario européen TYFA [37] – Ten Years for Agroecology in Europe – dessine un changement de système alimentaire pour relever ces défis. Il montre qu’une agriculture européenne convertie aux pratiques agro-écologiques permettrait de diminuer de 45 % les GES d’origine agricole, de stopper le déclin de la biodiversité, et qu’elle est possible d’ici 2050. Ce passage à un modèle 100 % agro-écologique qui satisferait les besoins nutritionnels de la population tout en réduisant l’empreinte environnementale de l’agriculture passe par une réduction de 40 % des protéines animales dans nos assiettes (viande, lait, œufs), une consommation plus importante de légumineuses (importantes d’un point de vue nutritionnel mais aussi fondamentales dans les pratiques agro-écologiques et la régénération de la fertilité des sols) et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’importance de la transition alimentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique s’impose toutefois peu à peu. En France, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 a prévu la publication d’une « Stratégie nationale bas carbone » (SNBC), document d’orientation indiquant les efforts nécessaires dans chaque secteur pour parvenir au « facteur 4 » d’ici 2050 (réduction de 75 % des émissions de GES par rapport à 1990). Publié en décembre 2016, ce document précise que l’objectif, pour les émissions d’origine agricole, est d’atteindre un « facteur 2 » (une réduction de 50 % par rapport à 1990). La SNBC précise que la baisse de la consommation de protéines animales est une condition nécessaire pour atteindre ces objectifs, condition également inscrite dans le nouveau Programme national nutrition santé (PNNS) qui recommande de privilégier la volaille [38] et de limiter les autres viandes (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à 500 g par semaine et d’alterner au cours de la semaine les différentes sources de protéines entre viande, poisson, œufs et légumes secs [39] .
Le scénario Afterres 2050, réalisé par l’association Solagro, travaille dans une direction voisine [40] . Selon lui, le système de production devrait évoluer progressivement vers un modèle proche de l’agro-écologie, et le régime alimentaire des Français verrait s’inverser le rapport protéines animales/protéines végétales. En misant sur un maintien de l’indice de masse corporelle (IMC) des individus et sur une diminution d’un tiers des surconsommations, en 2050, chaque Français adulte ne mangerait plus en moyenne que 94 g de viande par jour contre 185 g aujourd’hui. En contrepartie, la ration de légumineuses riches en protéines végétales augmenterait de 15 g à 41 g, et il y aurait davantage de céréales, de légumes et de fruits dans nos assiettes. Un tel scénario permettrait de couvrir nos besoins en protéines au-delà du nécessaire (0,8 g/j/kg de poids corporel, soit 12 % des apports énergétiques [41] ) et de limiter les apports en lipides.
1.1.3. Les enjeux économiques et sociaux
On ne conduira pas efficacement la transition alimentaire qui est devant nous sans la doter d’une forte soutenabilité économique et sociale. Pour cela, elle implique d’embarquer tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire dans une transformation des modes de production et de distribution, tout en leur garantissant des revenus et des conditions de vie décents. Comme toutes les transitions de grande ampleur, celle-ci fera des gagnants et des perdants. Toutefois, il est possible, si nous accompagnons correctement ce mouvement, de minimiser les pertes individuelles et de maximiser les gains collectifs.
Parmi les différents maillons de la chaîne de valeur alimentaire, le monde agricole est certainement le plus stratégique. Il ne pourra s’adapter à la transition alimentaire qu’en s’organisant pour produire mieux et vendre à meilleur prix, de manière à sortir du productivisme aveugle des décennies passées tout en protégeant leurs bénéfices et leurs revenus. Nous pensons qu’à moyen et long terme, leurs intérêts économiques et sociaux, d’une part, et les intérêts environnementaux et sanitaires, de l’autre, peuvent et doivent être convergents [42] : la montée en gamme va notamment souvent de pair avec le recul des méthodes de production intensives et industrielles, alors même qu’à budget constant les ménages peuvent accéder à une meilleure alimentation [43] (moins de gaspillage, moins de suralimentation, davantage de protéines végétales et de produits de qualité…).
De toute façon, le monde agricole n’a guère le choix : le modèle actuel ne leur permet guère de vivre décemment de leur travail ( cf. encadré ci-après), et il va être fortement impacté par le changement climatique [44] , comme en attestent déjà les sécheresses mettant en difficulté céréaliers et éleveurs. En dehors de quelques secteurs, de nombreux agriculteurs vivent en effet dans des conditions extrêmement pénibles et sont souvent les premières victimes des risques sanitaires liés à certains produits (en particulier les pesticides [45] ).
Les agriculteurs ne sont toutefois pas les seuls acteurs de la chaîne de valeur appelés à porter la transition alimentaire. Même en misant sur des circuits plus courts dont on a vu qu’ils peuvent être conformes aux intérêts environnementaux, il faut également compter avec les industries agro-alimentaires, les industriels de la restauration collective, les cuisiniers, les personnels de service en collectivité ou encore les collectivités territoriales. On verra qu’en matière de restauration scolaire ces dernières sont dans une position stratégique de donneuses d’ordre, mais qu’elles n’ont pas toujours l’expertise et les moyens nécessaires pour s’imposer comme des agents actifs de la transition alimentaire. On verra également que le rôle d’autres acteurs (notamment les cuisiniers et personnels de service) est insuffisamment valorisé, voire socialement déconsidéré, alors qu’ils pourraient et devraient être des acteurs de premier plan de la transition alimentaire.
En somme, la transition alimentaire appelle une transformation systémique de la chaîne de valeur qui implique l’ensemble de ces acteurs, du producteur jusqu’au consommateur.
Les difficultés actuelles des agriculteurs Une analyse de la Commission des comptes de l’agriculture de la nation fournit des chiffres assez éloquents sur les difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs [46] . En 2017, l’excédent brut d’exploitation (EBE) [47] était en moyenne de 72 400 euros, subventions comprises (et de 42 500 euros hors subventions). Le revenu médian par actif [48] était, lui, de 20 666 euros par an et cachait de grandes disparités : 14 % des agriculteurs avaient un revenu négatif, 25 % des agriculteurs avaient un revenu de moins de 7 651 euros et 10 % des agriculteurs avaient un revenu supérieur à 62 221 euros.


1.2. Le rôle des cantines scolaires du premier degré
Nous nous concentrons dans ce rapport sur le cas particulier de la restauration scolaire dans les établissements publics du premier degré (nous n’abordons qu’occasionnellement la question des établissements de l’enseignement privé). Quel est son rôle et en quoi peut-elle contribuer à la transition alimentaire que nous venons de décrire ?
1.2.1. Contribuer à l’équilibre nutritionnel des enfants
Les questions et les enjeux auxquels la cantine scolaire nous renvoie portent à la fois sur les dimensions économique, sanitaire, culturelle et sociale de l’alimentation. Il faut rappeler que la cantine scolaire a d’abord été créée dans le seul but de nourrir les enfants qui en avaient le plus besoin [57] . Et que cette institution a un rôle majeur à jouer dans la prévention et l’éducation alimentaire des enfants. Ce rôle, souvent sous-estimé, a été mis en évidence par plusieurs études qui se sont intéressées au lien entre l’alimentation et la santé des enfants [58] . Elles montrent que, si l’on veut préserver leur santé, il faut d’abord donner aux enfants des aliments de bonne qualité. Or c’est très exactement ce que fait la cantine en leur servant tous les jours un menu varié et nutritionnellement équilibré [59] .
Selon le Conseil national de l’alimentation (CNA, avis n° 77), les cantines scolaires ont d’abord un objectif de santé publique. Elles permettent de « contribuer à l’équilibre nutritionnel de la journée », et de « lutte[r] contre l’obésité ». En effet, l’accès quotidien à un repas complet, varié et équilibré est une nécessité pour la santé et l’aptitude à étudier des enfants [60] . Le CNA résume cette fonction de la manière suivante : « La raison première de la mise en place de la restauration scolaire est de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des enfants et des jeunes, leur permettant ainsi de pouvoir suivre les enseignements de l’après-midi. Pour cela, il est nécessaire de leur donner des aliments sûrs, sains, en quantité suffisante et à leur goût [61] . » Le ministère de l’Éducation nationale rappelle à cet égard les principes qui doivent être respectés : « Proposer quatre ou cinq plats à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat protidique accompagné d’une garniture, et un produit laitier ; respecter les exigences minimales de variété des plats servis ; mettre à disposition des portions de taille adaptée ; définir les règles adaptées pour le service de l’eau, du pain, du sel et des sauces. »
Selon une étude du Credoc publiée en juin 2012 [62] , les repas pris à la cantine sont à la fois plus complets (56 % d’entre eux comportent au moins six composantes alimentaires différentes contre 26 % des déjeuners pris à la maison) et plus conformes aux recommandations nutritionnelles traditionnelles (présence plus élevée et plus fréquente de légumes, poissons, viandes et pain). En 2016, une autre étude soulignait également pour la première fois l’impact des critères fréquentiels imposés sur le service des plats dans les menus des cantines. Elle démontrait que le suivi de ces critères impacte positivement la qualité nutritionnelle des repas. Les menus élaborés qui respectent les recommandations de fréquence et de grammage du GEM-RCN apportent en moyenne 36 % des apports journaliers en énergie et couvrent la moitié des besoins journaliers en nutriments protecteurs (protéines, fibres, vitamines, minéraux, acide gras essentiels…), soit une très bonne densité nutritionnelle [63] . Il existe également un lien entre la fréquence des repas pris à la cantine et la protection contre le surpoids et l’obésité [64] . La fréquence des repas pris à la cantine est donc l’un des principaux facteurs de protection contre le surpoids et l’obésité chez les enfants. De ce point de vue, la cantine apparaît comme un facteur majeur de prévention sanitaire.
Cette fréquentation présente également des avantages cognitifs. Selon Belot et James [65] , lorsqu’ils bénéficient d’un déjeuner nourrissant et équilibré, les élèves anglais seraient plus attentifs et dans de meilleures conditions pour apprendre. Les résultats scolaires d’élèves de CP en seraient améliorés (augmentation des résultats en anglais et en mathématiques) et l’absentéisme lié à des maladies diminuerait. Inversement, des enfants qui ne mangent pas à leur faim ou qui souffrent de déséquilibres alimentaires importants doivent faire face à des retards cognitifs et de croissance, qui freinent leurs efforts d’apprentissage [66] . Cet enjeu est d’autant plus prégnant que c’est à l’école primaire que se joue l’essentiel des destins scolaires ultérieurs.
Les habitudes alimentaires s’acquièrent en grande partie dans les premières années de la vie. Mais, si l’étape de la diversification alimentaire compte beaucoup dans l’acquisition de la capacité à accepter des aliments nouveaux, tout n’est pas joué dès l’âge de 3 ans, et d’autres périodes sensibles peuvent se faire jour. La maternelle et les premières années du primaire peuvent ainsi correspondre à une période de néophobie alimentaire [67] . Néanmoins, cette période est souvent temporaire. Il convient alors de répéter la présentation des aliments nouveaux, de les présenter sous différentes formes et diverses associations. Cette répétition permet à l’enfant de goûter et de s’acclimater au nouveau produit. Plus l’enfant grandit et plus il devient autonome. Il ne se contente alors plus uniquement de ce qui lui est imposé, mais imite les autres [68] . L’apprentissage devient un moyen d’intégration au sein du groupe. Le temps du repas en restauration collective redouble alors d’importance : à la fois parce qu’il intervient à une période clé de la construction de l’enfant mais aussi parce que, pris en groupe, le repas devient un temps social et que la découverte de nouveaux aliments peut être facilitée par leur acceptation par les autres.
L’école primaire est ainsi un temps privilégié pour l’apprentissage alimentaire. Cet apprentissage évolue dans le temps en fonction de l’âge des enfants, du sexe, du groupe de pairs auquel l’enfant appartient et des pratiques sociales. Tandis qu’entre 3 ans et 8 ans on observe une hausse de la quantité alimentaire consommée, entre 9 ans et 14 ans, les quantités consommées augmentent toujours mais avec une restriction au niveau de la diversité [69] .
Les âges concernés par l’école primaire forment au total une étape particulièrement sensible pour le développement des goûts et des préférences alimentaires des enfants alors même que les trois quarts d’entre eux connaissent une période de néophobie alimentaire. L’école du premier degré couvre de ce point de vue un temps dont il faut profiter pour installer les meilleures habitudes au regard de nos objectifs nutritionnels, sanitaires et environnementaux.
1.2.2. Contribuer à l’éducation et à la socialisation des enfants
Les objectifs sanitaires qui s’imposent aux cantines se prolongent dans l’éducation alimentaire des enfants. Il est tout aussi important de servir des repas équilibrés aux enfants que de leur apprendre à bien manger. Rappelons que la nutrition a été intégrée dans les programmes d’enseignement du premier degré [70] . Cette dimension éducative peut poursuivre simultanément des objectifs de transmission culturelle, de sensibilisation aux enjeux écologiques, de connaissance de son environnement (provenance des denrées alimentaires et des produits agricoles, histoire des terroirs, découverte des processus de transformation, etc.) et des principes nutritionnels essentiels.
Au total, servir des repas équilibrés ne suffit pas pour que les enfants apprennent à s’alimenter de façon équilibrée : il faut leur transmettre les connaissances correspondantes et leur expliquer pourquoi tel aliment a été combiné avec tel autre pour l’équilibre nutritionnel. Compte tenu des enjeux de transition alimentaire qui sont les nôtres aujourd’hui, il est fondamental qu’on forme des personnes capables de faire des choix de consommation informés autant du point de vue environnemental/sanitaire que du point de vue nutritionnel, ce qui est loin d’être encore le cas.
Autrement dit, la cantine doit être pensée comme partie intégrante d’une mission éducative, un lieu où, en cohérence avec les connaissances et compétences transmises en classe, on apprend à goûter et à aimer de nouveaux aliments, à manger ensemble, à heures fixes (on sait que la déstructuration des repas augmente les risques d’obésité et de surpoids [71] ), en quantité raisonnable, en prenant le temps et en évitant que leur attention ne soit captée par des écrans.
Naturellement, cet apprentissage du « bien manger » est aussi et d’abord de la responsabilité des parents : donner à ses enfants un repas équilibré, pris ensemble et dans le respect de ces règles, est la première chose que l’on peut faire chez soi pour préserver la santé de ses enfants. Mais la cantine « à la française » y contribue, elle aussi, car c’est là également que les enfants apprennent à se conformer, très tôt, à ces bonnes pratiques. La cantine, telle qu’elle est organisée dans notre pays, joue, de fait, un rôle très important dans l’éducation alimentaire des enfants. Et, pour certains, au même titre que les parents, puisque cette institution est la seule qui puisse se substituer à l’environnement familial ou social si nécessaire.
Le Conseil national de l’alimentation (Avis n° 77) prend d’ailleurs au sérieux l’objectif éducatif de la cantine en affirmant que la découverte, l’apprentissage de l’équilibre alimentaire, la transmission culturelle, la lutte contre le gaspillage et la formation citoyenne font partie de ses missions. Les cantines scolaires sont par ailleurs un lieu irremplaçable de socialisation et d’acquisition de règles d’hygiène et d’autonomie. Le déjeuner est un temps de socialisation et d’apprentissage des civilités et des codes sociaux [72] (respect des règles de vie, partage de l’espace, etc.). Mais comme elle permet aussi aux enfants de découvrir et de manger ensemble de nouveaux plats et de nouveaux aliments, elle est aussi l’un des lieux privilégiés de la « construction de la sensibilité enfantine [73] ».
Le bon déroulement de la pause méridienne a, en outre, un impact positif sur la capacité de concentration des enfants, l’atmosphère de la classe après le déjeuner et, plus largement, leur éducation alimentaire. Elle peut être un moment d’apprentissage et de convivialité si les enfants sont bien accompagnés, autonomisés et réunis dans une salle dont la configuration a également été bien pensée ( cf. infra partie 4.2.).
Enfin, il faut souligner que la mission éducative des cantines ne saurait faire oublier que le repas doit rester un moment de plaisir et que la qualité gustative des plats qui y sont proposés facilite les apprentissages qui y sont faits. Plus les repas seront appétissants, plus les cantines seront en situation de relever les défis de la transition alimentaire.
L’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire passe, non seulement par le repas lui-même, mais aussi par des actions éducatives spécifiques. Rappelons que la nutrition a été intégrée dans les programmes d’enseignement du premier degré [74] . Cette dimension éducative peut poursuivre simultanément des objectifs de transmission culturelle, de sensibilisation aux enjeux écologiques, de connaissance de son environnement (provenance des denrées alimentaires et des produits agricoles, histoire des terroirs, découverte des processus de transformation, etc.) et des principes nutritionnels essentiels.
Les personnels communaux et enseignants, acteurs clés pour l’éducation alimentaire des enfants Le personnel communal est l’interlocuteur le plus direct des enfants lors des repas servis à la cantine. Souvent informés de leurs éventuels interdits alimentaires, les personnels connaissent les enfants, les croisent tous les jours. C’est auprès d’eux que les enfants font leurs premiers retours sur les repas (quantité, goût, qualité, etc.). Cette proximité en fait des personnels clés pour sensibiliser les enfants à de nouvelles saveurs, à la lutte contre le gaspillage et à l’équilibre alimentaire.Le personnel enseignant, qui s’est assez largement désengagé de l’encadrement des repas, récupère les enfants à l’issue de la pause méridienne. Bien souvent, il pourra constater les effets de celui-ci sur l’enfant : somnolence, fatigue en milieu d’après-midi en cas de repas insuffisant, etc. ; ou, au contraire, disponibilité et meilleure concentration. Si les premiers participent au repas, les seconds tendent à y renoncer depuis quelques années. Cette tendance contribue à une distanciation des pratiques et des apprentissages entre les deux parties de la journée des enfants, pourtant intimement liées. La formation des personnels communaux est essentielle pour leur permettre d’être pleinement acteurs des apprentissages des enfants. L’implication des personnels enseignants l’est tout autant pour donner du sens aux enseignements en classe en les mettant en lien avec l’expérience de l’enfant sur les temps de repas ( cf. infra partie 4.2.).
1.2.3. Contribuer à la lutte contre les inégalités
La restauration scolaire dans les établissements publics du premier degré est aussi un instrument de lutte contre les inégalités sociales et sanitaires liées à l’alimentation. Celles-ci sont souvent le reflet de la diversité des publics accueillis. Rappelons par exemple que, selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), un enfant scolarisé sur cinq (19,5 %) vit au sein d’une famille monoparentale où le niveau de vie médian est de 15 225 euros (contre 20 601 euros en moyenne nationale) et le taux de pauvreté moyen de 31 % (contre 13,2 %).
Les enquêtes nationales de santé auprès des élèves de grande section de maternelle et de CM2 témoignent des effets des disparités qui caractérisent les régimes et habitudes alimentaires selon les milieux sociaux. Chez les élèves de CM2, la prévalence de la surcharge pondérale a reculé entre 2002 et 2015 (de 20,3 % à 18,1 %), de même que celle de l’obésité (de 4,2 % à 3,6 %) [75] . Mais les variations selon le milieu d’origine restent fortes. En 2014–2015, 21,5 % des enfants d’ouvriers étaient concernés par la surcharge pondérale contre seulement 12,7 % des enfants de cadres. De même, 26,4 % des enfants d’ouvriers consommaient quotidiennement des boissons sucrées contre 15,2 % des enfants de cadres. Des disparités analogues pourraient être relevées sur d’autres indicateurs (prise d’un petit

Source : Drees
Pour certains enfants, le déjeuner pris à la cantine est le seul repas équilibré de la journée. Il n’en est que plus décisif pour leur équilibre alimentaire. Il peut être aussi l’occasion de faire connaître aux familles d’autres habitudes alimentaires via leurs enfants.
Malheureusement, le milieu d’origine des enfants conditionne souvent le niveau de fréquentation des restaurants scolaires : plus les enfants sont issus d’un milieu défavorisé, plus ils auraient besoin de fréquenter la restauration scolaire et… moins ils le font ! Le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) l’a montré pour les cantines scolaires du second degré, mais le même mécanisme atteint, selon toute vraisemblance, celles du premier degré [76] . Dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire, c’est-à-dire ceux qui concentrent la plus grande proportion d’élèves issus de familles modestes ou pauvres, « 59 % des élèves n’utilisent jamais le service de restauration scolaire alors qu’ils sont en moyenne 22 % dans les collèges publics hors REP [Réseau éducation prioritaire] et 24 % dans les collèges privés [77] ».
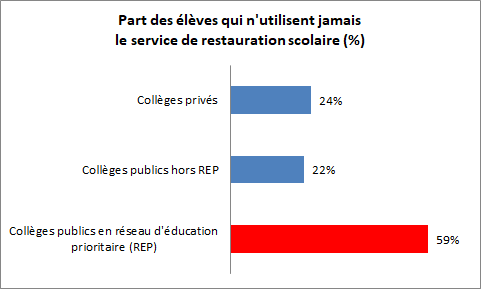
Naturellement, les tarifs proposés aux familles peuvent expliquer en partie ces choix – en partie seulement [78] . Dans le premier degré, la restauration scolaire est généralement prise en charge par les municipalités et gérée par la caisse des écoles, qui donne son avis sur les tarifs proposés aux familles. La participation financière de ces dernières est fixée par la commune, sur la base du quotient familial [79] . En moyenne, la participation demandée aux familles oscillerait entre 3,50 € et 4 € par repas [80] , cette moyenne cachant d’importantes disparités (50 centimes d’euro à Lille, par exemple).
Les débats actuels sur la modulation de ces tarifs sont nombreux, certains proposant la gratuité des repas, d’autres un repas à 1 € donnant lieu à une aide d’État de 2 € ( cf. infra partie 4.1.3.). En tout état de cause, on peut estimer, avec le Défenseur des droits, que la restauration scolaire peut être qualifiée de « service public à vocation sociale ». De ce fait, la question de la tarification et plus largement celle de la prise en compte des inégalités sociales doivent être posées.
1.2.4. Contribuer à la structuration de tissu socio-productif
La restauration scolaire a également un rôle de stimulation de l’économie locale ou régionale, des filières de production et des échanges avec les territoires voisins. Selon le type de denrées qu’elle utilise, le type de transformation qu’elle appelle, les intermédiaires qu’elle fait travailler, etc., elle contribue à orienter le tissu socio-productif qui l’entoure en sollicitant telle ou telle catégorie de producteurs ou de transformateurs. Elle peut, de cette façon, être un levier important pour favoriser le développement de l’agriculture biologique, inciter à la structuration de ses filières et favoriser de nouvelles coopérations entre territoires (on verra ainsi que des métropoles qui doivent servir de très importantes quantités de repas quotidiens toute l’année peuvent choisir d’adresser une partie de leur demande aux producteurs des territoires voisins).
Cette capacité est naturellement variable selon les communes, leur taille, leur environnement géographique et leur capacité financière. Mais elle varie aussi de façon significative en fonction de la compétence et de la volonté politique des décideurs publics. Elle met également en jeu le bon usage des deniers publics : une alimentation de meilleure qualité ou plus locale peut être plus onéreuse et impliquer, dans le contexte de budgets contraints, des économies correspondantes (par exemple, sur le gaspillage, les quantités en excès, etc.). Enfin, le choix de stimuler une production locale et de qualité suppose une bonne connaissance du tissu productif sur le territoire et une capacité à assurer aux producteurs une demande relativement stable dans le temps.
1.2.5. La restauration scolaire, un puissant accélérateur potentiel de la transition
Par le nombre d’enfants et de familles qu’elle touche chaque année aussi bien que par les volumes d’achat qu’elle représente, la restauration scolaire est un puissant levier d’action sur les principaux paramètres de la transition alimentaire. Quelques chiffres suffisent à le montrer.
En 2017–2018, les 50 877 écoles élémentaires et préélémentaires que compte notre pays ont accueilli 6,8 millions d’élèves, dont 5,8 millions dans les établissements publics [81] . Ces enfants sont dans des tranches d’âge où le taux de scolarisation est proche des 100 % (il est même de 100 % de 4 ans à 8 ans) et sont nombreux à utiliser les services de restauration scolaire. Selon les chiffres du rapport Gilda Hobert de mars 2015, « plus de 6 millions d’élèves recourent aujourd’hui régulièrement ou occasionnellement aux services de restauration scolaire. C’est le cas pour la moitié des élèves de l’école primaire et pour les deux tiers des collégiens et des lycéens [82] ». Cette proportion serait le double de celle observée au début des années 1970. En moins d’un demi-siècle, la fréquentation des cantines scolaires est donc devenue un phénomène de masse. Dans les écoles publiques du premier degré, ce sont donc près de 3 millions d’enfants qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement la cantine scolaire, et plus de 3 millions si l’on y ajoute le secteur privé.
De fait, aujourd’hui, près de 50 % d’une classe d’âge passe par les restaurants scolaires de manière régulière ou occasionnelle. Il y a peu de domaines dans lesquels on puisse agir sur les comportements de consommation et les choix d’une si grande part de la population. En termes de santé publique, d’éducation et de sensibilisation aux enjeux environnementaux notamment, c’est un levier que l’on aurait tort de négliger.
Ce levier est également économique. Alors qu’il s’agit d’un service public facultatif, près de 20 000 communes (80 % de celles dotées d’écoles publiques) ont mis en place une ou plusieurs cantines scolaires. Si l’on se concentre sur les seules écoles primaires publiques, ce sont près de 320 millions de repas qui sont servis par an en 2016 [83] . Le coût moyen unitaire de ces repas serait de l’ordre de 7 € mais il n’est facturé aux parents en moyenne qu’à hauteur de 2,5 € à 3 €. Ces chiffres montrent que les communes subventionnent très fortement ces services et qu’elles modèrent considérablement les tarifs appliqués aux parents. Un rapide calcul permet de conclure que l’effort net des communes se situe à près de 1,4 milliard d’euros [84] .
D’autres sources arrivent même à des ordres de grandeur légèrement supérieurs. Ainsi, selon le Cnesco (2017) et le Défenseur des droits (2013), le coût d’un repas servi et encadré pour la collectivité en école maternelle et primaire oscillerait entre 6,50 € et 10 € (dont 3,50 € à 5 € de matières premières, préparation et éventuellement livraison). En moyenne, les familles paieraient pour ce service entre 3,50 € et 4 €. Ce qui porterait l’effort net des communes à un peu plus 1,4 milliard d’euros [85] . Si l’on ajoute à cet effort net la contribution des familles, ce sont environ 2,5 milliards d’euros qui seraient consacrés chaque année à la restauration scolaire du premier degré, soit un peu plus d’un point de PIB.
Ces volumes peuvent être un puissant levier de stimulation des acteurs les plus vertueux de la filière alimentaire. Le contenu en denrées (transformées ou non) de 320 millions de repas a un impact sur les émissions de GES et sur la santé des sols, selon le type d’aliments retenus, les modes de production et de transformation sollicités [86] , la distance aux exploitations, etc. Tout en tenant compte des contraintes réglementaires liées au code des marchés publics, ces budgets permettent d’assurer aux producteurs de qualité et/ou de proximité des volumes de commande appréciables. D’autant que, selon le cabinet Gira Foodservice, près de 60 % des services de restauration scolaire (premier et second degrés confondus) sont en gestion directe, le reste étant concédé à des opérateurs le plus souvent privés.
1.3. Un cadre normatif en évolution rapide
Pour les écoles primaires du secteur public, la responsabilité de la restauration relève de la commune ou de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les modes d’organisation varient selon la taille des communes. Le service est généralement assuré par le personnel communal, en cuisine autonome au sein de l’établissement ou avec une cuisine centrale livrant différents établissements. Dans ce dernier cas, les repas sont livrés dans une cuisine dite « satellite », soit en liaison chaude, soit en liaison froide. Dans certains cas, la gestion est assurée par une société de restauration collective [87] .
La restauration scolaire dans les établissements d’enseignement du premier degré a toujours été un service public facultatif [88] soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) et administré dans le respect de la législation et des grands principes du droit administratif, notamment le principe d’égalité des usagers. Ce caractère facultatif n’a pas empêché le cadre réglementaire de la restauration scolaire de devenir toujours plus précis et contraignant à mesure que ce service se développait, comme le montre la chronologie sommaire qui suit.
1.3.1. La restauration scolaire et son cadre réglementaire
En 1936, le gouvernement du Front populaire rend obligatoires la construction d’un réfectoire dans toute nouvelle école et son aménagement à l’occasion des rénovations significatives des établissements existants. En 1949, le ministre de l’Éducation nationale (instructions du 30 août 1949) décide d’encourager la création des cantines en permettant à l’État de subventionner la moitié des dépenses de construction des locaux et introduit de premiers principes nutritionnels relatifs au contenu des repas (nature des aliments, diversité, qualité nutritive, quantité…).
Pour faire face au baby-boom d’après-guerre, les associations de parents d’élèves, puis les communes tissent progressivement un étroit maillage de cantines scolaires. Dans le même temps, les réglementations relatives à l’hygiène, à la qualité nutritionnelle et à la convivialité de l’accueil des enfants se font plus précises (circulaires du 6 mars 1968 et arrêté du 26 juin 1974 relatifs à l’hygiène dans la restauration collective, circulaire du 9 juin 1971 relative à l’alimentation de l’écolier…). Ce cadre réglementaire conjugué à la croissance des besoins conduit les communes à se substituer progressivement aux initiatives privées, soit en gérant directement le service, soit en le déléguant à des organismes privés de restauration collective.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le souci de la sécurité alimentaire et de la qualité nutritionnelle tend à s’imposer et appelle « un nouvel élan de structuration des services de restaurations scolaires » dans lequel l’Union européenne joue son rôle : le « paquet hygiène » adopté en 2004 par l’UE – en particulier le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires – harmonise et simplifie le cadre législatif européen.
À la fin des années 2000, les préoccupations environnementales font leur entrée dans le champ de la restauration scolaire. En 2007, le Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de 20 % de denrées alimentaire issues de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique. Cet objectif est réaffirmé en 2013 dans le programme « Ambition Bio 2017 », puis encore tout récemment dans la loi Egalim.
La modification de l’article 53 du Code des marchés publics (CMP, 2011) permet aux acteurs de la commande publique de s’inscrire dans cette démarche. Cette volonté est reprise lors de la rédaction de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016.
En 2010, une politique publique de l’alimentation est inscrite dans la loi, pour la première fois en France, et donne naissance au Programme national pour l’alimentation (PNA). De nombreux objectifs de cette politique et de ce programme concernent la restauration scolaire.
Un groupe d’étude des marchés consacré à la restauration collective et à la nutrition (le GEM-RCN) a par ailleurs été mis en place par la décision n° 2006–01 du 1 er mars 2007 du comité exécutif de l’Observatoire économique de l’achat public, afin qu’il publie régulièrement des recommandations à l’attention des décideurs et acteurs locaux. Ces recommandations ont fait l’objet d’importants débats ces dernières années.
1.3.2. Enjeux de santé publique et limites des recommandations du GEM-RCN
Afin de garantir l’équilibre alimentaire dans les cantines et de leur assigner une nouvelle mission d’éducation au goût, le décret n° 2011–1227 du 30 septembre 2011 et l’arrêté du ministre de l’Éducation nationale du 30 septembre 2011 imposent le principe de variété des repas et précisent les fréquences de présentation des plats ainsi que la taille des portions selon les qualités nutritionnelles des aliments. L’offre de restauration scolaire doit désormais se conformer au cadre de vingt menus consécutifs, respectant un schéma nutritionnel valorisant en particulier les crudités, les légumes cuits, les produits laitiers, les féculents, la viande et le poisson, et devant limiter les fritures, les préparations à base de viande hachée, les préparations reconstituées à base de viande, poisson ou œufs, les pâtisseries et les plats cuisinés industriels.
Pour préciser ce cadre et aider les acteurs publics à élaborer leur contrat de restauration collective et à guider leurs achats, le GEM-RCN publie des recommandations. Elles indiquent en particulier des grammages à respecter et des critères nutritionnels précis en fixant, sur vingt repas consécutifs, des fréquences de service des plats selon leur qualité nutritionnelle afin de répondre à plusieurs objectifs : augmenter la consommation de fruits, légumes et de féculents ; diminuer les apports lipidiques et rééquilibrer la consommation d’acides gras ; diminuer la consommation de glucides simples ajoutés ; augmenter les apports en fer ; augmenter les apports calciques.
Le suivi des fréquences nutritionnelles qu’il recommande nécessite l’expertise d’un diététicien nutritionniste pour évaluer la qualité nutritionnelle des plats proposés selon leur composition. Chaque préparation doit être classée selon sa teneur en protéines, lipides, sucres, calcium, rapport P/L, pourcentages de viande, œuf ou poisson mis en œuvre dans la recette selon le grammage recommandé pour une tranche d’âge considérée…
Les acheteurs publics qui ne font pas appel à des diététiciens-nutritionniste se fient, pour les préparations industrielles, aux informations communiquées sur les fiches techniques des fournisseurs. Mais celles-ci sont souvent incomplètes voire erronées, et la qualité nutritionnelle réelle des produits n’est pas forcément bien évaluée.
Aujourd’hui, le GEM-RCN n’existe plus mais ses recommandations continuent d’être suivies. Et elles ont permis de réaliser des progrès. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Inra [89] démontre qu’elles ont, au total, impacté positivement la qualité nutritionnelle des repas. Les menus élaborés qui respectent les recommandations (fréquence et grammage) couvrent en moyenne 36 % des apports journaliers en énergie et la moitié des besoins journaliers en nutriments protecteurs (protéines, fibres, vitamines, minéraux, acide gras essentiels, etc.).
Mais ces recommandations se révèlent être à présent un frein à de nouveaux progrès. Elles induisent notamment des gaspillages : les grammages recommandés n’envisagent que deux options selon l’âge des enfants (maternelle et élémentaire) et ils sont identiques pour des menus à quatre ou cinq composantes… En outre, les acheteurs publics peinant parfois à trouver certains aliments au grammage recommandé (steak haché, escalope, cordon bleu, poisson pané… en 50 g ou 70 g, par exemple), les enfants retrouvent dans leur assiette des préparations dont le grammage peut être largement supérieur aux recommandations.
Les critères du GEM-RCN induisent également un excès de protéines [90] . Les apports en protéines du déjeuner servis en restauration scolaire représentent en général un minimum de 40 % des apports journaliers en protéines chez l’enfant. Il faut savoir que les recommandations d’apport en protéines chez l’enfant se définissent en fonction de l’apport énergétique, selon la fourchette suivante : de 3 ans à 5 ans, 6 % à 16 % ; de 6 ans à 9 ans, 7 % à 17 %. Or le GEM-RCN se basait sur la borne haute pour définir ces grammages. En outre, les laitages sont présents à chaque repas et parfois plusieurs fois dans le repas. Et certains menus peuvent comporter trois sources de protéines animales sur les cinq composantes. C’est le cas lorsque les menus comportent une entrée protidique (œuf dur mayonnaise, sardines, charcuterie…), une viande ou un poisson et des produits laitiers (crème, fromage, yaourts, etc.).
Les critères du GEM-RCN encadrent par ailleurs insuffisamment la fréquence des plats ultra-transformés et n’encouragent pas assez les préparations « maison ».
1.3.3. Un cadre de recommandations à revoir
De fait, les recommandations du GEM-RCN ne sont pas en adéquation avec le PNNS 4, qui préconise de réduire « chez l’adulte » (recommandations nutritionnelles pour les enfants en attente de parution) la consommation de produits laitiers à deux par jour (au lieu de trois), de limiter la consommation de viande (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) et de charcuterie, de valoriser la consommation des légumineuses, de favoriser les préparations « maison », de limiter les produits ultra-transformés et surtout de prendre du plaisir à manger.
Il faut donc revoir ce cadre en profondeur. D’autant que la loi Egalim du 30 octobre 2018 (article n° 24 L.230–5–4) impose dorénavant aux gestionnaires des restaurants collectifs publics ou privés la mise en place d’un plan pluriannuel de diversification des protéines pour les restaurants de plus de 200 couverts par jour en moyenne, ainsi que la mise en place, à titre expérimental, une fois par semaine, d’un menu végétarien [91] composé de protéines animales ou végétales (que certains ont traduit par « menu ovo-lacto-végétarien » au risque de laisser penser qu’il fallait combiner protéines végétales et protéines animales alors que la loi dit « protéines animales ou protéines végétales »).
Par ailleurs, l’article 24 de la loi Egalim instaure l’obligation de servir des repas « dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge » qui comprennent une part au moins égale à 50 % de produits bénéficiant de labels ou issus des circuits courts [92] et au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique (produits certifiés bio ou en conversion). Les labels autorisés dans les 50 % ont été fixés par un décret du 23 avril 2019. Y sont compris : le label rouge ; l’appellation d’origine ; l’indication géographique ; la spécialité traditionnelle garantie ; la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » ; la mention « fermier » ou « produit à la ferme », pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

L’ensemble de ces innovations législatives appellent de nombreuses précisions concernant les normes et standards en vigueur en matière de restauration collective. C’est justement l’objet de deux instances nouvellement créées : le Conseil national de la restauration collective (piloté par le ministère de l’Agriculture) et le GT Nutrition (piloté par le ministère de la Santé), qui auront notamment pour rôle de donner des recommandations plus précises aux cantines. Il est à noter que ces instances ont ouvert leurs portes à des représentants d’associations, notamment environnementales [94] .
D’ores et déjà, le 1 er mars 2019, le Groupe restauration collective et nutrition (GRCN) [95] , composé d’anciens membres du GEM-RCN, a publié, en attendant la parution d’un nouveau décret, un complément à la fiche plat protidique de 2015 de l’ex-GEM-RCN. Dans cette annexe, le GRCN émet des recommandations pour la mise en application des dispositions de la loi Egalim, en particulier concernant le repas végétarien hebdomadaire mis en expérimentation. Il propose de nouveaux critères de fréquence pour les plats protidiques et recommande de diversifier les composantes protidiques et les plats complets végétariens proposés sous toutes leurs formes (produits bruts, semi-élaborés, élaborés)… Mais aucune indication n’est donnée sur la nécessité de favoriser les plats « fait maison » alors que cette nouvelle disposition risque de faire la part belle aux aliments industriels ultra-transformés à base de protéines végétales. Concernant les composantes protidiques végétariennes, l’annexe recommande quatre types de plats [96] , dont deux composés de protéines d’origine animale mais non carnés (œufs et/ou produits laitiers) et « alerte les collectivités excluant tous les aliments d’origine animale (végétalisme) des risques de carences délétères pour la santé des enfants » sans citer de sources scientifiques pour étayer cette affirmation ; ce qui apparaît contestable [97] , en particulier lorsqu’il s’agit d’un seul repas par semaine.
1.4. Des attentes multiples et contradictoires
1.4.1. Prix, qualité, quantité, proximité… la quadrature du cercle
La recherche d’une alimentation durable, telle que définie plus haut, oblige à concilier des objectifs qui, s’ils sont éminemment souhaitables, ne sont pas tous immédiatement compatibles. La dimension sociale, on l’a vu, requiert des prix aux familles qui soient suffisamment bas pour pouvoir attirer les enfants qui en ont le plus besoin. La satisfaction des exigences environnementales et climatiques requiert de son côté que l’on privilégie des produits issus de l’agriculture biologique et, si possible, de proximité. Mais cela tend à renchérir le coût global des repas si l’on ne fait pas d’économies par ailleurs : les produits de l’agriculture biologique sont en effet plus chers que ceux de l’agriculture traditionnelle, et la recherche de la proximité limite les bénéfices d’une large mise en concurrence des producteurs.
En outre, les économies qui pourraient être réalisées sur les quantités servies aux enfants se heurtent souvent à la méfiance des parents qui ne veulent pas que l’on « mégote » sur la taille des portions… De même, la dimension économique de la transition alimentaire implique que les producteurs puissent tirer des revenus décents de leur activité, ce qui risque de renchérir les prix à la vente.
Bref, un consensus se forme aisément autour de prix bas, de produits de qualité, de quantités satisfaisantes, de circuits de proximité et d’une alimentation cohérente avec nos impératifs environnementaux. Mais, dans la pratique, tenir ensemble ces différentes dimensions relève parfois de la quadrature du cercle, et les arbitrages entre ces différents objectifs, notamment dans les communes les plus modestes, sont parfois très contraints.
1.4.2. La hiérarchie des attentes et l’ordre des urgences
Ces difficultés sont d’autant plus difficiles à surmonter que la hiérarchie des attentes varie d’une catégorie d’acteurs à l’autre. Les producteurs et les acteurs de la filière alimentaire tendent à privilégier leurs intérêts économiques, souvent de court terme. En amont de la chaîne de valeur, du côté des agriculteurs, les conditions de vie et de travail exercent une pression considérable en faveur de la recherche de revenus décents.
Du côté des collectivités territoriales, la contrainte budgétaire et fiscale incline volontiers à la recherche du moindre coût, mais avec une préoccupation croissante pour la sécurité alimentaire des repas servis dans les écoles. Les communes les plus petites ou les plus modestes sont en outre souvent dans un rapport de négociation peu favorable avec les fournisseurs et industriels : elles ne représentent pas un marché suffisamment large pour pouvoir jouir de la meilleure offre.
Du côté des parents d’élèves, enfin, les exigences sont plus nombreuses et parfois contradictoires : prix et quantité arrivent souvent en tête, suivis de près par des préoccupations sur la qualité des repas (avec des criteriums variables selon les milieux sociaux et les niveaux d’information, et avec parfois de forts clivages sur la question des repas végétariens) et de plus loin par leur empreinte environnementale.
1.4.3. Une pression politique croissante ?
La plupart de nos interlocuteurs, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou du côté des industriels de la restauration collective, sont cependant convenus du fait que la qualité des repas servis dans les cantines du primaire fait l’objet d’une pression politique croissante et d’une attention nouvelle de la part des citoyens. C’est d’ailleurs souvent la conjonction des deux qui crée une dynamique vertueuse. D’après une étude menée par l’Observatoire de la restauration collective bio et locale [98] , les cantines qui ont élaboré un projet de transition alimentaire ont commencé sous l’impulsion d’une volonté politique (65 %) et sous l’impulsion de membres de la société civile (32 %).
En 2018, 90 % des parents interrogés (contre 86 % en 2017) voulaient plus de produits bio dans les cantines de leurs enfants (rapport Fnab [99] ). Sur le terrain, les collectifs de parents se multiplient et s’associent parfois avec des chercheurs et des professionnels pour se faire entendre et crédibiliser leur action, comme c’est le cas avec le collectif « Cantine sans plastique ». Ce collectif a obtenu la fin des barquettes en plastique à Montrouge [100] (avant la loi Egalim) et à Bordeaux (après avoir obtenu de la mairie de faire des tests sur les assiettes utilisées qui se sont révélées contenir du bisphénol A, pourtant interdit depuis 2015). D’autres associations locales, comme par exemple « La Coordination » de Pontoise, ont obtenu le retour à l’inox suite à une pétition en ligne [101] . Signe que ces revendications portent, de nombreuses villes sont maintenant signataires de la charte « Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens [102] », ou du « Pacte de Milan » en faveur de politiques alimentaires ambitieuses à l’échelle locale [103] .
On le voit, l’attention portée par les familles au contenu des assiettes de leurs enfants est grandissante [104] , tant du point de vue sanitaire et nutritionnel que du point de vue environnemental, même si cette dernière dimension reste encore relativement secondaire dans les esprits. Il n’est pas impossible – il est même très probable – que les cantines scolaires du premier degré seront l’un des thèmes d’attention des électeurs lors des prochaines élections municipales dans de nombreuses communes.
La problématique environnementale arrive d’ailleurs dans les premières préoccupations des électeurs pour les municipales (47 % des votants souhaitant que leur maire préserve l’environnement sur le territoire de leur commune, quelle que soit la taille de la commune). Parmi les actions jugées prioritaires en la matière, 19 % des votants pensent qu’il faut renforcer l’alimentation bio et locale dans la restauration collective (en particulier dans les communes de moins de 10 000 habitants [105] ).
2. Les difficultés liées à l’approvisionnement bio et local
Parce qu’ils sont plus respectueux à la fois de l’environnement et de la santé humaine, les produits bio sont l’une des clés de la transition alimentaire. Or, en dépit des efforts qui peuvent être réalisés ici ou là et des intentions affichées par les pouvoirs publics depuis quelques années, les cantines scolaires servent encore trop peu de produits bio dans les assiettes des enfants, et les disparités entre une commune et une autre, un établissement et un autre sont souvent très grandes dans ce domaine. Alors que certaines communes ont dépassé la barre des 50 % de produits bio dans leurs restaurants scolaires, une étude publiée par l’Agence Bio en novembre 2018 [106] montre qu’en moyenne en France la part du bio en restauration collective est d’environ 3 % des achats. On est donc encore très loin du compte.
Les difficultés d’approvisionnement – la quantité de bio disponible sur le marché est encore insuffisante et la restauration scolaire n’y est pas toujours prioritaire – et le coût économique de ces produits constituent souvent les premiers obstacles à la réalisation des objectifs de la loi Egalim ( cf . supra 1.3.3.). Les principaux freins cités à la fois par les responsables de la restauration collective (responsables des achats et cuisiniers) et les élus locaux sont en effet, d’une part, les surcoûts liés au prix de ces produits et, d’autre part, les difficultés d’approvisionnement.
En ce qui concerne les surcoûts, ils sont estimés par les structures qui ont commencé à introduire des produits bio à environ 18 % des coûts de matières premières, ceux-ci ne représentant cependant que 30 % du prix d’un repas (soit entre 5 % et 6 % du coût total). Afin de compenser une partie de ces surcoûts et de ne pas devoir les répercuter dans les tarifs proposés aux familles, les collectivités les plus avancées font des économies dans l’organisation des repas. Dans le détail, l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable nous fournit des indications précises avec une étude publiée récemment [107] à partir des résultats d’un sondage détaillé : le coût matière des cantines répondantes est d’environ 1,88 € par repas pour 34 % de bio, un coût qui se situe dans la moyenne des coûts généralement observés. Les principaux leviers de maîtrise des coûts observés sont la lutte contre le gaspillage, les menus végétariens, l’utilisation de produits bruts/de saison et la formation. Dans les autres leviers cités par les collectivités, on trouve également : un meilleur équipement des cuisines et l’évolution des modes d’approvisionnement pour privilégier le local (groupement d’achats, plateformes).
Cette politique intervient donc en amont et/ou en aval des repas. En amont, il s’agit de travailler sur les quantités servies (servir de plus petites portions en encourageant les élèves à se resservir le cas échéant). En aval, il s’agit de revaloriser les restes (compostage, reconditionnement, etc.). Certains exemples montrent que cette stratégie peut s’appuyer sur des mesures très simples et très efficaces comme en témoignent les pratiques en vigueur dans des communes telles que Mouans-Sartoux ou Carrières-sur-Seine. Par exemple, au lieu de proposer des pommes brutes en dessert, que l’on retrouve souvent à peine croquées dans la poubelle à la fin du repas, il suffit de les proposer coupées en quartiers et épépinées pour diviser par deux la quantité servie tout en augmentant la consommation réelle ! ( cf . infra encadré sur les initiatives de lutte contre le gaspillage, partie 3.4.).
Les difficultés d’approvisionnement sont, elles, liées à l’insuffisance de filières capables de proposer des produits bio utilisables directement dans les cantines. Il est ainsi souvent nécessaire de développer des légumeries et autres ateliers de transformation de produits bruts, y compris pour permettre la consommation de fruits et légumes et de viandes en dehors des périodes de consommation. Dans certains territoires, les acteurs locaux du bio essaient de proposer des plateformes d’approvisionnement, mais les règles des marchés publics sont souvent pointées comme trop complexes par ces acteurs ( cf . partie 2.4.).
Ces difficultés renvoient aux enjeux plus globaux de la production de bio en France, qui ne représente encore que 7,5 % de la surface agricole utile (SAU) [108] . La production domestique en bio peine donc à servir une demande croissante du côté des consommateurs. En 2018, la consommation finale de produits bio a augmenté de 15 % pour atteindre 9,7 milliards d’euros, soit près de 5 % des achats alimentaires des Français. Mais la part des importations dans cet ensemble est restée stable à 31 %, et même à 18 % si on exclut les produits exotiques [109] . De même, l’introduction d’un repas végétarien par semaine dans les cantines à partir de novembre 2019, conformément à la loi Egalim [110] , et l’obligation pour celles-ci de lancer un plan de diversification des protéines servies aux enfants pourraient accentuer l’insuffisance de l’offre en protéines végétales bio sur le territoire français. La production de protéines végétales bio ne représente en effet que 10 % des terres arables en France [111] .
Même au-delà des productions bio, l’Union européenne est encore très loin de l’autosuffisance en matière de protéines végétales : comme on l’a déjà souligné, en 2016–2017, elle importait environ 17 millions de tonnes de protéines brutes, dont 13 millions à base de soja, denrées souvent produite au Brésil aux dépens de la forêt amazonienne [112] . Développer le secteur des protéines végétales bio répond donc à de multiples enjeux : agronomique et environnemental (ces productions sont souvent excellentes pour la santé des sols qu’elles rendent plus fertiles, et leur production locale permettrait d’éviter la déforestation et de longs transports, source d’émissions de GES), nutritionnel et sanitaire (augmenter la part des protéines végétales dans nos assiettes et celles de nos enfants permettrait de réduire les apports de protéines d’origine animale) et économique (cette production locale permettrait d’éviter de coûteuses importations et d’améliorer notre balance commerciale). Pour accompagner ce mouvement, une réorientation des subventions de la PAC [113] serait très utile : ces subventions encouragent aujourd’hui davantage la production de protéines animales que celle de protéines végétales [114] . Les légumineuses sont d’ailleurs en train de connaître une vraie dynamique en France (que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’alimentation humaine) puisque les surfaces en légumineuses ont été multipliées par trois entre 2014 et 2018 [115] . Les 70 000 hectares qui y sont consacrés en 2018 restent néanmoins très insuffisants pour couvrir les besoins domestiques, et c’est pourquoi un plan d’indépendance en protéines végétales devrait être renforcé, tant au niveau français qu’européen [116] .
2.1. Évolution des quantités disponibles en bio et non-bio
La progression de l’agriculture biologique s’observe à la fois du côté de la demande et du côté de l’offre. L’évolution du nombre d’agriculteurs en bio et des surfaces cultivées selon ce mode de production est spectaculaire depuis quelques années, comme en témoigne le graphique suivant.
Progression des surfaces et du nombre de fermes en bio et conversion,
en France depuis 1995

Source : Agence Bio
Cette production a connu deux fortes accélérations : dans les années 2008–2011 puis à partir de 2014. En moins de dix ans, les surfaces et le nombre de fermes engagées ont plus que doublé. Pour apprécier le rythme de cette progression, il faut tenir compte de la durée des processus de conversion visible sur ce graphique (différence entre surfaces en conversion et surfaces certifiées). En effet, en fonction des productions, il faut compter deux à trois ans pour que les produits issus d’une ferme en bio puissent être certifiés comme tels. À partir du début de la deuxième année de conversion, et pour des produits bruts, on peut valoriser le caractère « en conversion » avec un prix souvent intermédiaire entre le conventionnel et le bio.
Cette photographie à fin 2018 est toutefois insuffisante, car il faut pouvoir se projeter dans les cinq à dix ans à venir pour imaginer la suite de cette dynamique. Les États généraux de l’alimentation qui ont eu lieu au cours du deuxième semestre 2017 ont abouti au programme « Ambition Bio 2022 », qui prévoit notamment de passer de 6,5 % à 15 % la part de la surface agricole utile (SAU) française cultivée en bio.
La question fondamentale est celle de la capacité à atteindre cet objectif de 15 % et du modèle de développement de l’agriculture biologique française qui le permettra (i.e. avec des pratiques agro-écologiques ou industrielles). Mais la demande est bel et bien là. L’industrie agroalimentaire a d’ailleurs pris conscience de sa croissance et elle s’y intéresse sérieusement. Tout récemment, la marque Hénaff a ainsi lancé son pâté bio, alors même que le territoire breton et la production de porc ont historiquement adopté un modèle d’élevage très intensif, plus difficilement convertible en bio. De même, des enseignes comme Carrefour ou Leclerc ont lancé des partenariats avec des agriculteurs en cours de conversion pour les encourager et pour sécuriser l’approvisionnement de leurs magasins. Et l’on pourrait multiplier les exemples allant dans le même sens.
Quand consommer bio n’est pas possible en raison d’une offre insuffisante, une étape intermédiaire consiste à adopter une consommation locavore, c’est-à-dire de saison et régionale. Ce choix est même parfois préférable à celui qui consiste à consommer des fruits et légumes bio importés, lorsque ceux-ci ont été produits sous serre de manière quasi industrielle, dans des conditions de travail peu exemplaires et avec une empreinte environnementale importante [117] . Quant aux fruits et légumes bio produits en France hors saison, il faut avoir conscience qu’ils ont été souvent, eux aussi, cultivés sous serre chauffée et hors sol, entraînant d’importantes émissions de GES [118] . La tendance à l’industrialisation du bio, entretenue par de grandes enseignes qui veulent pouvoir disposer de grandes quantités et casser les prix, comporte un réel risque de dévoiement des visées et principes originels de l’agriculture biologique. La vigilance doit donc rester de mise sur les pratiques adoptées lors de ce passage à l’échelle du bio, afin que ce label reste fiable, crédible et source de progrès environnementaux.
Le temps qu’une production bio suffise à satisfaire la demande domestique, consommer local, de saison et des produits issus de filières de qualité (label rouge, élevage en plein air, AOC, etc.) permet également d’enclencher une transition alimentaire. De même, concernant la viande, des filières qualité semblent se développer (label rouge), en particulier pour les volailles (fermières, élevage en plein air, etc.).
Quoi qu’il en soit, dans le cas de la restauration scolaire, le mouvement de transition va devoir s’accélérer. L’article 24 de la loi Egalim prévoit, on l’a vu, que les structures publiques chargées de la restauration collective atteignent 50 % de leurs achats en alimentation durable, principalement bio et sous signes de qualité, au 1 er janvier 2022. Cet objectif n’est pas inaccessible. Quand le sujet est pris avec énergie et conviction, des solutions existent d’ores et déjà. Mais il faut accompagner et former le personnel [119] , les élèves et leurs parents, acheter des produits de saison, supprimer les achats à la portion, etc. Des exemples comme celui de la commune de Mouans-Sartoux montrent que l’on peut même atteindre 100 % de repas bio en maîtrisant les coûts grâce à une réduction drastique du gaspillage (qui a en l’occurrence été divisé par cinq, voir encadré ci-après).
Manger 100 % bio, majoritairement local, et au même prix ; le pari réussi de Mouans-Sartoux La commune de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes compte 10 500 habitants. Après la crise dite de la « vache folle » en 1999, ses élus ont fait le choix de prendre en main la restauration scolaire (sous forme de régie municipale) et décidé d’introduire des produits bio dans les trois cantines de la commune (1 100 repas par jour, 143 500 par an).Aujourd’hui, Gilles Pérole, adjoint au maire en charge de l’éducation indique que 100 % des repas sont bio, que le gaspillage par repas servi est passé de 147 grammes à 30 grammes (une réduction d’un facteur 5), qu’il n’y a pas de plastique dans sa cantine, que les enfants consomment essentiellement des produits de saison, que pas un fruit n’est gaspillé et que les élèves sont globalement satisfaits de leur alimentation ; le tout sans contestation confessionnelle.Dans le même temps, les coûts ont été tenus. Le prix du repas en 2017 revient à 8,39 € TTC (y compris les coûts de personnel, d’administration, de culture, d’énergie, etc.) hors frais d’animation. Et il est facturé aux familles entre 2 € et 6,80 €, selon le quotient familial.Pour parvenir à ces résultats, il a fallu aux élus de fortes convictions et beaucoup de volontarisme :– création d’une régie agricole sur 6 hectares de terrain communal, avec l’installation de trois « agriculteurs communaux » ;– création d’une unité de conservation/congélation des fruits et légumes ;– création de 3 cuisines intégrées aux 3 groupes scolaires ;– engagement de 21 agents travaillant au service restauration (un animateur pour 10 enfants en maternelle).Au final, 85 % des familles auraient modifié leurs pratiques alimentaires [120] , et les enfants sont éduqués autour des aliments qui proviennent de leur territoire. Plus récemment, une Maison d’éducation à l’alimentation durable (Mead) a été créée pour approfondir le projet en créant un lieu d’éducation, de recherche et de partage, afin d’essaimer le projet dans d’autres territoires.
Il reste cependant que, pour se diffuser plus largement, plusieurs difficultés doivent être surmontées, à commencer par celles auxquelles se heurtent les agriculteurs désireux de se convertir au bio.
2.2. Conversion au bio : engouement et difficultés
2.2.1. Engouement : entre raisons économiques, environnementales et sanitaires
La demande pour une baisse de la chimie dans les modes de production agricoles s’affirme, y compris chez un nombre croissant d’agriculteurs et d’éleveurs. Et si on baisse les apports chimiques, pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas sauter le pas en passant en bio ? Car, sur nombre de cultures ou d’élevages intensifs, la demi-mesure risque d’être trop pénalisante pour les rendements et pour les revenus… Sur les grandes cultures, par exemple, il est nécessaire de passer en polyculture pour compenser la baisse de rendements induite par le passage en bio. C’est donc tout le système d’une exploitation qu’il faut revoir de manière globale pour retrouver un équilibre économique.
En tout cas, l’engouement est là. Et il va croître notamment sous la pression des jeunes agriculteurs qui s’installent ou des néoruraux [121] . Ceux-ci font de plus en plus le choix d’exploitations en bio, attirés par les vertus environnementales de ce mode de production et les moindres risques qu’il fait courir à la santé des producteurs eux-mêmes. En lien très probable avec l’utilisation de produits phytosanitaires, on note en effet une prévalence supérieure de la maladie de Parkinson et de certains cancers chez les professionnels du monde agricole [122] : cancers du système lymphatique, de la peau, de la prostate, des lèvres et des ovaires, de la thyroïde, etc. Les jeunes agriculteurs sont aussi attirés par un prix de revente supérieur à celui des produits de l’agriculture conventionnelle, ce qui leur assure un revenu plus décent pour une surface d’exploitation égale.
Les motivations pour se convertir au bio sont donc multiples. Elles oscillent entre convictions environnementales, volonté d’être plus autonome [123] , opportunités économiques ou encore événement biographique (par exemple, le décès ou la maladie d’un agriculteur voisin ou d’un membre de la famille, pour des raisons liées ou non à l’utilisation de produits phytosanitaires). Ces facteurs se combinent souvent, et la conversion au bio intervient majoritairement à l’issue d’un long cheminement personnel et professionnel [124] .
L’aspect économique (les aides reçues et le prix de vente plus intéressant) est ce qui rend la conversion possible. Quelles que soient les motivations, il est donc nécessaire que le prix de vente en bio reste incitatif. Pour cela, plusieurs facteurs doivent se conjuguer. Les agricultrices et les agriculteurs doivent tout d’abord maintenir leur position sur le segment « qualité » du marché. Du côté des consommateurs, il faut ensuite encourager l’intérêt croissant pour des achats plus « responsables » d’un point de vue sanitaire et environnemental. Les produits bio, ou à haute valeur environnementale, contiennent plusieurs promesses (y compris sociales), qui correspondent à des valeurs de plus en plus partagées et qui devraient continuer à se diffuser. C’est à ces conditions que l’agriculture bio pourra rester attractive et consolider sa place sur le marché, face au modèle conventionnel.
2.2.2. Difficultés (structurelles, techniques, psychologiques)
Les difficultés sont cependant nombreuses. Elles sont à la fois structurelles, techniques et psychologiques.
a) Structurelles : un système agricole intégré et verrouillé
Les difficultés sont d’abord structurelles et concernent le verrouillage du modèle agricole, dû notamment à une hyperspécialisation des systèmes de production sur de grandes surfaces, ce qui rend difficile l’émergence d’un modèle alternatif. En effet, cette spécialisation a été autant poussée par les marchés que par les politiques publiques (subventions européennes liées à la taille des exploitations, en particulier) et a induit un modèle de commercialisation de masse de produits standardisés issus de l’agriculture conventionnelle, habituant le consommateur à des prix toujours plus bas [125] . Cette commercialisation de masse a permis de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts logistiques et de transformation. Progressivement, les aides de la Politique agricole commune (PAC) – proportionnelles à la quantité produite puis à la surface cultivée – et la grande distribution ont poussé les agriculteurs à produire le plus possible et le moins cher possible, au détriment de la qualité des produits et de leur impact environnemental.
Le développement d’une agriculture productiviste s’est articulé autour de la coopération – qui a organisé les débouchés –, du syndicalisme – qui a défendu ses intérêts –, des banques – qui ont aidé au financement –, de certaines mutuelles et assurances, d’instituts de recherche, des chambres d’agriculture – qui représentent les agriculteurs et participent aux actions de développement, de vulgarisation et de formation –, des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) – qui ont aidé aux remembrements du foncier et à l’agrandissement des exploitations. Ainsi, les mêmes agriculteurs sont souvent administrateurs à la fois de la coopérative, du syndicat majoritaire, du Crédit agricole, de la Safer…
Cette organisation a accompagné le développement d’une agriculture intensive, d’un système coopératif extrêmement puissant et d’un syndicalisme fort et très unitaire. C’est le modèle de l’agriculture intégrée. La prescription agricole régionale ou nationale (journaux, coopératives, conseils) est très uniforme et pousse les agriculteurs à l’intensification, à la monoculture, qui elle-même alimente la coopération. Peu de place donc pour la vente directe ou pour la diversification.
À mesure que ce modèle agricole se construisait, il a créé des freins à l’émergence d’une alternative, que ce soit en amont (en termes de semences disponibles), pendant la production agricole (en termes de techniques et de pratiques agricoles) et en aval (dans la collecte, le stockage et la commercialisation des produits). En particulier, la diversification et la rotation des cultures, qui sont deux des principales pratiques utilisées par les agriculteurs bio aujourd’hui, induisent des cultures de plus petite taille qui peinent à trouver des débouchés pour des produits non standardisés et en plus petites quantités.
Pour lever ces freins, deux voies sont en train d’émerger : une coordination des acteurs de la filière autour de groupements de producteurs et de coopératives de produits bio, et un développement des circuits courts (type Amap) permettant de créer des débouchés pour des cultures diversifiées, et donc pour des petites quantités de produits non standardisés. Mais les initiatives de vente directe de la part d’exploitations familiales en maraîchage ou en élevage sont très récentes et le plus souvent le fruit d’initiatives individuelles. La restauration collective, qui permet souvent de faire le « pont » entre les mondes professionnels conventionnels et alternatifs ainsi qu’entre les agriculteurs et les autres habitants du territoire, peut servir de levier de structuration au niveau territorial pour un modèle agricole plus durable.
La transformation à grande échelle du modèle agricole nécessite cependant une impulsion nationale et européenne, en avalisant le fait que les enjeux sont aujourd’hui très différents de ceux qui ont présidé à l’élaboration de la PAC en 1962. Les États généraux de l’alimentation étaient une première occasion de changer la position française sur la PAC et d’utiliser la marge de manœuvre existante au niveau national. Mais ils n’ont pas été suffisamment structurés en ce sens. En effet y était d’abord discuté le rapport de force entre agriculteurs et grande distribution concernant le partage de la valeur ajoutée. C’est seulement ensuite qu’ont été débattues les questions relatives à la qualité de l’offre, la création de cette valeur ajoutée et son modèle. Il aurait pourtant d’abord fallu se concerter sur le modèle alimentaire aujourd’hui souhaité, avant de réfléchir au partage de sa valeur ajoutée. Car ces débats conditionnent en grande partie la levée des obstacles existants au développement de l’agriculture bio, qui sont surtout structurels et se déclinent ensuite en difficultés techniques et psychologiques.
b) Techniques
L’agriculture biologique est plus technique que l’agriculture conventionnelle. Là où l’agriculture conventionnelle a le plus souvent recours à des engrais ou des pesticides de synthèse pour augmenter la fertilité des sols et lutter contre les maladies et ravageurs, l’agriculture biologique nécessite de réfléchir globalement à son système agricole, d’avoir un grand sens de l’observation pour anticiper les aléas, de faire de la polyculture et d’utiliser les complémentarités qui existent naturellement dans le monde végétal et animal.
L’agriculture biologique n’est surtout pas un retour au passé ; c’est la redécouverte et la mise en œuvre de techniques oubliées avec les moyens d’aujourd’hui. Les moyens modernes sont essentiellement mécaniques (matériel de binage, de semis direct, herse étrille, utilisation du GPS…), voire génétiques (semences résistantes ou tolérantes à des maladies, plus rustiques, moins vulnérables à la sécheresse…). Ils concernent aussi des connaissances agro-écologiques (rotation et complémentarité des cultures, infrastructures agro-écologiques, couvert végétal, introduction de légumineuses, etc.) qui permettent en partie de compenser la perte de rendement par rapport au modèle conventionnel.
Les difficultés des agriculteurs qui se convertissent viennent souvent de leur manque de compétences techniques, de la trop forte attente qu’ils avaient à l’égard des « aides financières bio » (dont les grands retards de paiement fragilisent les exploitations), des espoirs excessifs qu’ils placent dans un positionnement prix élevé, que le consommateur/acheteur refuse parfois et qui devrait s’atténuer avec le développement de l’offre bio.
Pour passer de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture bio, il faut une forte motivation, une bonne technicité, ne pas « courir derrière les primes », s’efforcer de rester compétitifs en termes de prix (et/ou s’inscrire dans un autre modèle de distribution, par exemple en vente directe). Il faut accepter d’être raisonnable (ne pas « pousser » les cultures, les élevages et les sols au-delà de leurs limites, tenir compte du climat local…) et avoir recours à des pratiques agro-écologiques : rotation des cultures, mélange de céréales (méteil), développement des légumineuses et des protéagineux (afin de remplacer progressivement le soja importé), combinaison polyculture-élevage, valorisation du fumier, etc.
c) Psychologiques
Il existe aussi une difficulté psychologique à ne pas négliger dans le monde rural. L’agriculteur converti au bio est encore souvent considéré comme un marginal, voire comme un « soixante-huitard », et mis à l’index par son environnement dans les territoires les plus conservateurs. Ce type d’agriculture y est en effet souvent regardé comme un retour en arrière, à des pratiques jugées archaïques et contraires aux progrès scientifiques appliqués par les entreprises agrochimiques.
D’où l’obligation de considérer l’agriculture biologique comme issue d’un progrès en termes de connaissances et de pratiques, et non comme un retour au passé. L’agro-écologie est en effet une sous-discipline de l’agronomie, qui ne cesse de se développer, et sa généralisation est recommandée par un nombre croissant d’institutions (FAO, AFD, Cirad, Iddri, etc.).
S’ajoute à cela le fait que les pratiques agricoles de la communauté des agriculteurs bio sont une remise en cause de celles de l’agriculture conventionnelle. Cette remise en cause, assumée par les agriculteurs bio ou fantasmée par leurs collègues en conventionnel, crée des tensions entre les membres de la communauté.
2.2.3. Formation et accompagnement des agriculteurs
Parce que le passage à l’agriculture biologique est un choix technique difficile, des formations spécifiques et un accompagnement suivi sont souvent souhaitables, voire nécessaires ; ce qui n’est pas suffisamment le cas aujourd’hui.
Comme la vente directe à partir d’exploitations familiales de moins de 10 hectares n’était pas prévue dans l’organisation du modèle agricole français mis en place dans la seconde moitié du XX e siècle, les formations correspondantes sont restées confidentielles, voire longtemps inexistantes, mises à part quelques initiatives locales isolées. Les producteurs locaux sont donc insuffisamment formés aux questions agronomiques, mais aussi « aux questions de logistique, d’achats publics, de prix et de négociations commerciales [126] » induites par une insertion dans des circuits courts ou par la commande publique. Longtemps, la formation des agriculteurs (maisons familiales, enseignement agricole, Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles/CFPPA…) a participé ainsi à la perpétuation d’un système agricole intégré et verrouillé en ignorant les organisations alternatives.
Des progrès ont néanmoins été réalisés depuis 2008, année à partir de laquelle il est devenu obligatoire d’aborder le mode de production « Agriculture biologique » dans toutes les formations de l’enseignement agricole technique. Six ans plus tard, en 2014, un plan « Enseigner à produire autrement » a été lancé pour rénover les référentiels pédagogiques afin d’intégrer l’agro-écologie, de mobiliser les exploitations et ateliers des lycées professionnels, de renforcer la gouvernance régionale et de former le personnel éducatif pour lui donner les ressources nécessaires. CAP, bac pro, brevet et BTSA ont ainsi été réformés pour intégrer des modules sur l’agro-écologie ou l’agriculture bio. Le réseau d’établissements Formabio, créé en 1985, s’est renforcé, et des ressources pédagogiques ont été créées [127] . Désormais, la part des terres des exploitations agricoles de l’enseignement agricole public (19 000 ha) atteint 19 % en 2018, soit trois fois la proportion nationale. 125 exploitations (sur 190) de l’enseignement agricole public ont au moins un atelier bio (et une trentaine sont entièrement en bio) [128] .
Les enseignements dans les lycées agricoles évoluent donc depuis quelques années pour intégrer des modules en agriculture bio ou en agro-écologie. Mais le « socle de base de formation AB » n’est pas homogène dans tous les établissements, les modules sont souvent optionnels ou insuffisamment abordés par manque de temps [129] . Par ailleurs, le message d’ensemble que véhicule le système de formation ne s’en trouve pas radicalement modifié. L’agriculture bio est souvent enseignée comme une technique agricole parmi d’autres, ce qui réduit ainsi son potentiel critique, et donc sa capacité à remettre en cause l’organisation globale de l’agriculture conventionnelle [130] . Il en résulte que peu d’agriculteurs sortant du système de formation se tournent effectivement vers le bio, à la fois parce que cette solution n’est pas considérée comme économiquement viable, et parce que les histoires familiales et l’ambiance dans les campagnes enferment encore souvent l’agriculture dans une vision hyper productive. Enfin, si la formation initiale a bien intégré les enjeux de l’agriculture biologique, l’accompagnement de ceux qui veulent se convertir, des accédants à l’agriculture « hors cadre familial » et des professeurs eux-mêmes (qui se sentent insuffisamment formés pour enseigner ces nouveaux modules) reste un réel enjeu, notamment parce que les outils de formation professionnelle et continue sont encore assez peu développés et/ou peu connus.
Pour remédier à cette situation, davantage de plateformes d’échange pourraient être montées entre acteurs de la communauté éducative, car elles sont un vrai lieu d’apprentissage entre pairs. De même, les chambres d’agriculture pourraient jouer un rôle moteur, et l’enseignement agricole pourrait aider et former les jeunes agriculteurs à la fois à des pratiques de production respectueuses de l’environnement et aux enjeux et pratiques des nouveaux modes de commercialisation connus sous le nom de « circuits courts ». L’appui des Centre de gestion et d’économie rurale (CER), dont la présence se renforce et dont la compétence est reconnue, pourrait également aider les agriculteurs à la gestion à la fois de ces nouvelles exploitations et de ces nouveaux circuits de distribution, et leur apporter un appui juridique.
2.3. Ordre sur le marché : premiers et derniers servis
2.3.1. Positionnement de la grande distribution
La demande forte des Français pour les produits bio se traduit depuis plusieurs années par une croissance à deux chiffres du marché chaque année. Fin 2018, le marché des produits bio en France s’élevait à 9,3 milliards d’euros avec une croissance de 15 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est pour la deuxième année consécutive plus forte en grandes et moyennes surfaces qu’en magasins spécialisés bio (22 % vs 9 %). On pourrait donc imaginer que cet appel d’air préempte tous les produits bio disponibles au détriment de la restauration collective, d’autant plus que les distributeurs cherchent aussi des produits locaux (ou du moins français) car la demande des consommateurs est bien celle-ci en magasin également.
Cette croissance de la demande se traduit en effet par une forte tension sur l’offre bio. La grande distribution fait son maximum pour capter la production des agriculteurs passant en bio ; certaines enseignes incitent même les agriculteurs conventionnels à se convertir. Elles utilisent, pour ce faire, deux méthodes : le paiement aux agriculteurs d’un prix intermédiaire entre le prix conventionnel et le prix bio pour les exploitations en conversion, d’une part, et l’aide directe à la conversion, d’autre part.
Pour autant, la restauration collective ne part pas forcément perdante vis-à-vis des grandes enseignes. Elle peut utiliser les mêmes outils à condition de s’organiser pour le sourcing en ayant une connaissance plus précise des producteurs installés sur son territoire. Par ailleurs, la restauration collective a aussi l’avantage de pouvoir acheter des produits qui ne sont pas forcément recherchés par la grande distribution comme des fruits de petit calibre ou des produits en grand conditionnement. La grande distribution rencontre en effet des difficultés à mettre sur le marché certains fruits et légumes bio car ces produits sont moins homogènes et souvent plus fragiles. Inversement, elle a plus de facilité à commercialiser des produits bio transformés. Il n’y a donc pas forcément de concurrence directe sur tous les segments entre grandes surfaces et cantines scolaires.
2.3.2. Intérêt des circuits courts pour la restauration scolaire
Il ne faut pas négliger par ailleurs l’intérêt du marché de la restauration collective pour des producteurs ou des transformateurs locaux. Elle est en effet susceptible de leur assurer des débouchés complémentaires et de les libérer d’une dépendance trop étroite à la grande distribution. Elle peut également s’inscrire dans le cadre des « circuits courts » qui tendent à se développer ces dernières années et qui répondent à une attente forte des consommateurs : vente directe à la ferme, marché, Amap, Ruche qui dit Oui, boucheries partagées entre plusieurs éleveurs… Outre qu’ils permettent de limiter le nombre des intermédiaires, ces circuits valorisent le plus souvent les produits locaux et de saison.
En approvisionnant les cantines scolaires en bio ou en produits locaux et de saison, les producteurs maraîchers, éleveurs de volaille plein air, producteurs de fruits et de fromages pourraient former des groupements de producteurs bio et ainsi trouver un débouché rémunérateur, relativement stable et souvent complémentaire des autres circuits courts. Pour assurer une continuité de la demande pendant les vacances scolaires d’été (juillet-août), il faut bien sûr une structure de transformation et imaginer que les producteurs puissent livrer d’autres restaurants collectifs se substituant alors aux écoles primaires pendant ces périodes. Une cuisine centrale desservant non seulement le restaurant scolaire, mais aussi le restaurant du personnel, l’Ehpad ou encore l’hôpital local peut être une solution pour garantir un marché constant aux agriculteurs.
Les prix ne devraient pas impliquer un trop gros effort puisque l’approvisionnement ne passera pas par la centrale d’achat d’un groupement ou d’un industriel. Il ne représente par ailleurs qu’un petit tiers du coût d’un repas ; cela peut donc rester maîtrisable. D’autant plus que la plupart des collectivités qui ont introduit une part importante de produits frais locaux et de saison ont également réussi à réduire fortement le gaspillage alimentaire.
Il est communément admis que, pour inciter à la transformation du modèle agricole en faveur de l’agriculture biologique, il faut construire des relations commerciales durables avec les agriculteurs. C’est pourquoi les modèles de contractualisation longue doivent être privilégiés, c’est-à-dire des contrats d’une durée de minimum trois à six ans. L’objectif est à la fois de couvrir la période de transition (appelée période de conversion en agriculture biologique) mais aussi de permettre à l’agriculteur (et aussi aux transformateurs) de gérer les changements économiques (augmentation du coût de la main-d’œuvre et changement de clientèle, par exemple).
Comme l’ont mis en exergue les États généraux de l’alimentation en 2017, il est également important, d’une part, de prendre en compte l’ensemble des coûts de production réels qui pèsent sur les agriculteurs, et d’autre part, d’assurer la valorisation économique de la diversité des productions dans un modèle plus vertueux d’un point de vue environnemental. Le premier point est traité dans la première partie de la loi Egalim votée fin octobre 2018. Le second est moins connu. Il consiste à prendre en compte la diversité et les aléas de production dans un système reposant sur les principes de l’agro-écologie. En clair, il faut établir des contrats longs et intégrant une souplesse cohérente avec les spécificités de l’agriculture (aléas climatiques, diversification des cultures, etc.). La restauration collective n’a pas forcément l’habitude de mettre en œuvre ce type de contrat, mais des collectivités ont déjà réussi à tenir compte de ces aspects dans leurs marchés ; elles peuvent donc servir d’exemple.
Piloter la transition alimentaire grâce aux Projets alimentaires territoriaux (PAT) Un nombre croissant de territoires commencent à se poser la question de leur résilience en cas de crise. Sur le plan alimentaire, cela se traduit souvent par une volonté de relocaliser l’agriculture. Aujourd’hui, 80 % de la population vit dans des villes dont l’autonomie alimentaire n’excède pas en moyenne un à trois jours. S’il n’est pas possible d’atteindre une autonomie alimentaire complète dans la majorité des cas, de plus en plus de villes s’emparent néanmoins de cette problématique en élaborant leurs politiques alimentaires [131] . Cette tendance répond également à une aspiration grandissante des Français à une alimentation issue d’une agriculture durable et de proximité.Pour répondre à ces défis, la France a créé en 2014 un dispositif juridique et politique permettant de piloter la transition alimentaire à l’échelle territoriale. L’article 39 de la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (Laaf) de 2014 prévoit la mise en place de Projets alimentaires territoriaux (PAT). Ceux-ci doivent être « élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique ». Les parties prenantes doivent pour cela s’accorder sur « un diagnostic partagé de l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et [sur] la définition d’actions opérationnelles visant la réalisation du projet ». Cela implique un état des lieux de la production agricole locale et des besoins alimentaires exprimés (consommation individuelle et/ou de restauration collective). Ce projet vise à renforcer l’agriculture locale, le dynamisme des terroirs, la cohésion sociale et la santé des populations.La mise en œuvre d’un PAT se fait le plus souvent sous l’impulsion d’une collectivité territoriale qui s’entoure d’acteurs pertinents du territoire (groupements d’agriculteurs et de producteurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, de la distribution et de la commercialisation, organismes de développement et de recherche, etc). Ce plan alimentaire permet de structurer des Systèmes alimentaires territorialisés durables (SATD), élaborés à la fois par les acteurs du développement agricole, par des représentants de la société civile et des citoyens. Cette gouvernance partagée permet de mettre en adéquation l’offre et la demande alimentaires. Afin d’aider l’offre agricole à se structurer en filières (en bio notamment), il peut être nécessaire d’aider les agriculteurs à s’installer, de se concerter sur la nécessité de construire des lieux de transformation et de coordonner les différents maillons de la chaîne agroalimentaire à l’échelle locale. Un PAT permet également de coordonner des initiatives qui existent déjà mais qui sont souvent éparpillées.La restauration collective, en particulier publique et scolaire, constitue un débouché naturel pour ces projets [132] . Elle permet de sécuriser les débouchés d’agriculteurs installés ou accompagnés dans le cadre d’un PAT et ainsi d’inciter à la conversion en bio. La dimension éducative des PAT permet également aux usagers des cantines d’entrer en contact avec les producteurs via des visites à la ferme, l’installation de maraîchers à proximité des écoles, etc. Construire un PAT est particulièrement pertinent pour répondre aux difficultés de l’approvisionnement bio et local des cantines car celui-ci permet de coordonner différents acteurs afin de répondre aux contraintes de la restauration collective (menus élaborés strictement, régularité dans la livraison et volumes exigés).L’état des lieux requis par un PAT peut permettre d’identifier des cuisines sous-utilisées, des légumeries à réinvestir ou encore différents lieux de restauration collective qui représentent des débouchés complémentaires (par exemple des centres de vacances qui peuvent être approvisionnés pendant l’été à la place des cantines scolaires).De la même manière, la question du foncier agricole constitue souvent une grande difficulté pour une mairie qui voudrait aider des agriculteurs à s’installer en bio pour approvisionner ses cantines scolaires. On a vu que, à Mouans-Sartoux, le maire avait dû préempter 6 hectares de terres pour répondre à cette difficulté. C’est le cas dans une grande partie des villes qui cherchent à maîtriser davantage les flux alimentaires de leur territoire. La gestion du foncier se révèle décisive pour que des agriculteurs puissent s’installer en bio, et cette question est plus facile à résoudre dans le cadre d’un PAT. D’abord parce que sa rédaction et sa mise en œuvre nécessitent de se pencher sur les questions d’aménagement territorial et d’urbanisme. Il est en effet nécessaire de se baser sur des documents de planification existants (SCO, PLU), notamment pour identifier des friches qui pourraient devenir des terres agricoles et pour savoir si des mesures de protection des espaces agricoles sont prévues ou pourraient l’être [133] . Dans cette optique, la lutte contre l’artificialisation des terres [134] devient une priorité pour reterritorialiser l’agriculture. Ensuite, parce que les décisions prises en matière de foncier ne sont pas toujours consensuelles ; le cadre d’un PAT peut alors apaiser les débats puisque des concertations préalables auront été organisées et rendront plus légitimes les décisions politiques ultérieures. Des exemples locaux montrent qu’on peut utiliser le statut de ZAD (Zone d’aménagement différé) qui permet à une collectivité locale de disposer pendant six ans d’un droit de préemption sur toutes les ventes de biens immobiliers. Enfin, il existe des communautés de communes qui achètent du foncier puis font une convention avec la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) pour installer des maraîchers qui pourront ensuite racheter quelques années plus tard les terres à la commune, ce qui lui permettra d’acheter d’autres terres pour y installer d’autres maraîchers, etc. Cela permet d’installer de jeunes agriculteurs, en bio notamment, tout en maîtrisant les dépenses des communes en achat de foncier. Les communes peuvent également prendre contact avec l’association Terres de lien qui peut former les élus, apporter du conseil sur la maîtrise foncière, voire même faire des acquisitions conjointes [135] .Les PAT permettent donc de penser ensemble des secteurs souvent traités séparément (le développement agricole et économique, la santé, l’éducation, l’environnement, l’aménagement territorial, etc.), qui constituent chacun les facteurs clés d’une transition alimentaire. Enfin, élaborer un PAT permet de couvrir différentes dimensions territoriales de l’alimentation. Une dimension économique d’abord : un PAT fournit des outils pour la relocalisation et la structuration des filières alimentaires, pour l’accompagnement des agriculteurs, pour la mise en place d’une réflexion sur l’économie circulaire agricole, et pour la création d’emplois non délocalisables (l’agriculture biologique est plus intensive en main-d’œuvre que l’agriculture conventionnelle [136] ). Une dimension environnementale ensuite, puisque l’idée est de créer une dynamique pour le développement d’une production et d’une consommation de produits locaux et biologiques, et puisque la multiplication d’activités agricoles en bio peut faire revenir de la biodiversité près des villes et améliorer la qualité de l’eau. Une dimension sociale enfin, puisque cela permet de recréer du lien ville-campagne, de construire des activités pédagogiques pour les enfants comme pour les adultes, d’insérer des personnes sur le marché du travail via des activités de maraîchage [137] et d’offrir une alimentation de qualité à tous les enfants via l’approvisionnement des cantines scolaires. À ce titre, si l’agriculture urbaine ne peut naturellement pas suffire à assurer l’autonomie alimentaire d’une ville, son développement est particulièrement intéressant d’un point de vue social et environnemental [138] .Pour financer un PAT [139] , différents appels à projets existent, auxquels il faut candidater : appels à projets nationaux (ministère de l’Agriculture, de la Santé, de la Ville, de l’Environnement), régionaux (Ademe, Feader) et européens (Feder, FSE, EuSEF). Des fonds privés (mécénat, appels à projet de fondations, financement participatif, etc.) peuvent également être mobilisés.
2.4. Circuits courts et locaux : les contraintes juridiques
Faire le lien entre restauration scolaire et producteurs locaux présente donc a priori de nombreux avantages. Toutefois, les acteurs locaux ne sont pas toujours bien armés pour faire face à la complexité des règles présidant à l’organisation des marchés publics. C’est vrai des agriculteurs qui peinent parfois à surmonter la lourdeur et les contraintes juridiques des appels d’offres des collectivités : il est parfois plus facile de livrer 7 000 quintaux de blé tendre à une coopérative que 100 kg de tomates à une cantine ! Mais c’est vrai aussi de nombreuses collectivités à qui le code des marchés publics interdit de formuler une préférence géographique…
En effet, pour les achats de denrées alimentaires, comme pour tout achat direct, les structures publiques, et donc les collectivités, sont soumises à des procédures spécifiques, encadrées par le code des marchés publics. Pour assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, tout marché public doit respecter trois principes : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures [140] . Le respect de ces principes doit permettre aux structures publiques de mettre en concurrence sur un pied d’égalité les prestataires et fournisseurs potentiels afin d’obtenir le meilleur prix et de favoriser ainsi une bonne allocation des ressources publiques. En ce sens, l’attribution d’un marché public sur la base d’un critère de préférence locale, que ce soit sur l’origine des produits ou sur l’implantation des entreprises, est a priori contraire aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
Selon une enquête menée par l’Agence Bio, comme nous l’avons déjà signalé, le surcoût matière annoncé par les structures publiques qui ont commencé à introduire des produits bio dans leur offre de restauration collective est d’environ 18 %. Si ces structures cherchent en outre à s’approvisionner localement pour limiter l’impact environnemental des transports, pour épouser la saisonnalité des produits et pour stimuler le tissu productif régional de qualité, elles sont amenées à resserrer le périmètre de la mise en concurrence imposée par le code des marchés publics et, du même coup, elles s’exposent à des prix plus élevés. En effet, selon ces règles, l’expression d’une préférence géographique concernant le coût matière en denrées alimentaires pourrait s’apparenter à du favoritisme au détriment d’autres candidats potentiels ainsi qu’à une mauvaise allocation des finances publiques. En outre, le fait de favoriser des fournisseurs et prestataires locaux pourrait cacher des ententes, voire diverses formes de clientélisme. Ces règles de procédure complexes nécessitent donc de l’expérience pour être bien comprises, alors que les acheteurs publics manquent souvent de connaissance pour adapter le marché public à une réponse locale.
De même, pour les candidats souhaitant répondre à un appel d’offres, un dossier complet avec plusieurs pièces justificatives doit être fourni afin que l’acheteur public puisse procéder à la notation et au classement des offres en fonction des critères de sélection préalablement définis (ex. : prix, qualité de l’offre, approvisionnement, développement durable, etc.). Le prix est souvent le critère déterminant dans le choix de l’offre qui sera retenue, faute d’une réflexion et d’une stratégie d’élaboration du cahier des charges. D’autres critères peuvent entrer en compte, notamment qualitatifs, ou en termes de création d’emplois. La formulation complexe des appels d’offres est un facteur vraiment dissuasif pour les petits producteurs qui ne sont pas suffisamment structurés. En effet, répondre à un appel d’offres demande du temps et des connaissances, en particulier parce que la concurrence y est forte et que le producteur s’expose à des pénalités en cas de dysfonctionnement.
Néanmoins, la volonté de développer l’offre bio en restauration collective étant une démarche favorisant l’achat responsable, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a mis en place des outils pour la soutenir sans pour autant contourner le code des marchés publics. C’est notamment le cas de Localim [141] . Les fiches méthodologiques proposées dans cette boîte à outils prennent soin de rappeler la règle aux décideurs publics territoriaux : « Les spécifications techniques ne pouvant faire mention d’une provenance ou origine déterminée des produits, vous ne pouvez pas exiger dans votre cahier des charges que le lieu d’implantation d’un fournisseur soit situé dans une zone géographique identifiée. » Les textes relatifs aux marchés publics précisent toutefois qu’« une telle mention […] est possible si elle est justifiée par l’objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché public n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes “ou équivalent” » (article 8 du décret n° 2016–360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). De même, la plateforme Agrilocal [142] , d’abord mise en place dans un département puis rapidement adoptée par la moitié des départements français, permet aux acheteurs de trouver une liste de producteurs (qui se sont préalablement inscrits) correspondant à leurs critères et d’entrer en contact avec eux, tout en respectant le code des marchés publics et de manière totalement gratuite.
Il existe ainsi quelques marges de manœuvre raisonnables pour promouvoir les productions locales sans pour autant tomber dans l’arbitraire du favoritisme et biaiser excessivement les principes de la concurrence. On peut ainsi, en respectant le code des marchés publics, faire le lien entre une offre réelle du territoire et la demande de la collectivité pour l’approvisionnement de son service de restauration collective. Mais il faut pour cela avoir une bonne connaissance des ressources disponibles sur le territoire et être en mesure de décrire et de justifier précisément la qualité de ce que l’on recherche. Cela peut en particulier s’appuyer sur les Projets alimentaires territoriaux (PAT) définis dans la Loi d’avenir de l’agriculture de l’alimentation et la forêt de 2014 ( cf. supra encadré). En amont, ou même sans PAT, on peut également recourir à des stratégies plus indirectes. Ainsi, pour contrer l’impossibilité de mettre une clause de provenance locale dans le cahier des charges en gestion directe, la mairie d’une grande ville (Paris) a imposé le respect de la saison locale et régionale limitrophe pour 80 % des fruits et légumes. Dans le même esprit, la ville de Toulouse a organisé une rencontre entre acheteurs de la restauration collective de la métropole et acteurs capables de fournir des produits bio et locaux. Avec une démarche de « marché inversé », la métropole s’est mise à l’écoute des producteurs pour savoir ce qu’ils étaient en mesure d’offrir pour approvisionner les cantines scolaires. En parallèle, des acheteurs de la restauration collective ont fait part à une association de producteurs bio de leurs expériences en tant qu’acheteurs. Ces échanges ont permis à chacune des parties prenantes de comprendre les attentes et difficultés de l’autre partie, et de créer des partenariats de long terme, que ce soit pour adapter la rédaction d’appels d’offres appropriés pour des contrats de longue durée ou pour rédiger un PAT approprié par rapport au contexte agricole local.
Dans l’ensemble, on voit que le sourcing et l’allotissement des marchés sont les deux principaux leviers permettant de lancer des appels d’offres cohérents avec l’offre de produits de qualité de la région. Le sourcing (recommandé par l’Union européenne) consiste à identifier ce dont on a besoin et ce qui est fait et faisable sur son territoire, puis à ajuster sa demande et son cahier des charges en fonction. Il faut en somme passer des commandes réalistes par rapport à ce qui peut être produit sur son territoire et être à la fois précis sur le type d’aliments (s’agit-il de viande ou de yaourt bio par exemple ?) et en même temps flexible (en demandant un type d’aliments, par exemple des « fruits de saison », et non un fruit particulier). L’idée est d’associer le plus étroitement possible ce qui existe localement et ce qui est demandé par les convives ou recherché par la collectivité pour faciliter l’appariement de l’offre et de la demande locales. Certaines des grandes collectivités ont, dans ce domaine, une expertise et une expérience qui ont fait leurs preuves. On pense notamment à des métropoles comme Toulouse ou Paris. D’autres utilisent même des arguments auxquels ni les préfets ni les tribunaux administratifs n’ont jusqu’ici rien trouvé à redire comme, par exemple, l’argument du bien-être animal pour justifier le choix d’élevages proches (de manière à faire faire les trajets les plus courts aux animaux).
L’allotissement, de son côté, consiste à fractionner un marché en plusieurs sous-ensembles appelés « lots », lesquels peuvent ensuite être attribués séparément et donner lieu, chaque fois, à l’établissement d’un marché distinct. On peut ainsi faire valoir, pour chaque lot, des caractéristiques différentes. Ce fractionnement permet de mieux cibler une offre locale disponible dans un domaine alors que, dans un autre domaine, l’offre locale peut être moins disponible ou moins satisfaisante.
Pour les aider dans ces démarches qui peuvent être assez techniques et générer des lourdes procédures administratives, les collectivités territoriales concernées peuvent recourir à différents outils : Localim, dont nous avons déjà parlé, qui est destiné aux acheteurs publics de la restauration collective en gestion directe pour accompagner le développement de l’approvisionnement local, durable et de qualité ; les outils du CNFPT (cahier des charges type marchés publics, logiciel EMApp) en libre accès en ligne sur l’e-communauté « Alimentation et restauration » (on y trouvera des outils d’aide sur marché public, gaspillage alimentaire et formations pour une restauration scolaire durable) ; les Guides DAJ (guide « achat public : une réponse aux enjeux climatiques », guide pratique de l’achat public innovant) et DAE (guide sur le sourcing opérationnel).
Malgré ces outils, il est certain que de grandes inégalités règnent entre les collectivités concernées. Les plus grandes ont souvent les moyens, pourvu qu’elles en aient la volonté, de développer une fine connaissance du tissu productif local, de formuler précisément leurs besoins et leurs attentes, et de déployer des stratégies d’allotissement adaptées à une stratégie d’achat responsable. Les plus petites, inversement, peuvent se passer de ces stratégies car le niveau de leurs achats est tellement bas qu’elles échappent aux règles des marchés publics. Mais, entre les deux, un grand nombre de communes modestes sont le plus souvent contraintes de renoncer à la gestion directe et de contracter avec un prestataire privé pour tout ou partie de leur service de restauration collective. Dans ce cas, beaucoup dépend de leur capacité à établir un cahier des charges précis avec le prestataire concerné et surtout à en suivre rigoureusement l’exécution… Si le prestataire privé agissant dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) n’est pas formellement soumis lui-même au code des marchés publics, c’est tout de même à lui qu’il reviendra d’utiliser les ressources du territoire et, pour cela, de les analyser, voire de les stimuler.
3. Les marges de manœuvre du donneur d’ordre
En dépit de sa vocation sociale et éducative, le service de restauration scolaire des écoles primaires constitue toujours, comme on l’a vu précédemment, un service public facultatif. À la différence des dépenses liées au bâti scolaire ou au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires qui sont obligatoires, les dépenses relatives à la restauration scolaire ne sont pas une obligation pour les communes. Ce caractère non obligatoire n’offre aux usagers aucun droit d’en réclamer la création ou le maintien.
L’organisation et la gestion de ce service public sont également laissées à la libre initiative des communes. Ainsi, elles définissent les règles d’organisation de celui-ci et disposent d’une liberté d’appréciation pour choisir le mode de gestion qui leur paraît le plus approprié. Elles peuvent soit assurer directement la gestion des cantines scolaires, soit déléguer la compétence à une personne ou une entreprise, du moins pour la partie qui concerne la confection et la distribution des repas. Elles ne peuvent cependant pas déléguer la surveillance des élèves, cette tâche leur incombant en propre. Le tiers à qui la confection et/ou la distribution des repas peuvent être déléguées n’est pas nécessairement un tiers de droit privé. Il peut également s’agir d’un établissement public local qu’elles auront créé, à l’image des caisses des écoles, ou encore d’un transfert de compétence vers l’intercommunalité.
Les chiffres clés de la restauration collective [143] ▪ 1 restaurant collectif sur 3 est géré par une société de restauration collective dans le cadre d’une gestion concédée. Cela signifie que la préparation et le service des repas sont confiés à une société de restauration collective.▪ 21 500 restaurants sont en gestion concédée dans toute la France.▪ 3,8 millions de repas sont servis en moyenne chaque jour par des sociétés de restauration collective.▪ 94 000 collaborateurs travaillent dans la branche restauration collective concédée dont 75 000 collaborateurs dans les Sociétés de restauration collective (SRC) et dont 93 % sont en CDI.▪ 500 000 heures de formation sont dispensées chaque année.
3.1. Disparités d’expertise et de marges de manœuvre entre petites et grandes communes
Toutes les communes ne disposent pas des moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la prise en charge d’un service public aussi complexe que celui qui nous occupe. Sur l’emploi par exemple, en 2016 [144] , 5 073 collectivités locales ne disposaient d’aucun agent, 18 389 disposaient de moins de 4 agents et 8 141 disposaient d’entre 5 et 9 agents. Au total, 31 603 collectivités locales sur les 47 306 recensées par l’Insee (soir 69 % d’entre elles) disposent de moins de 9 ETP [145] pour assurer leurs missions.
Dans ces conditions, l’organisation en propre par la collectivité du service public de restauration est quasiment impossible pour de nombreuses communes. Si les élus locaux font le choix d’offrir ce service à leur administrés, l’unique solution reste de ne pas gérer eux-mêmes celui-ci, soit en le transférant à l’intercommunalité, soit en déléguant la compétence à un organisme privé.
La concession de ce service public n’exonère par ailleurs pas la collectivité de ses obligations de surveillance et lui ajoute même une nouvelle charge : le suivi du contrat de délégation et du respect des clauses établies avec le prestataire ( cf. infra ).
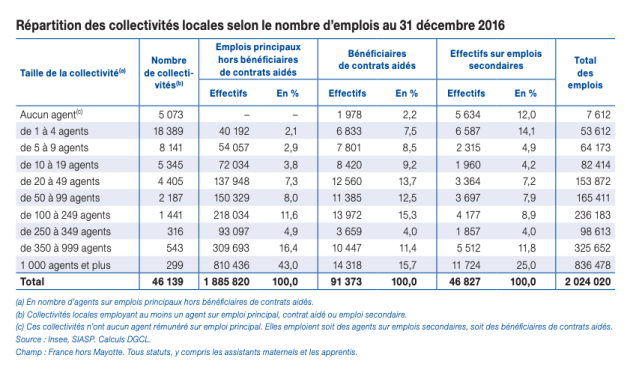
Par ailleurs, si la collectivité concernée souhaite privilégier un approvisionnement local, la localisation géographique de la commune joue à plein. Dans les zones montagneuses mais aussi pour certaines communes insulaires, cette question est souvent rendue très complexe. Néanmoins, les collectivités de taille modeste disposent d’un avantage sur leurs homologues de plus grande taille : le faible nombre de repas servis par jour leur donne une plus grande marge de manœuvre et peut même leur permettre d’échapper aux règles des marchés publics, et ainsi de privilégier des producteurs locaux [146] .
3.2. Quel modèle choisir ?
On dispose de peu de statistiques sur les modes de gestion utilisés par les communes pour la restauration scolaire. Une enquête de 2017 de l’association des maires et présidents de communautés des Pyrénées-Atlantiques (ADM64) s’est attachée à recenser les modes de gestion [147] . Elle met en exergue une égale partition entre les communes ayant choisi un mode de gestion public (gestion directe, CCAS, intercommunalité, collège de secteur) et celles qui ont opté pour un mode de gestion privé (association, établissement scolaire privé, cuisine centrale privée, traiteur ou restaurant).
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, d’après le recensement de l’ADM64, les cantines en régie publique entraînent moins de transport des repas (60 % des repas sont confectionnés et consommés sur place) que les cuisines desservies par un organisme privé (9,6 %). Cette enquête souligne également que le coût moyen de confection des repas est plus important si la collectivité́ fait appel à un prestataire (public ou privé). Ce coût moyen [148] pour une cuisine en régie est en effet de 5,58 € contre 5,99 € (+ 7 %) pour des repas confectionnés par un prestataire public ou privé. Le crédit nourriture moyen de l’assiette (l’ensemble des achats de denrées alimentaires sur le nombre de convives d’une année) est également moins important dans le cas des cuisines en régie directe. Il s’établit en moyenne à 1,79 € contre 2,97 € pour les cuisines gérées ou desservies par un prestataire public ou privé.
Outre ces avantages économiques apparents, la gestion directe offre à la collectivité la possibilité de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de production, lui permettant ainsi une meilleure transparence vis-à-vis de ses usagers. Néanmoins, comme nous le notions plus haut, un nombre conséquent de collectivités locales ne disposent pas des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de ce service public par leurs soins.

3.2.1. Gestion directe, gestion concédée, régie publique : comment s’y retrouver ?
a) La gestion directe
Dans le cas de la gestion directe, c’est l’établissement ou la collectivité qui gère la restauration, les équipes, les achats et l’élaboration des repas, parfois par l’intermédiaire d’une régie publique (un établissement public en charge de la gestion du service). On utilise bien souvent l’expression « régie publique » indifféremment selon que la collectivité gère le service elle-même ou qu’elle en a confié la compétence à un établissement public, par exemple une caisse des écoles.
b) Régie publique
Un service public est géré en régie lorsque la collectivité le gère elle-même avec ses propres moyens financiers et matériels, et ses propres agents, mais avec une comptabilité propre et la possibilité de procéder à des emplois de droit privé. La régie n’a donc normalement aucune personnalité juridique. Lorsqu’une commune gère un service public en régie, cela signifie que le service compétent pour mener à bien l’activité emprunte la personnalité de la commune et que les moyens en matériel et en personnel sont ceux de la commune. Cette régie est également dépourvue d’autonomie financière. Elle ne gère pas de recettes propres, et les dépenses engagées ne sont pas distinctes du reste des dépenses de la collectivité. Il existe des régies dites autonomes ou indirectes : le service dispose alors d’une certaine autonomie budgétaire mais c’est toujours la collectivité qui est responsable.
c) La gestion concédée ou déléguée à un prestataire
Dans ce cas, un prestataire (entreprise privée, association, établissement scolaire privé, restaurateur, Ehpad…) assure la restauration, gère les équipes et l’approvisionnement. Ce prestataire peut être public ou privé. On parlera de gestion déléguée en cas de prestataire privé, de gestion concédée en cas de partenaire public. Trois modalités de fonctionnement sont alors possibles : 1) cuisines sur place ou cuisines autonomes (voir ci-après), 2) cuisines centrales (voir ci-après), 3) restaurants satellites (il s’agit d’« établissements ou locaux aménagés desservis par une cuisine centrale » qui peuvent fabriquer certaines fractions de repas sur place).
3.2.2. Cuisine autonome ou cuisine centrale, comprendre la différence
Également appelées cuisines de préparation sur place, elles sont, dans leur fonctionnement, proches de la cuisine familiale. Les repas sont confectionnés et consommés sur place. C’est un mode d’organisation encore utilisé par un certain nombre d’écoles maternelles et primaires.
Le faible nombre de repas, la commande en plus petites quantités et le ratio investissements et main-d’œuvre vs nombre de repas servis contribuent souvent à un coût d’exploitation plus élevé, mais le contrôle sur le choix des fournisseurs et la qualité des produits utilisés est direct.
Ce mode de production a également l’avantage d’être local, favorisant le contact entre le personnel et les usagers (en l’occurrence, les enfants). Il permet également d’éviter un certain nombre de contraintes comme le transport des repas entre le point de production et le lieu de consommation ou la remise ou maintien en température des plats.
Comme son nom l’indique, la cuisine centrale dessert, elle, plusieurs lieux de service aux usagers. La fabrication des repas est centralisée. Ceux-ci sont ensuite livrés dans les sites de consommation. Cette livraison peut se faire en liaison chaude ou froide ( cf.infra ).
Ce système centralisé permet des économies d’échelle sur les charges de personnels et sur les investissements en équipement qui permettent de diminuer le coût unitaire de préparation d’un repas.
Les sites locaux, même s’ils ne servent pas à transformer des aliments, doivent être déclarés au même titre que la cuisine centrale et satisfaire les mêmes règles d’hygiène et de propreté. Néanmoins, l’arrivée sur site de produits déjà prêts en conditionnés diminue les investissements matériels et bâtis à consentir. Les municipalités doivent cependant prévoir des zones spécialisées pour : la préparation et le dressage ; la réception et le stockage ; le lavage (vaisselle et conteneurs de transport).
Comme précisé plus haut, la cuisine centrale et ses sites locaux sont éloignés dans l’espace, parfois d’une distance conséquente. Les textes officiels autorisent un délai de liaison de quatre jours (y compris le jour de production). Toutefois, si une analyse des risques a été réalisée, l’établissement peut bénéficier d’un délai supplémentaire.
3.2.3. Liaison chaude et liaison froide
En liaison chaude, les préparations culinaires sont maintenues à une température supérieure ou égale à 63 °C, sans rupture thermique, et transportées en conteneurs isothermes ou chauffants jusqu’au lieu de distribution. Les repas sont destinés à la consommation immédiate. Le satellite (l’école) en liaison chaude reçoit les éléments de la cuisine centrale et les distribue sans délai. La liaison chaude permet uniquement de déplacer la distribution dans l’espace (le jour de consommation correspond au jour de production).
En liaison froide, la production est réalisée en cuisine centrale, où les denrées sont préparées et cuites, puis réfrigérées (jusqu’à + 10 °C en moins de deux heures). Les plats sont acheminés ensuite en camion réfrigéré ou en containers isothermes. La consommation s’effectue dans les sites locaux, où les denrées sont d’abord stockées en chambre froide entre 0 °C et + 3 °C, puis remises à température (63 °C en moins d’une heure).
On notera qu’il existe des restaurants scolaires qui fonctionnent en « liaison froide avec cuisson courte et finition » fonctionnant ainsi de façon mixte : à la fois en liaison froide et en cuisine sur place pour les denrées nécessitant cuissons courtes et finitions.
La liaison froide permet de déplacer la distribution dans l’espace et de la différer dans le temps (le jour de consommation correspond au jour de production + 3 jours maximum).
Au cours de nos échanges avec un grand nombre d’acteurs, il ne nous a pas été possible de dégager une position de principe sur ce sujet. À vrai dire, le bon choix dépend beaucoup de la situation des communes, de leur taille, de leur expertise et de leur projet. L’intuition suggère certes que le modèle gestion directe/cuisine autonome permet une plus grande transparence, économise des coûts d’intermédiation, favorise une préparation de qualité, un contact entre les personnels et les usagers, un mode de production local et le pilotage d’une transition alimentaire locale avec toutes les externalités positives que cela génère ( cf. supra encadré sur les Projets alimentaires territoriaux). Mais la réalité peut être assez différente. Une petite commune aura souvent plus de difficultés à pratiquer la gestion directe. Non seulement sa capacité de négociation avec les fournisseurs risque d’être relativement faible, mais elle peinera sans doute à mobiliser les compétences et ressources nécessaires pour bien connaître le tissu des producteurs autour d’elle (sourcing) et pratiquer des achats éclairés et pleinement responsables. Dans ce cas, la gestion déléguée paraît préférable. En outre, l’expérience prouve que certaines délégations de service public en la matière fonctionnent plutôt bien. À condition toutefois que les responsables publics soient capables d’élaborer un cahier des charges précis avec le prestataire et d’en suivre rigoureusement la mise en œuvre, ce qui n’est pas toujours simple ( cf. infra partie 3.3.). De la même façon, le recours à une cuisine centrale lui permettra de profiter d’économies d’échelle sur les coûts de personnels et d’équipements, même si sa situation géographique la contraindra peut-être au choix d’une liaison froide.
Inversement, une commune plus importante peut envisager plus facilement la gestion directe et le développement de cuisines autonomes dans les établissements concernés. Mais elle doit alors avoir une gestion avisée de ses achats et des marchés publics correspondants, ce qui est loin d’être simple, surtout si, comme il est souhaitable, elle veut augmenter la part de produits bio dans les assiettes des enfants et favoriser l’achat local. Pour l’y aider, l’outil Agrilocal a été élaboré : il permet de visualiser en ligne les producteurs présents sur son territoire et d’entrer facilement en contact avec eux, tout en respectant le code des marchés publics.
S’il n’y a pas de modèle idéal qui pourrait s’imposer à tous en toutes circonstances, il est apparu évident, en revanche, que, quelle que soit l’organisation retenue, les communes et donneurs d’ordre territoriaux doivent monter en compétence et en expertise sur ces questions. La gestion directe comme la DSP nécessite en effet des ressources de temps et de qualifications. En gestion directe, la commune devra réaliser un état des lieux de l’offre agricole sur son territoire si elle veut acheter local (dans le respect du code des marchés publics, cf. supra partie 2.4.). Elle devra également rédiger et gérer les appels d’offres et l’allotissement des marchés. Elle devra aussi veiller elle-même à la qualité nutritionnelle, sanitaire et environnementale des repas servis… En DSP, inversement, elle devra prendre le temps d’identifier le bon prestataire compte tenu de ses besoins et exigences (la meilleure offre n’est pas nécessairement la moins chère…), de construire un cahier des charges précis avec lui, d’en suivre attentivement l’exécution sans se limiter au contrôle des coûts et de veiller à appliquer les pénalités en cas de manquement. Le cahier des charges est donc décisif.
Bref, aucune formule ne saurait dispenser le responsable public de mobiliser de l’expertise, du temps et des compétences pour investir réellement ces enjeux. Pour les communes les plus démunies face à ces exigences, il existe certes des cabinets de conseil. Mais il peut être plus pertinent et moins onéreux de mutualiser ces moyens au niveau de l’intercommunalité. Les économies d’échelle qui peuvent être réalisées à ce niveau sont significatives et permettraient de partager, par exemple, les services d’un nutritionniste ou de rémunérer un agent dédié à ces sujets. Comme nous l’a suggéré une grande entreprise de restauration collective, il peut y avoir un intérêt à la fois pour les communes et pour le(s) prestataire(s) à ce que le cahier des charges lui-même soit élaboré par plusieurs communes, ou au moins sur la base d’un référentiel commun, afin d’augmenter l’efficience et de réduire le gaspillage, ce qui permettrait notamment de financer les surcoûts induits par une demande croissante de qualité.
3.3. Négociation, rapports de force, élaboration et suivi du cahier des charges avec les industriels
Comme nous l’avons vu précédemment, le code des marchés publics implique de nombreuses contraintes pour l’approvisionnement local et en circuit court, et nécessite donc une bonne connaissance à la fois des règles en vigueur et de l’offre agricole présente sur son territoire ( cf. supra 2.1.4.).
Dans cet environnement complexe, les grands industriels de la restauration collective sont beaucoup mieux organisés et structurés pour pouvoir répondre aux appels d’offres que les agriculteurs locaux. Leur rôle d’intermédiaire avec les producteurs leur permet de répondre aux demandes de produits locaux et biologiques sans tomber sous le coup des obligations du code des marchés publics. Leur taille leur permet ainsi de proposer une part de bio et de local dans une offre globale, quand les producteurs locaux ne peuvent souvent répondre qu’à des segments de la commande publique.
Le critère du prix étant prépondérant dans la sélection des offres, ils répondent souvent en proposant des aliments à un tarif compétitif mais de moins bonne qualité nutritionnelle. Leur dossier technique est complet et très bien rédigé par rapport aux offres remises par les petits producteurs. Ils disposent de préparations dont la qualité nutritionnelle respecte les recommandations publiques mais dont la composition nutritionnelle se situe souvent à la limite des seuils critiques. Par exemple, beaucoup de fromages sont enrichis en sels de calcium (dont l’assimilation est controversée) ; certaines préparations riches en lipides ne dépassent jamais le seuil des 15 g de lipides pour 100 g mais ont des teneurs proches de cette limite ; certains desserts contiennent plus de 19 g de sucre par portion, sans jamais dépasser les 20 g…
Dans ce contexte, il peut être tentant de préférer la gestion directe, voire d’internaliser une grande partie de la chaîne de valeur en favorisant l’auto-production. C’est le choix qu’a fait la commune de Mouans-Sartoux, qui est passée à 100 % de repas bio pour sa restauration scolaire sans augmenter le coût des repas : afin de mieux sélectionner les denrées alimentaires et pour faciliter son approvisionnement, elle a en effet opté pour une régie agricole intégrée pour la production de ses légumes.
Toutes les communes ne peuvent sans doute pas faire de même. Mais, dans le cas où l’on opte pour une gestion déléguée à un prestataire privé, la réalisation du cahier des charges revêt une importance majeure pour s’assurer de la qualité nutritionnelle des repas proposés.
La politique nutritionnelle doit en effet être définie en amont par les élus de chaque commune, et l’élaboration des cahiers des charges être réalisée par le service des marchés publics selon les directives des politiques, les besoins de la collectivité et les dispositions réglementaires. Certaines communes s’appuient sur les compétences d’un expert en restauration collective et/ou en nutrition pour la rédaction des cahiers des charges. Mais ce n’est en aucun cas une obligation.
La forte disparité de qualité et de tarifs entre les différents contrats existants suggère pourtant que des marges de manœuvre et une grande diversité de modèles existent, et qu’il vaut la peine d’y consacrer du temps et des compétences. Mais cette diversité d’attentes, de demandes et de préférences a également des conséquences plus ou moins défavorables, comme le souligne le responsable d’un grand groupe de restauration collective : les économies d’échelle sont plus difficiles à réaliser quand les cahiers des charges diffèrent fortement d’une commune à l’autre au sein d’une même agglomération ou intercommunalité, et la diversité des menus demandés peut accroître les difficultés d’approvisionnement, de production et entraîner du gaspillage alimentaire. C’est pourquoi, comme on l’a déjà suggéré, il peut être utile de construire un référentiel commun à plusieurs communes (éventuellement au niveau de l’intercommunalité), de manière à mieux conjuguer la recherche du meilleur prix avec la quête d’une bonne qualité nutritionnelle. En outre, ces rapprochements entre communes sont l’occasion pour les unes de s’informer sur les stratégies et le degré de satisfaction des autres et de mettre en commun des expériences et des apprentissages. Si une commune ne dispose pas d’une cuisine autonome, cela peut aussi être l’occasion pour elle de se renseigner sur l’existence d’une autre cuisine centrale dans le périmètre des communes voisines, de manière à faciliter le travail du futur prestataire et à pouvoir exiger de lui des tarifs plus intéressants. Ces rapprochements peuvent également être l’occasion de mutualiser les personnels compétents pour le suivi du contrat mais aussi des investissements plus lourds. Bref, avant même de s’engager dans une négociation avec un prestataire, il peut être utile de regarder autour de soi et de discuter avec ses voisins. Le cahier des charges final n’en sera que mieux conçu.
La durée des contrats mis en place peut également être un levier important. Quand elle est trop courte, elle ne favorise pas les investissements pour le prestataire ni le passage de contrats sécurisants pour les agriculteurs locaux qui pourraient être contactés pour répondre aux besoins en approvisionnement local et biologique. Inversement, des contrats plus longs créent un intérêt plus grand pour le prestataire à rechercher les meilleures solutions et lui donnent une visibilité lui permettant de s’investir davantage dans le sourcing des producteurs les plus adaptés. C’est ce qu’a fait la commune de Carrières-sur-Seine dans la région parisienne : après un contrat de courte durée (un an), elle s’est engagée dans une durée plus longue, permettant de construire une relation de service plus performante avec son prestataire.
Le suivi de la prestation réalisée est une autre condition de succès. Quand il n’est pas assuré, la qualité nutritionnelle et organoleptique [149] des menus proposés peut rapidement se détériorer. C’est pourquoi il importe d’y allouer des moyens humains, de prévoir dans le contrat des pénalités en cas de retard, de changement de menu inopiné ou de manquement quelconque aux termes de l’accord, et de les appliquer dès que la situation le permet.
Pour qu’elle se passe bien, une délégation nécessite au final un véritable investissement de la collectivité, dans le suivi contractuel mais aussi dans le dialogue en amont du contrat, puis au quotidien à la fois avec le prestataire et avec les usagers. La place accordée à ces derniers peut s’avérer décisive. Une élaboration collaborative des objectifs poursuivis permet de mieux intégrer les familles et de se prémunir contre les critiques quant à la qualité des repas servis. C’est ce qu’ont bien compris les responsables de Carrières-sur-Seine, qui ont choisi de construire le cahier des charges avec les parents d’élèves et l’ont ensuite négocié très précisément avec un prestataire privé (qui leur livre un repas bio par mois, du label rouge, du pain bio, beaucoup de « fait maison » et du poisson frais).
3.4. Équilibres budgétaires et gaspillage
Le gaspillage alimentaire se définit comme « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, dégradée [150] ». Parce qu’il comporte d’importants enjeux environnementaux, économiques, éducatifs et sanitaires, la lutte contre ce phénomène nous concerne tous. A fortiori quand il atteint les proportions que nous lui connaissons aujourd’hui : en France, le gaspillage alimentaire représente en effet 20 kg de nourriture par an et par Français (Ademe, 2017).
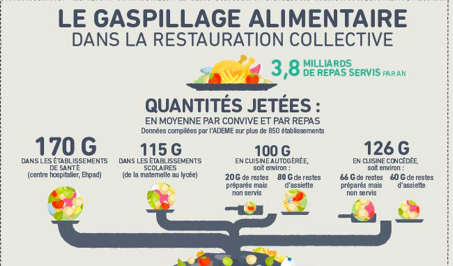
Source : Ademe [151]
3,8 milliards de repas sont servis chaque année dans les restaurants collectifs français. Si on prend en compte les plats qui n’ont pas été consommés, ceux produits en trop grande quantité ou ceux écartés de la phase de production, le gaspillage alimentaire se situe le plus souvent entre 150 g et 200 g par personne et par repas ; soit entre 570 000 tonnes et 760 000 tonnes de nourriture jetées chaque année dans la restauration collective [152] . Dans la restauration scolaire, il atteint 115 g par repas.
Les quantités perdues se concentrent en particulier sur deux catégories d’aliment : les légumes (39 % des pertes) et les viande/poisson/œuf (21 %). Le pain est également souvent gaspillé, notamment lorsqu’il est servi à volonté ou en libre-service.
En restauration collective, le gaspillage alimentaire se réalise à différentes étapes [153] . D’abord en cuisine, au niveau des menus (menu mal adapté aux convives), de la commande (surestimation des quantités achetées), des stocks (erreur de manipulation ou de stockage, gestion non planifiée), de la préparation (surévaluation des quantités cuisinées) et de la gestion des restes (surplus non réutilisés). Ensuite, lors du service avec des portions mal adaptées à la faim des enfants, et en raison d’un manque d’accompagnement des convives pour goûter les différents aliments proposés. Enfin, en bout de chaîne, en raison de consommateurs « difficiles » n’appréciant pas certains plats, manquant de temps ou ne se trouvant pas dans un cadre propice au plaisir de manger.
Plusieurs textes imposent cependant une meilleure gestion du gaspillage alimentaire. L’article L.244–21–1 du code de l’environnement stipule ainsi que « les personnes qui produisent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol ». La restauration collective est donc concernée. L’Ademe doit d’ailleurs remettre un rapport au Parlement avant le 1 er janvier 2022 pour proposer une meilleure gestion du gaspillage dans la restauration collective et dans la grande distribution. Par ailleurs, aux termes de la loi Egalim, les opérateurs de la restauration collective devraient se voir imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable. Certains d’entre eux devront rendre publics leurs engagements sur ce sujet, notamment les procédures de contrôle interne engagées. En outre, l’obligation du don des excédents aux associations va être appliquée à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire, selon des modalités qui tiendront compte des expérimentations menées par les associations volontaires.
S’il est très important de pouvoir donner une seconde vie aux biodéchets (via des dons aux associations ou via du compost qui pourrait ensuite être donné aux agriculteurs locaux), le meilleur déchet reste néanmoins celui qui n’est pas produit. Cela nécessite de revoir les quantités cuisinées et servies aux convives. À cet égard, les recommandations du GEM-RCN ont souvent été incriminées, car les grammages conseillés sont souvent appliqués « à la lettre » et induisent beaucoup de gaspillage. En effet, le GEM-RCN propose uniquement deux grammages différents pour les enfants en primaire (un grammage spécifique « maternelle » de 3 ans à 6 ans et un grammage « élémentaire » de 6 ans à 11 ans). Certains aliments piécés sont difficiles à trouver au grammage recommandé (steak haché, poisson pané, etc., en 50 g) et sont beaucoup plus chers à l’achat ; ils sont donc souvent proposés aux enfants avec des grammages supérieurs. Les grammages sont par ailleurs identiques pour les menus à 4 ou à 5 composantes. Les menus à 4 composantes sont donc souvent privilégiés, en dépit du fait qu’ils favorisent une offre alimentaire moins diversifiée. Et quand un menu à 5 composantes est servi, c’est une grande source de gaspillage. Enfin, les fruits sont souvent proposés « entiers » alors qu’ils sont rarement consommés en intégralité. Dans le cas des gestions déléguées, les indications de grammage du GEM-RCN sont très souvent notées de façon stricte lors de la rédaction des contrats avec les prestataires de fabrication des repas. Or la taille des portions est souvent trop élevée et induit beaucoup de gaspillage alimentaire.
Le coût du gaspillage alimentaire ne se limite pas à la valeur des denrées non consommées. Il faut aussi tenir compte du coût des transports des aliments, de leur stockage, de leur préparation et de la gestion des déchets. L’Ademe a ainsi estimé que le coût du gaspillage moyen pour les écoles qui est de 0,27 €/repas pourrait être diminué de 28 % (passant alors à 0,19 €/repas) après des actions de sensibilisation. La maîtrise du gaspillage alimentaire permettrait de faire des économies budgétaires importantes, lesquelles pourraient être ensuite réinvesties dans l’achat de denrées de meilleure qualité et dans des quantités mieux ajustées. D’après ses estimations, le coût du gaspillage alimentaire pourrait passer de 10 000 € à 8 000 € pour un établissement moyen de 365 élèves. L’Ademe en conclut que, pour 1 € investi dans des actions de sensibilisation au gaspillage, 2 € peuvent être économisés [154] .
Les initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire Le gaspillage alimentaire en restauration collective n’est pas une fatalité ! Beaucoup de collectivités aujourd’hui sont engagées dans des démarches actives de lutte contre les excédents alimentaires afin d’être en conformité avec la Loi de transition énergétique pour la croissance verte qui stipule : « L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1 er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. »Les initiatives en la matière sont nombreuses. En 2014, par exemple, 70 établissements scolaires de Basse-Normandie ont mené des actions pilotes de sensibilisation avec de très bons résultats puisque les restes dans les assiettes des enfants ont diminué de plus de la moitié (de 150 g à 70 g par personne et par repas) [155] .À Mouans-Sartoux, depuis 2010, les restes dans les assiettes des enfants sont pesés tous les jours, et la quantité servie de chaque préparation est ajustée en fonction de son appréciation gustative. Les enfants peuvent choisir entre des portions de différentes tailles selon leur appétit et leur envie : petite, moyenne ou grande. Les fruits sont coupés en quartiers pour limiter les pertes, et les enfants peuvent se resservir à volonté. Des actions pertinentes et efficaces puisque les restes alimentaires sont aujourd’hui évalués à Mouans-Sartoux à 30 g par enfant et par repas alors que la moyenne nationale pour les primaires est d’environ de 70 g [156] . À Carrières-sur-Seine, il existe une table de troc où les enfants peuvent déposer ce qu’ils n’ont pas mangé et où d’autres peuvent venir se resservir. Les restes de pain sont conservés, et un atelier cuisine est organisé tous les mercredis pour les transformer en « gâteaux » ou tranches de pain perdu.Avec la loi Egalim, la réduction du gaspillage alimentaire est devenue un enjeu majeur pour beaucoup de collectivités, qui comptent sur les économies réalisées pour améliorer sensiblement la qualité des repas proposés (augmentation de la part du bio, des produits locaux, des denrées sous labels de qualité, etc.).
4. Relation aux usagers : tarification et organisation du service
La transition alimentaire dans la restauration scolaire doit veiller à ne pas discriminer entre les populations. C’est un enjeu de justice, bien sûr, mais aussi d’efficacité à grande échelle : si nous voulons en tirer tous les bénéfices sanitaires et environnementaux, cette transition doit « embarquer » le plus grand nombre, y compris, et peut-être même d’abord, les plus vulnérables. Cette ambition appelle en particulier une grande vigilance sur les tarifs de la restauration scolaire et la maîtrise des coûts pour les familles, afin que tous les enfants puissent bénéficier de la meilleure qualité des repas servis. Elle appelle également une meilleure organisation du service : il faut en augmenter la qualité et améliorer les conditions de la pause méridienne pour favoriser la participation active à l’effort de transition non seulement des enfants eux-mêmes mais aussi des agents qui les servent et sont encore souvent peu ou mal considérés. Enfants et agents de la restauration sont au quotidien les véritables acteurs de la transition alimentaire dans les cantines.
4.1. Un service public à vocation sociale qui se heurte à de nombreuses inégalités
Aucune enquête n’a jusqu’à présent pu présenter un panel exhaustif des pratiques tarifaires de l’ensemble des communes françaises en matière de restauration scolaire. L’enquête la plus complète et la plus récente reste celle menée par le journal Sud Ouest [157] en décembre 2017 sur 168 communes de la région. C’est de cette enquête que sont tirés les chiffres cités ci-après.
4.1.1. Tarification sociale et gratuité
Jusqu’en 2006 [158] , les tarifs de la restauration scolaire étaient encadrés [159] . Depuis 2006, il appartient aux collectivités territoriales de fixer librement leurs tarifs. Du point de vue des communes, la tarification est donc une question qui a « à peine » treize ans mais qui a déjà fait l’objet de nombreuses expérimentations locales.
Pour fixer les prix, les collectivités tiennent compte de leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement, ainsi que des niveaux de services accordés selon les demandes des usagers. Néanmoins, le tarif de la restauration scolaire ne peut être supérieur au coût par usager.
Plusieurs politiques tarifaires peuvent être appliquées : la commune peut proposer un tarif unique pour tous les enfants, des tarifs sociaux (incluant parfois la gratuité pour les plus défavorisés) ou plus rarement la gratuité totale du service pour tous. Les élèves venus d’autres communes peuvent se voir appliquer un tarif spécifique.

Quelques rares communes ont fait le choix de la gratuité complète du service pour l’ensemble des usagers (Le Bourget et Bobigny en Seine-Saint-Denis, par exemple). D’autres, plus nombreuses, proposent la gratuité pour les familles les plus vulnérables ou un dispositif s’approchant de la gratuité (les familles ne paient que l’inscription au service moyennant une somme modique).
L’accès de tous les enfants à la restauration scolaire En 2017, le législateur introduisait dans le code de l’éducation un nouvel article L. 131–13 qui visait à consacrer le principe de non-discrimination des citoyens dans l’accès au service public.Jusque-là, souvent en raison du manque de places, de nombreuses communes inscrivaient dans leur règlement intérieur que l’accès au service était réservé aux enfants dont les deux parents étaient en emploi. Bien que ces dispositions aient été jugées discriminatoires par le juge administratif à plusieurs reprises, la pratique perdurait.L’entrée en vigueur de ce nouveau texte, à la rentrée 2017, a contraint les communes à s’adapter. Certaines n’ont pas anticipé ces nouvelles dispositions. Ce fut le cas de la commune de Besançon, où une mère d’élève a saisi le juge administratif après s’être vu refuser une place pour son fils. Le 7 décembre 2017, le tribunal administratif se rangeait à son avis en déclarant illégale cette décision : « Les collectivités publiques qui choisissent de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. En conséquence, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent opposer un refus d’inscription au motif de l’absence de places disponibles [160] . » La ville avait en effet refusé « faute de places » l’inscription de plusieurs enfants. La commune a fait appel de la décision du tribunal administratif de Besançon, appel rejeté par la cour administrative d’appel de Nancy, le 5 février 2019.
4.1.2. Inégalités territoriales et urbaines
On observe une corrélation entre la taille des communes et leur capacité à proposer des tarifs différenciés en fonction de la situation économique des familles. Cette corrélation s’observe également dans la capacité des communes à proposer des tarifs très bas pour les familles les plus vulnérables. De même, plus la commune est grande, plus l’écart de prix proposé entre le premier et le dernier échelon est important.
L’enquête de Sud Ouest met en lumière les difficultés des « petites » communes pour proposer des tarifs différenciés, ainsi 94 % des communes de moins de 1 500 habitants interrogées par le journal pratiquent le tarif unique. Le prix moyen d’un repas dans ces communes était ainsi de 2,59 euros fin 2017.
A contrario, ce sont les communes de plus de 5 000 habitants qui proposent le plus souvent des tarifs calculés à partir des revenus des parents. 51 % d’entre elles proposent un quotient familial avec en moyenne 7 échelons de prix différents par commune. Le tarif moyen minimum est ainsi de 1,2 euro, quand le tarif maximum est de 5,99 euros (Bègles en Gironde).
La taille de la commune joue ainsi pleinement sur sa capacité à offrir une tarification la plus socialement juste. Mais les inégalités se nichent également dans les habitudes et préférences alimentaires des familles, lesquelles varient sensiblement selon le niveau social. Ainsi l’Anses a démontré, dans une étude de 2017, que les habitudes et modes de consommation alimentaires des Français sont un miroir des inégalités sociales. Les personnes ayant suivi des études supérieures consomment plus de fruits et de légumes, mais également plus de fromage, de yaourt et fromage blanc ou encore de chocolat. Au contraire, les individus qui se sont arrêtés au primaire ou au collège boivent plus de soda et privilégient la viande (hors volaille) et les pommes de terre. Chez les mineurs, le bilan est le même lorsque l’enfant est âgé de moins de 10 ans : ces habitudes alimentaires sont positivement corrélées au niveau d’études du parent représentant.
Le déséquilibre social se manifeste également lorsqu’on cible certains produits, comme les aliments issus de l’agriculture biologique. Un individu exerçant la profession de cadre ou ayant au minimum le bac en consomme deux fois plus qu’un ouvrier ayant arrêté son cursus au collège ou au lycée. Une observation également valable chez les enfants, en fonction du niveau d’études et de la profession de leurs parents.
Ces différences sociales dans le rapport à l’alimentation vont se retrouver dans le rapport des élèves à leur assiette en restauration scolaire, et dans celui de leurs parents aux menus proposés. Ainsi, il n’est pas rare que l’introduction d’alternatives végétales aux protéines carnées soit vue d’un mauvais œil par certaines familles, qui les considèrent comme moins nourrissantes. De même, le faible apport en féculents peut parfois être source de reproches. De même encore, l’introduction du bio et du local, considérés comme plus chers, fait souvent craindre à certains parents une hausse des tarifs de la restauration scolaire, qui leur serait préjudiciable.
Ces différenciations dans les habitudes alimentaires et dans le rapport aux aliments introduisent un paramètre nouveau pour les acteurs publics : l’information et la formation des usagers.
4.1.3. Évaluation de quelques propositions récentes
a) Le petit déjeuner gratuit
Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos, ont annoncé en avril 2019 une mesure visant à offrir à 100 000 enfants de quartiers défavorisés des petits déjeuners gratuits, pour un coût public de 6 millions d’euros.
Cette initiative, déjà déployée dans huit académies tests – Amiens, La Réunion, Lille, Montpellier, Nantes, Reims, Toulouse, Versailles – a été « généralisée au mois de septembre » à l’ensemble des écoles volontaires qui appartiennent à une zone REP (réseau d’éducation prioritaire), REP+ ou quartiers politique de la ville ou encore à certaines zones rurales où « le besoin social est identifié ».
Selon les résultats d’un rapport publié par la Banque alimentaire d’Australie et intitulé « Hunger in the Classroom » (Faim en Classe) [161] , les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin perdent, à la fin de la journée, deux heures d’apprentissage comparé à leurs camarades qui se nourrissent au réveil. Ainsi, 73 % des enfants qui sautent ce repas auraient des difficultés à se concentrer et 66 % deviendraient léthargiques à mesure que les heures de la matinée passent. Par ailleurs, plus de la moitié de ces enfants se montrent dissipés et manifestent un comportement problématique (irritabilité, colère, tristesse…). Or, en France, près d’un enfant sur cinq saute au moins un petit déjeuner par semaine [162] . Les enseignants constatent les effets démontrés par la Banque alimentaire d’Australie puisqu’ils estiment à 82 % que les enfants n’ayant pas pris de petit déjeuner sont davantage fatigués et à 83 % qu’ils sont moins attentifs.
L’initiative du gouvernement répond donc à une véritable problématique sociale mais aussi éducative. Elle pose cependant plusieurs problèmes. D’abord, de ciblage des usagers concernés : en effet, les familles en grande difficulté sociale ne résident pas exclusivement dans les quartiers politiques de la ville (QPV). Ensuite, de ciblage social : l’absence de petit déjeuner le matin ne concerne pas uniquement des enfants issus des catégories populaires mais également des familles de classe moyenne ou aisée qui n’ont pas l’habitude du petit déjeuner, ou dont l’emploi du temps rend sa prise épisodique.
Une question de financement se pose également. En effet, l’État va verser 2 euros par petit déjeuner, quand ceux-ci sont estimés à 4 euros, voire 4,5 euros par les communes.
Enfin, cette mesure pose également une question de santé publique. Il est possible que certains enfants profitent de cette mesure pour petit déjeuner deux fois, risquant alors une surdose alimentaire répétée dans le temps.
Afin d’éviter qu’une bonne idée ne se transforme en risque sanitaire, deux options peuvent finalement être envisagées. La première consisterait à laisser la mise en place du dispositif à la discrétion des enseignants ; ce serait à eux d’identifier les enfants n’ayant pas petit-déjeuné. La seconde reposerait sur une stratégie de communication et d’information aux familles. Si le petit déjeuner gratuit devait être mis en place, il conviendrait en outre de veiller à ce que les enfants n’aient pas mangé deux fois. Le meilleur moyen de l’éviter reste alors de sensibiliser les parents au fait que le petit déjeuner sera pris en classe. Il conviendrait également d’envisager que ce repas soit pris sur l’accueil du matin, afin de ne pas empiéter sur le temps de classe.
b) Tarification à 1 euro
Le 13 septembre 2018, le président de la République Emmanuel Macron a présenté dans un discours les principales mesures de son Plan Pauvreté, et notamment concernant la restauration scolaire : « L’accès à la cantine sera rendu plus universel en développant les repas à 1 euro pour les personnes les plus pauvres. De nombreux maires ont déjà pris des initiatives fortes en la matière, que je salue. Je souhaite que nous puissions accompagner les communes dans ce juste combat. Aussi, une incitation financière sera mise en place dans les communes les plus pauvres. »
Le dossier de presse de l’Élysée précise : « Un mécanisme d’incitation sera […] mis en place en direction des communes les plus fragiles de moins de 10 000 habitants pour appliquer une tarification sociale de la restauration scolaire avec un plafond du barème le plus bas à 1 euro le repas. »
Au-delà du caractère symbolique et facilement mémorisable du « 1 euro », cette annonce ne fait que reprendre des initiatives déjà conduites par de nombreux maires. Les tarifs sociaux sont ainsi assez largement pratiqués : la Ville de Paris a établi depuis 2015 un système d’échelle des tarifs à dix niveaux. Les plus faibles revenus déboursent uniquement 13 centimes d’euro par repas. Lille, quant à elle, propose une grille à quinze niveaux allant de 50 centimes à 5,62 euros. On retrouve le même type de grille à Lyon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Metz, Toulon, Avignon, Aix-en-Provence ou encore Grenoble. Tous proposent des plateaux-repas à 1 euro ou moins pour les familles les plus pauvres.
Il s’agit néanmoins de villes de taille conséquente. L’enquête de Sud Ouest montre en effet, que, parmi les communes qui pratiquent des prix différenciés suivant les revenus des familles, ce sont les plus grandes qui proposent les prix minimums les plus bas. Par exemple, à La Rochelle (Charente-Maritime) 0,10 euro, Pau (Pyrénées-Atlantiques) 0,29 euro, Libourne (Gironde) 0,42 euro et Bordeaux (Gironde) 0,45 euro. Mais les communes sont nombreuses à faire des efforts de tarification, même lorsqu’elles proposent un tarif unique. Depuis 2007, les villes du Bourget et de Drancy (Seine-Saint-Denis), par exemple, ont instauré la gratuité totale de leurs cantines scolaires.
En l’absence de précision sur le montant et les modalités de cette aide aux communes, on peut craindre un « effet d’aubaine » qui amènerait des communes qui, jusque-là, pratiquaient des tarifs sociaux en deçà de 1 euro à réévaluer à la hausse leur tarif pour pouvoir bénéficier de l’aide, ceci dans un contexte de difficulté de financement des collectivités territoriales sur fond de baisse de la Dotation horaire globale (DHG).
On peut regretter le caractère peu ambitieux de cette annonce par rapport à la proposition de loi déposée par Gaël Le Bohec (député LREM) et un peu plus d’une centaine de parlementaires de son groupe politique. Cette proposition de loi visait à garantir la mise en place d’une tarification sociale de la restauration scolaire avec une tranche gratuite pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté.
4.1.4. Un univers méconnu du public et des parents d’élèves : peu d’ouverture de la cantine
L’hygiène est souvent agitée comme un chiffon rouge par les collectivités pour éviter de se pencher sur la question de la fabrication des repas. Or, aujourd’hui, la règle sanitaire reste un outil mais ne doit pas devenir un frein (il n’a jamais été interdit d’utiliser des œufs en coquille dans l’élaboration des repas, par exemple – un préjugé pourtant très répandu).
Dans le premier degré, l’une des demandes récurrentes des parents est de pouvoir visiter la cantine scolaire et « goûter » les repas servis aux enfants. Si certaines collectivités jouent le jeu, d’autres s’y refusent. Quand l’information offerte aux parents se limite au seul menu, cela crée parfois un sentiment de suspicion chez certaines familles, et les réponses qui leur sont apportées ne sont pas toujours à même de les rassurer : redirection vers le service juridique de la mairie (Paris 18 e ), refus de répondre en raison d’une « clause de discrétion » vis-à-vis du prestataire (78), pas de visite de la cantine pour cause de respect des règles d’hygiène dans une cantine en liaison chaude, etc.
Des collectivités essaient néanmoins de mettre en place des actions pour valoriser les métiers des agents via leur direction de la communication : campagnes de promotion du métier d’agent en restauration scolaire, par exemple à Toulouse. Des opérations spéciales sont aussi mises en place dans les cantines autour du développement durable, de la semaine du goût : des menus « bas carbone », des menus gastronomiques une fois par mois, etc. Elles veulent valoriser la capacité à produire de bons repas, à développer des menus plus recherchés, etc…
4.2. Formation, implication du personnel et organisation de la pause méridienne
4.2.1. L’encadrement des enfants pendant la pause méridienne
La restauration scolaire regroupe différents segments d’activité, de la production du repas à l’animation de la pause méridienne en passant par la direction des cuisines et le suivi des questions sanitaires. L’avis 77 du Conseil national de l’alimentation (CNA) indique que « l’implication du personnel est un enjeu essentiel » afin de contribuer à l’éducation nutritionnelle des enfants. Mais, dans la plupart des cantines scolaires, le nombre d’encadrants est insuffisant (un encadrant pour trente élèves en moyenne à l’école primaire), ils sont insuffisamment formés pour accompagner les élèves (il n’existe pas de formation spécifique en dehors des questions d’hygiène et de sécurité alimentaire) et on remarque un désengagement du corps enseignant lors de la pause méridienne, qui n’est pas un temps éducatif reconnu. En outre, les différents acteurs intervenants durant cette pause (cuisiniers, « dames de cantine », animateurs, agents de restauration, Atsem, etc.) sont insuffisamment coordonnés, et il y a un fort turnover chez les encadrants. Par ailleurs, le temps de cantine est souvent organisé en deux services, et il faut souvent gérer dans les écoles les groupes en attente entre ces deux services.
À ce manque de fluidité s’ajoutent un saucissonnage du temps de l’enfant au cours de la journée, la pause méridienne étant déconnectée des autres séquences, ainsi qu’une fragmentation des différentes tâches liées à cette pause et un cloisonnement de l’espace en fonction des différents rôles attribués aux membres du personnel. La vision qui préside à l’animation de ce temps est principalement utilitariste (la cantine est le lieu où les enfants mangent ) et souvent disciplinaire (le temps de repas étant bruyant et le personnel trop peu nombreux et formé pour animer ce moment), d’autant plus que des conflits peuvent se créer à la cantine entre enfants et perdurer jusque dans la salle de classe l’après-midi. Alors que la cantine pourrait être un lieu d’apprentissage et de socialisation ( cf. supra partie 1 et avis n° 77 du CNA), l’absence de vision globale de ce temps et de ressources associées à son animation ne permettent pas de réaliser cette ambition.
4.2.2. Formation et implication du personnel
On l’a dit, il n’existe pas aujourd’hui d’offre de formation spécifique des encadrants en restauration scolaire. D’ailleurs, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) n’octroie pas de formation spécifique à des personnes non titulaires pour l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne. Les besoins sont pourtant manifestes.
La charge de l’encadrement des enfants est aujourd’hui, le plus souvent, confiée à des personnels municipaux embauchés dans des conditions précaires, pour des contrats courts (six heures en moyenne par semaine). Il peut aussi s’agir de personnels employés par la collectivité locale sur des domaines divers (espaces verts, circulation, activités périscolaires…) et souvent assez éloignés de la restauration collective. Si l’accompagnement des convives fait partie des tâches d’un agent polyvalent de restauration scolaire, celui-ci est essentiellement formé à être un commis de cuisine et un agent de nettoyage en premier lieu. Sa formation porte avant tout sur l’hygiène et la sécurité au sein de la cantine. Il n’y a donc pas aujourd’hui de métier à proprement parler d’encadrant de cantine pour animer le temps des repas, faire de la pédagogie nutritionnelle et sensibiliser au gaspillage alimentaire [163] . Pourtant, l’implication d’un personnel formé est une des conditions de la réussite d’une transition alimentaire dans les cantines [164] ( cf. supra l’encadré « Les personnels communaux et enseignants, acteurs clés pour l’éducation alimentaire des enfants »).
a) Les cuisiniers
La formation initiale des cuisiniers est une formation de CAP cuisine qui se prépare en deux ans après la troisième, ou en un an après un premier diplôme (autre CAP, bac professionnel…) ou une seconde professionnelle, que ce soit sous statut scolaire ou par apprentissage. Les formations pour devenir cuisinier en restauration scolaire sont au nombre de quatre : CAP cuisine, BPA transformations alimentaires, CAP agent polyvalent de restauration, CAP métier de bouche.
Le métier de cuisinier en restauration scolaire a ses propres spécificités, en plus d’une base de cuisine, avec la nécessité de maîtriser des gros volumes et un gros outillage, des régimes alimentaires spéciaux, un référentiel important en matière de sécurité alimentaire et des notions sur les textures et menus adaptés. La production de repas est particulièrement impactée par des règles de sécurité sanitaire strictes (la sûreté alimentaire peut être décourageante car elle est omniprésente), l’assemblage de produits semi-élaborés (réchauffage et assemblage, appauvrissement du « culinaire », contraintes sur les menus) et le manque de valorisation du savoir-faire des agents (en effet, ils sont peu impliqués dans des actions de pédagogie alimentaire pour les convives ou dans des actions de sensibilisation pour encourager le public à mieux manger).
Il existe néanmoins un certificat « spécialisation en cuisinier de restauration collective » depuis 2010, qui est le seul certificat élaboré conjointement par le ministère de l’Agriculture et Restau’Co. Il pourrait, dès la formation initiale des cuisiniers se destinant à travailler en restauration scolaire, être un levier d’innovation intéressant. Mais il est encore trop peu identifié dans le secteur [165] .
Ces enjeux sont d’autant plus importants qu’il y a aujourd’hui une pénurie de chefs gérants et de seconds de cuisine (pénurie constatée par les sociétés de restauration collective), ainsi qu’un fort turnover chez les agents polyvalents (alors qu’il faut aujourd’hui entre huit et dix-huit mois pour recruter une personne capable de produire 1 000 repas par jour).
Le manque d’attractivité du secteur y est pour beaucoup et vient notamment des salaires proposés. Il y a peu de différences salariales entre les différents niveaux hiérarchiques dans une équipe de restauration collective, la rémunération moyenne étant de 1 600 euros net par mois, et un cuisinier en fin de carrière pouvant gagner jusqu’à 1 950 euros net [166] .
La loi Egalim prévoit 50 % de produits durables dont 20 % de produits bio et l’obligation à partir de novembre 2019 de proposer un repas végétarien par semaine dans la restauration collective publique. Mais les cuisiniers n’ont, pour la plupart, pas été formés à cuisiner à partir de produits bio (dont l’aspect diffère des produits conventionnels) ou à composer des repas végétariens. Ils peuvent alors être tentés d’avoir recours à des produits transformés (type galettes de soja ou « steak » végétarien) ou servir un plat à base d’œufs pour remplacer la viande ou le poisson.
Pourtant, les repas végétariens peuvent être l’occasion de composer un repas sain à partir de produits bruts (en cuisinant du « fait maison ») et de diversifier les sources de protéines (en associant des légumineuses et des céréales pour remplacer les protéines animales). Mais, faute de formation adéquate du personnel de cuisine, le menu végétarien peut devenir un menu ultra transformé (en ayant recours à des préparations industrielles), faisant une place importante aux œufs (ce qui ne permet pas de diversifier les sources de protéines), notamment en poudre ou étant insuffisamment équilibré (quand le plat principal se compose uniquement de céréales et de légumes, les sources de protéines végétales sont mal combinées et donc la complémentation en acides aminés essentiels n’est pas assurée).
C’est ce que montre l’étude de 2016 de Nicole Darmon, Florent Vieux et Christophe Dubois, en évaluant la qualité nutritionnelle de 40 menus végétariens servis dans des cantines scolaires. Les auteurs observent que ces menus, tels qu’ils sont composés, n’apportent pas tous les nutriments dont les enfants ont besoin. En effet, sur les 40 plats principaux étudiés, 15 étaient composés d’œufs, 15 de céréales et légumes (sans légumineuses donc), et seulement 5 de plats pouvant être faits maison et associant céréales et légumineuses. Car les légumineuses sont une source importante de protéines, mais aussi de fer, vitamines B [167] , magnésium, calcium et sélénium. Il est donc crucial que les cuisiniers soient formés pour savoir les préparer et les valoriser au mieux.
Si des progrès ont été réalisés dans les cantines depuis, avec la diffusion croissante des principes nutritionnels végétariens, cette étude doit nous alerter sur la nécessaire formation à la nutrition et cuisine végétariennes de l’équipe en charge de la composition des repas. Des formations ont récemment été créées par le CNFPT et par le collectif « Les pieds dans le plat », mais elles sont pour l’instant peu sollicitées par manque d’information.
b) Les « dames de cantine »
Celles qu’on appelle communément les « dames de cantine » (car ce sont majoritairement des femmes) servent les plats, nettoient les lieux et encadrent la pause méridienne. Elles sont le plus souvent dans une situation précaire, puisque leur temps partiel ne leur permet de gagner qu’environ 700 euros par mois (d’après les témoignages recueillis). Leur travail est considéré comme ne nécessitant aucune compétence particulière. Elles souffrent d’un manque de reconnaissance et d’interactions avec les autres membres de l’équipe. Au contact avec les enfants, véritables intermédiaires entre les cuisiniers et les convives, elles peuvent pourtant être à l’origine de demandes de changement de menu, de propositions dans les commissions de menu ou d’augmentation de la part de bio dans les cantines, par exemple. Parce qu’elles sont un relais important dans l’accompagnement des enfants à la cantine, elles sont incontournables dans tout projet d’éducation alimentaire, que ce soit pour expliquer l’introduction de repas végétariens, pour faire goûter de nouveaux aliments ou pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage. Les former et les intégrer dans un projet de transition alimentaire au sein des cantines apportent également un sens à leur métier, en enrichissant leur expérience quotidienne avec les enfants.
Faire connaître son engagement : charte, label et évaluation… Des solutions existent ▪La charte qualité d’Agores, les professionnels s’engagent Fondée à l’initiative de professionnels de la restauration municipale en 1986, Agores fédère ses membres autour d’une ambition : « proposer une restauration territoriale moderne, citoyenne et de qualité au plus grand nombre ». Cet objectif est né d’une double volonté : sortir les gestionnaires de leur isolement et défendre l’image d’une restauration collective publique exigeante et performante. La charte qualité Agores vise les collectivités qui attachent une attention particulière à leur service de restauration. C’est ainsi qu’elles s’engagent, selon un programme précis et transparent, à se faire évaluer sur leurs prestations, dans une logique d’amélioration continue.Cette démarche s’appuie sur trois principes directeurs qui se déclinent en neuf engagements concrets :
Principes | 1/ Production – Fabrication des menus Des denrées sélectionnées et cuisinées dans les règles de l’art | 2/ Distribution – Prise en compte des convives usagers Des restaurants conviviaux, lieu de vie, d’éducation et de citoyenneté | 3/ Service public – Gestion raisonnée de la prestation Maîtrise de la gestion du service en adéquation avec les objectifs |
Engagement 1 | Outils de production Concevoir des outils de production adaptés aux attentes et besoins Parmi les critères > dimensionnement de l’outil de production | Accueil Concevoir des restaurants accueillants Parmi les critères > acoustique, décor, mobilier, organisation de la distribution et du service | Ressources humaines Recruter, former et promouvoir les ressources humaines Parmi les critères > gestion des compétences, promotion interne… |
Engagement 2 | Approvisionnements & transformation Garantir et maîtriser la traçabilité des denrées (circuits courts, bio, labels qualité) Parmi les critères > taux de produits frais, cuisine maison ou d’assemblage… | Transmission Éduquer au goût, à l’alimentation, à la nutrition Parmi les critères > diversité des animations et projets, démarches éducatives | Budget Connaître, analyser et maîtriser les coûts du service Parmi les critères > coût matière, coûts d’exploitation, masse salariale… |
Engagement 3 | Hygiène Assurer une prestation alimentaire garantissant la sécurité et la qualité sanitaire. Parmi les critères > process de fabrication, plan de maîtrise sanitaire, résultats des contrôles sanitaires | Vivre ensemble Développer un projet éducatif citoyen Parmi les critères > promotion du développement durable, lutte contre le gaspillage alimentaire, laïcité… | Information Fournir aux usagers une information transparente sur la prestation fournie Parmi les critères > information aux consommateurs, communication régulière aux usagers… |
▪ Mon Restau Responsable®, s’engager à progresser Mon Restau Responsable® est une démarche de progrès accessible à tous les professionnels de la restauration collective, créée par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le réseau Restau’Co, qui regroupe 10 000 restaurants collectifs publics et privés. Cette démarche repose sur quatre domaines : le bien-être des convives, l’assiette responsable, les éco-gestes et l’engagement social et territorial. Elle comporte quatre étapes. Après avoir rempli un questionnaire d’auto-évaluation, l’établissement reçoit la visite d’un pair pour échanger sur ses pratiques, puis choisit des pistes d’amélioration. Lors d’une séance publique d’engagement, le restaurant fait part des progrès qu’il souhaite réaliser. Dès lors, il bénéficie du logo Mon Restau Responsable®, ce qui lui permet de valoriser son engagement. Lorsqu’il estime avoir progressé, il réunit de nouveau ses parties prenantes, qui lui attribuent la garantie Mon Restau Responsable® au vu de la réalité des progrès. Tous les restaurants peuvent obtenir la garantie, il suffit simplement d’entrer dans la démarche et de progresser à son rythme.Le label « En cuisine » d’Ecocert, une certification :Délivré par le groupe Ecocert, le label « En cuisine » est le premier cahier des charges français dédié à la restauration collective bio qui impose des critères non seulement au contenu de l’assiette mais aussi à l’établissement. Il prend en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et de santé publique des établissements de la restauration collective en trois niveaux de labellisation [168] .

4.2.3. L’organisation de la pause méridienne : les bonnes pratiques
a) Organisation du restaurant scolaire
Aujourd’hui, les locaux sont souvent petits, mal insonorisés et donc très bruyants. Les conditions ne sont pas réunies pour que le repas soit un moment serein de découverte culinaire et de convivialité.
Toutefois, de plus en plus de restaurants scolaires sont aménagés de telle sorte que la pause méridienne soit plus agréable pour les convives et qu’elle s’accompagne de moins de gaspillage. Les différents plats peuvent être proposés en carrousel en « libre-service » où fruits, légumes et fromages sont prédécoupés, où les enfants se servent selon leur faim et où les différents aliments peuvent être disposés judicieusement afin d’optimiser le flux des enfants. L’environnement dans lequel les enfants mangent est l’un des premiers déterminants de changement d’habitudes alimentaires. Il doit donc être soigné, à travers la présentation des plats, la mise en valeur des vitrines, la décoration de la salle de restauration, la sensibilisation au tri à travers des tables de tri, etc.
De nombreuses communes se saisissent également de la question du confort acoustique des convives durant le repas. Dans certaines cantines, le bruit ambiant peut en effet monter jusqu’à 85 DB [169] , soit l’équivalent du niveau sonore d’un camion diesel roulant à 50 km/h et passant à proximité. Si certaines innovent dans la construction de nouveaux espaces modulaires ou dans la réalisation de tiers lieux partagés, il n’est pas toujours nécessaire de faire du neuf pour améliorer la vie des personnels et des convives. Ainsi, un travail important peut être réalisé à partir de panneaux antibruit ou de mobilier adapté.
b) Animation, encadrement et lien avec d’autres activités éducatives
C’est, rappelons-le, l’une des recommandations du CNA : utiliser la cantine comme un lieu d’éducation pour des actions conviviales, simples et courtes ( cf. avis n° 77 du CNA).
L’éducation alimentaire des enfants passe par des activités éducatives spécifiques : visite de producteurs locaux, repas à thèmes, animations de type « saveurs et découvertes », séances de sensibilisation sur le développement durable ou sur l’équilibre nutritionnel. Des événements peuvent également être organisés en dehors de la pause méridienne comme des ateliers cuisine, des séances de jardinage ou encore des séances sur la gestion des déchets.
Ces projets éducatifs peuvent trouver leur place dans le projet d’école. Celui-ci, discuté et voté en conseil d’école, peut permettre une coordination et un échange entre la mairie qui organise le service de restauration et les enseignants qui sont en charge des contenus pédagogiques et des projets éducatifs menés sur le temps de classe.
Ils permettent également de remplir le parcours éducatif santé, instauré par la loi de 2013, particulièrement l’axe consacré à la prévention, qui comprend un volet consacré à l’alimentation (circulaire n° 2016–008 du 28–1–2016).
Des ressources pédagogiques ont également été développées afin d’aider les enseignants à faire le lien entre les programmes scolaires et l’alimentation (exemple : la fiche pratique vocabulaire destinée aux enseignants de grande section de maternelle [170] ).
Plusieurs communes ont déjà réalisé des efforts pour améliorer la pause méridienne. C’est notamment le cas de la Ville de Lille qui, dans le cadre de son projet éducatif global s’est dotée d’une charte de la pause méridienne. Celle-ci reconnaît le temps du midi comme un temps éducatif à part entière et se donne quatre objectifs : se restaurer dans de bonnes conditions, se sociabiliser, se reposer et s’amuser. Cette charte institue la pause méridienne, l’ensemble des acteurs qui y interviennent et les différentes séquences qui la structurent comme un tout, pensé comme tel [171] .
En partenariat avec le conseil départemental du Val-d’Oise et l’Anegj (Association nationale pour l’éducation au goût des jeunes), l’association Teragir a également développé un outil pédagogique, Miamm (Méthode d’investigation sur l’alimentation pour mieux manger), autour de l’éducation au goût et à l’alimentation. La particularité de cet outil est qu’il propose d’utiliser l’école et son environnement proche comme lieu d’investigation [172] .
c) La durée de la pause méridienne, entre trop et pas assez, il faut trouver l’équilibre
La durée de la pause méridienne a une influence directe sur la qualité du temps de repas. Si la pause est trop courte, les enfants sont pressés, ne prennent pas le temps de manger, n’ont pas le temps d’arriver à satiété et ne finissent pas leur assiette. Une étude américaine menée en 2015 montre que la durée du repas a une incidence sur la consommation alimentaire des enfants : les jeunes qui mangent en moins de vingt minutes consomment 13 % moins d’entrée, 12 % moins de légumes et 10 % moins de lait que les enfants qui mangent en vingt-cinq minutes ou plus [173] . Il est d’ailleurs prévu que le temps accordé au repas ne doit pas être inférieur à une demi-heure et ne doit pas comporter d’attente avant le service [174] . Si la pause est trop longue, elle nécessite d’être occupée, car elle peut devenir facteur de fatigue et de stress, influant directement sur les enseignements de l’après-midi. Elle peut aussi devenir source d’inconfort en période hivernale ou durant les jours de pluie si les enfants n’ont pas d’espace clos ou protégé où jouer.
Une enquête du SNUipp-FSU, menée dans la foulée de l’instauration de la réforme des rythmes scolaires en 2013, montre que plus la pause méridienne est longue, plus les enseignants veulent que l’organisation du temps scolaire soit revue (81 % pour une pause d’une heure trente, 86 % pour deux heures et 88 % pour plus de deux heures [175] ). Lors de nos auditions, un enseignant nous a expliqué que cette question pouvait être source de tension entre les équipes enseignantes et la mairie.
Néanmoins, une dimension purement structurelle peut amener à rallonger le temps du midi. En effet, certaines communes ne disposent pas de locaux suffisamment grands pour accueillir l’ensemble des enfants en un seul service. Ils instaurent alors un roulement dans le restaurant scolaire. Jusqu’en 2017, les communes qui ne disposaient pas d’infrastructures adaptées à leur population scolaire pouvaient limiter l’accès à la restauration scolaire en fonction des capacités dont elles disposaient. Désormais, la loi reconnaît le droit pour tous les enfants d’être inscrits à la cantine, les communes doivent donc trouver des solutions d’accueil, temporaires ou pérennes, pour absorber une potentielle hausse de fréquentation.
5. Propositions
Doter les collectivités d’outils humains et financiers pour piloter la transition alimentaire des cantines
PROPOSITION 1 : Créer un service d’appui aux collectivités |
De nombreuses collectivités locales doivent être accompagnées pour pouvoir réorganiser convenablement l’approvisionnement de leurs cantines en produits locaux, sains, de saison, le moins transformés possible, majoritairement issus de l’agriculture biologique, et pour développer l’offre de protéines végétales. |
Les réseaux des chambres agricoles et de la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab) apportent déjà une expertise sur les filières. Mais il serait plus efficace que les départements puissent héberger un service commun d’appui aux compétences sous la forme d’un guichet d’information, de conseil et d’orientation destinés aux décideurs locaux. Placé à ce niveau, ce service d’aide donnerait accès à une meilleure connaissance des acteurs locaux. |
À défaut, les CRAlim (Comités régionaux de l’alimentation) pourraient assumer le rôle de hotline pour rediriger les communes ou intercommunalités vers la bonne personne et recenser tous les acteurs et informations utiles. Il faudrait pour cela qu’ils aient un volet plus opérationnel : un guichet unique de service aux agriculteurs et aux collectivités afin de faciliter les contacts et de faire circuler l’information entre les deux ; aujourd’hui, ils n’ont pas les moyens de monter un tel service. |
PROPOSITION 2 : Permettre aux collectivités de réaliser des audits sur leur service |
Les collectivités compétentes ont besoin de pouvoir réaliser des audits sur leur service de restauration scolaire, notamment pour faire le point sur ce dont elles ont besoin en termes de repas, de grille tarifaire et de forfaits à proposer. Les dépenses correspondantes seraient rentabilisées ensuite avec les économies réalisées sur le gaspillage. A fortiori si les communes recourent à certains services de conseil gratuits comme celui que propose la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH). |
Pour cela, le CNFPT pourrait être mis à contribution. Il dispose de moyens sous-utilisés qui pourraient être alloués à ce type de services, notamment en matière de gestion des personnels, en particulier dans les territoires où il est bien structuré. L’Association des maires de France (AMF) pourrait également créer une hotline dédiée pour rendre service à ses maires et ainsi leur donner l’expertise dont ils ont besoin. |
PROPOSITION 3 : Consolider des financements pour l’élaboration de Projets alimentaires territoriaux |
Il existe des financements (des ministères, en particulier celui de l’agriculture mais aussi des régions et des fonds européens) pour les Projets alimentaires territoriaux (PAT) pour lesquels les cantines scolaires et plus largement la restauration collective locale (Ehpad, hôpitaux, etc.) sont des débouchés naturels. Mais ces financements fonctionnent par appels à projets (exigeant des collectivités une compétence qu’elles n’ont pas toujours) et l’enveloppe budgétaire du ministère pour ces PAT reste fragile. Ce qui est dommage car les PAT permettent d’avoir une vision globale du développement agricole et de l’approvisionnement alimentaire au sein d’un territoire, et ce dans le cadre d’une gouvernance partagée qui intègre toutes les dimensions de la question (économiques, sociales, environnementales…). C’est pourquoi nous recommandons que les enveloppes budgétaires consacrées aux initiatives de PAT soient étendues et consolidées sur plusieurs années, et que les collectivités soient mieux accompagnées pour se porter candidates aux fonds européens Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) dont les critères correspondent parfaitement à l’esprit des PAT. |
PROPOSITION 4 : Mettre en place une prime à l’investissement pour les cantines qui s’engagent dans la transition alimentaire |
Mettre en place une aide financière à l’entrée dans la transition alimentaire pour les collectivités qui doivent se plier à la loi sur le bio et le local. Passer au bio dans les cantines engendre une évolution des coûts en cloche, avec une hausse suivie d’une stabilisation, puis d’une baisse. Cette aide permettrait d’absorber une partie de la hausse initiale et donc, en accélérant la transition, de hâter ses bénéfices ultérieurs. Rappelons que, selon l’Ademe [176] , pour 1 euro investi par exemple dans les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, 2 euros sont rapidement économisés. |
Selon la FNH [177] , il faudrait un peu plus de 300 millions d’euros par an pendant trois ans pour aider au financement des investissements nécessaires (équipements, formations, actions de sensibilisation) afin d’atteindre les objectifs de la loi Egalim. Faute de financements suffisants, une enveloppe inférieure fléchée sur les territoires les plus fragiles pourrait être envisagée. Cela pourrait prendre la forme d’une prime à l’investissement pour les volontaires. Cette aide pourrait être financée notamment par une réaffectation d’une partie du fonds « publics et territoires » de la Cnaf, qui a vocation à développer l’accessibilité des bâtiments publics. Ce fonds, abondé récemment mais sous-utilisé, pourrait permettre de faire les travaux d’agrandissement, de modernisation et d’isolation phonique nécessaires dans les restaurants scolaires. Les investissements requis (dans les équipements, dans la formation et la sensibilisation) pourraient également recevoir le soutien du Grand Plan d’investissement. Enfin, les fruits et les légumes achetés sous signe de qualité pourraient en partie être financés par le programme de l’Union européenne « Lait et fruits à l’école », qui prend désormais en charge les denrées alimentaires consommées pendant le déjeuner et dont les financements sont nettement sous-utilisés. |
Favoriser les économies d’échelle et créer du lien social par la mutualisation de moyens et de lieux
PROPOSITION 5 : Mutualiser les moyens, commandes et ressources humaines sur un territoire |
L’économie de la transition alimentaire à l’échelle locale sera d’autant plus performante qu’elle pourra réaliser des économies d’échelle sur les infrastructures et les ressources humaines dans les territoires concernés. Nous recommandons à ce titre, à l’échelle communale dans les villes moyennes et grandes, et à l’échelle intercommunale dans les plus petites villes, un examen approfondi des opportunités de mutualisation des moyens et des commandes entre les différents types de restaurant collectif public du territoire (cantines scolaires, centres de vacances, etc.), voire entre les cantines scolaires de plusieurs communes voisines. De telles initiatives existent déjà dans certaines collectivités. Il arrive notamment que des cuisines soient sous-utilisées dans certains établissements ou que d’anciennes légumeries puissent être réinvesties. De la même façon, nous recommandons qu’à l’échelle intercommunale, notamment dans les territoires ruraux, les ressources humaines en matière d’expertise (sourcing, structuration des marchés publics, construction du cahier des charges dans le cadre d’une délégation de service public, suivi d’exécution des contrats…) soient mutualisées aussi souvent que possible. |
PROPOSITION 6 : Regrouper les publics de la restauration, favoriser la mixité sociale et l’intergénérationnel |
Les économies d’échelle peuvent également passer par le regroupement de certains publics. De tels regroupements peuvent faire sens à bien d’autres titres. Cela peut se faire, par exemple, en favorisant la mixité et l’intergénérationnel dans les restaurants. Certains grands groupes de restauration collective ont conduit des expériences de ce type avec des résultats très prometteurs. Lorsque des publics de maison de retraite déjeunent avec des enfants inscrits à la cantine scolaire, on observe que les enfants sont beaucoup plus calmes et que le niveau de convivialité dans la cantine s’améliore sensiblement. |
Œuvrer pour un véritable accompagnement social des employé.e.s
PROPOSITION 7 : Garantir aux employé.e.s un volume horaire suffisant et reconnaître la pénibilité de leur travail |
Il importe que chaque mairie (ou communauté de communes) dispose d’une gestion RH ayant une vision globale des différents services et une attention particulière aux personnels les plus précaires des restaurants scolaires. Il s’agit de mettre en place des modes d’organisation du temps salarié de nature à garantir des volumes horaires suffisants pour les personnes (en particulier concernant les personnels de service, majoritairement des femmes en temps très partiel et disposant souvent de revenus très bas), au besoin en diversifiant leurs missions et en leur permettant ainsi d’avoir une vision plus globale des enjeux. La position de ces personnels au plus près des enfants, leur connaissance des attentes et des difficultés en font des acteurs stratégiques de la transition alimentaire dans les cantines. |
Il s’agit aussi de reconnaître la pénibilité du travail de ces employés, en termes auditifs notamment, et d’adapter la configuration acoustique des salles en conséquence. |
PROPOSITION 8 : Proposer une meilleure offre de formation et améliorer les référentiels métier du personnel
La gestion RH des personnels de la restauration scolaire passe également par une meilleure offre de formation et des référentiels métier enrichis (former sur les dimensions socio-spatiales, comportementales et relationnelles : placement à table, déplacement des enfants, style d’encadrement, interaction avec les enfants, etc.). Cette offre doit également viser les cuisiniers, auxquels il faut donner les moyens de mieux maîtriser les notions d’équilibre nutritionnel d’une cuisine plus végétale. Certains grands acteurs privés de la restauration collective sont eux-mêmes engagés dans des actions de formation et la création de CFA spécifiques pour les cuisiniers en restauration scolaire. Ces initiatives doivent être encouragées et mieux connues.
Faire de chaque moment une opportunité pour l’éducation alimentaire des enfants
PROPOSITION 9 : Changer le statut juridique des écoles et des cantines et reconnaître le temps du repas comme un temps éducatif |
La transition alimentaire étant un processus global impliquant une grande diversité d’acteurs, il importe de faire revenir les enseignants dans le monde de la restauration scolaire. Pour cela, il serait utile de changer le statut juridique des écoles et des cantines pour mettre en place une gouvernance tripartite (collectivité, école et parents) de façon à ce que les cantines entrent désormais dans le champ de compétence des conseils d’école et donc aussi des enseignants. Afin d’inciter les enseignants à être plus souvent présents dans le restaurant scolaire au moment du déjeuner, l’Éducation nationale pourrait jouer sur les primes de surveillance et reconnaître le temps du repas comme un temps éducatif à part entière (les fonds de la CAF pourraient alors aider au financement des encadrants et favoriser une hausse du taux d’encadrement [178] ). Les personnels en lien avec la restauration scolaire (notamment les cuisiniers) devraient avoir un interlocuteur sur les questions alimentaires dans les équipes pédagogiques, notamment en lien avec le programme de CE2 et CM1, où la question de l’équilibre alimentaire est abordée. |
PROPOSITION 10 : Favoriser les initiatives éducatives en termes de transition alimentaire et agricole |
Il importe de mieux connecter le temps du déjeuner à la cantine aux corpus pédagogiques. Les enjeux liés au repas de midi et à la cantine sont encore trop absents des programmes scolaires. La pause méridienne pourrait être ainsi mieux intégrée à la journée de classe. |
De la même façon devraient être favorisées les actions et initiatives liées à la transition agro-écologique et à l’alimentation durable dans les écoles, pour mieux expliquer le chemin du potager à l’assiette et comment on produit ce que l’on mange : les potagers pédagogiques (Harfleur, Mouans-Sartoux…), les systèmes de compost pour éviter le gaspillage, mais aussi les visites de fermes, de lycées hôteliers, des ateliers d’éveil sensoriel, la valorisation du circuit de production… Harfleur, par exemple, a créé des « directeurs mandataires » d’école, qui sont chargés de développer ces actions. |
Mettre à jour les recommandations nutritionnelles et changer les pratiques pour permettre une réduction substantielle des protéines animales
PROPOSITION 11 : Proposer une alternative végétarienne quotidienne à partir de 2022 dans les communes de plus de 100 000 habitants et diversifier les sources de calcium |
Pour les raisons sanitaires et environnementales développées dans ce rapport, il apparaît urgent de diversifier davantage les apports en protéines dans les assiettes des enfants. En imposant à titre expérimental un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires à compter du 1 er novembre 2019, la loi Egalim permet de faire une partie du chemin [179] . Mais il nous semble qu’il faut aller plus vite et plus loin. Pour cela, un bon objectif serait de viser pour 2022 l’obligation de proposer à chaque repas servi une alternative végétarienne dans toutes les communes de plus de 100 000 habitants, ou dans celles proposant déjà deux choix de plat aux enfants, en privilégiant dans le plat principal le « fait maison » avec des produits bruts, les associations légumineuses-céréales et la diversification des sources de calcium (amandes, légumes verts…). Pour atteindre un tel objectif dans le respect des équilibres nutritionnels, il importera, comme il a été dit ( cf. supra Proposition 8), de mieux former les cuisiniers aux équilibres d’une cuisine plus végétale ainsi que de diffuser une information cohérente auprès des enfants et de leurs familles. Cette option végétarienne quotidienne marquera un progrès sanitaire et environnemental. Mais elle assurera également un progrès culturel en garantissant le pluralisme alimentaire et la liberté de choix. |
PROPOSITION 12 : Revoir les recommandations nutritionnelles en termes de quantité, de fréquence, et diversifier les sources de protéines |
Nous proposons également de revoir les recommandations nutritionnelles sur les grammages proposés, de les adapter en fonction du nombre de composantes du menu, de prendre en compte l’apport calcique des produits laitiers présents dans le plat principal ainsi que l’apport calcique d’autres aliments (en tenant compte de leur degré d’assimilation), et de faire dépendre le nombre de composantes (4 ou 5) des plats choisis. De même, la réduction de la part des protéines animales peut passer par un mix protéines animales-végétales dans un même plat afin de diminuer les portions de viande tout en habituant progressivement les enfants à manger des légumineuses. |
Rendre la gouvernance alimentaire plus transparente à toutes les échelles de son élaboration en incluant davantage les citoyens et la société civile
PROPOSITION 13 : Rendre la gouvernance alimentaire plus transparente |
La crédibilité des recommandations nutritionnelles passe par une gouvernance de la politique alimentaire qui soit transparente et, autant que possible, partagée, ainsi que par des débats scientifiquement argumentés. Une pluralité d’acteurs doivent y être associés, que ce soit en termes d’autorités publiques pilotant ces recommandations (ministère de la Santé, ministère de l’Agriculture, ministère de la Transition écologique et solidaire…) ou en termes de qualité des membres impliqués dans les groupes de travail (nutritionnistes, scientifiques, entreprises, associations d’usagers, associations de professionnels, ONGs environnementales, etc.) afin de prendre en compte les multiples enjeux liés à l’alimentation. Le ministère de la Santé vient d’ailleurs de créer un groupe de travail « nutrition » dans lequel siègent, aux côtés des acteurs traditionnellement impliqués, des associations de protection de l’environnement. Ce groupe de travail est chargé de réécrire le décret de 2011, qui impose certains critères et fréquences d’aliments dans les menus et sera chargé d’évaluer l’expérimentation des repas végétariens. Les débats qui ont lieu à cette occasion doivent être le plus transparents possible et encadrés par la puissance publique afin de réduire la suspicion à l’égard des recommandations et de permettre un débat contradictoire où toutes les voix se seront fait entendre. |
PROPOSITION 14 : Pour une démocratie participative, créer des conseils de politique alimentaire à l’échelle locale |
L’introduction d’une nouvelle gouvernance de la chaîne alimentaire locale favoriserait des liens économiques et sociaux plus directs entre zones rurales, périurbaines et urbaines. Malgré une profusion d’initiatives, les politiques alimentaires globales font aujourd’hui défaut à l’échelle des territoires. Les Plans alimentaires territoriaux (PAT) créés en 2014 sont un excellent point de départ pour la consolidation de filières territorialisées et le développement de la consommation de produits issus de circuits courts. |
Ils pourraient s’appuyer localement sur des conseils de politique alimentaire (inspirés des Food Policy Councils anglo-saxons) permettant une réelle démocratie participative dans l’élaboration d’une stratégie alimentaire locale. Ces conseils incluraient citoyens et acteurs de la société civile pour proposer des solutions innovantes et transdisciplinaires en vue d’améliorer les systèmes alimentaires à l’échelle territoriale, en s’assurant qu’ils soient plus durables du point de vue environnemental et plus justes du point de vue social. La multiplicité des acteurs impliqués permettrait de développer une approche plus holistique et transdisciplinaire en rassemblant différentes expertises complémentaires autour de la table. |
Ces conseils se verraient confier quatre missions : 1) servir de forums pour discuter de questions liées à l’alimentation, 2) encourager la coordination entre différents secteurs liés à l’alimentation, de la production au recyclage, 3) émettre des avis afin d’influencer les politiques publiques et réaliser un travail de suivi et de monitoring sur la mise en œuvre des politiques publiques, 4) fournir des conseils stratégiques et mener des initiatives concrètes qui répondent à des besoins locaux. |
PROPOSITION 15 : Impliquer davantage les enfants et leur famille dans l’organisation de la cantine
La confiance est une condition clé de la bonne conduite de la transition alimentaire dans les cantines. Pour cela, il importe d’améliorer la transparence à destination des usagers et de leur famille en facilitant la visite des cuisines, en proposant des repas tests, des rencontres avec le personnel, en communiquant sur la composition des préparations, en organisant des commissions menus hors les murs, en distribuant des questionnaires/tests auprès des enfants pour connaître leur retour sur les repas (guidés par les enseignants jusqu’en CE1) et en faisant connaître leurs résultats.
Améliorer la configuration des espaces de restauration afin de les rendre propices au bien-manger
PROPOSITION 16 : Investir dans le bien-être à la cantine |
Comme il a été suggéré précédemment ( cf. Proposition 4), le fonds « Publics et territoires » pourrait être mobilisé pour accompagner les collectivités dans leurs entreprises de rénovation et d’amélioration de leurs espaces de restauration (isolation phonique, mobilier modulable, îlots, etc.). Cet accompagnement pourrait également viser la conception et la construction d’espaces de restauration neufs qui prennent en compte les problématiques de circulation, de modularité et d’isolation phonique. On sait que la configuration de l’espace et l’atmosphère d’une salle ont une grande influence sur ce que mangent les enfants. Il s’agit de pouvoir disposer de locaux agréables et adaptés au nombre de convives accueillis en repensant la circulation des usagers et des flux pour mettre en valeur certains aliments, pour favoriser des temps de repas adaptés aux besoins des enfants et pour faciliter leur encadrement par le personnel de cantine. |
Avoir une politique ambitieuse de réduction du gaspillage alimentaire
PROPOSITION 17 : Lutter contre la production de déchets et valoriser tous les excédents inévitables |
La loi Egalim contient d’ores et déjà les dispositions nécessaires pour que le gouvernement puisse imposer rapidement aux acteurs de la restauration collective la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, ainsi que la publication de leurs engagements en ce sens, notamment les procédures de contrôle interne qu’ils comptent mettre en place en la matière. De la même façon, elles vont permettre d’appliquer à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire une obligation de don des excédents à des associations volontaires en tenant compte des expérimentations conduites par ces dernières. |
Mais il importe de sensibiliser les acteurs au fait que l’objectif doit rester de générer le moins d’excédents possible tout au long de la chaîne. Pour cela, ce sont les pratiques qu’il faut changer. Par exemple, une partie du gaspillage dans les cantines est lié à une mauvaise estimation des convives effectivement présents. Pour s’ajuster au mieux aux besoins réels, il importe d’accompagner les collectivités pour simplifier les procédures d’inscription et de désinscription au repas (possibilité de décommander son repas en ligne notamment). De la même façon doivent être développées dans les cantines les tables de troc, la découpe à l’avance des fruits, les pratiques de self-service permettant aux enfants de se servir selon leur appétit (plutôt que de leur présenter des portions excessives), etc. |
Bien sûr, une partie de ces excédents reste inévitable. Pour la gérer, la contractualisation avec une association volontaire est une solution. Il peut être également envisagé de recycler/valoriser les excédents qui ne pourraient pas être pris en charge par l’association, par exemple par le compostage, qui pourrait d’ailleurs alimenter des jardins publics ou servir aux agriculteurs locaux (en cas de gestion directe notamment), ou encore par la livraison de ces excédents organiques à une structure disposant d’un méthaniseur. |
Se doter des outils politiques pour permettre un approvisionnement plus local des cantines
PROPOSITION 18 : Réfléchir à une exception alimentaire de 30 % de produits régionaux dans les cahiers des charges
Nous proposons d’étudier la possibilité d’introduire dans le code des marchés publics une exception alimentaire permettant de conclure des marchés de gré à gré avec des petits producteurs locaux qui répondent rarement à un marché public, faute de moyens ou de compétences, et avec lesquels il peut être difficile voire impossible d’anticiper des approvisionnements à six mois alors même que les acteurs privés agissant dans le cadre d’une délégation de service public ont, eux, la possibilité de s’ajuster au dernier moment en fonction des quantités et des prix proposés. Cette exception alimentaire pourrait justifier l’introduction d’une marge de 30 % de produits régionaux dans les cahiers des charges. Ces perspectives devraient être instruites sans attendre au niveau national comme au niveau européen.
PROPOSITION 19 : Avoir une politique volontariste de gestion du foncier pour accroître la diversité et l’autonomie alimentaires des territoires |
Une politique volontariste de gestion du foncier est nécessaire pour permettre un approvisionnement bio des cantines scolaires, sans avoir recours à des importations. En effet, cet approvisionnement peut passer par l’accompagnement d’un agriculteur déjà en activité vers une production bio destinée à l’alimentation humaine et/ou par l’installation de nouveaux agriculteurs. En particulier, des dispositifs d’accompagnement de jeunes agriculteurs doivent être imaginés pour reprendre les exploitations de la moitié des agriculteurs qui va partir à la retraite dans les dix prochaines années. |
Pour encourager le changement de pratiques et l’installation des agriculteurs, et afin d’améliorer l’approvisionnement des cantines, trois axes doivent guider l’action publique, que ce soit en termes d’aménagement du territoire ou de développement : 1) s’inscrire dans l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, dans la continuité des lois de 2014 et 2016 sur l’agriculture et la biodiversité, objectif retenu également dans le Plan biodiversité (section 1.3.) publié par le gouvernement en juillet 2018 [180] ; 2) préempter au besoin des terres, notamment en revalorisant des friches, pour lutter contre la déprise agricole et accompagner l’installation d’agriculteurs bio, en soutenant et en travaillant étroitement avec des associations compétentes ; 3) œuvrer pour une diversification des cultures au sein des territoires afin d’augmenter le nombre d’hectares couverts par des cultures vivrières et ainsi améliorer l’autonomie alimentaire des villes sans les mettre en concurrence entre elles. |
Ces trois axes doivent être traités en parallèle, et il est recommandé aux communes de ne pas se limiter à un court rayon d’action ; il est ainsi possible de créer des coopérations avec d’autres départements plus ruraux que ceux des grandes métropoles pour créer un effet d’entraînement vertueux et pour ne pas pénaliser des territoires à faible potentiel agronomique. |
Conclusion
La transition alimentaire repose sur un pari ambitieux, énoncé dès le début de ce rapport : développer une alimentation à la fois plus conforme aux impératifs de santé publique, plus respectueuse des équilibres écologiques, plus cohérente avec un modèle agricole soutenable (pour les agriculteurs comme pour les sols qu’ils cultivent) et plus accessible pour les catégories modestes. Les politiques agroalimentaires ne peuvent plus être guidées, comme elles le furent dans l’après-guerre, par le seul souci de produire en masse pour nourrir une population en forte expansion, ou, comme elles furent dans les années 2000, par le seul souci de prévenir des affections de longue durée associées à la surconsommation de produits trop gras, trop sucrés et trop salés. Si les préoccupations nutritionnelles et sanitaires demeurent et même s’aiguisent, elles ont été rejointes par un impératif écologique qui appelle une profonde réforme du modèle agricole et des habitudes alimentaires, c’est-à-dire en définitive une transformation de l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. En ce sens, ces politiques publiques doivent désormais relever un défi beaucoup plus systémique.
Comme l’ont compris les initiateurs de la loi Egalim, les cantines scolaires sont l’un des leviers stratégiques à la disposition des pouvoirs publics pour relever ces défis et accélérer la transition au bénéfice du plus grand nombre. Mais on est encore loin du compte. Notre exploration a montré, s’il en était besoin, que le chantier est vaste et qu’il y a beaucoup de chemins à parcourir pour passer d’une disposition législative et son application efficace.
Pour mener à bien la transition alimentaire dans les cantines scolaires, il faut en effet revoir une partie significative de leur organisation (la formation et le traitement de leurs personnels, la structuration de leur restaurant scolaire, leur système d’approvisionnement, la construction de leurs marchés publics, etc.), redéfinir les équilibres nutritionnels des menus (les grammages recommandés, la part des protéines végétales, etc.), lutter contre le gaspillage (réduire les excédents, gérer les déchets organiques, etc.), mieux éduquer à l’alimentation… Le tout sans perdre de vue les dimensions sociales et économiques de la restauration collective en milieu scolaire : non seulement les cantines doivent être accessibles aux enfants de tous les milieux sociaux, mais l’intérêt des agriculteurs doit être pris en compte et les meilleures pratiques dans leur domaine encouragées par la commande publique (bio, agro-écologie, etc.). Pour réussir la transition alimentaire, il faut en effet embarquer les agriculteurs et même, si possible, piloter le processus à l’échelle du territoire en y développant une gouvernance la plus inclusive possible (par exemple dans le cadre d’un PAT).
Les propositions que nous faisons sont, dans une large mesure, complémentaires des objectifs désormais fixés par la loi, mais elles invitent à aller plus loin et plus vite, et à s’intéresser de plus près aux blocages concrets auxquels se heurtent les donneurs d’ordres, en l’occurrence les collectivités locales. Si l’on ne s’arrête pas sur ces difficultés, il y a de fortes chances que les engagements généraux, si vertueux soient-ils, restent lettre morte dans de nombreuses villes et villages de France. Or, si la transition alimentaire est possible partout, force est de reconnaître que l’on ne rencontre pas les mêmes problèmes et que l’on ne dispose pas des mêmes atouts dans une petite ville de l’Ardèche et dans une grande métropole. Partout, en revanche, s’imposent la montée en compétence, une bonne connaissance des ressources du territoire et la mobilisation des énergies. Partout également doivent être envisagées les mutualisations utiles (des moyens, des lieux, des personnels, des compétences…).
Mais si nous avons mis l’accent ici sur les cantines scolaires du premier degré, c’est parce que nous faisons le pari que les enfants d’aujourd’hui pourront être demain les agents déterminants d’une alimentation plus lucide et plus durable. Les progrès réalisés aux âges de l’école élémentaire peuvent se diffuser à la fois dans les familles, sur d’autres tranches d’âge, puis, par un effet de halo, dans l’ensemble de la société. Pour accompagner cette diffusion, il convient toutefois de veiller à ce qu’il n’y ait pas de ruptures importantes dans la suite du parcours scolaire et que les efforts ainsi réalisés ne soient pas ruinés au collège, au lycée, voire plus tard dans les restaurants universitaires et professionnels. C’est pourquoi il serait utile de prolonger ce travail dans ces différentes directions.
Enfin, il convient de rappeler avant de refermer ce rapport que la transition alimentaire ne réussira que si le repas reste une source de partage et de plaisir. Rien dans les transformations qu’implique cette transition ne l’interdit, au contraire. La lucidité sur l’impact environnemental de l’alimentation et la meilleure connaissance de ses effets sur la santé conduiront à redécouvrir un nuancier de saveurs que l’usage des produits ultra-transformés, la spécialisation agricole et les manipulations de l’industrie agroalimentaire nous ont fait oublier. Une nouvelle culture alimentaire et gastronomique est sur le point de voir le jour. Elle rappellera que savoir et saveur ont la même origine.
« La viande au menu de la transition alimentaire : enjeux et opportunités d’une alimentation moins carnée », rapport de Terra Nova, octobre 2017, http://tnova.fr/rapports/la-viande-au-menu-de-la-transition-alimentaire-enjeux-et-opportunites-d-une-alimentation-moins-carnee ↑
Nous nous sommes concentrés sur le secteur public, numériquement très dominant dans la restauration scolaire dans notre pays. Toutefois, de nombreuses considérations de ce rapport vaudraient également dans les cantines des écoles privées. Du reste, la plupart des dispositions de la loi Egalim relatives à la restauration collective, et en particulier scolaire, s’appliquent au privé. ↑
Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. ↑
Sont concernés par l’article 24 de la loi Egalim (codifié aux articles L. 230–5, L. 230–5–1 et L. 230–5–2 du CRPM) 1) pour les personnes morales de droit public, l’ensemble des restaurants collectifs dont elles ont la charge ; 2) pour les personnes morales de droit privé, les services de restauration scolaire et universitaire, les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires dont elles ont la charge. Il s’agit des services mentionnés à l’article L. 230–5 du CRPM. Les restaurants administratifs des entreprises privées ne sont pas concernés. ↑
C’était l’une des propositions phares du rapport de Terra Nova « La viande au menu de la transition alimentaire », op. cit . ↑
La notion d’AUT est récente. Elle a été mise en avant par une équipe de chercheurs de l’université de São Paulo au Brésil et en France par Anthony Fardet, docteur et chercheur à l’Inra en nutrition préventive. ↑
La classification Nova, créée en 2010 et reconnue par la FAO, permet de mettre en évidence le degré de transformation des aliments. Elle se décompose en quatre catégories : groupe 1 (aliments frais ou minimalement transformés – fruits et légumes, légumineuses, œufs, viandes fraîches, lait, yaourt nature…) ; groupe 2 (ingrédients culinaires peu transformés – condiments, beurre, huiles, sucres…) ; groupe 3 (aliments transformés – produits simples fabriqués avec des aliments du groupe 1 avec ajout de substances du groupe 2, comme les légumes en bouteille, conserves de poisson, fruits au sirop, fromages, pains…) ; groupe 4 (aliments ultra-transformés – produits industriels comportant plus de 4 ou 5 ingrédients). Ces derniers produits sont généralement denses, riches en sucres ajoutés, en sel et en matières grasses, comme par exemple les sodas, céréales pour petits déjeuners, plats cuisinés, biscuits, yaourt aux fruits… ↑
Le Plan national nutrition santé (PNNS 4) renvoie sur ce sujet à l’étude Nutri-Net Santé, qui suggère une association entre la consommation de produits ultra-transformés (selon la définition Nova) et le risque de développement de maladies chroniques, en précisant que « les études doivent être poursuivies, notamment pour caractériser des aliments ultra-transformés, dresser un état des lieux de l’utilisation des additifs dans les denrées et établir les liens entre l’occurrence de tel ou tel additif dans les denrées et son impact sur la santé » (p. 26). Une large étude prospective met en avant qu’une consommation plus élevée d’AUT est associée à une augmentation de risques de maladies cardiovasculaires, coronariennes et cérébrovasculaires (Srour B., Fezeu L.K., Kesse-Guyot E., Allès B., Méjean C., Andrianasolo R.M., Chazelas E., Deschasaux M., Hercberg S., Galan P., Monteiro C.A., Julia C., Touvier M., « Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study », BMJ , 29 mai 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31142457 ). ↑
Voir à ce sujet les recommandations de « Manger Bouger » (PNNS), http://www.mangerbouger.fr/ ↑
« Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 », The Lancet , vol. 393, p. 1958–1972, mai 2019, disponible ici : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140–6736(19)30041–8/fulltext ↑
Voir le PNNS 2019–2021. On en trouvera un bon résumé ici : https://quoidansmonassiette.fr/pnns-4-nouvelles-recommandations-alimentaires-et-sur-lactivite-sportive-de-sante-publique-france-pour-2019–2021/ ↑
Voir par exemple l’étude de l’Inserm de 2016, sur le développement cognitif des enfants : « Pyrethroid insecticide exposure and cognitive developmental disabilities in children: The PELAGIE mother–child cohort », Environment International , v ol. 82 , septembre 2015, p. 69–75, disponible ici : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412015001245 ↑
Voir, par exemple, C. Hylanda, A. Bradman, R. Gerona, S. Patton, I. Zakharevich, R. B.Guniera, K . Klein, « Organic diet intervention significantly reduces urinary pesticide levels in U.S. children and adults », Environmental Research , vol. 171, avril 2019, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119300246 ↑
Voir J. Baudry, P. Pointereau, L. Seconda, R. Vidal, B. Taupier-Letage, B. Langevin, B. Allès, P. Galan, S. Hercberg, M.-J. Amiot, « Improvement of diet sustainability with increased level of organic food in the diet: findings from the BioNutriNet cohort », The American Journal of Clinical Nutrition , vol. 109, n° 4, avril 2019. ↑
Alors que 1,5 million de tonnes de plastique étaient produites au niveau mondial en 1950, environ 300 millions le sont maintenant chaque année selon https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017–002.pdf ↑
Agores, « Les alternatives aux conditionnements en plastique dans la restauration collective », Livre blanc, acte 1 (2019). ↑
Ce collectif mêle chercheurs et parents d’élèves. On peut consulter leur site Internet ( https://cantinesansplastique.wordpress.com/ ) ou encore leur livre paru en 2018 : Association Cantine sans plastique France, Pas de plastique dans nos assiettes ! Des perturbateurs endocriniens à la cantine , Éditions du Détour, 2018. ↑
Gideon Chibuisi, Caterina Faggio, « Microplastics in the marine environment: Current trends in environmental pollution and mechanisms of toxicological profile », Environmental Toxicology & Pharmacology , mai 2019, vol. 68, p. 61–74. DOI: 10.1016/j.etap.2019.03.001 ↑
En 2002, l’OMS a proposé une définition, ensuite reprise par l’Union européenne : « Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et, de ce fait, induit des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants et de (sous-) populations. » La spécificité de ces substances est d’entraîner une modification de la régulation hormonale pouvant contribuer à des cancers, à l’altération de la fertilité, au développement de maladies neurologiques, etc. Pour plus d’informations : Robert Barouki, « Les perturbateurs endocriniens et la prévention de précision », intervention lors de la Journée de l’Amisp, ministère des Solidarités et de la Santé, Paris le 19 juin 2017, Inserm UMR-S 1124 Toxicologie Pharmacologie et Signalisation Cellulaire. ↑
L’effet cocktail désigne les effets sur la santé de plusieurs substances chimiques ou contaminants auxquels les êtres humains sont simultanément exposés. Cette définition suggère que des molécules prises séparément peuvent voir leur toxicité augmenter lorsqu’elles sont combinées. ↑
D’après un sondage mené par la FNH auprès des restaurants collectifs engagés dans la démarche « Mon restau responsable ». La FNH explique ce fait par les difficultés organisationnelles qui en résultent, mais aussi par le coût matériel (achat de fours, de lave-vaisselle, d’infrastructures pour atténuer la pénibilité du travail, achat d’une flotte de véhicules plus importante pour supporter la surcharge correspondante) et par le coût humain (plus de personnel sera nécessaire pour laver la vaisselle et la pénibilité du travail pouvant résulter de ce changement pourrait augmenter l’absentéisme). Voir : http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/enquete_rc_062019.pdf ↑
D’ores et déjà, 20 % des cantines interrogées par Agores n’utilisent pas du tout de plastique et 16 % en utilisent seulement pour le stockage des denrées après déconditionnement. Agores note sur ce point qu’il n’y a pas de corrélation entre la taille des communes et les « bons et mauvais élèves ». La récente étude d’Unplusbio suggère néanmoins que les petites cantines ont plus de marge de manœuvre pour réaliser ces changements. Enfin, dans les alternatives déjà mises en œuvre, on peut citer : Bordeaux, qui a 12 cuisines centrales ou autonomes en liaison chaude, exemptes de plastiques pour cuire et réchauffer les aliments, Cenon (en Gironde), où l’inox devrait remplacer les plastiques, la Gironde qui a décidé de relocaliser ses cuisines et de privilégier une alimentation bio et locale (donc des produits bruts ne nécessitant pas de mise sous plastique), et Paris, où la sortie des plastiques a été votée pour 2020 et où un audit très complet est en train d’être mis en œuvre. ↑
Nous recommandons de consulter le « Guide méthodologique pratique d’évaluation de solutions de substitution » réalisé par l’Ineris en 2017 : https://substitution.ineris.fr/sites/substitution-portail/files/documents/guide_substitution_version_finale_1.pdf ↑
Par exemple, en mettant en place des réseaux de connaissances, des partenariats avec des centres techniques et scientifiques ou des pôles universitaires (Agores). ↑
L. Rogissart, C. Foucherot et V. Bellassen, « Estimer les émissions de gaz à effet de serre de la consommation alimentaire : méthodes et résultats », I4CE, 25 février 2019, https://www.i4ce.org/download/estimer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-la-consommation-alimentaire-methodes-et-resultats/ ↑
https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-des-terres-et-les-gaz-effet-de-serre-en-france ↑
Les émissions de GES importées désignent les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de produits importés, puis consommés ou transformés sur notre territoire. ↑
Greenpeace, rapport « Mordue de viande, l’Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja », juin 2019, https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/06/hooked_on_meat_FR_web.pdf?_ga=2.57880490.1263683881.1567358793–214749628.1553807285 ↑
Rapport de la Commission européenne sur le développement des protéines végétales dans l’UE, décembre 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0757 ↑
Le rapport d’IPBES permet d’identifier deux causes majeures de l’effondrement de la biodiversité : les pratiques agricoles d’abord et l’artificialisation des terres liée à l’urbanisme ensuite. Ces deux causes contribuent également à l’émission de GES qui contribuent eux-mêmes à l’érosion de la biodiversité. Le dernier rapport du Giec sur l’utilisation des sols le confirme. Voir : https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr et https://www.ipcc.ch/report/srccl/ ↑
Voir Rapport du Giec : https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr et https://www.ipcc.ch/report/srccl/ ↑
Voir WWF, « Pulse fiction. Pour une transition agricole et alimentaire durable », Rapport 2019 : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2019–10/20191015_Rapport_Pour-une-transition-agricole-alimentaire-durable-min.pdf ↑
Les circuits courts et de proximité permettent également de recréer du lien ville-campagne, consommateurs-agriculteurs, et surtout du lien à notre alimentation. ↑
E. Stehfest, L. Bouwman, D. P. van Vuuren et al ., « Climate benefits of changing diet », Climatic Change (2009) https://foodethics.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_foodethik/Stehfest__E._Netherlands_Enviro_Ass._Agency_2009._Climate_and_diet.pdf ↑
Ce gaspillage intervient à parts égales à tous les moments de la production-consommation. Les efforts doivent donc être faits à chaque étape. ↑
Voir le rapport de la FAO, « Global Losses and Food Waste : Extend, Causes and Prevention », 2011 : http://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.pdf ↑
Poux X., Aubert P.-M. (2018), « Une Europe agro-écologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. Enseignements d’une modélisation du système alimentaire européen », Iddri-AScA, Study n° 09/18, Paris, https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/une-europe-agroecologique-en-2050-une-agriculture ↑
D’un point de vue sanitaire, consommer de la volaille semble meilleur que consommer de la viande rouge, même si les recherches en la matière doivent se préciser. D’un point de vue environnemental, la tendance qui semble se dessiner chez les consommateurs de substituer de la volaille à de la viande rouge est cependant préoccupante. D’une part, parce qu’il s’agit de réduire la consommation de protéines animales en général et non pas de substituer un type de protéines animales à un autre, d’autre part car les élevages de volailles, contrairement à une idée reçue, sont aussi très nocifs pour l’environnement : la moitié du soja importé l’est pour nourrir la volaille et son alimentation fait concurrence à l’alimentation humaine. ↑
Voir notamment « Alimentation, agriculture et climat : état des lieux des politiques publiques et leviers d’action », 24 mars 2017, Réseau Action Climat France, www.rac-f.org ↑
Association Solagro, Le Scénario Afterres 2050, version 2016 : http://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf ↑
Et encore… Le besoin nutritionnel moyen en protéines a été établi par la FAO avec un niveau de preuve élevé, à 0,66 g/kg/j. Un apport nutritionnel conseillé à 0,8 g/kg/j, tel que préconisé par l’Afssa (Ambroise Martin, dir., Apports nutritionnels conseillés pour la population française , 3 e édition, Éditions TEC&DOC, 2009) est une recommandation de confort, dite de sécurité, pour une population habituée à consommer trop de protéines. Les protéines représentent ainsi en France 15 % à 17 % des apports énergétiques alors qu’un apport de 10 % serait sans doute suffisant. ↑
Par rapport à notre objet d’étude, il est intéressant de noter que les cantines engagées dans une démarche environnementale introduisent très souvent simultanément un menu végétarien par semaine et de la viande bio un autre jour de la semaine. En effet, 50 % des cantines avec des menus végétariens ont au moins une des viandes systématiquement en bio contre 14 % dans les cantines sans menu végétarien. Source : http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf ↑
C’est en effet le constat fait par WWF et ECO2 Initiative. Ils ont calculé que pour un même panier alimentaire pour une famille de 4 personnes, il était possible de diminuer l’empreinte carbone des repas de 38 %, de manger équilibré, et d’acheter 50 % de produits sous signes de qualité (dont du bio). Les conditions à remplir sont : diminuer la viande de 31%, les poissons sauvages de 40 %, les produits transformés industriels de 69 %, substituer des produits à base de farines raffinées par des produits à base de farines complètes à hauteur de 46 %, et augmenter la part des légumes, céréales et légumineuses de 95 %. Ce panier répondrait en grande partie aux préconisations environnementales et serait de meilleure qualité sanitaire à budget constant pour les ménages. Voir l’étude : https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/pour-le-meme-prix-manger-mieux-tout-en-reduisant-notre-impact-sur-la-planete-cest-possible ↑
Réseau Action Climat, « Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. Recueil d’expériences territoriales », septembre 2014. ↑
Voir l’enquête Agrican, « Agriculture et Cancer », novembre 2014, http://cancerspreventions.fr/wp-content/uploads/2014/12/AGRICAN.pdf ↑
Commission des comptes de l’agriculture de la nation, « Les résultats économiques des exploitations agricoles en 2017 », 18 décembre 2018, voir : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CCAN_resultats_eco_Rica_2017_18_12_2018–2.pdf ↑
L’excédent brut d’exploitation est la valeur produite au cours d’un cycle de production après déduction des approvisionnements utilisés (engrais, semences, produits phytosanitaires, aliments…), des services auprès des tiers (assurances, travaux par tiers, honoraires…), des impôts et taxes (non compris l’impôt sur le revenu) et des frais de personnel (salaires, charges sociales). Son calcul ne prend pas en compte les dotations aux amortissements et les éléments financiers et exceptionnels. ↑
Ce revenu est calculé en divisant le résultat courant avant impôt (RCAI) par le nombre d’unité de travail annuel non-salarié (UTANS), c’est-à-dire le nombre d’actifs familiaux. ↑
Commission des comptes de l’agriculture de la nation, op. cit. ↑
L’alimentation des bêtes représente 60 % à 66 % du coût de production dans la filière porcine, la rendant particulièrement sensible aux variations des cours mondiaux de certaines matières premières importées (notamment le soja). ↑
Dans la filière porcine, le niveau d’endettement moyen par exploitation a atteint 425 000 euros (soit un taux d’endettement de 65 %). ↑
Comme le regrette le président de l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, en préambule (p. 28) de son rapport 2019 https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Lists/Liste%20Rapports%20au%20Parlement%20et%20Lettres/Attachments/28/version_site_internet.pdf ↑
Ibidem. ↑
La marge nette se calcule en rapportant le bénéfice net au chiffre d’affaires afin de déterminer en pourcentage la rentabilité d’une entreprise, en prenant en compte toutes les charges. ↑
Observatoire des prix et des marges, rapport 2019, op. cit. , p. 343. ↑
Le groupe de suivi de la loi Egalim au Sénat note ainsi une inflation sur les produits frais de 1,2 % sans que cela « ruisselle » sur les revenus des agriculteurs. Mais une inflation de cet ordre est relativement normale, voire faible, et il est donc logique que cela ne se soit pas répercuté sur la rémunération des agriculteurs puisque les prix ont suivi leur tendance générale. Plus intéressant, ce groupe note aussi que les PME ont été fragilisées car la guerre des prix entre enseignes aurait été déplacée sur les marques de distributeurs dont les produits sont fournis par les PME. La plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire, notamment composée de la Confédération paysanne et d’UFC-Que-choisir, rapporte également que les bénéfices induits par la montée en gamme des produits alimentaires seraient accaparés par l’aval alors que les efforts sont consentis par les agriculteurs. Voir : https://www.senat.fr/rap/r19–089/r19–089-syn.pdf et
https://www.fne.asso.fr/communiques/loi-alimentation-un-apr%C3%A8s-peu-dam%C3%A9liorations ↑
Aymard M., Grignon C. & Sabban F., Le Temps de manger : alimentation, emploi du temps et rythmes sociaux , Éditions de la MSH, Inra, Paris, 1994. ↑
Pour une synthèse récente, voir : Haines J., Haycraft E., Lytle L., Nicklaus S., Kok F.J., Merdji M., Fisberg M., Moreno L.A., Goulet O., Hughes S.O., « Nurturing Children’s healthy eating: Position statement », Appetite. 2019. ↑
Credoc, revue Consommation et modes de vie , n° 253, juin 2012. ↑
Le ministère de l’Éducation nationale précise sur son site : « L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d’apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée et répartie au cours de la journée : par exemple 20 % du total énergétique le matin, 40 % au déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % le soir. » Voir https://www.education.gouv.fr/cid45/la-restauration-scolaire.html ↑
Conseil national de l’alimentation, « Les enjeux de la restauration collective en milieu scolaire », Avis n° 77, juillet 2017. ↑
Credoc , revue Consommation et modes de vie, n° 253, juin 2012. ↑
Voir Nicole Darmon, Florent Vieux et Christophe Dubois, « Qualité nutritionnelle des repas servis en restauration primaire », août 2016, https://umr-moisa.cirad.fr/content/download/6600/46353/version/2/file/Rapport+Etude+Restauration+Scolaire+2018+avec+resume.pdf ↑
Thibault H., Carriere C., Langevin C., Kossi deti E., Barberger-Gateau P., Maurice S., « Prevalence and factors associated with overweight and obesity in French primary-scholl children », Public Health Nutrition , 16(2): p. 193–201, 2013 et Cnesco, « Qualité de vie à l’école, comment l’école peut-elle proposer un cadre de vie favorable à la réussite et au bien-être des élèves ? » sous la direction d’Agnès Florin et de Philippe Guimard (octobre 2017). ↑
Belot, M. & James, J. (2011), « Healthy school meals and educational outcomes », Journal of Health Economics ,
30(3), p. 489–504. doi: 10.1016/j.jhealeco. ↑
Huebner, G., et al . 2016, « Beyond Survival: The Case for Investing in Young Children Globally », document de discussion, Académie nationale de médecine, Washington DC. ↑
La néophobie alimentaire est un sentiment de peur ressenti par certains enfants face à de nouveaux aliments. Ils présentent alors une grande réticence à goûter les plats inconnus et ont tendance à trouver « mauvais » toutes les préparations nouvelles. La néophobie alimentaire peut être plus ou moins marquée selon les enfants et elle peut s’exprimer de 2 ans à 10 ans. ↑
Chiva C. (2001), Émotion et pratiques alimentaires, approches neurophysiologiques , In w ww.lemangeur-ocha.com ↑
https://mrm.edu.umontpellier.fr/files/2016/01/JMAM-2005-J1_Articles.pdf ↑
Voir arrêté du 9 juin 2008, BO hors-série n°3 du 19 juin 2008, http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/NutritionProgrammesEnseignement.pdf ↑
Thibaut de Saint Pol et Layla Ricroch, « Le temps de l’alimentation en France », Insee Première , n° 1417, octobre 2012, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281016#titre-bloc-11 ↑
« La civilité, le savoir-vivre, enseignés de fait durant le temps de la restauration scolaire, peuvent également être considérés comme un objectif de base, même implicite (apprendre à partager l’espace, à respecter les règles de vie, à respecter l’autre). » (Conseil national de l’alimentation, avis cité). ↑
Comoretto G., « La « cantine », lieu privilégié de construction de la sociabilité enfantine », Actes du colloque international Alimentation, cultures enfantines et éducation, Centre européen des produits de l’enfant, université de Poitiers, Poitiers, 2010. ↑
Voir arrêté du 9 juin 2008, BO hors-série n°3 du 19 juin 2008, http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/NutritionProgrammesEnseignement.pdf ↑
Voir « La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine sociale », Drees, Études et résultats , n° 0993, février 2017. ↑
Cnesco, « Qualité de vie à l’école. Enquête sur la restauration et l’architecture scolaire », octobre 2017. ↑
Ibid . ↑
D’autres facteurs peuvent en effet intervenir et éventuellement s’ajouter : distance du lieu de restauration, temps d’attente, écart aux habitudes alimentaires, qualité des repas, etc. ↑
Le décret du 29 juin 2006 définit le principe de la liberté des tarifs de la restauration scolaire (les tarifs ne peuvent cependant excéder le coût du service rendu, selon l’article 147 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions). ↑
Chiffres un peu anciens cités par le Défenseur des droits, « Rapport sur les cantines scolaires », 28 mars 2013. ↑
https://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres.html ↑
Assemblée nationale, Rapport n° 2616 de Mme Gilda Hobert, mars 2015. ↑
Selon Gira Foodservice cité par Les Échos , 25/09/2018, « Cantines scolaires : le nouveau casse-tête des maires ». En 2013, le Défenseur des droits évoquait le chiffre de 400 millions de repas pour le premier degré. ↑
[7 – 2,75] x 320 millions = 1,36 milliard d’euros. ↑
[8,25 – 3,75] x 320 millions = 1,44 milliard d’euros. ↑
La transformation des aliments par l’industrie agroalimentaire représente 15 % de l’énergie mobilisée par la production et la commercialisation d’une denrée alimentaire (soit 4,9 millions de tonnes en équivalent pétrole), d’après https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-francais-bilan-carbone-alimentation-france-2019.pdf et https://negawatt.org/IMG/pdf/2018_unw_atelier_etude-cecam_c.barbier.pdf ↑
Selon le Défenseur des droits (2013), 20 % des repas du premier degré sont servis dans 4 550 structures de restauration avec préparation sur place, et 80 % le sont dans des cuisines centrales. ↑
Cette situation diffère de celle de la restauration scolaire dans les collèges et les lycées, assumée d’abord par l’État, puis transférée aux départements et aux régions en 2004. ↑
Nicole Darmon, Florent Vieux et Christophe Dubois ( https://umr-moisa.cirad.fr/content/download/6600/46353/version/2/file/Rapport+Etude+Restauration+Scolaire+2018+avec+resume.pdf ). ↑
En se basant sur des recommandations de l’Anses, Greenpeace a ainsi calculé que les recommandations du GEM-RCN couvraient jusqu’à 371 % des besoins des enfants de 6 ans. Pour plus de détails, voir : Greenpeace, « Viande et produits laitiers : l’État laisserait-il les lobbies contrôler l’assiette de nos enfants ? » (2017). ↑
Il faut rappeler ici qu’un menu végétarien peut comprendre des œufs et des laitages. En effet, les végétariens ne mangent ni viande ni poisson, mais ne s’interdisent pas les œufs, les laitages ou le miel. Les végétaliens, quant à eux, ne consomment aucun produit issu de l’exploitation animale (œufs, lait, miel…). Enfin, les vegan ajoutent au régime alimentaire des végétaliens un mode de vie qui exclut toute forme d’exploitation animale : ils ne portent pas de laine, cuir, soie, etc. ↑
La notion de circuits courts étant peu précise juridiquement, la loi a prévu que le critère serait : « Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ». L’Ademe doit aider les responsables de cantines à traduire ces notions de façon opérationnelle. ↑
Calendrier élaboré par le Conseil national de la restauration collective dans le cadre d’une brochure sur les mesures mises en place par la loi Egalim. Voir : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/105398?token=4395f84f0e3853d25f1305012ef853c4 ↑
Pour plus d’informations sur la gouvernance des recommandations nutritionnelles dans les cantines et ses évolutions récentes, l’analyse (critique) de Greenpeace est à consulter : « Cantines scolaires : les lobbies continuent de défendre leur bifteck » (2019). ↑
Ce groupe de travail est composé d’anciens membres du GEM-RCN mais il nous a été impossible de savoir s’il avait été mandaté par une autorité publique pour publier ces nouvelles recommandations ou s’ils ont agi de leur propre initiative. ↑
Les quatre types de composantes protidiques recommandées sont : 1/ composantes ou plats complets associant céréales et légumineuses ; 2/ composantes ou plats complets associant œufs et/ou produit laitier ; 3/ composantes ou plats complets associant céréales et/ou pommes de terre et/ou légumineuses + œufs et/ou produit laitier ; 4/ composantes ou plats complets à base de soja. ↑
La littérature scientifique sur le végétarisme et végétalisme est foisonnante ces dernières années dans les revues anglo-saxonnes, et la France apparaît d’ailleurs en retard dans la production et diffusion de ces recherches. En 2016, l’American Dietetic Association (la plus grande association mondiale de diététiciens) a publié une revue de littérature qui a acquis une certaine autorité depuis. Elle conclut qu’un régime végétarien ou végétalien, s’il est bien mené, ne comporte pas de risques de santé et peut même réduire la probabilité de certaines maladies, que ce soit durant l’enfance, l’âge adulte ou la grossesse. Voir : Melina V., Craig W., Levin S., « Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets », in Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (décembre 2016). Voir le résumé de l’étude : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886704 ↑
http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf ↑
https://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/dossier_de_presse-agence_bio_16_nov-def.pdf ↑
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/barquettes-en-plastique-a-la-cantine-grace-aux-parents-de-montrouge-c-est-presque-fini-06–05–2018–7701513.php#xtor=AD-1481423553 ↑
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/pontoise-le-plastique-a-la-cantine-c-est-bientot-fini-17–10–2019–8174883.php#xtor=AD-1481423552 ↑
http://www.reseau-environnement-sante.fr/charte-dengagement-villes-territoires-perturbateurs-endocriniens/ ↑
https://www.lagazettedescommunes.com/643247/pacte-de-milan-ces-villes-qui-sengagent-pour-une-alimentation-plus-durable/ ↑
Comme en témoigne la multiplication de collectifs de parents, l’ouvrage récent de Sandra Franrenet ( Le Livre noir des cantines scolaires. Sucre, bio, gaspillage, inégalités… La vérité sur les repas de nos enfants , septembre 2018), ou encore la publication d’un « Guide pratique pour les parents » sur les cantines, rédigé par le réseau Unplusbio ( http://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2016/11/Cantines-Bio-Guide-pratique-des-parents-Un-Plus-Bio.pdf ). ↑
Sondage réalisé en juin 2019 par Ipsos et le Cevipof, pour l’Association des maires de France (AMF). En ce qui concerne les priorités, les votants pouvaient voter pour trois priorités différentes (parmi dix), et la protection de l’environnement est arrivée en premier. La sympathie partisane ne change que très peu le score de cette priorité. En ce qui concerne les actions jugées prioritaires pour préserver l’environnement, les votants avaient deux choix (parmi huit), et la restauration collective est arrivée en sixième position. Pour plus de détails : https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=bff5dc2b94a752ebf825d768e1e69d44.pdf&id=39532 ↑
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2018/11/Restauration-Collective-Agence-Bio_2018.pdf ↑
http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf ↑
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/06/DP-AGENCE_BIO-4JUIN2019.pdf ↑
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/06/DP-AGENCE_BIO-4JUIN2019.pdf ↑
Elle précise en effet, dans son article 24 : « À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi […] pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. » ↑
Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&from=EN ) ↑
Rapport de la Commission européenne sur le développement des protéines végétales dans l’UE, décembre 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0757 ↑
En effet, la France reçoit aujourd’hui 9 milliards d’euros de la PAC chaque année, très insuffisamment orientés vers des pratiques et productions écologiques. Pour des propositions ambitieuses de réorientation de la PAC, voir : France Stratégie, « Faire de la politique agricole commune un levier de la transition agro-écologique » (23 octobre 2019), disponible ici : https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-de-politique-agricole-commune-un-levier-de-transition-agroecologique ↑
D’après GreenPeace, comme 71 % des terres agricoles européennes sont destinées à nourrir du bétail, l’élevage au sens large bénéficie de 28 à 32 milliards d’euros d’aides directes de la PAC en Europe, soit 18 % à 20 % du budget de l’Union européenne en 2017, que ce soit via des aides couplées ou via des aides à l’hectare. Voir rapport : « Feeding the problem, the dangerous intensification of animal farming in Europe », février 2019. https://www.greenpeace.fr/espace-presse/de-terres-agricoles-destinees-a-lelevage-europe/ ↑
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/ce-que-revelent-les-declarations-pac-sur-la-diversification-des-assolements-202–147473.html ↑
https://www.actu-environnement.com/ae/news/proteines-vegetales-importees-volonte-independance-europe-33954.php4 ↑
Une récente enquête du Monde , qui succède à de nombreux articles sur le sujet, montre comment en Andalousie (Espagne), région qui approvisionne l’Europe entière en légumes bio, ces légumes sont produits de manière industrielle, avec des conditions de travail délétères, exploitant notamment des migrants clandestins, dans une absence totale de transparence quant au respect de normes sociales et environnementales, en épuisant les nappes phréatiques d’une région soumise à de longues sécheresses et en utilisant massivement du souffre pour cultiver tomates, concombres, pastèques, aubergines et courgettes. Voir : Le Monde , « En Andalousie, plongée dans l’enfer des serres de tomates bio », 2 septembre 2019, https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/02/en-andalousie-plongee-dans-l-enfer-des-serres-de-la-tomate-bio_5505296_3244.html#xtor=AL-32280270 ↑
En juillet 2019, après de longs débats ayant divisé le monde agricole, le Comité national de l’agriculture biologique a autorisé les agriculteurs bio à utiliser des serres chauffées, à condition de ne pas les vendre entre le 21 décembre et le 30 avril (donc en hors saison) et à condition que le chauffage utilisé provienne d’énergies renouvelables à partir de 2020 pour les nouveaux entrants sur le marché, et à partir de 2025 pour les anciens acteurs de la filière. À noter qu’il faudrait utiliser près de 200 000 à 250 000 litres de fioul par hectare pour chauffer des serres bio tout l’hiver à 20 degrés (d’après un représentant de la Fnab) et que selon l’étude Food’GES de l’Ademe , une tomate produite en France sous serre chauffée émet quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate importée d’Espagne et huit fois plus qu’une tomate produite en France en saison. ↑
L’Observatoire national de la restauration collective bio et durable note ainsi que 80 % des collectivités qui ont répondu à leur dernier sondage et sont dans une démarche volontariste ont organisé des formations auprès du personnel de cuisine pour mener à bien leur projet ; et que 60 % d’entre elles sont intervenues sur la gestion des équipes en recrutant une personne, en réorganisant les postes et le temps de travail (http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf) ↑
http://restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr/category/observer/retour-denquete/ ↑
Un néorural est un citadin qui décide de s’établir en milieu rural et d’y travailler, ce terme étant utilisé dans cette note pour définir les citadins qui décident de s’installer dans l’agriculture. ↑
Voir, par exemple, Luoping Zhang, Lemaan Rana, Rachel M. Shaffer, Emanuela Taioli, Lianne Sheppard, « Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence », Mutation Research , vol. 781, juillet-septembre 2019. Voir également « Agricultural Health Study » (https://aghealth.nih.gov/), ainsi que l’enquête Agrican, « Agriculture et Cancer », novembre 2014, http://cancerspreventions.fr/wp-content/uploads/2014/12/AGRICAN.pdf ↑
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/10841/$File/conversion%20agri%20bio.pdf?OpenElement ↑
Voir Françoise Alavoine-Mornas et Sophie Madelrieux, « Passages à l’agriculture biologique. Une diversité de processus », Économie rurale , n° 339–340, janvier-mars 2014, p. 65–79, https://journals.openedition.org/economierurale/4235#tocto2n3 ↑
Un responsable de la grande distribution nous confiait récemment que cette course aux prix bas conduit à de véritables aberrations, donnant l’exemple de promotions proposant de la viande de bœuf à un prix inférieur aux aliments pour animaux domestiques. ↑
Fondation pour la Nature et l’Homme, Enquête « Quels besoins d’investissement en restauration collective pour engager la transition agricole et alimentaire dans les territoires ? », Juin 2019 http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/enquete_rc_062019.pdf ↑
On peut ainsi citer les manuels et ressources numériques créés par la maison d’édition Educagri Éditions, les documents techniques publiés par l’Itab, les groupes d’échanges de pratiques Pédagobio, ou encore le MOOC Bio porté par VetAgro Sup, Agreenium et l’Inra. ↑
Voir https://www.natexbio.com/quelle-place-pour-lagriculture-biologique-dans-lenseignement-agricole-aujourdhui/ ↑
Voir Jean-Marie Morin et Bertrand Minaud, « L’agriculture biologique dans l’enseignement agricole. Panorama, freins et leviers », Pour , n° 227, 2015, p. 207–215. Les auteurs sont les animateurs du réseau Formabio. ↑
Ibid. ↑
En France, on peut citer les exemples de Strasbourg, Le Havre, Montpellier, Douaisis, etc. (voir la liste : http://rnpat.fr/les-projets-alimentaires-territoriaux-pat/banque-des-pat/ ). L’association Terres en villes fédère également les initiatives, via une gouvernance paritaire entre élus et responsables agricoles. Dans les pays anglo-saxons, des exemples plus anciens tels que le Toronto, Portland ou Bristol Food Policy Council existent depuis plusieurs années, voire décennies, et montrent l’implication relativement ancienne de citoyens sur les sujets alimentaires. ↑
L’Observatoire national de la restauration collective bio et durable note ainsi que 68 % des collectivités ayant répondu à leur dernier sondage et étant dans une politique d’approvisionnement volontariste ont un projet alimentaire territorial (labellisé ou non). Voir : http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf ↑
Comme dispositions, on peut notamment citer les zones agricoles protégées (ZAP) ou les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (Paen). ↑
Pour un état des lieux de l’artificialisation croissante des sols, de ses conséquences et des leviers pour y remédier, voir : https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols ↑
Pour plus d’informations, voir : https://terredeliens.org/agir-avec-les-collectivites.html ↑
Pour plus de détails, voir Agence Bio, « L’emploi en agriculture biologique sur le territoire français », septembre 2017, http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/liste-biblio-emploi-agence-bio_coul.pdf ↑
De nombreuses associations se spécialisent dans l’insertion de personnes en situation de grande précarité via des activités de maraîchage. À titre d’exemple, on peut citer Les jardins de cocagne qui « permettent à des personnes de retrouver un emploi et de (re)construire un projet professionnel et personnel ». ( http://www.reseaucocagne.asso.fr/cest-quoi-un-jardin-de-cocagne/ ). ↑
L’agriculture urbaine n’a pas été traitée dans cette note car son potentiel est limité pour approvisionner toutes les cantines scolaires d’une grande ville. Néanmoins, son développement doit être encouragé, que ce soit pour sa dimension pédagogique ou parce qu’elle permet de végétaliser les villes. Pour un état des lieux exhaustif de l’agriculture urbaine et de ses potentialités, voir : Julien Fosse, « Les agricultures urbaines : potentiel de développement et impacts sur l’environnement et l’aménagement des territoires », La Fabrique écologique (mars 2019), disponible en ligne : https://www.lafabriqueecologique.fr/les-agricultures-urbaines-potentiel-de-developpement-et-impacts-sur-lenvironnement-et-lamenagement-des-territoires/ ↑
Un rapport très exhaustif a été publié sur l’ingénierie financière des PAT ( http://rnpat.fr/wp-content/uploads/2018/03/rnpat11-finpatrapport-2018.pdf ) et la Draaf d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis en ligne un outil pour comprendre les différents financements possibles ( http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Financer-un-Projet-alimentaire-sur ) ↑
En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2015–899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. ↑
https://agriculture.gouv.fr/localim-la-boite-outils-des-acheteurs-publics-de-restauration-collective ↑
Syndicat national de la restauration collective - http://www.snrc.fr/ ↑
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les_cl_en_chiffres_2018.pdf (p. 86). ↑
Équivalent temps plein. ↑
Art. 52-I de l’ordonnance n° 2015–899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; art. 62-II-2° du décret n° 2016–360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Un critère d’attribution reposant directement sur l’origine, l’implantation ou la proximité́ géographique des concurrents ne saurait être choisi par les acheteurs car il méconnaitrait les principes de non-discrimination, de liberté́ d’accès à la commande publique et d’égalité́ de traitement des candidats. ↑
https://www.adm-64.fr/fileadmin/adm/6_dossiers-thematiques/Enquete_VF_juin2017.pdf ↑
Le coût moyen de confection d’un repas s’obtient par l’addition de toutes les charges annuelles (denrées, personnel et toutes les autres charges induites) rapportée au nombre de convives de l’année. ↑
Une propriété organoleptique est une propriété qui affecte la sphère sensorielle (goût, odorat, etc.). ↑
Source : Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire (juin 2013). ↑
Ademe : infographie gaspillage alimentaire 2018, https://www.optigede.ademe.fr/sites/default/files/ademe-infographie-gaspillage-alimentaire-restauration-collective.pdf ↑
150 g * 3,8 milliards / 1 million = 570 000 tonnes ; et 200 g * 3,8 milliards / 1 million = 760 000 tonnes. ↑
« Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective », Guide pratique Ademe, ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, mars 2018. ↑
Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-1000-ecole-colleges-201809-synthese.pdf ↑
Guide méthodologique « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective » / Ademe – Draff Basse-Normandie, octobre 2014. ↑
Source ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. ↑
Enquête Sud Ouest http://www.sudouest.fr/dossiers/prix-des-cantines/ ↑
Tribunal administratif de Besançon, plénière, 7 décembre 2017, « Mme G. / Commune de Besançon », n° 1701724. ↑
h ttp://www.foodbank.org.au/wp-content/uploads/2015/05/Foodbank-Hunger-in-the-Classroom-Report-May-2015.pdf ↑
Enquête Credoc sur les Comportements et consommation alimentaires des Français (CCAF, 2016). ↑
Source : École nationale des industries du lait et de la viande – CAP agent polyvalent de restauration collective ; http://www.enilv74.org/cap-agent-e-polyvalent-e-de-restauration/ ↑
D’après l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable, 80 % des collectivités (répondantes) qui sont engagées dans une démarche responsable ont organisé des formations auprès du personnel de cuisine et 60 % sont intervenues sur la gestion des équipes en recrutant une personne, en réorganisant les postes et le temps de travail. Selon cette étude, le temps de travail récupéré ou investi est généralement consacré à la préparation des repas et à l’animation en salle ( http://observatoire-restauration-biodurable.fr/sites/default/files/R%C3%89SULTATS%202019%20-%20Observatoire%20national%20de%20la%20restauration%20collective%20bio%20durable.pdf ). ↑
Source : École nationale des industries du lait et de la viande, http://www.enilv74.org/certificat-de-specialisation-restauration-collective/ ↑
Source : « Quelles qualifications et compétences attendre des équipes de cuisine ? », intervention d’Yvan Cadou, directeur du développement RH chez Elior, président de la commission formation au Syndical national de la restauration collective, Séminaire sur les cantines scolaires, Cese, 13 juin 2019. ↑
Les légumineuses sont en effet une source importante de vitamines B1, B3, B5, B6 et B9. Elles ne contiennent en revanche aucune source de vitamine B12, laquelle fait défaut dans un régime exclusivement végétalien si des produits enrichis ne sont pas consommés ou si une supplémentation par comprimé n’est pas prévue. ↑
En savoir plus : http://labelbiocantine.com/wp-content/uploads/2019/07/Référentiel-EN-CUISINE-V5–01-janvier-2019-I-LEC-002.pdf ↑
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/cantines-bruit-et-stress-au-menu-tous-les-midis ↑
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/12/4/Module_2_Alimentation_301124.pdf ↑
Source : Charte de la pause méridienne – Ville de Lille https://www.lille.fr › Lille-Centre › content › download › file › charte+de+… ↑
Cohen J., Jahn J., Richardson S. et col. (2015) : « Amount of Time to Eat Lunch Is Associated with Children’s Selection and Consumption of School Meal Entrée, Fruits, Vegetables and Milk », Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Pour un résumé, voir :
https://www.cerin.org/etudes/cantines-scolaires-plus-la-duree-du-repas-est-courte-moins-les-enfants-mangent-bien/ ↑
Circulaire n° 2001–118 du 25 juin 2001. ↑
Selon les résultats d’une enquête sur les rythmes scolaires conduite par le SNUipp, disponible ici : http://consult-rythmes.snuipp.fr/les-resultats/des-organisations-diverses-des-pauses-meridiennes-souvent-longues-1 ↑
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-1000-ecole-colleges-201809-synthese.pdf ↑
http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/enquete_rc_062019.pdf ↑
La CAF octroie des financements pour l’encadrement des temps dit « éducatifs » mais elle ne reconnaît pas la pause méridienne comme tel. Par conséquent, ses financements sont inaccessibles pour ce temps du midi. ↑
C’était l’une des propositions du rapport de Terra Nova, « La viande au menu de la transition alimentaire », octobre 2017. ↑
Cet objectif a également été rappelé tout récemment dans une circulaire de J. Denormandie, J. Gourault, E. Borne et D. Guillaume aux préfets (« Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace »). ↑