Politique migratoire : l’exception espagnole
Tous les pays européens sont confrontés à une baisse des naissances qui fragilise les équilibres démographiques. Cette évolution a déjà des effets sur le marché du travail, où le recours à la main d’œuvre étrangère se révèle indispensable. Le cas espagnol étudié ici montre que la lucidité politique peut accompagner le réalisme économique.


L’immigration pour faire face au déclin démographique
L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. Longtemps pays d’émigration, l’Espagne devient une des premières terres d’immigration en Europe à partir des années 1990, en relation avec la croissance économique liée à son entrée dans l’UE. Le nombre d’immigré·es passe de 700 000 en 1999 à 5 millions en 2009. Après un recul dû à la crise économique de 2008, les arrivées repartent à la hausse depuis 2018. En 2022, les motifs d’entrée sont variés : circulation des citoyen·nes européen·nes, travail, regroupement familial ou raisons humanitaires.
L’immigration compense partiellement le vieillissement démographique. Sans elle, la population espagnole pourrait chuter de 48 à 24 millions d’ici 2100. En 2025, près de 19 % de la population résidente est immigrée. 40 % viennent d’Amérique Latine, tandis que les Marocain·es sont devenu·es la première communauté étrangère. Dans l’ensemble il s’agit d’une immigration assez jeune. La naturalisation concerne en moyenne 150 000 personnes par an, selon un régime fondé sur la résidence. Ces tendances font des migrations un enjeu crucial pour l’avenir démographique et économique de l’Espagne.
Travail et régularisations comme moteur de l’économie
Début 2025, l’Espagne est le seul pays européen à voir son PIB croître (croissance de 3,2 % en 2024). Trois facteurs sont désignés comme participant à la croissance : le tourisme, le plan de relance européen et l’immigration. L’Espagne a ainsi su lier politique migratoire et besoins économiques en s’appuyant sur l’immigration pour soutenir sa croissance, notamment via l’intégration d’immigré·es déjà présent·es sur son territoire.
Les régularisations de travailleurs·euses sans-papier ont concerné 1,25 million de personnes entre 1985 et 2006, et quelques 900 000 personnes pourraient être concernées à partir de 2025, avec des dispositifs législatifs assouplis. L’impact de la plus importante vague de régularisation en 2005 (environ 600 000 personnes) a été évalué : aucune hausse des flux migratoires n’a été observée, contredisant le mythe de l’appel d’air. Au contraire, l’emploi formel a progressé pour les immigré·es sans affecter celui des nationaux, tandis que l’emploi informel a reculé. Les recettes fiscales ont augmenté sans hausse des dépenses publiques. Ces régularisations ont ainsi favorisé l’intégration, stimulé l’économie et amélioré les conditions de travail.
Garde-frontières de l’UE : contrôle, externalisation et accords bilatéraux
En tant que pays frontalier de l’Union européenne, l’Espagne est un point d’entrée majeur de l’espace Schengen. L’intégration de l’Espagne à l’espace Schengen a renforcé son rôle de garde-frontière de l’UE avec une forte pression, impliquant des contrôles accrus et des accords bilatéraux avec les pays tiers africains, notamment le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. La coopération migratoire s’inscrit dans des stratégies mêlant sécurité, aide au développement et réadmission.
Le plus récent plan « Espagne-Afrique 2025–2028 » propose une approche réaliste du sujet en estimant que les migrations en Afrique ne se limitent pas à un déplacement unidirectionnel vers l’Europe, mais sont plus complexes et souvent des déplacements de proximité. L’Espagne est l’un des seuls pays européens à augmenter son aide publique au développement en 2025.
En revanche, le droit d’asile, bien que reconnu par la Constitution espagnole, est faiblement appliqué : le taux de protection est parmi les plus bas d’Europe, l’accueil est inégal et les capacités d’hébergement insuffisantes. Les pratiques aux frontières, notamment les refoulements depuis les enclaves de Ceuta et Melilla, sont régulièrement dénoncées. En tension entre exigences européennes, enjeux sécuritaires et droits fondamentaux, la politique espagnole aux frontières révèle les contradictions d’un modèle tourné vers l’intégration par le travail, mais confronté à des contraintes de contrôle toujours plus fortes.
Intégration décentralisée par le travail
En Espagne, l’intégration des immigré·es repose principalement sur l’accès au travail. Depuis 2020, le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, issu du ministère du Travail et indépendant de l’Intérieur, fixe les orientations en matière de politique migratoire et d’intégration. Sa mise en œuvre est largement décentralisée vers les Communautés Autonomes et les municipalités.
L’économie espagnole – notamment les secteurs du tourisme, du bâtiment, de l’agriculture et de l’hôtellerie-restauration – dépend largement de la main-d’œuvre étrangère. Entre 2021 et 2024, 40 % des nouveaux emplois ont été occupés par des immigré·es.
Les politiques publiques privilégient l’insertion professionnelle, avec l’implication des organisations patronales. L’acquisition de compétences et la reconnaissance progressive des qualifications facilitent l’intégration socio-économique. Toutefois, des obstacles persistent : précarité de certains emplois, accès au logement, ou encore inégalités d’accès aux droits. Le modèle espagnol se distingue par une approche pragmatique fondée sur l’inclusion via le travail malgré des parcours administratifs qui restent complexes.
Une opinion publique majoritairement favorable, malgré la polarisation politique
L’Espagne se distingue en Europe par une opinion publique relativement ouverte à l’égard de l’immigration, bien que marquée par une polarisation croissante. Le gouvernement de Pedro Sánchez assume une position singulière, défendant l’immigration comme une nécessité économique et démographique.
Cette approche contraste avec la montée du parti d’extrême droite Vox, qui a fait de l’immigration un levier de mobilisation électorale, notamment dans les régions les plus exposées aux arrivées. Les débats publics restent moins focalisés sur la sécurité que dans d’autres pays européens, et plus orientés vers les enjeux économiques ou humanitaires. Les médias jouent un rôle ambivalent, entre récits anxiogènes sur les arrivées irrégulières et valorisation du rôle des immigré·es. Malgré des tensions locales et une instrumentalisation politique croissante, une large majorité des Espagnol.es adhère à une vision pragmatique de l’immigration, fondée sur l’intégration par le travail et la reconnaissance de la contribution économique et sociale des immigré·es.
Résumé
Longtemps terre d’émigration, l’Espagne est devenue en quelques décennies l’un des principaux pays d’accueil de l’immigration au sein de l’Union européenne. Cette transformation rapide, amorcée dans les années 1990, a profondément marqué sa trajectoire démographique, économique et politique. En 2025, près de 19 % de la population résidant en Espagne est immigrée, avec des profils et origines très diverses telles que l’Amérique latine, le Maroc, ou encore l’Europe de l’Est. L’immigration constitue aujourd’hui un levier indispensable pour faire face au vieillissement démographique du pays, maintenir sa croissance économique et répondre aux besoins de son marché du travail.
L’Espagne se singularise par une politique migratoire pragmatique, centrée sur l’immigration de travail et fondée sur l’inclusion par l’emploi. Les programmes successifs de régularisations d’ampleur ont permis l’intégration de centaines de milliers de travailleurs·euses sans-papiers, sans générer d’appel d’air, avec un impact positif démontré sur les finances publiques et la croissance économique. Ce choix assumé s’appuie largement sur la tradition de dialogue social entre l’État, les syndicats et les organisations patronales et sur l’implication des collectivités locales. L’accès aux droits reste toutefois inégal, et les parcours administratifs souvent complexes.
La position géographique de l’Espagne en fait une porte d’entrée stratégique de l’espace Schengen. La gestion des routes migratoires, notamment à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries, est marquée par des tensions récurrentes et des pratiques controversées. Les accords bilatéraux avec les pays frontaliers de départ et de transit, en particulier le Maroc, s’accompagnent de coopérations sécuritaires et de politiques de réadmission, dans un cadre européen contraint. Le taux de protection au titre du droit d’asile reste relativement faible et les capacités d’accueil sont insuffisantes.
Malgré la montée des discours à l’encontre des personnes étrangères, fortement portés par le parti politique Vox, l’opinion publique espagnole reste majoritairement favorable à l’accueil, portée la perception du rôle positif des immigré·es dans la société sur le plan économique. Les médias, les ONG et l’Église participent à cette dynamique. L’Espagne assume une politique migratoire singulière, fondée sur le travail et l’inclusion, son gouvernement actuel porte un discours humaniste dans un contexte européen de plus en plus polarisé et des politiques de fermeture et de rejet vis-à-vis de l’immigration.
Introduction
Longtemps pays d’émigration, l’Espagne est devenue, en quelques décennies, l’un des principaux pays d’immigration en Europe. Ce retournement historique, amorcé dans les années 1990, s’est opéré dans un contexte de croissance économique, de mutation démographique et d’intégration européenne. Aujourd’hui, près d’un cinquième de la population résidant en Espagne est née à l’étranger. Cette dynamique place la politique migratoire espagnole au cœur de ses enjeux économiques, sociaux et géopolitiques contemporains.
L’objectif de cette étude est d’analyser, dans toutes ses dimensions, la politique migratoire de l’Espagne telle qu’elle s’est construite et transformée depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Elle met en lumière la manière dont l’Espagne a articulé immigration, marché du travail et intégration, tout en tenant compte des exigences européennes en matière de contrôle des frontières, et ses engagements en matière de droit d’asile et de coopération internationale. En croisant les évolutions législatives, les pratiques administratives et les réalités économiques et sociales, l’étude met en évidence une approche pragmatique singulière fondée notamment sur l’inclusion par le travail et des régularisations massives.
Cette singularité espagnole, qui s’incarne notamment dans le rôle central des considérations économiques, soulève une question essentielle : en quoi la politique migratoire espagnole se distingue-t-elle de ses voisines européennes, et quels enseignements peut-on en tirer dans un contexte de recomposition des équilibres démographiques et politiques sur le continent ?
Pour y répondre, l’étude est structurée en cinq parties. Elle retrace d’abord l’évolution démographique et les flux migratoires depuis les années 1980 en Espagne (1), puis examine le rôle de l’immigration de travail et des programmes de régularisations (2). Elle analyse ensuite la politique aux frontières et l’asile (3), les dispositifs d’intégration (4), et enfin la façon dont le monde politique espagnol aborde l’immigration, sa perception dans l’opinion publique et son traitement médiatique (5).
1. Démographie et immigration, faire face au déclin
En Bref
L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. Longtemps pays d’émigration, l’Espagne devient une des premières terres d’immigration en Europe à partir des années 1990, en relation avec la croissance économique liée à son entrée dans l’UE. Le nombre d’immigré·es passe de 700 000 en 1999 à 5 millions en 2009. Après un recul dû à la crise économique de 2008, les arrivées repartent à la hausse depuis 2018. En 2022, les motifs d’entrée sont variés : circulation des citoyen·nes européen·nes, travail, regroupement familial ou raisons humanitaires. L’immigration compense partiellement le vieillissement démographique. Sans elle, la population espagnole pourrait chuter de 48 à 24 millions d’ici 2100. En 2025, près de 19 % de la population résidente est immigrée. 40 % viennent d’Amérique Latine, tandis que les Marocain·es sont devenu·es la première communauté étrangère. Dans l’ensemble il s’agit d’une immigration assez jeune. La naturalisation concerne en moyenne 150 000 personnes par an, selon un régime fondé sur la résidence. Ces tendances font des migrations un enjeu crucial pour l’avenir démographique et économique de l’Espagne.
Pour mieux cerner la politique migratoire menée par l’Espagne, il est nécessaire de s’attarder sur l’évolution des flux migratoires (1.1), sur les profils des immigré·es (1.2) ainsi que les conditions d’acquisition de la nationalité espagnole pour les immigré·es (1.3).
1.1 Émigration ancienne, immigration récente
L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. En effet, l’Espagne a davantage été un pays d’émigration jusque dans les années 1990, pour ensuite devenir l’un des principaux pays d’immigration en Europe dans les années 2000[1] (a), avec des motifs variés d’immigration (b), qui s’inscrivent dans un paysage de déclin démographique ©.
Les flux migratoires dans l’histoire espagnole contemporaine
Pour bien comprendre l’évolution des flux migratoires, il est utile de se référer au solde migratoire[2], qui mesure la différence entre les arrivées (l’immigration) et les départs (l’émigration).
Figure 1. Solde migratoire de l’Espagne, 1960–2022

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat et ‘Perspective Monde’, Université Université de Sherbrooke, Québec, Canada[3]
En ce qui concerne l’émigration, dès la fin du XIXe siècle, les départs des Espagnol·es avaient pour destination l’Amérique latine ainsi que l’Algérie et la France[4]. Dans les années 1960 à 1980, période marquée par le franquisme, les départs sont nombreux vers l’Europe, avec environ 1,3 million d’Espagnol·es qui quittent leur pays[5], tandis que plus de 100 000 nationaux émigrent vers l’Amérique latine, le Canada et les Etats-Unis[6]. Plus récemment, dans la dernière décennie, un flux vers la France et le Royaume-Uni des jeunes Espagnol·es a été constaté, en lien avec un rapport moins favorable entre niveau élevé de diplômes et opportunités de travail[7].
En ce qui concerne l’immigration, les flux significatifs d’arrivées vers l’Espagne datent des années 1990, sous l’effet d’une croissance économique largement attribuée à son entrée dans la Communauté européenne en 1986. L’immigration augmente rapidement jusqu’en 2009. En 1999, l’Espagne comptait environ 700 000 immigré·es, soit 1,6 % de la population pour atteindre plus de 5 millions en 2009, 10 ans plus tard, soit 12 % de la population[8]. Par la suite, la proportion des immigré·es dans la population fluctue, baissant en 2010 à 10,7 %, sous le double effet d’une hausse de l’émigration de ressortissant·es espagnol·es et de départ des immigré·es, liés notamment à la crise économique de 2008[9].
Figure 2. Part des étranger·ères dans la population espagnole, 1980–2024

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données de l’INE[10]
Immigration et émigration fluctuent ainsi depuis les années 1990 en fonction de la santé économique du pays. Au cours des années 1990, c’est notamment le secteur de la construction et de l’immobilier qui explose et attire les immigré·es[11]. A contrario, la crise économique de 2008 a entraîné une chute de l’immigration et une reprise de l’émigration, résultant en un solde migratoire négatif de 2011 à 2014, avant de repartir à la hausse[12]. D’autres facteurs expliquent également un recul de l’immigration, comme le développement d’une politique des visas à l’égard de certains pays d’Amérique latine ainsi que des incitations financières au retour des immigré·es[13]. Pour autant, les flux d’arrivées reprennent à partir de 2018[14], jusqu’à aujourd’hui, avec une parenthèse lors de la crise sanitaire du COVID.
Figure 3. Mouvements migratoires en Espagne, 2015–2022
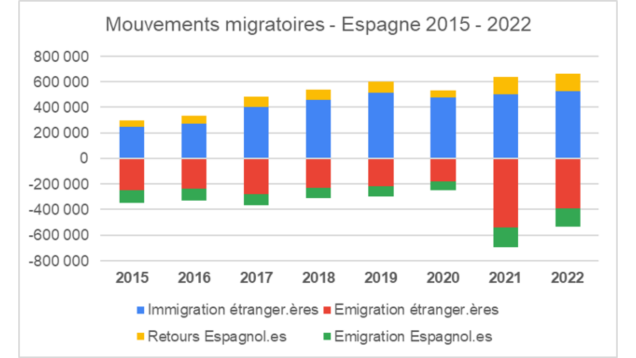
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données INE et OCDE[15]
À la fin du premier trimestre 2025, selon les statistiques publiées par l’Instituto Nacional de Estadistica (Institut national de la statistique espagnol – INE)[16], sur une population de 49,2 millions d’habitants, l’Espagne compte 9,1 millions d’immigré·es (18,6 % de la population) dont 2,5 millions sont naturalisé·es espagnol·es, et 6,9 millions d’étrangers·ères (14,1 % de la population).
Figure 4. Population immigrée et étrangère en Espagne par rapport à la population totale, 1er trimestre 2025

Source : élaboration par les auteurs·rices à partir des données INE[17]
L’Espagne se classe, au 1er janvier 2024, au 9e rang des pays de l’Union européenne, en proportion de personnes nées à l’étrangers au sein de sa population[18].
Figure 5. Proportion dans la population de personnes nées à l’étranger, au 1/1/2024, classement des 15 premiers pays de l’UE.
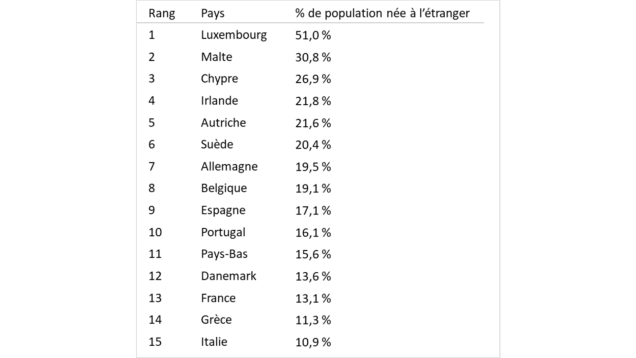
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[19]
À propos de la tendance démographique de l’immigration en Espagne au sein de l’Europe, la dynamique comparée avec les autres pays de l’Union montre que l’Espagne, à l’instar d’autres pays comme l’Irlande ou l’Allemagne, a vu ces deux dernières décennies une augmentation très significative de sa population immigrée, représentant presque 20 % de sa population aujourd’hui, un écart très significatif avec certains pays comme la France ou le Danemark, dont la proportion d’immigrés n’augmente que faiblement sur la même période[20].
Figure 6. Evolution de la part de population née à l’étranger, dans 9 pays l’UE, 2000–2024
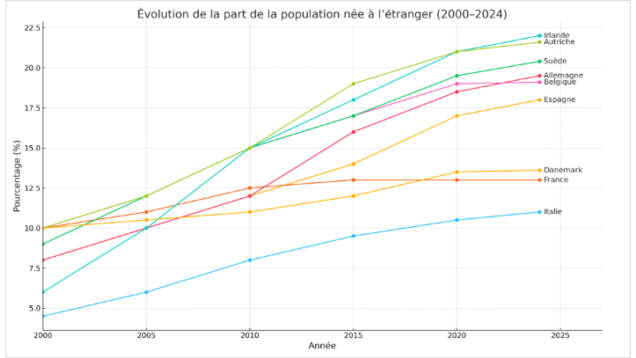
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[21]
b.Les différents types d’immigration vers l’Espagne
Figure 7. Nombre de titres de séjours délivrés par motifs en Espagne, par an, 2015–2022
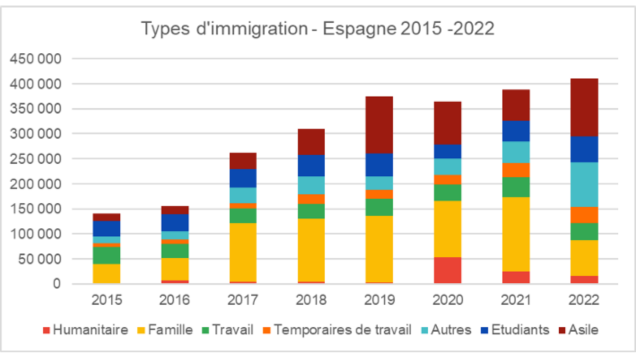
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données OCDE – Perspectives des migrations internationales[22]
Selon l’OCDE, en 2022, la répartition des nouveaux immigrés admis en Espagne par motif est la suivante : 35 % au titre de la libre circulation au sein de l’espace européen[23], 11 % pour le travail, 22 % en tant que membres de la famille (y compris la famille accompagnante) et 5 % pour des raisons humanitaires. Environ 49 000 permis de séjour ont été délivrés à des étudiant·es en mobilité internationale dans l’enseignement supérieur et 35 000 à des travailleurs·euses migrant·es temporaires et saisonniers (à l’exclusion de la migration intra-UE). Par ailleurs, 150 000 détachements intra-UE ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2021. Ces travailleurs·euses détaché·es ont généralement des contrats de courte durée[24].
Figure 8. Distribution de l’mmigration par motifs en 2022 en Espagne

Source : rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2024 pour l’Espagne[25]
c. Immigration et déclin démographique espagnol
En Espagne, dès les années 1980, la fécondité est inférieure au simple remplacement des générations et l’accroissement naturel est négatif depuis 2015[26]. L’immigration a permis de stabiliser le pays sur le terrain démographique, avec une croissance moyenne annuelle de sa population totale de l’ordre de 0,5 % sur la dernière décennie. En l’absence d’immigration, l’Espagne est exposée à un déclin démographique, une décroissance démographique majeure d’ici 2040 qui mettrait son modèle social et économique sous forte tension[27].
Figure 9. Projection de population en Espagne, 2025–2050
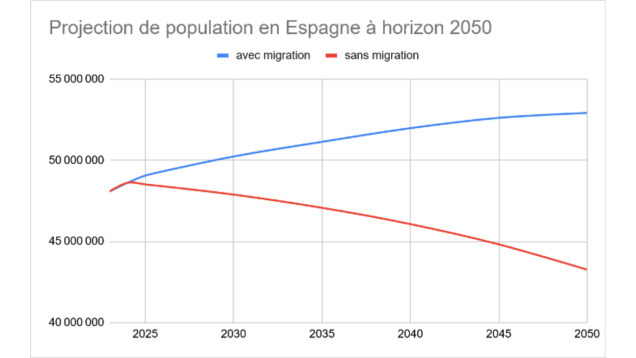
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat – Short-term population projections[28]
Les prospectives à long terme, ne prévoyant pas de rebond de la natalité, montrent qu’en l’absence d’immigration, la population de l’Espagne pourrait passer de 48 à 24 millions d’habitants d’ici 2100[29].
Le graphique ci-dessous, publié par le média The Guardian en février 2025, à partir de données Eurostat, projette le visage des populations européennes avec ou sans immigration. Selon cette illustration, si l’Espagne est très affectée par son déclin démographique[30], c’est une tendance commune à l’ensemble des pays européens.
Figure 10. Projections long terme à 2100 de population en Europe
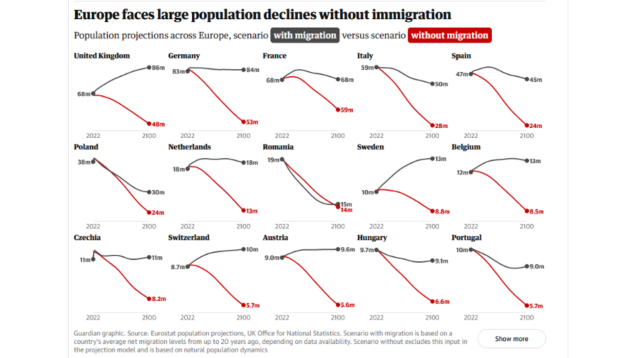
Source : The Guardian[31]
La politique migratoire espagnole est donc en partie à considérer en regard de ses projections démographiques, compte tenu des besoins de main-d’œuvre d’une économie en croissance, ainsi que d’un modèle social redistributif reposant largement sur la proportion d’actifs au sein de sa population.
1.2 Des profils de plus en plus divers
Pour percevoir qui sont les personnes immigrées présentes en Espagne, il est utile de s’intéresser à leurs origines (a.), leur genre (b.) et leur âge (c.).
a. Origines géographiques
Figure 11. Origines des immigré·es en Espagne par zones géographiques, 2024
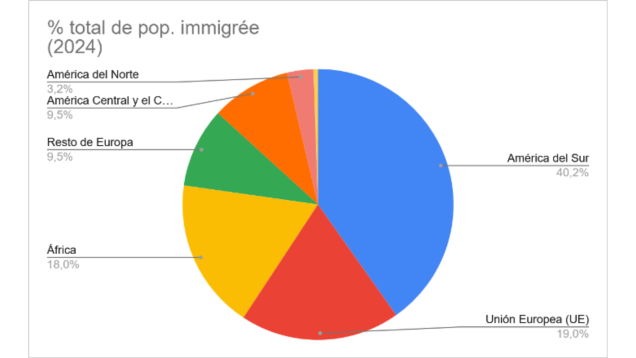
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données de l’INE[32]
Les nationalités d’origine des immigré·e.es sont d’abord liées à l’histoire coloniale de l’Espagne en Amérique latine, et à la proximité culturelle et linguistique qui en résulte. Ainsi, en 2024, 40 % de la population immigrée est issue de cette région. Ce sont ensuite les Roumain·es qui sont les plus nombreux jusqu’en 2012 (900 000), avant de diminuer au profit des Marocain·es (plus d’un million aujourd’hui). Les Britanniques arrivent dans les 10 premières nationalités d’origine, et la première de l’Union européenne (avant Brexit), avec un record en 2012 de 400 000 personnes, et près de 300 000 aujourd’hui[33].
La douceur du climat et l’attrait du mode de vie espagnol attire en effet des étrangers·ères d’Europe occidentale, en particulier du Royaume-Uni, qui se concentrent sur le littoral et dans les régions insulaires : retraité·es[34], mais aussi « digital nomads »[35], ou entrepreneurs des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration[36].
Population espagnole par pays de naissance :

Source: INE[37]
L’augmentation notable des flux en provenance de l’Amérique latine remonte aux années 1990. Alors qu’ils ne sont que quelques dizaines de milliers à résider en Espagne au début de la décennie, les graves crises financières, économiques et institutionnelles de la période 1998–2000, qui appauvrit brutalement les classes moyennes, génère des flux importants en provenance notamment de l’Equateur, de la Colombie et du Vénézuela[38].
À partir de 2002, et notamment suite à l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007, une expansion considérable de la diaspora roumaine dans différents pays de l’Union est observée, en particulier vers l’Espagne[39].
Enfin, avec une forte croissance ces dernières décennies jusqu’à aujourd’hui, ce sont les Marocain·es qui représentent les flux les plus importants, jusqu’à devenir la première communauté étrangère en Espagne. Cela s’explique par la proximité géographique : frontières terrestres avec le Maroc aux enclaves de Ceuta et Melilla, frontière maritime avec le détroit de Gibraltar et les îles Canaries.
En 2023, l’OCDE recense 52 % de femmes parmi la population immigrée en Espagne[40], proportion à l’image du reste de l’Europe[41]. Cependant, il existe des différences importantes en fonction de l’origine des immigré·es :
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les immigré·es d’Amérique du Sud (53,42 % de femmes) et d’Amérique Centrale (59,42 % de femmes).
Le rapport entre les femmes et les hommes originaires du continent européen est légèrement en faveur des hommes (52,41 % d’hommes).
Les hommes sont nettement majoritaires parmi les immigré·es d’origine africaine (subsaharienne et Nord-africaine) : la proportion de femmes dans ce groupe n’est que de 31,81 %.
La population immigrée venant en Espagne est globalement plus jeune que la population espagnole. Ainsi, 51,91 % des étrangers·ères résidant en Espagne (contre 32,66 % de la population dans son ensemble) sont âgé·es de 20 à 39 ans et 30,19 % des étrangers·ères sont âgé·es de 25 à 34 ans (contre 17,44 % de la population dans son ensemble)[42].
Les flux migratoires ont évolué dans le temps, qu’il s’agisse de l’émigration ou de l’immigration. Pour cette dernière, les profils des personnes venant s’installer en Espagne est variable mais peut être résumé en trois type de provenance : des anciennes colonies en Amérique Latine, de pays proches géographiquement, comme le Maroc, ou encore de pays membres de l’UE qui bénéficient de la liberté de circuler, comme les Roumains. Les immigré·es peuvent ensuite prétendre à la nationalité espagnole.
1.3 Les conditions d’acquisition de la nationalité espagnole
La principale voie d’acquisition de la nationalité espagnole pour les étrangers·ères est la naturalisation pour résidence, qui peut être demandée, en prouvant sa résidence « légale, continue et immédiatement antérieure à la demande », ainsi qu’un « degré suffisant d’intégration dans la société espagnole[43] ».
La période de résidence à démontrer est en principe de dix ans mais peut être réduite dans certains cas. Par exemple, la durée de résidence demandée est de cinq ans pour les personnes ayant le statut de réfugié·e ; deux ans pour les ressortissant·es originaires des pays d’Amérique latine ou de Guinée équatoriale ou encore un an pour celles et ceux qui sont né·es en Espagne[44].
Sur la décennie 2013–2023, l’Espagne a accordé la nationalité à 150 000 personnes par an en moyenne[45], et ces deux dernières années à plus de 200 000 par an (240 000 en 2024[46]).
Figure 12. Nombre de personnes résidentes ayant acquis la nationalité espagnole, par an, 2013–2023
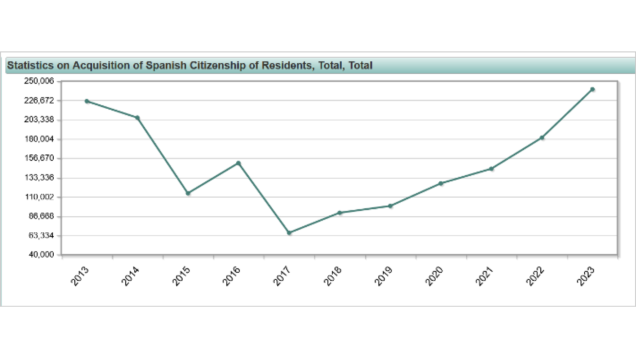
Source : INE[47]
En Espagne, l’acquisition de la nationalité pour les enfants nés sur le territoire espagnol de parents étrangers est régie par l’article 17 du Code civil espagnol[48], de même que pour les enfants dont au moins un des parents étranger est lui-même né en Espagne, né de parents apatrides ou de filiation inconnue.
Une douzaine de pays tels l’Argentine, le Brésil ou le Portugal, ont des accords spécifiques avec l’Espagne, permettant une acquisition facilitée de la nationalité pour les enfants nés en Espagne de parents étrangers, notamment des accords de double nationalité[49].
* * *
Le statut récent de pays d’immigration a influencé les choix de politique migratoire espagnole, en lien avec son évolution démographique, ses besoins économiques et son modèle social. Les profils des immigré·es sont variables, liés d’une part aux anciennes colonies latino-américaines et d’autre part aux zones géographiques les plus proches, mais sont, dans l’ensemble, plus jeunes que la population espagnole. L’objectif de l’Espagne est principalement d’attirer par le travail, pour intégrer et potentiellement accorder la nationalité aux immigré·es présent·es depuis un certain temps sur le territoire.
2. Immigration de travail et régularisations, pour la croissance économique
En bref
Début 2025, l’Espagne est le seul pays européen à voir son PIB croître (croissance de 3,2 % en 2024). Trois facteurs sont désignés comme participant à la croissance : le tourisme, le plan de relance européen et l’immigration. L’Espagne a ainsi su lier politique migratoire et besoins économiques en s’appuyant sur l’immigration pour soutenir sa croissance, notamment via l’intégration d’immigré·es déjà présent·es sur son territoire. Les régularisations de travailleurs·euses sans-papier ont concerné 1,25 million de personnes entre 1985 et 2006, et quelques 900 000 personnes pourraient être concernées à partir de 2025, avec des dispositifs législatifs assouplis. L’impact de la plus importante vague de régularisation en 2005 (environ 600 000 personnes) a été évalué : aucune hausse des flux migratoires n’a été observée, contredisant le mythe de l’appel d’air. Au contraire, l’emploi formel a progressé pour les immigré·es sans affecter celui des nationaux, tandis que l’emploi informel a reculé. Les recettes fiscales ont augmenté sans hausse des dépenses publiques. Ces régularisations ont ainsi favorisé l’intégration, stimulé l’économie et amélioré les conditions de travail.
Centrale pour le gouvernement espagnol, l’immigration de travail est au cœur des discussions politiques actuelles. En effet, même si l’immigration anticipée est assez faible (2.1.), les régularisations permettent d’intégrer des travailleur·euses étrangères·ers en grand nombre sur le marché du travail (2.2.).
2.1 Immigration de travail : moteur de la croissance économique espagnole
L’Espagne a fait de l’immigration l’un de ses moteurs de sa croissance économique (a.), les organisations syndicales et patronales sont impliquées pour combler les besoins de main-d’œuvre des secteurs en tension (b.), notamment pour les forts besoins de travailleurs·euses saisonniers dans le secteur agricole (c.).
a. Une croissance économique dynamique liée à l’immigration
Selon les Nations unies[50], il faudrait que l’Espagne intègre environ 12 millions d’immigré·es entre 2000 et 2050 pour répondre aux besoins de son marché du travail[51]. L’immigration s’avère être un des leviers du développement économique de l’Espagne, comme le confirme l’INSEE[52]. En effet, le pays connaît une forte croissance économique en 2024, plus forte que ses voisins européens[53]. Trois facteurs expliquent cette poussée : l’utilisation du plan de relance financé par des fonds européens, le tourisme et l’immigration[54].
Figure 13. Croissance annuelle du PIB dans différents pays d’Europe, 2015–2025
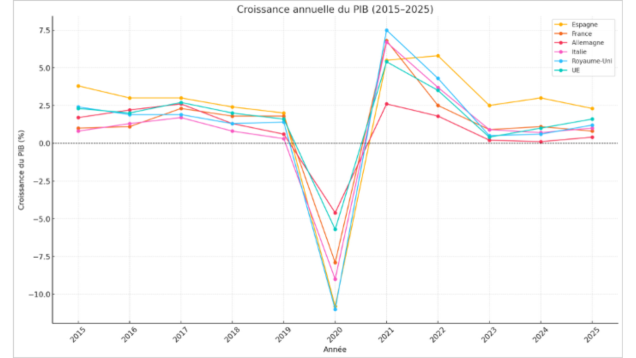
Source : Elaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[55]
La croissance espagnole bénéficie de façon structurelle d’une dynamique démographique alimentée par la croissance de la population immigrée. En effet, les immigré·es rajeunissent la population, ce qui implique une population plus active et qui soutient l’économie[56]. Ainsi, entre 2021 et 2024, 40 % des emplois créés en Espagne ont été pourvus par des étrangers·ères, représentant quelques 800 000 emplois et soulignant l’importance de la dynamique démographique dans la croissance du PIB[57]. Selon certains auteurs, le gouvernement a fait le pari que les immigré·es deviendraient des contribuables, participant activement à l’économie espagnole[58]. En 2006 déjà, le média Les Échos en France relevait que « l’immigration joue un rôle capital dans le “miracle économique” espagnol »[59]. Le constat se fondait sur un rapport présenté par l’économiste espagnol Miguel Sebastian.
Dans les années 1990, l’Espagne tente d’organiser l’immigration économique, en étant le premier pays européen à mettre en place un système de quotas pour la délivrance de titres de séjour pour le travail[60]. Ce sont des syndicats et représentants d’employeurs qui négocient les quotas, par région et par secteur économique[61], ce qui leur donne une place importante dans la gestion de l’immigration et favorise son acceptation dans la société. Dès sa mise en place, le système de quota ne fonctionne pas, les seuils peinant à être atteints. Une solution pragmatique est alors envisagée, celle d’intégrer les personnes déjà présentes en Espagne, mais en situation irrégulière. Ainsi, le quota d’entrées annuel donne finalement lieu à des objectifs de régularisation annuels[62]. Ce système sera pérennisé par l’adoption d’une loi en 2000[63].
b. Le rôle des organisations syndicales et patronales dans la politique migratoire
L’Espagne connaît une longue tradition de dialogue social tripartite (Diálogo Social) entre gouvernement, syndicats et organisations patronales, un marqueur de son modèle politique et social depuis la transition démocratique de 1978. Ce dialogue social donne lieu à l’adoption de nombreux accords sociaux tant au niveau national que des Communautés autonomes, qui se traduisent ensuite par des législations, issue donc de cette négociation[64] (par exemple, le décret royal de 2024 sur les régularisations[65]). Ainsi, les organisations patronales, les branches professionnelles et les syndicats jouent un rôle moteur dans la politique espagnole d’immigration de travail[66].
Bien que la collaboration entre les organisations patronales, syndicales et l’administration espagnole sur la politique d’immigration du travail existait avant 2004 dans le cadre du Diálogo Social, c’est surtout à partir de cette date qu’elle s’est institutionnalisée. En effet, le programme de régularisation le plus important de l’histoire espagnole, élaboré en 2004 par le gouvernement, est le fruit d’une collaboration directe avec les syndicats de travailleurs CCOO (Comisiones Obreras, Commissions ouvrières), UGT (Unión General de Trabajadores, Union générale des travailleurs), et les organisations patronales, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Confédération espagnole des organisations patronales) et la CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises). L’accord conclu a notamment mis en évidence le besoin d’assurer l’intégration effective de la population immigrée sur le marché du travail et dans la société espagnole, soulignant que l’immigration de travail est « un domaine dans lequel il est essentiel que le gouvernement et les partenaires sociaux parviennent à un consensus[67] ».
Le gouvernement a par la suite institutionnalisé la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (Commission de travail tripartite sur l’immigration), rassemblant administration, organisations patronales et syndicats majoritaires, chargée de définir les orientations politiques de l’immigration de travail[68]. Cet organe consultatif permanent, rattaché au ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, est sollicité pour fixer les règles courantes en matière de gestion de l’immigration de travail et pour avis sur des réformes majeures, notamment en matière de régularisation et de besoins du marché du travail[69].
Lors de la campagne électorale des législatives de 2008, les principales organisations patronales espagnoles ont soutenu publiquement le bilan et la politique d’immigration du Gouvernement sortant (PSOE), reconnaissant l’intérêt du contrat d’intégration pour les étrangers·ères et la régularisation de 600 000 travailleurs·euses sans-papier de 2005[70].
Aujourd’hui, face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, des organisations patronales proposent des solutions pour intégrer les immigré·es en situation irrégulière dans le marché du travail. Ainsi, en mars 2025, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC, Fédération nationale de la construction) a lancé un plan visant une formation rapide de ces personnes, afin de répondre aux besoins du secteur du bâtiment. Ce plan comprend des cours de 60 à 100 heures pour faciliter leur insertion professionnelle et propose également d’élargir le catalogue des métiers en tension afin de recruter des travailleurs·euses qualifié·es depuis l’étranger[71].
Hostelería de España, principale organisation patronale du secteur hôtellerie-restauration, souligne qu’en 2024, 25 % des employé·es du secteur sont étrangers·ères. L’hôtellerie et la restauration est ainsi le secteur où la présence de travailleurs étrangers·ères est la plus élevée. Pour l’organisation patronale : « les travailleurs étrangers sauvent l’industrie hôtelière et soulagent le secteur[72] ».
Selon le secrétaire général de l’organisation patronale Hostelería de España, Emilio Gallego, l’immigration est un facteur « d’expansion et de croissance très positive » pour le secteur, compte tenu du fait que la pyramide des âges espagnole tend à vieillir[73]. « Le secteur appelle au recrutement à la source, en encourageant le recrutement de travailleurs dans leur pays d’origine afin de répondre à la difficulté de trouver des personnes en dehors de l’Espagne qui souhaitent rejoindre les bars et restaurants espagnols ». Le secrétaire général qualifie le modèle espagnol de recrutement à la source d’« insuffisant » pour une raison très claire : il est « inexistant ». Selon lui, l’Espagne a une « grande lacune » en ce qui concerne ce modèle d’immigration et « ne dispose pas d’un format puissant pour les visas de travail dans les pays d’origine avec le recrutement de travailleurs potentiels »[74].
c. Immigré·es dans le secteur agricole et programme de migration circulaire
Le secteur agricole espagnol dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère, en particulier pour les travaux saisonniers, notamment dans des régions comme l’Andalousie (Almería, Huelva) et la Catalogne (Lleida). Elle est essentielle pour la récolte de fruits et légumes, souvent dans des conditions précaires[75].
Depuis 2000, l’Espagne a mis en place des programmes de migration circulaire, qui implique un retour dans son pays d’origine après chaque saison, avec des pays comme le Maroc, permettant le recrutement de travailleurs·euses saisonniers·ères pour des périodes déterminées[76]. En 2023, environ 17 200 personnes ont participé à ces programmes[77].
En 2022, un décret-loi est adopté pour faciliter l’obtention de permis de travail et de séjour temporaire pour les personnes étrangères, dans la continuité de la directive de l’Union européenne sur les travailleurs·euses saisonniers·ères de 2014[78]. Pour les rendre plus attractifs, et surtout pour améliorer les conditions de vie des travailleurs·euses saisonniers·ères, les personnes étrangères intéressées pourront désormais demander une autorisation de travail de quatre ans. Ce document permet à la personne concernée de travailler jusqu’à neuf mois par an, mais elle aura l’obligation de rentrer dans son pays après chaque saison de récolte. Au bout de quatre ans, s’ils et elles remplissent toutes les conditions, les travailleurs·euses pourront demander un permis de travail et de séjour de deux ans, sans obligation de retour régulier, ouvrant la voie à une résidence continue et à une possible demande ultérieure de permis de longue durée. La réforme prévoit aussi d’actualiser tous les trois mois une liste d’employeurs espagnols qui rencontrent des difficultés à trouver du personnel. Et ce, afin de faciliter l’embauche et de la rendre plus rapide[79].
En 2025, les Marocain·es constituent la plus grande communauté étrangère en Espagne, avec plus de 343 000 travailleurs·euses inscrit·es à la sécurité sociale. Environ 33 % d’entre elles et eux sont employé·es dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, des secteurs offrant des salaires inférieurs à la moyenne nationale[80].
L’immigration de travail est centrale en Espagne, pour répondre aux besoins du marché du travail, ce qui explique notamment les démarches entreprises pour des régularisations à grande échelle.
2.2 Régularisations : l’exception espagnole
L’Espagne a régularisé davantage que tout autre pays européen, avec 6 campagnes menées depuis 1985, ayant abouti à la régularisation d’environ 1,25 millions d’immigré·es entre 1985 et 2006[81] (a.). En 2025, le pays s’apprête à régulariser entre 300 000 et 500 000 personnes (b.), soutenu par une initiative législative populaire (c.), afin de réduire drastiquement le nombre de personnes sans-papier sur le territoire et inciter au travail déclaré. En dehors des programmes extraordinaires, l’Espagne dispose, via un titre de séjour dédié, d’un processus de régularisation basé sur la présence sur le territoire, dont plus de 300 000 personnes bénéficient fin 2024 (d.). La recherche, portant sur deux décennies, démontre l’absence d’effet « d’appel d’air » des programmes de régularisations, ainsi que leurs effets économiques et sociaux positifs (e.).
a. Historique des programmes de régularisations
Période 1985–2004
Bien que des premières procédures de régularisation aient eu lieu en 1968[82] puis 1978[83], la loi de 1985 relative aux ressortissant·es étrangers·ères constitue le premier programme de régularisation d’ampleur mis en place par l’Espagne. Il permet de régulariser en 1986, l’année d’entrée de l’Espagne au sein de la Communauté économique européenne, près de 40 000 personnes[84], en majorité des Marocain·es.
Dans les années suivantes, des programmes similaires sont mis en place avec la régularisation de 100 000 personnes en 1992 et de 20 000 personnes en 1996[85].
En 2000, un nouveau programme voit le jour, mais alors que le gouvernement et la société civile s’attendaient à quelques 80 000 à 100 000 demandes, plus de 240 000 demandes seront déposées[86]. Cet épisode donne lieu à une période de tensions sociales sur l’immigration, avec des occupations de lieux dans tout le pays, par des sans-papier demandant leur régularisation[87]. À l’issue de divers processus, l’Espagne régularise alors quelque 500 000 personnes sur les années 2001–2002[88].
À partir de janvier 2002, le Gouvernement en place (Parti Populaire – PP, à droite) déclare catégoriquement qu’il n’y aura plus de régularisation en Espagne, et prend des mesures visant à lutter contre l’immigration irrégulière[89]. Il s’y tiendra jusqu’en 2005.
2005
A la fin de l’été 2004, le Gouvernement du socialiste José Luis Rodriguez Zapatero (PSOE), décide de lancer un processus de régularisation massif, fondé sur des critères professionnels. Le but affiché du gouvernement est de faire émerger l’économie souterraine espagnole et de lutter contre le travail non déclaré[90].
Le programme de régularisation s’est attaché à faire basculer les travailleurs du secteur informel vers le secteur formel, accroissant les recettes fiscales et les cotisations de sécurité sociale, et favorisant l’intégration des immigré·es. Le programme résulte de la recherche d’un consensus entre le Gouvernement (PSOE), les syndicats, les employeurs, la société civile et les régions. Il a été motivé par une réelle demande de toutes les parties concernées pour répondre aux besoins du marché du travail et de la société. Il convient de noter à cet égard, que plus de 33 % des personnes dont la situation a été régularisée travaillaient comme personnel de maison[91], ce qui explique en partie le fort soutien du public à ce programme, de nombreuses familles ayant ainsi eu la possibilité de régulariser leur situation, en tant qu’employeurs ou salariées.
Les Sud-Américain·es, Marocain·es et Roumain·es forment la majorité des candidat·es au programme de régularisation de 2005, les pays les plus représentés étant l’Equateur (21 %), la Roumanie (17 %), le Maroc (13 %), la Colombie (8 %) et la Bolivie (7 %)[92]. Toutefois, le chiffre de 600 000 personnes régularisées représente moins de la moitié du nombre d’immigré·es sans-papier présent en Espagne à cette époque (1,7 million selon des estimations croisées[93]).
Figure 14. Nombre de personnes régularisées suivant les programmes de régularisation extraordinaires en Espagne
Historique 1986–2024, projections 2025 – 2027. Couleur politique du gouvernement au pouvoir lors des régularisations.
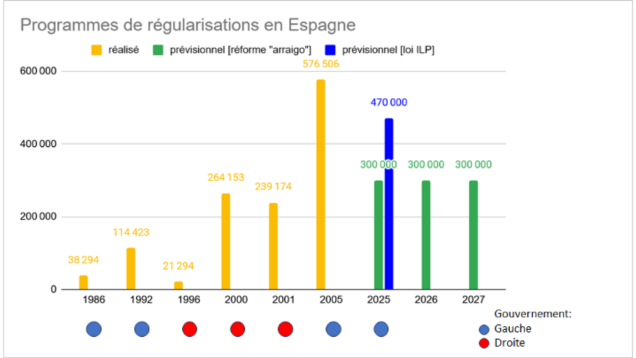
Source : élaboration des auteurs·rices, à partir des données historiques compilées par le Real Instituto Elcano et des prévisions communiquées par le Gouvernement espagnol[94]
b. Perspectives 2025
La dernière régularisation extraordinaire d’immigré·es remontait à 2005. Par un Décret Royal publié le 20 novembre 2024, le Gouvernement espagnol adopte une réforme de sa législation sur l’immigration[95], qui vise, à partir de son entrée en vigueur le 20 mai 2025[96], à régulariser des centaines de milliers de sans-papiers présents sur le territoire, en simplifiant les procédures d’obtention des permis de séjour et de travail. L’objectif est indiqué dans les exposés des motifs : il s’agit de répondre aux besoins économiques et sociaux de l’Espagne, tout en souhaitant que les personnes étrangères qui veulent s’installer en Espagne puissent bénéficier de nouvelles opportunités[97].
La réforme assouplit les conditions d’obtention des permis de séjour spécifiques appelés « arraigos », « enracinements » en français, destinés à des personnes en situation irrégulière, qui peuvent justifier de leur enracinement dans la société espagnole pour régulariser leur situation. Fin 2023, plus de 210 000 personnes disposaient d’un « titre enracinement » en Espagne, contre 900 000 personnes estimées en situation irrégulière[98].
Plusieurs types de titres de séjour sont créés dans ce programme de régularisation :
- « arraigo de la deuxième chance », pour les personnes dont le permis a expiré ;
- « arraigo socio-formatif » pour les personnes en formation professionnelle à un métier en manque de main-d’œuvre, permettant d’exercer un emploi dès le début de sa formation ;
- « arraigo socio-professionnel » qui réduit le nombre d’heures travaillées exigées, sous réserve de deux ans de résidence en Espagne ;
- « arraigo social » pour les personnes ayant des liens familiaux avec d’autres résident·es en situation régulière, réduisant l’exigence de résidence en Espagne à deux ans contre trois auparavant ;
- « arraigo familial », qui en plus des parents et enfants des citoyen·nes de nationalité espagnole, concerne à présent les parents d’enfants mineur·es et les aidant·es de personnes handicapées, originaires de pays extra européens.
La réforme prévoit également des aménagements pour les visas de durée de validité d’un an, qui sont désormais renouvelables pour quatre ans. Enfin, la nouvelle loi intègre aussi une régularisation temporaire pour les demandeurs·euses d’asile débouté·es qui pourront faire une demande pour le « titre enracinement » de leur choix à la condition de six mois de présence sur le sol espagnol. Ce processus extraordinaire doit durer un an et prend en compte le temps de présence pendant la demande d’asile.
En outre, le regroupement familial est assoupli, et la nouvelle autorisation de séjour pour les travailleurs·euses saisonniers renforce leurs droits et leur protection. Cette nouvelle loi permettrait la régularisation de 300 000 travailleurs sans-papiers par an d’ici 2027. « Une main d’œuvre indispensable pour maintenir le niveau de vie de l’Espagne d’ici 2050 », affirme le Gouvernement espagnol[99].
Si les objectifs de régularisations affichés emportent l’adhésion des défenseurs de cette politique, majoritaires dans la classe politique, un certain nombre de critiques, émanant de la société civile, sont émises quant à la complexité et aux obstacles à sa mise en oeuvre, mettant en doute la possibilité d’atteindre les objectifs de nombre de personnes régularisées par an. Parmi ces critiques :
L’exclusion des demandeurs·euses d’asile débouté·es hors période exceptionnelle : en dehors de la période exceptionnelle d’un an, désormais, le temps passé en Espagne pendant l’examen d’une demande d’asile ne sera plus pris en compte pour l’obtention d’un titre de séjour via l’« arraigo ». Ainsi, un demandeur débouté devra attendre deux années supplémentaires en situation irrégulière avant de pouvoir entamer une procédure de régularisation. Cette disposition est jugée injuste, car elle pénalisera des personnes déjà intégrées dans la société espagnole[100] ;
La complexité administrative et les obstacles bureaucratiques : malgré la réduction du délai de résidence requis de trois à deux ans, les procédures restent complexes. Les personnes étrangères doivent fournir de nombreux documents, obtenir des rendez-vous difficiles à décrocher, et faire face à des délais prolongés[101] ;
Des résultats mitigés pour l’« arraigo para la formación » : ce dispositif permet aux immigré·es de suivre une formation dans des secteurs en tension pour obtenir un titre de séjour. Cependant, sur les 23 097 personnes ayant suivi une telle formation entre 2022 et 2023, seules 1 347 ont obtenu un contrat de travail à l’issue de celle-ci. Ce faible taux de conversion souligne les limites de cette mesure[102].
c. Un projet de loi sur la régularisation issu d’une initiative législative populaire
En Espagne, l’initiative législative populaire (ILP) est un outil de démocratie semi-directe inscrit dans la Constitution espagnole qui permet à une proposition de loi soutenue par au moins 500 000 citoyen·nes espagnol·es (soit environ 1,26 % du corps électoral), d’être déposée au Congrès des députés[103].
Lancée par la plateforme citoyenne Regularización Ya (Régularisation Maintenant), une ILP intitulée « Esenciales », visant à régulariser environ 500 000 personnes en situation irrégulière en Espagne, a reçu un large soutien transpartisan, avec plus de 700 000 signatures récoltées après plus de deux ans de mobilisation, lui permettant d’être déposée au Congrès des députés, puis acceptée par une large majorité de 89 % des député·es le 9 avril 2024[104].
En mai 2025, le Gouvernement espagnol annonce vouloir passer un projet de loi correspondant, en procédure accélérée, qui doit permettre la régularisation de 470 000 personnes, à la seule condition qu’elles soient arrivées avant le 31 décembre 2024 en Espagne. Le texte, discuté avec les groupes parlementaires, doit permettre de délivrer une « autorisation pour circonstances exceptionnelles unique » et autoriserait toutes les personnes étrangères arrivées avant 2025 de résider légalement et de travailler librement sur l’ensemble du territoire espagnol[105].
Ces conditions d’obtention de titre de séjour, bien plus simples que celles de la réforme des titres « arraigos » de novembre 2024, permettrait, selon les partisans de l’ILP, d’atteindre les objectifs de régularisation dès 2025. Le calendrier de soumission du texte de loi au vote des députés n’est pas encore connu[106].
d. Les régularisations en dehors des programmes extraordinaires
En dehors des régularisations extraordinaires, les personnes en situation irrégulière peuvent accéder à un titre de séjour via les procédures « arraigos », qui constituent la principale voie de régularisation individuelle. Au 31 décembre 2024, 313 075 personnes disposaient d’un permis de séjour valide accordé sur la base de leur « enracinement », en très nette augmentation depuis 2020[107].
Figure 15. Evolution du nombre de personnes bénéficiant d’un titre de séjour « arraigo », 2013–2024

Source : Observatorio Permanente de la Inmigración[108]
Les titres de séjour « arraigo » sont délivrés dans le cadre de procédures spécifiques destinées aux personnes en situation irrégulière pouvant justifier de leur enracinement en Espagne. Les principaux types et leurs conditions sont :
- Arraigo social : résidence continue en Espagne pendant au moins 3 ans, contrat de travail d’au moins 30 heures par semaine ou 20 heures si cumulées, absence de casier judiciaire.
- Arraigo laboral : résidence continue pendant au moins 2 ans, preuve d’une relation de travail d’au moins 6 mois, absence de casier judiciaire.
- Arraigo familial : liens familiaux avec des citoyen·nes espagnol·es ou des résident·es en situation régulière, conditions spécifiques selon le lien.
- Arraigo para la formación : résidence continue pendant au moins 2 ans, inscription à une formation professionnelle dans des secteurs en tension, absence de casier judiciaire.
Ces procédures permettent aux personnes en situation irrégulière de régulariser leur statut en Espagne en fonction de leur situation personnelle et professionnelle[109].
e. Impacts des régularisations et absence d’appel d’air
La politique de régularisation de nombreux·euses immigré·es en situation irrégulière menée par l’Espagne date des années 2000, ce qui permet d’en mesurer les effets avec un recul suffisant.
Ainsi, la vaste étude « Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants » menée par trois économistes espagnols[110], publiée en 2023, analyse les conséquences de la politique espagnole de régularisation, sur la base des quelque 600 000 régularisations de 2005.
Elle démontre, en particulier, l’inexistence d’appel d’air et l’absence de corrélation avec les flux migratoires des années suivantes (par exemple l’immigration baisse fortement sur la période 2008–2016).
Par ailleurs, l’emploi formel des immigré·es augmente, tandis que celui des nationaux n’a pas été affecté. De plus, les programmes de régularisation d’ampleur entraînent une diminution de l’emploi informel, tant pour les nationaux que pour les immigré·es peu qualifié·es.
L’impact sur les recettes fiscales est nettement positif, avec une augmentation d’environ 4 000 euros par immigré·e régularisé·e, sans que l’on puisse constater une augmentation des dépenses publiques[111].
Figure. Flux migratoires extra-UE vs. régularisation en Espagne, 2000–2021
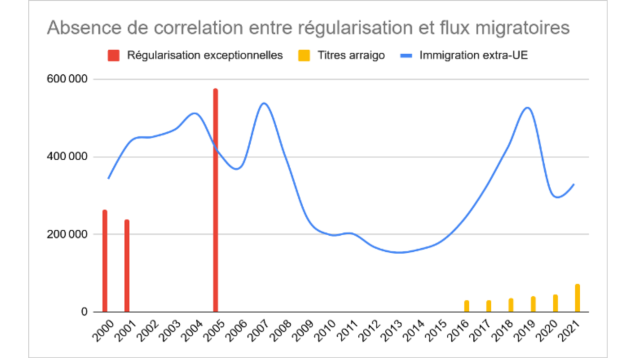
Source: élaboration des auteurs à partir des données INE et OPI[112]
* * *
L’Espagne a misé sur l’immigration de travail au bénéfice principal de son économie, ce qui se reflète dans la croissance de son PIB en 2024. Ce choix prend le pas sur d’autres motifs de délivrance de titres de séjour, notamment l’asile, nombre de demandeur·ses d’asile sont redirigé·es vers l’immigration de travail. Par ailleurs l’approche adoptée par le pays vis-à-vis de la surveillance de ses frontières est dictée par les règles européennes en raison de l’existence de l’espace Schengen.
3. Frontières extérieures et asile : l’influence européenne
En bref
En tant que pays frontalier de l’Union européenne, l’Espagne est un point d’entrée majeur de l’espace Schengen. L’intégration de l’Espagne à l’espace Schengen a renforcé son rôle de garde-frontière de l’UE avec une forte pression, impliquant des contrôles accrus et des accords bilatéraux avec les pays tiers africains, notamment le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. La coopération migratoire s’inscrit dans des stratégies mêlant sécurité, aide au développement et réadmission.
Le plan « Espagne-Afrique 2025–2028 » propose une approche réaliste du sujet en estimant que les migrations en Afrique ne se limitent pas à un déplacement unidirectionnel vers l’Europe, mais sont plus complexes et souvent des déplacements de proximité. L’Espagne est l’un des seuls pays européens à augmenter son aide publique au développement en 2025.
En revanche, le droit d’asile, bien que reconnu par la Constitution espagnole, est faiblement appliqué : le taux de protection est parmi les plus bas d’Europe, l’accueil est inégal et les capacités d’hébergement insuffisantes. Les pratiques aux frontières, notamment les refoulements depuis les enclaves de Ceuta et Melilla, sont régulièrement dénoncées. En tension entre exigences européennes, enjeux sécuritaires et droits fondamentaux, la politique espagnole aux frontières révèle les contradictions d’un modèle tourné vers l’intégration par le travail, mais confronté à des contraintes de contrôle toujours plus fortes.
La Constitution espagnole de 1978 mentionne expressément le droit d’asile (article 13 § 4). L’Espagne a adhéré à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, lors de sa période de transition politique, en août 1978[113]. Le pays est une des portes d’entrée vers l’espace Schengen, impliquant des responsabilités vis-à-vis des autres Etats membres (3.1). Une des stratégies espagnoles a été le développement d’accords bilatéraux (3.2.), tandis que la question de l’accueil et la gestion des demandeur·euses d’asile reste insuffisante (3.3.) ainsi que la situation des mineur·es non accompagné·es (3.4.). L’Espagne procède également à des éloignements, conformément aux exigences réglementaires européennes (3.5).
3.1 Les routes migratoires vers l’Espagne et les conséquences de l’espace Schengen
À partir des années 1990, en raison de la création de l’espace Schengen, concrétisé en 1995, la politique espagnole des visas évolue : la possession d’un visa devient une obligation pour un nombre plus important d’étrangers·ères, dont les Marocain·es[114]. Cette obligation pèse sur l’Espagne car elle possède une frontière externe de l’espace Schengen et doit, pour cette raison, renforcer ses contrôles au nom des autres pays de l’espace Schengen. Les traversées d’embarcations précaires se multiplient à partir des années 1990, même si des passages avaient lieu dès les années 1970, au départ des côtes Marocaines[115]. L’objectif des personnes migrantes est de passer le détroit de Gibraltar ou d’atteindre à la nage Ceuta ou Melilla[116], les deux enclaves espagnoles au Maroc (Ceuta se situe à 13 kilomètres des côtes espagnoles).
Les années 1990 marquent également les esprits espagnols avec des images récurrentes de personnes qui disparaissent en mer, et dont les corps sont retrouvés sur la côte, notamment sur les plages de Cadix[117], dans le sud de l’Espagne. Entre 1990 et 2010, une centaine de personnes meurent chaque année dans le détroit de Gibraltar en tentant la traversée[118].
Face à cette augmentation d’arrivées en situation irrégulière sur le territoire, le Gouvernement espagnol investit dans un grillage de sécurité en acier autour de ses enclaves marocains et dans un « Système intégral de vigilance extérieure » (SIVE installé sur la côte sud espagnole, imaginé en 1998 et effectif en 2002[119]), qui permet la détection d’objets mobiles dans un champ instable, autrement dit, en mer. La mise en place du SIVE va notamment avoir pour conséquence d’ouvrir la route migratoire vers les Canaries[120]. Le Gouvernement espagnol déploiera ensuite le SIVE également aux Canaries[121].
Ainsi, dès les années 2000, les contrôles exercés par le Maroc et cette surveillance du détroit de Gibraltar vont entraîner le développement d’une autre route migratoire, au départ du Sénégal ou de la Mauritanie, vers les îles Canaries[122], qui font parties de l’espace Schengen, contrairement aux enclaves de Ceuta et Melilla[123].
Figure 16. Personnes mortes et disparues en mer en tentant de rejoindre l’Europe
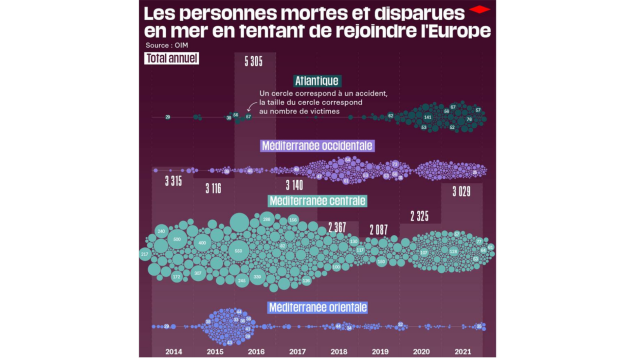
Source : données OIM traitées par Libération, 2022[124]
L’infographie ci-dessus permet de comprendre l’évolution des routes maritimes au cours du temps et leur dangerosité. La fermeture de certaines routes engendre l’ouverture de nouvelles, ce qui est particulièrement frappant avec la route Atlantique vers les Îles Canaries.
Les politiques contraignantes espagnoles et marocaines, induites par la surveillance de la frontière externe de Schengen, vont également avoir des conséquences sur les enclaves de Ceuta et Melilla. Bien qu’étant éloignées de plus de 400 kilomètres l’une de l’autre, des approches similaires de surveillance et de stratégies de passages existent. En septembre 2005, des rumeurs se propagent quant à un passage réussi du côté de Melilla[125], incitant les personnes dans les camps proches de Ceuta à une approche en groupe, qui sera répliquée début octobre à Melilla. Une dizaine de personnes sont tuées lors de ces évènements, et de nombreuses sont blessées[126]. L’Espagne déploie par la suite l’armée à Ceuta et Melilla[127]. Des épisodes de ce type se reproduisent régulièrement, notamment en juin 2022, lorsqu’un des affrontements avec les gardes-frontières aboutit au décès d’une quarantaine de personnes, selon l’ONG Caminando Fronteras[128].
Les routes migratoires évoluent régulièrement. Il y a ainsi une augmentation importante des passages vers l’Espagne entre 2015 (5 000 arrivées recensées) et 2018 (58 000 recensées) pour diminuer de moitié en 2019 (29 000)[129]. Depuis 2022, la route migratoire en provenance de l’Algérie se déplace vers l’Est pour atteindre les îles Baléares. 2 278 personnes sont ainsi arrivées sur ces îles en 2023, nombre en nette évolution en 2024 (3 700 comptabilisées entre janvier et octobre 2024)[130].
En plus des traversées maritimes, un réseau de passage de personnes par camions passant par Tanger au Maroc se développe, pour rejoindre Algeciras en Espagne. Cette voie a incité le le Maroc à construire une protection de 6 mètres de haut autour du port, avec l’appui de fonds européens[131].
Dans ce contexte, l’Espagne a très rapidement fait le choix de développer des partenariats avec les pays tiers, dans l’objectif double de peser sur les flux migratoires et d’assurer des partenariats commerciaux.
3.2 Des relations actives avec les pays tiers en matière de migrations
L’Espagne a très tôt investi la question des migrations dans ses relations avec les pays tiers. Cette démarche a été initiée depuis les années 1990 avec le Maroc. En effet, le Maroc est un interlocuteur privilégié : les immigré·es marocain·es représentent la plus grande communauté étrangère en Espagne (1 million de ressortissant·es en 2024) et ce pays frontalier est aussi un lieu de transit et de départ vers l’Espagne. Autre dimension à ne pas négliger, le Maroc et l’Espagne entretiennent des relations économiques importantes sur le terrain des importations et exportations[132].
En février 1992, les deux pays signent un premier accord bilatéral de réadmission, qui ne sera cependant pas appliqué avant les années 2000[133]. Celui-ci implique que le Maroc accepte de réadmettre les personnes qui ont transité par son territoire avant d’atteindre l’Espagne, quelle que soit leur nationalité. Cependant, le Maroc a rapidement voulu renégocier l’accord[134]. En effet, à part dans les cas d’entrées par Ceuta et Melilla, il est difficile de démontrer qu’un·e ressortissant·e étranger·ère non marocain·e a effectivement transité par le Maroc avant d’atteindre l’Espagne. Le Maroc a donc très peu repris en charge des personnes dans ce cadre[135].
Pour clarifier cette problématique, les deux pays sont parvenus à un accord prenant en compte la nationalité du conducteur de la « patera » (embarcation précaire) : s’il est Marocain, les personnes présentes sur le bateau sont supposées avoir transité par le Maroc et y sont reconduites[136].
De plus, l’Espagne s’appuie sur le Maroc pour contrôler les entrées sur son territoire. Ce rôle de surveillance déléguée des frontières entraîne un rapport de force diplomatique, le Maroc pouvant parfois faire usage de « chantage migratoire ». À ce titre, l’incident frontalier qui s’est produit en mai 2021, à la suite d’une crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, est particulièrement frappant. En réponse à l’accueil par l’Espagne en avril 2021 du représentant du mouvement indépendantiste sahraoui (Front Polisario)[137], le Maroc relâche ses contrôles à Ceuta. Environ 8 000 personnes, essentiellement marocaines, dont de nombreux·euses mineur·es, ont accédé à l’enclave espagnole en quelques heures, la plupart à la nage depuis la côte marocaine[138]. Les discussions diplomatiques aboutiront à un retour à la situation préalable en mai 2022[139], après deux années de crise[140], ce qui ne met pas fin aux incidents frontaliers pour autant. Ainsi, le 24 juin 2022, une trentaine de personnes meurent lors d’une nouvelle tentative d’entrée de près de 2 000 personnes à Melilla[141].
De façon plus structurelle, l’Espagne a développé sa coopération avec les États tiers dans le cadre d’un « programme global de régulation et coordination des étrangers et de l’immigration » (2001–2004), qui comprend la signature d’accords de réadmission mais aussi des aspects portant sur l’octroi de visas ou encore sur l’aide au développement[142]. Le programme prévoit également une collaboration et l’échange d’informations entre les services de police espagnols et ceux des pays d’origine ou de transit, ainsi que le renforcement des frontières extérieures. Avec l’Équateur et la Colombie, l’Espagne adopte deux accords en 2001, qui comprennent des quotas d’immigration de travail[143].
Dès 2003, l’Espagne adopte un accord de réadmission avec la Mauritanie, puis en 2006 un plan urgent de coopération qui aboutira également à la création d’un centre de rétention à Nouadhibou, pour les personnes expulsées des Canaries en situation irrégulière[144], l’accord concernant tant les Mauritanien·nes que les personnes provenant d’autres pays[145]. Vivement critiqué, le centre en question a notamment été surnommé « Guantanamito », en référence au centre de détention américain et aux conditions déplorable qui y règnent[146]. Sur ce plan, l’Espagne figure parmi les premiers pays européens à investir dans l’externalisation de sa politique migratoire, dans l’objectif d’empêcher les départs de personnes en situation irrégulière.
En 2006, l’Espagne affiche sa stratégie diplomatique avec un deuxième « plan Afrique » (période 2006–2008), précipité par l’arrivée d’environ 40 000 pirogues aux Canaries. Celui-ci lie immigration, sécurité et développement, alors que le premier plan (2001–2002) ne s’intéressait principalement qu’aux relations économiques[147]. En matière de sécurité, l’Espagne se positionne afin de participer à la stabilisation des pays en conflit, avec une présence diplomatique accrue, une coopération policière et un volet d’aide au développement. L’Espagne a ainsi été à l’origine de la mise en place de patrouilles Frontex, au Sénégal en 2006–2008[148] et entre la Mauritanie et les îles Canaries (opération Héra dès 2006[149]). Par la suite, les accords bilatéraux se multiplient (Gambie et Sénégal en 2006, Guinée et Mali en 2007, Niger et Cap Vert en 2008 et Guinée Bissau en 2009)[150], et seront parfois modifiés pour intégrer d’autres dimensions, comme par exemple le renforcement des capacités des services mauritaniens en matière de surveillance des frontières[151]. Avec cette série d’accords, « l’Afrique devenait une priorité de la diplomatie espagnole »[152].
En mai 2019, le « plan Afrique III » est publié. Il poursuit ces objectifs[153] et s’inscrit plus largement dans une volonté de partenariat durable, intégrant une stratégie commerciale. Si les objectifs commerciaux semblent atteints, avec l’implantation d’entreprises espagnoles ainsi que l’utilisation de la langue espagnole sur le continent, les résultats concernant la question des migrations sont jugés moins positifs[154]. Un « Focus Afrique 2023 »[155] est alors adopté en mars 2021 qui, dans la continuité du troisième plan Afrique, se concentre sur certains pays du continent : le Nigéria, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud d’une part, en tant que « pays phares », en raison de leur démographie et de leur situation économique, et le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et l’Angola, d’autre part, considérés comme « prioritaires ». L’Espagne cherche donc à investir le continent africain, alors que pendant longtemps, ses relations économiques et diplomatiques y étaient assez faibles, y compris avec la Guinée équatoriale, ancienne colonie[156]. Cette volonté d’investissement se traduit par une coopération commerciale, parfois accompagnée d’aide au développement, considérées comme des instruments classiques de politique extérieure, mais qui peuvent être aussi utilisés avec des objectifs de contrôle des flux migratoires. Ce qui n’est pas sans interroger sur le potentiel détournement des finalités de l’aide au développement[157].
Concernant les questions de migrations, le « Focus Afrique 2023 » indique, par exemple, soutenir des actions pour améliorer les capacités des pays d’origine et de transit en matière de contrôle aux frontières et de gestion des migrations, ou encore promouvoir des mécanismes migratoires réguliers[158].
Le « plan Espagne – Afrique » le plus récent couvre la période 2025–2028[159], plus dense que le « Focus Afrique 2023 », il propose une approche plus globale, avec des questions de développement durable notamment. De façon pragmatique, le plan mentionne la réalité des migrations sur le territoire africain, et relève que « les migrations sont des réalités complexes puisque les pays africains ne sont pas uniquement des pays d’émigration ; ils peuvent également être des pays de transit et des pays récepteurs »[160].
Il faut relever par ailleurs que les Espagnol·es, dans leur majorité, partagent l’idée que les immigré·es contribuent à la société d’accueil. L’opinion publique espagnole se montre ainsi très critique des accords d’externalisation des frontières avec les pays extérieurs à l’Union européenne et se déclare défavorable à l’expulsion d’immigré·es en situation irrégulière n’ayant commis aucun délit, surtout s’il ou elle travaille[161]. Les politiques migratoires visant à élargir les voies et les mécanismes légaux d’immigration vers l’Espagne bénéficient d’un bien large soutien (immigration de travail depuis les pays d’origine vers les secteurs économiques en manque de main-d’œuvre, corridors sûrs pour les réfugié·es, simplification de la reconnaissance des diplômes ou regroupement familial)[162].
Sur les questions migratoires, le « plan Espagne – Afrique 2025–2028 » indique se fonder sur trois piliers :
- « le traitement des causes profondes des migrations forcées, avec un renforcement des programmes de développement ciblant particulièrement les jeunes ;
- le dialogue avec les partenaires africains pour parvenir à une migration sûre, ordonnée et régulière ;
- et la lutte contre les réseaux criminels de migration irrégulière, qui mettent en danger la vie des personnes migrantes »[163].
Ce plan inscrit l’action sur la migration dans un ensemble plus large, correspondant également à l’augmentation de l’enveloppe allouée à l’aide publique au développement. En 2023, les parlementaires espagnol·es adoptent une nouvelle loi sur la coopération, pour le développement durable et la solidarité mondiale, qui remplace la précédente de 1998[164]. La loi va, pour la première fois, afficher un objectif d’augmentation de l’aide publique au développement à 0, 7 % du revenu national brut (RNB) à l’horizon 2030. En 2022, l’OCDE a estimé les dépenses de l’Espagne dans l’aide publique au développement à 4 milliards d’euros, soit 0,3 % du RNB[165]. Parmi la douzaine d’objectifs affichés, celui de « promouvoir une approche globale des migrations, axée sur les personnes et leurs droits, sur les causes profondes des migrations, sur la mobilité par des voies régulières, ordonnées et sûres, et sur le développement durable »[166] est notable. L’aide publique au développement est portée par l’AECID (l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement), créée en 1998, et la FIIAPP (Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques). Comme le souligne le « plan Espagne – Afrique 2025–2028 », la FIIAPP joue aussi un rôle en matière de lutte contre la traite des êtres humains, avec des projets qui renforcent les capacités des institutions des pays africains à l’encontre de la traite (le plan donne comme exemple le projet A-TIPSOM au Nigeria, axé sur la prévention de la traite et du trafic des femmes et des jeunes filles)[167] ou encore la promotion de migrations légales et sécurisées (projet Migrasafe[168], qui consiste en des cours en ligne sur la migration régulière).
Figure 17. Evolution des politiques nationales d’aide au développement en 2025 en Europe
L’Espagne est le seul pays à augmenter son budget en 2025.
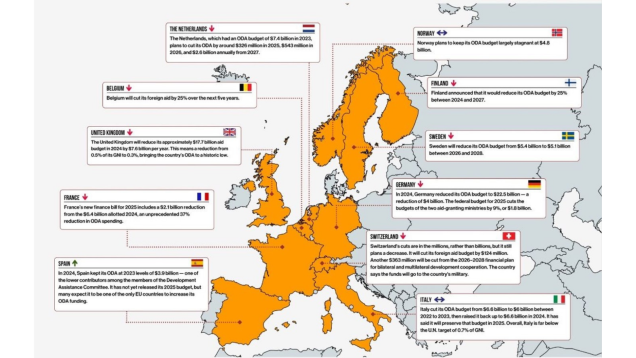
Source : Jesse Chase-Lubitz et Yula Marie Mediavillo, Devex, Mars 2025[169]
Cela étant, le Maroc reste l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement espagnol, en cohérence avec la politique européenne sur les migrations. Le sujet de la migration est un levier diplomatique non négligeable, parfois qualifié de « chantage diplomatique » : « La conclusion d’un accord de pêche, la concurrence maraîchère, les trafics de drogue et de contrebande, les revendications territoriales (présides, îlot du Persil) ou l’avenir diplomatique du Sahara Occidental sont autant de sujets de désaccords dont le règlement est aujourd’hui conditionné par la gestion des flux migratoires qui transitent par le Maroc »[170].
Le Maroc bénéficie d’aides de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année, versés par l’Espagne à partir de leur part du EUTF (le fonds de l’Union européenne pour l’Afrique), notamment pour renforcer le système sécuritaire marocain[171].
L’autre partenaire sur lequel mise l’Espagne est la Mauritanie, qui a, par exemple, reçu 2 millions d’euros en 2020 du fonds EUTF pour améliorer sa gestion des migrations[172]. Par ailleurs, la Police nationale et la Guardia civile espagnole sont déployées en permanence en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie (une centaine de personnes). Ces pays ont accepté une coopération étroite avec l’Espagne sur les questions de migration irrégulière. Selon l’Espagne, ces opérations affichent des résultats « très positifs »[173]. Le déploiement de personnel est augmenté lorsque des activités des réseaux de passeurs sont détectées[174]. Cette approche est également bien présente dans le « plan Espagne-Afrique 2025–2028 » : « Nous continuerons à lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains, en privilégiant une stratégie préventive, menée en collaboration avec les pays d’origine et de transit »[175].
Une fois que les personnes ont accédé au territoire espagnol, malgré les accords d’externalisation et la dangerosité de la route migratoire, l’accueil fait aux demandeurs·euses d’asile – qui répond également à une exigence européenne – est critiquable.
3.3 Accueil et gestion des demandeurs·euses d’asile sous tension
L’asile est géré au niveau national par un organisme dédié, avec un taux de protection assez faible (a.), tandis que le dispositif d’hébergement des demandeuses et demandeurs d’asile est sous tension (b.), avec de nombreuses défaillances relevées (c.).
a. Gestion de l’asile
La demande d’asile a été réglementée en Espagne en 1984 pour la première fois[176], alors que la ratification de la Convention de Genève date de 1978. Le statut de demandeur·euse d’asile est reconnu par l’OAR (Oficina de Asilo y Refugio, Bureau chargé de l’asile et des réfugiés, sous autorité du ministère de l’Intérieur) qui délivre une « carte rouge » au bout de six mois de présence, permettant alors à la personne qui demande l’asile de travailler (à l’enregistrement de la demande c’est une « carte blanche » qui est délivrée). Des cours de langues sont dispensés dans les centres d’accueil, avec une visée professionnelle.
L’entretien pour la demande d’asile est réalisé par un agent de l’OAR qui décide dans un premier temps de la recevabilité de la demande. Dans un second temps, lorsqu’une protection est envisagée, le projet de décision est soumis à la Commission interministérielle de l’asile et des réfugiés (CIAR), qui accordera ou refusera la protection internationale, puis signée par le ministre de l’intérieur (en pratique par le sous-secrétaire d’État à l’intérieur)[177]. La CIAR est composée d’une représentation de chacun des services ayant des compétences en matière d’affaires intérieures et étrangères, de justice, d’immigration, d’accueil des demandeurs d’asile et d’égalité. La représentation espagnole du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) y participe également[178], mais ne peut qu’exprimer un avis consultatif sur les dossiers, sans droit de vote[179].
Alors que dans les années 2015–2016, l’Espagne n’a reçu qu’une dizaine de milliers de demandes d’asile (et moins avant), l’augmentation est progressive jusqu’en 2019, avec plus de 100 000 demandes d’asile cette année-là. En 2023, ce sont 163 200 personnes qui ont demandé une protection à l’Espagne (+ 37 % par rapport à 2022)[180]. Ce sont les Vénézuélien·nes qui demandent le plus l’asile (plus de 60 000), suivi des Colombien·nes et Péruvien·nes.
Le taux de protection en Espagne est très bas : 19,8 % en première instance en 2024[181], 12 % en 2023[182]. En pratique, les personnes qui demandent l’asile sont souvent réorientées vers un titre humanitaire ou vers le système de régularisation par le travail.
Par ailleurs, il existe également un titre de séjour humanitaire, qui est accordé par les mêmes autorités que l’asile[183]. Le fondement initial est la reconnaissance d’une vulnérabilité particulière, qui serait exacerbée en cas de retour dans le pays d’origine et qui nécessite un titre de séjour. En revanche, il est plus précaire qu’un statut de réfugié, puisque le titre n’est valide que pour une année, et ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Pour les étrangers·ères concerné·es, il est souvent plus simple de se tourner vers un autre fondement, comme le travail, pour obtenir un titre de séjour. Ainsi, le gouvernement a annoncé en 2019 que les Vénézuelien·nes (qui ont un faible taux de protection) dont la demande a été rejetée, peuvent prétendre au titre humanitaire. Cela leur permet d’accéder au marché du travail puis de changer pour un titre de séjour lié au travail[184].
En effet, la stratégie espagnole est concentrée sur le développement de l’immigration de travail et non sur l’asile, ce qui est symptomatique de l’approche pragmatique (voire utilitariste selon certains auteurs[185]) du gouvernement, qui privilégie l’immigration de travail pour l’économie du pays. Ainsi, le système de l’asile est assez peu réformé et connaît des difficultés récurrentes, notamment en ce qui concerne les structures d’accueil. En pratique, le système de l’asile est plus restreint que l’accès aux titres de séjour de travail, ce qui transforme de potentiels réfugié·es en travailleurs·euses[186], avec un statut moins protecteur.
L’Espagne a aussi accueilli plus de 200 000 Ukrainien·nes bénéficiant de la protection temporaire depuis 2022, se positionnant au quatrième rang des pays européens d’accueil[187]. Enfin, l’Espagne ne transfert que très peu de demandeurs·euses d’asile dans le cadre de la procédure Dublin, étant davantage destinataire de demandes : 9 000 demandes des autres pays à l’Espagne contre 600 demandes espagnoles aux autres pays en 2022[188].
b. Accueil des demandeuses et demandeurs d’asile
L’Espagne est fortement régionalisée, cependant l’Etat central reste seul compétent en matière de « nationalité, émigration, statut des étrangers et droit d’asile » (article 149–2 de la Constitution). C’est le ministère de l’Inclusion, des Migrations et de la Sécurité sociale, créé en 2020, qui s’occupe de l’hébergement des personnes en demande d’asile, tandis que les centres qui accueillent les personnes en situation irrégulière relèvent du ministère de l’Intérieur. La question de la gestion de l’accueil arrive tardivement en Espagne, en raison de son statut de pays d’émigration et de transit pendant plusieurs décennies. Elle est introduite sous l’impulsion de l’Union européenne, à cause des obligations européennes d’accueil des demandeurs·euses d’asile.
Actuellement, les règles d’hébergement varient en fonction du statut de la personne, selon qu’elle est en demande d’asile ou en situation irrégulière. Les immigré·es qui possèdent un titre de séjour et qui ne sont pas en demande d’asile, peuvent être hébergé·es s’ils et elles sont en situation de vulnérabilité, selon le système de droit commun espagnol. La question de l’accueil concerne donc principalement les personnes en demande d’asile, conformément aux exigences européennes sur le sujet (directive dite « Accueil »[189]).
Aujourd’hui, en ce qui concerne l’hébergement, le parcours type d’une personne qui demande l’asile comprend plusieurs étapes[190] :
- « Accueil » : pendant les 30 premiers jours, l’hébergement se fait dans un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros, capacité totale de 1 000 places à l’échelle nationale) ou bien dans des centres d’urgence et hôtels réquisitionnés. L’objectif est l’identification, l’enregistrement de la demande d’asile, les premiers soins et l’hébergement temporaire des personnes demandant l’asile. Ces centres sont gérés par le ministère de l’Intérieur.
- « Intégration » : pour 6 mois maximum, la personne est hébergée dans un CAR (Centros de Acogida de Refugiados). Les CAR sont complétés par des centres directement gérés par des associations, notamment la Croix Rouge et le CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Le nombre total de places pour les demandeurs·euses d’asile est de 21 000[191] au niveau national. Le parc d’hébergement est géré par le ministère de l’Inclusion, des Migrations et de la Sécurité sociale.
- « Autonomie » : de 6 à 18 mois, les personnes sont relogées dans des appartements partagés, avec un accompagnement social, toujours sous gestion du ministère de l’Inclusion, des Migrations et de la Sécurité sociale (environ 6 800 places[192] au niveau national).
Les situations à Ceuta et Melilla étant particulières, l’hébergement y est envisagé différemment. L’Espagne a mis en place des centres d’accueil semi-ouverts sur ces territoires, initialement à destination des demandeurs·euses d’asile[193] (le CETI – Centra de Estancia Temporal de Immigrantes : 520 places et La Esperanza (centre d’accueil pour les mineurs : 300 places). Les centres servent à trier les personnes qui seront refoulées vers le Maroc de celles qui pourront rejoindre la péninsule ibérique, moins nombreuses. En pratique, « l’image d’arrivées massives par Ceuta est largement contredite par les chiffres qui montrent qu’une faible partie des personnes obtient in fine un accueil pérenne »[194]. Centres semi-ouverts, les personnes sont, de fait, cloisonnées au petit territoire de chaque enclave. Aucune limite temporelle d’accueil n’est prévue, des personnes y sont parfois restées plusieurs années[195].
c. Les défaillances dans l’hébergement et l’accueil des demandeuses et demandeurs d’asile
À l’image de la plupart des pays européens, les places d’hébergement des demandeurs·euses d’asile sont insuffisantes en Espagne, comme le relève le Défenseur des droits espagnol en 2022[196]. Face à l’augmentation des personnes demandant l’asile, l’Espagne a opté pour davantage de collaboration avec des ONG[197], comme la Croix Rouge ou CEAR, même si des investissements sont régulièrement annoncés[198]. Malgré cette démarche, de nombreuses personnes se retrouvent à la rue, sans solution d’hébergement[199], ou font appel à leur famille ou communauté, une option plus facile d’accès pour les latinos-américains[200].
Les difficultés sont particulièrement importantes à Ceuta, Melilla et dans les Îles Canaries, territoires de première arrivée. La situation dans les îles Canaries a incité le gouvernement espagnol à déclencher un état d’urgence migratoire pour maintenir certains dispositifs d’hébergement ouvert, ainsi que pour assurer un transfert plus fluide entre les Canaries et l’Espagne continentale[201]. Cette déclaration d’urgence en 2023–2024 s’est accompagnée d’investissements budgétaires[202].
À Ceuta et Melilla, ce sont les obstacles pour déposer une demande d’asile qui interrogent. Des paradoxes apparaissent : pour accéder aux bureaux espagnols de l’asile dans les enclaves de Ceuta et Melilla, il faut déjà avoir un titre de séjour régulier (passeport valable et permis de travail ou visa) ou arriver par ses propres moyens, à savoir la nage[203]. Certains relèvent que les bureaux d’asile ne sont pas ouverts aux ressortissants subsahariens qui seraient bloqués en amont par les militaires marocains (selon une étude couvrant la période septembre 2014 à mars 2015[204], confirmée en 2021[205]). Ce constat de la difficulté d’accès aux bureaux de l’asile est partagé par la Commission des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, qui relève en 2022 une impossibilité réelle et effective de demander l’asile dans les enclaves[206]. Par ailleurs, les critères de transfert des personnes des enclaves vers le continent ne sont pas transparents, des rapports dénoncent des discriminations fondées sur la nationalité[207]. L’Espagne a adopté en 2015 un dispositif législatif de refoulement immédiat aux frontières en cas d’entrée en situation irrégulière dans les enclaves de Ceuta et Melilla[208]. Cette pratique a d’abord été condamnée par une Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme en 2017, en raison du refoulement sans aucune considération ni décision individuelle, en violation de l’interdiction d’expulsions collectives[209]. Néanmoins, la décision a été révisée par la Grande chambre[210], qui a considéré en 2020 qu’il n’y avait pas de violation de la Convention européenne des droits de l’Homme, car les personnes concernées auraient pu tenter une entrée régulière sur le territoire espagnol, par le dépôt d’une demande de protection internationale au poste-frontière de Beni‑Enzar[211] (ville marocaine proche de Melilla).
Enfin, les CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros, centres de rétention pour organiser les expulsions) sont souvent pointés du doigt par les institutions de défense des droits humains, notamment concernant les mauvaises conditions de vie des étrangers[212]. Des rapports relèvent que des personnes qui ne devraient pas être retenues se trouvent parfois en CIE, comme des mineurs présumés ou des citoyens européens, et que la gestion des CIE est différente d’un centre à l’autre[213]. Le manque de transparence quant aux conditions de détention est également interrogé[214], notamment concernant les violences que peuvent y subir les étrangères·ers.
Le décès en 2011 de Martine Samba, étrangère retenue en CIE, a fait émerger le débat sur la détention des étrangers·ères en Espagne[215] de façon notable. Le manque de soin reçu par cette femme a entraîné son décès, pour lequel sa famille a finalement été indemnisée en 2020 par le Gouvernement. Le ministère de l’Intérieur – en charge des CIE – et le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, ont admis que son décès était lié à un fonctionnement défaillant du CIE concerné, à Madrid[216].
L’accueil difficile des étrangers·ères concerne également les mineur·es non accompagnés, récemment au centre d’âpres débats sur la répartition territoriale de leur prise en charge, en particulier de celles et ceux qui arrivent par les îles Canaries.
3.4 La situation difficile des mineur·es non accompagné·es
Depuis 2021, les enfants non accompagnés âgés de moins de 18 ans qui franchissent la frontière d’une façon irrégulière, sont placés dans des établissements de protection de l’enfance et se voient offrir la possibilité d’obtenir le statut de résident à leur majorité[217]. En effet, les MENA (Menores Extranjeros No Acompañados, mineur·es étrangers·ères non accompagné·es), considéré·es comme « abandonné·es et désemparé·es », relèvent de la protection de l’enfance, gérée par les Communautés autonomes, ce qui peut d’ailleurs entraîner une différence de traitement d’une Communauté à l’autre[218], puisque c’est la Communauté dans laquelle se trouve le ou la mineur·e qui en a la charge. Pour que la protection s’applique, le mineur doit être reconnu comme tel, en application d’une procédure de détermination de l’âge qui date de 2014 (protocole MENA[219]). En cas de doute, le Procureur général déclenche le processus d’examens médicaux (notamment une radio des poignets, clavicules ou molaires)[220]. En 2021, le gouvernement a d’autre part adopté un décret afin de faciliter l’accès à un titre de séjour pour les mineur·es non accompagné·es devenu·es majeur·es, tout en excluant celles et ceux ayant un casier judiciaire non vierge. L’objectif : éviter la situation irrégulière des jeunes lorsqu’ils fêtent leur majorité. Après une première année de mise en place, plus de 16 000 jeunes ont obtenu un titre de séjour, excédant les prédictions du gouvernement de 10 %[221].
Néanmoins, des expulsions de mineur·es sont tout de même organisées, notamment depuis les enclaves espagnoles au Maroc. En effet, l’Espagne a adopté avec le Maroc un accord qui prend en compte la situation des mineur·es marocain·es isolé·es, dans l’objectif de pouvoir les renvoyer. Selon un mémorandum hispano-marocain de 2003, il est prévu que les autorités marocaines identifient les familles des mineur·es avant leur renvoi, ce qui ne semble pas toujours respecté[222]. Ce renvoi s’accompagne d’un financement espagnol pour la formation des mineur·es expulsé·es, une fois de retour au Maroc, selon un protocole de 2007 d’application du mémorandum[223]. Par la suite, l’Espagne a adopté un accord similaire concernant les retours de mineur·es non accompagné·es avec le Sénégal en 2008[224].
Par exemple, en 2021, l’Espagne et le Maroc s’accordent sur le transfert de 700 jeunes, mais en pratique ce sont moins de 50 mineur·es non accompagné·es qui ont effectivement été refoulé·es au Maroc. Le juge espagnol a tout de même estimé que parmi les 50 jeunes transférés, certains n’auraient pas dû l’être, faute de respect des conditions de renvoi des mineur·es[225]. En effet, pour un éloignement de mineur·e, les conditions suivantes doivent être remplies : le renvoi prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, le retour en toute sécurité est garanti, le retour est volontaire et le jeune a pu se faire entendre par la justice[226]. Cela souligne la complexité de la question des mineur·es.
Par ailleurs, le gouvernement espagnol tente régulièrement de modifier la compétence des Communautés pour déplacer la responsabilité de l’accueil des mineur·es au niveau central[227]. C’est notamment en raison d’une charge plus importante aux Canaries que se posait la question de revoir le fonctionnement entre Communautés autonomes, avec environ 5 000 mineur·es pour une capacité de 900 places[228]. La répartition de l’accueil des mineur·es non accompagné·es sur le territoire espagnol est un sujet complexe, en raison du système institutionnel régional. Ainsi, le PP, parti d’opposition au Gouvernement actuel, est en position de majorité au sein de nombreuses Communautés autonomes et s’oppose aux propositions de relocalisation du gouvernement central. Ce dernier a finalement fait coalition en 2024 avec un parti Catalan pour aboutir à un accord au niveau national.
Finalement, en mars 2025, un décret-loi royal a été adopté pour mieux répartir entre les régions les mineur·es non accompagné·es[229]. Pour assurer la répartition, la réforme prend en compte les caractéristiques de la Communauté (population, économie, efforts d’accueil, taux d’emploi, etc.). Le transfert devrait avoir lieu dans les 15 jours après l’arrivée de la personne mineure sur le territoire espagnol[230]. La capacité d’accueil de chaque Communauté va être calculée comme base de répartition. Néanmoins, rien n’est évoqué concernant la prise en compte des souhaits de la personne mineure.
Le ministre de la Politique territoriale assume la nécessité d’intégrer pleinement les mineur·es en déclarant que l’Espagne a accueilli des dizaines de milliers de mineur·es après l’invasion de l’Ukraine, que ce sont les mêmes enfants, qui ont le même âge mais que la seule différence est leur couleur de peau[231]. En substance, il affirme que ce qu’il est possible de faire pour les Ukrainien·nes (l’Espagne est le quatrième pays européen à avoir accueilli le plus d’Ukrainien·nes, ) doit être possible pour les jeunes d’autres nationalités.
Au premier trimestre 2025, environ 19 000 mineur·es étrangers·ères non accompagné·es sont officiellement pris·e en charge en Espagne, sous la protection des services sociaux des Communautés autonomes, avec un « expediente de tutela abierto[232] » (dossier de tutelle officiel), assurant hébergement, scolarisation, soins et accompagnement éducatif et social. Par ailleurs, l’Espagne compte en 2025 environ 17 000 ancien·nes mineur·es non accompagné·es âgé·es de 18 à 23 ans disposant d’un titre de séjour spécifique d’« extutelado[233] » (sortie de tutelle). Il s’agit de jeunes ayant été pris·es en charge par le système de protection de l’enfance espagnol, qui, à leur majorité, ont obtenu un titre de séjour spécifique, grâce à la réforme de 2021. Il existe des programmes d’accompagnement spécifiques pour les « extutelados », gérés au niveau des Communautés autonomes (hébergement, études, formation profesionnelle), mais ce n’est pas un droit garanti et uniforme sur tout le territoire, chaque Communauté autonome définit ses propres dispositifs, capacités et critères[234].
Figure 18. Mineur·es étrangers·ères non accompagné·es prises en charge en Espagne, 2021–2025
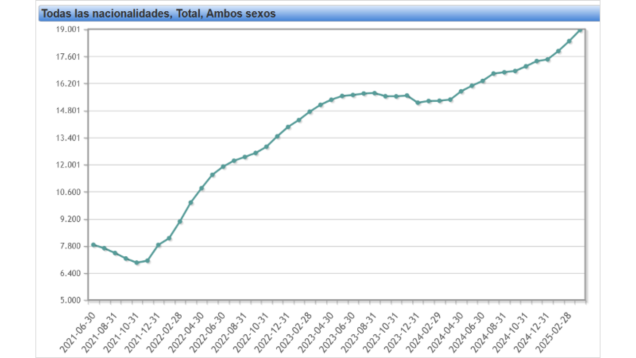
Source : Observatorio Permanente de la Inmigración[235]
La question de la prise en charge des mineur·es est importante en Espagne, avec une tension entre les compétences des Communautés autonomes et celles gouvernement central, qui semble s’être saisi du sujet. A l’exemple du ministre actuel de la Politique territoriale, Angel Victor Torres, qui estime qu’il faut investir dans la prise en charge de ces enfants, appelés à contribuer demain à la structure économique et sociale de l’Espagne[236].
3.5 L’éloignment des étranger·ères en situation irrégulière
Pour répondre aux exigences européennes liées à la création de l’espace Schengen et aux contrôles renforcés des frontières externes de l’Union européenne, une première loi sur les étrangers·ères (Ley de Extranjería) est adoptée en 1985. Celle-ci va ouvrir la possibilité de créer des Centres d’internement des étrangers·ères (CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, qui dépendent du ministère de l’Intérieur). Le placement dans les CIE est une mesure administrative privative de liberté, visant à organiser une expulsion. Il y a actuellement 1 200 places en CIE sur 7 centres actifs dans toute l’Espagne[237].
La deuxième loi sur les étrangers de 2000 va préciser les modalités de détention des étrangers·ères, notamment l’autorisation préalable par un juge et l’interdiction des mineur·es sauf en famille. La durée maximale de rétention en CIE est de 60 jours actuellement[238]. Au cours de ce délai, leur expulsion est organisée. A défaut, ils et elles seront libéré·es et transféré·es sur la Péninsule lorsque le CIE se situe sur une île ou dans les enclaves espagnoles au Maroc. Actuellement, les CIE de Ceuta et Melilla ne sont plus opérationnels, la gestion des expulsions se fait depuis les CETI (Centres temporaires d’accueil semi-ouvert). En effet, pour gérer les arrivées aux enclaves de Ceuta et Melilla, l’Espagne adopte une loi en mars 2015 qui permet des expulsions immédiates[239], pourtant contraires à la possibilité légale de contester cette décision administrative.
Rapidement après l’adoption de la loi de 2000, pour réduire le nombre de personnes en situation irrégulière, le gouvernement Espagnol teste différents mécanismes. Il propose par exemple aux Équatorien·nes de leur payer un billet aller-retour, afin de demander un visa depuis leur pays d’origine et de revenir en Espagne en situation régulière. Ce programme séduit quasiment 25 000 Équatoriens, ce qui rend le plan inopérable. Finalement, le gouvernement optera pour une régularisation sur place[240].
Les CIE servent à organiser le refoulement des personnes en situation irrégulière arrivées récemment. La rétention pour le refoulement se fait parfois également dans des locaux de détention moins formels, notamment dans des anciennes casernes militaires de l’île de Las Palomas, à Tenerife ou Gran Canaria[241]. D’autres espaces sont utilisés, comme les zones de transits des aéroports internationaux (la « salle 4 » de l’aéroport de Madrid) pour une durée maximale de 72 heures.
Passé les 72 heures, les personnes qui demandent l’asile doivent être hébergées dans des CAR ou dans des centres gérés par des ONG (capacité totale dans les CAR publics de 833 places principalement situés à Madrid[242]).
Concernant le rythme des expulsions, les chiffres semblent indiquer que celui-ci reste assez constant dans le temps. Ainsi, selon les données Eurostat, depuis 2015, il y a environ 10 000 personnes éloignées chaque année[243]. Les mesures administratives d’expulsion, elles, varient davantage, avec environ 50 000 ordres de quitter le territoire depuis 2018 et plutôt autour de 30 000 les années précédentes[244].
Figure 19. Obligations de quitter le territoire et expulsions, Espagne, 2017–2024
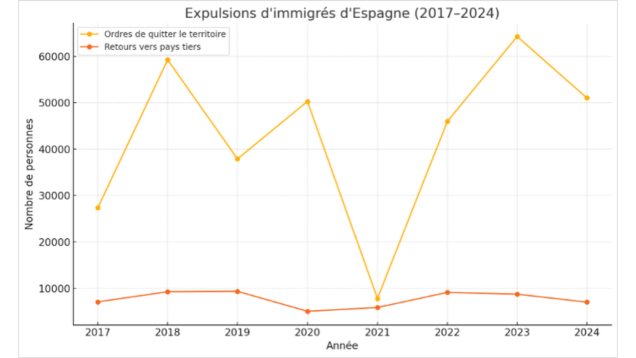
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[245]
* * *
Les objectifs des dirigeants espagnols sont clairs : les étrangers·ères sont plutôt dirigés vers les titres de séjour économique, plutôt que l’asile. Les règles qui régissent ces deux questions ne sont pas les mêmes, d’un côté l’asile est encadré par l’Union européenne et la Convention de Genève, de l’autre, l’immigration de travail est pleinement gérée par l’Etat. Les conséquences sont également différentes puisque les pays européens se sont engagés à accueillir dignement les demandeurs·euses d’asile, tandis que les travailleurs·euses ne peuvent prétendre qu’aux aides de droit commun. Est-ce cela qui explique en partie ce choix ou bien la seule volonté de maintenir une croissance économique ? Le constat est clair en tout cas : les étrangers·ères sont majoritairement dirigés vers les titres de séjour de travail, qui doit aider à leur intégration.
4. Intégration des immigré·es, la voie du travail
En bref
En Espagne, l’intégration des immigré·es repose principalement sur l’accès au travail. Depuis 2020, le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, issu du ministère du Travail et indépendant de l’Intérieur, fixe les orientations en matière de politique migratoire et d’intégration. Sa mise en œuvre est largement décentralisée vers les Communautés Autonomes et les municipalités.
L’économie espagnole – notamment les secteurs du tourisme, du bâtiment, de l’agriculture et de l’hôtellerie-restauration – dépend largement de la main-d’œuvre étrangère. Entre 2021 et 2024, 40 % des nouveaux emplois ont été occupés par des immigré·es. Les politiques publiques privilégient l’insertion professionnelle, avec l’implication des organisations patronales. L’acquisition de compétences et la reconnaissance progressive des qualifications facilitent l’intégration socio-économique. Toutefois, des obstacles persistent : précarité de certains emplois, accès au logement, ou encore inégalités d’accès aux droits. Le modèle espagnol se distingue par une approche pragmatique fondée sur l’inclusion via le travail malgré des parcours administratifs qui restent complexes.
L’existence d’un ministère spécifique, détaché du ministère du travail sur les questions d’inclusion, de sécurité sociale et des migrations (4.1.) est un signe supplémentaire de l’orientation et priorité données au travail pour les immigré·es (4.2).
4.1 Décentralisation et ministère dédié
Jusqu’en 1986, date de son adhésion à la Communauté européenne, l’Espagne n’avait aucune politique d’immigration, pas même une loi sur l’immigration. Ce n’est qu’en 1985 que la première loi sur l´immigration a été promulguée, comme condition préalable de l’adhésion de l’Espagne à la Communauté européenne. Au tournant des années 1980, l’Espagne était encore un pays d’émigration et les accords bilatéraux de l’époque, avec des pays d’Europe occidentale, visaient à accueillir et protéger les travailleurs·euses espagnol·es émigré·es. Dix ans plus tard, l’Espagne est devenue un pays d’immigration avec des flux migratoires de plus en plus hétérogènes[246].
Avant 2020, les compétences ministérielles en matière d’immigration relevaient d’une part, d’un secrétariat d’État à l’Immigration et à l’Émigration au sein du ministère du Travail, et d’autre part de la Direction générale des Relations internationales et des Étrangers au ministère de l’Intérieur. En 2020, le Premier ministre Pedro Sánchez crée un ministère détaché du ministère du Travail, doté des compétences en matière de sécurité sociale, auxquelles lui sont adjointes les compétences en matière d’inclusion sociale et de migrations. Le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations est ainsi chargé de l’élaboration et du développement de la politique gouvernementale relative aux étrangers·ères, à l’immigration et à l’émigration et aux politiques d’inclusion. Sous sa responsabilité, le secrétariat d’État aux migrations est l’organe chargé de développer la politique migratoire définie par le gouvernement en termes d’immigration, d’intégration des immigré·es et de citoyenneté espagnole à l’étranger[247]. La délivrance de titres de séjour relève de la compétence du ministère de l’Intérieur, à travers la Oficina de Extranjería (bureau des étrangers), rattachée à la Subdelegación del Gobierno (sous-délégation du Gouvernement) dans chaque province, qui est chargée de recevoir et d’instruire les demandes sur le territoire.
De 1985 à 2017, différents gouvernements ont approuvé six lois sur le statut des étrangers et des règlements d’application afférents. Au niveau de l’État, les premières politiques portant spécifiquement sur l’intégration des immigré·es ont fait leur apparition avec le Plan d’intégration sociale des immigré·es de 1994[248], puis les Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración de 2007–2010 (PECI) et de 2011–2014 (PECI II)[249].
En 2007, le premier PECI est adopté par le gouvernement, doté d’un budget de 2 milliards d’euros pour la période 2007–2010, indiquant aux régions, municipalités et à la société civile ses priorités pour l’éducation, l’accueil et l’emploi. Il ne s’agit pas de proposer aux étrangers·ères des services sociaux ou des prestations spécifiques, mais de favoriser l’accès universel aux services publics, avec la coordination et l’évaluation des actions de proximité des régions, municipalités et associations dans l’insertion, sans volonté de centralisation[250].
L’Etat-providence reculant depuis de nombreuses années en Espagne et la gestion des politiques sociales étant largement transférée aux Communautés Autonomes, l’accès au droit et aux prestations est inégal selon les régions[251]. Ces difficultés peuvent être aggravées par les freins de maîtrise de la langue, par l’isolement, la connaissance du droit, etc.[252].
Le gouvernement central énonce des principes et fixe un cadre assez peu contraignant, à l’intérieur duquel interviennent les collectivités territoriales. Les subventions destinées à la politique d’intégration se négocient de façon bilatérale, en fonction d’indices objectifs tels que le taux de population étrangère, mais aussi en fonction des alliances politiques[253]. La concertation d’une Communautés Autonomes à l’autre est faible[254].
La politique d’intégration espagnole est à considérer au regard du modèle social et démocratique de l’Espagne, où les identités régionales prennent souvent le pas sur l’idée d’une nation, par ailleurs très décentralisée[255]. En Espagne, les étrangers·ères ont à s’intégrer à la société et non à la nation[256], l’intégration passe par un niveau très local.
L’Espagne, connaissant une pluralité culturelle affirmée, se traduisant par exemple par la coexistence de 5 langues officielles[257], aurait ainsi une certaine tolérance à la diversité liée à la présence des étrangers·ères dans l’espace public. L’Espagne impose peu de conditions d’initiation ou d’adhésion aux valeurs de la société d’accueil, par ailleurs peu définies en raison d’une identité nationale multiculturelle[258].
En juillet 2023, l’Espagne a adopté un nouveau plan en faveur de l’intégration : le « Cadre stratégique pour la citoyenneté et l’inclusion, contre le racisme et la xénophobie, 2023‑27[259] ». Ce cadre stratégique vise à promouvoir l’intégration et l’inclusion des immigré·es, à lutter contre le racisme, la xénophobie et les autres formes d’intolérance. Par ailleurs, le gouvernement espagnol a annoncé s’intéresser à la question du déclassement professionnel des étrangers·ères, en les accompagnant davantage dans leur intégration au marché du travail[260].
Rattaché au Secrétariat d’Etat aux migrations, donc au ministère de l’Intégration, de la Sécurité sociale et des Migrations, l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE) crée en 2000 a pour mission l’étude, l’analyse et les propositions d’action en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie en Espagne. L’Observatoire publie régulièrement des rapports et des campagnes, notamment à l’encontre d’attitudes persistantes et discriminatoires à l’égard des étrangers et comprend un Observatoire permanent sur l’immigration[261].
La revitalisation de territoires ruraux par l’accueil d’immigré·es, l’exemple de Burbáguena Le village rural espagnol de Burbáguena, dans la province Teruel en Aragon, est situé dans l’une des zones les moins densément peuplées d’Europe[262]. Sa population, en fort déclin depuis des années, comptait 207 habitant·es[263], avant l’ouverture en 2021 d’un centre destiné aux demandeur·euses d’asile, opéré par l’association Accem[264]. Depuis son ouverture, le centre a accueilli plus de 1 000 personnes en attente de l’examen de leur demande. Une centaine d’entre elles s’est désormais installée dans la région, faisant presque doubler la population de Burbáguena, qui compte aujourd’hui 350 habitants, dont 25 enfants[265]. Les effets sur la revitalisation du village sont notables, avec par exemple la réouverture des petits commerces (pharmacie, boulangerie, bar) ou la reprise de service du bus scolaire[266]. |
Les droits sociaux des étrangers·ères en situation régulière sont identiques à ceux des citoyen·nes espagnol·es, en particulier pour les prestations sociales, sous condition de résidence[267] :
- accès au système de santé public universel, au même titre que les citoyen·nes espagnol·es, sous condition de résidence légale et d’inscription au registre municipal (padrón).
- Revenu minimum vital (Ingreso Mínimo Vital), sous condition d’au moins un an de résidence et sous réserve de conditions de ressources et de participation à des mesures d’inclusion sociale, telles que la recherche active d’emploi.
- Aides au logement, gérées au niveau des communautés autonomes, s’ils ou elles remplissent les critères de résidence et de ressources définis par chaque région.
- Prestations familiales, retraite, allocation chômage, à condition d’avoir cotisé au système de sécurité sociale espagnol.
Les étrangers·ères en situation irrégulière n’ont pas accès à ces droits sociaux, à l’exception du système de santé publique. Depuis le décret-loi 7/2018[268], les étrangers·ères en situation irrégulière ont un accès quasi universel au système de santé publique, incluant les soins primaires, spécialistes, urgences, hospitalisation, prévention et médicaments, sous réserve de trois conditions cumulatives : s’ils ou elles résident en Espagne depuis plus de 90 jours, ne bénéficient pas d’une couverture santé dans leur pays d’origine, et ne disposent pas de ressources suffisantes[269].
En termes de droits civiques, les étrangers·ères en situation régulière résidant en Espagne depuis au moins cinq ans sans interruption ont le droit de vote aux élections municipales à condition que leur pays d’origine applique la réciprocité pour lesressortissant·es espagnol·es. Dans les faits, cela ne concerne qu’une douzaine de pays dans le monde[270].
4.2 L’accès au travail en priorité
Depuis 2002, la population née en Espagne et en âge de travailler a diminué de plus d’un million de personnes, tandis que celle née à l’étranger a augmenté de près de 4,2 millions. L’augmentation de la main-d’œuvre disponible en Espagne est ainsi entièrement due à l’immigration, avec un taux d’actifs parmi les immigré·es de 78 %, contre 63 % dans la population espagnole. Le taux d’activité global des étrangers·ères est supérieur à celui des Espagnol·es, en raison d’une plus grande concentration des étrangers·ères dans la tranche d’âge 25 – 54 ans, ainsi que dans les zones géographiques à fort emploi[271].
Selon l’étude « Informe sobre la Integración de la población extranjera en el mercado laboral español »[272], si les étrangers·ères abandonnaient le marché du travail, l’économie espagnole perdrait immédiatement 16,9 millions d’emplois.
Cependant, l’Espagne observe un déficit d’intégration des étrangers·ères dans le marché du travail. En 2023, le taux de chômage parmi la population étrangère atteint 19,7 %, soit une différence de 7 points au-dessus du taux de chômage des Espagnol·es (12 %)[273]. Ceci n’inclut pas la proportion importante de personnes étrangères résident en Espagne sans titre de séjour. À âge et niveau de formation équivalent, le chômage reste plus important parmi les étrangers·ères que pour les Espagnol·es, une différence particulièrement marquée dans le cas des diplômé·es de l’enseignement supérieur (4–5 % dans la population espagnole de plus de 35 ans, 11–19 % dans la population étrangère)[274]
Figure 20. Taux de chômage en Espagne, 2005–2023

Source : Statista[275]
A contrario, les métiers peu qualifiés représentent 28 % de salarié·es étrangers·ères contre seulement 9 % des salarié·es espagnol·es, avec un phénomène de déclassement des étrangers·ères par rapport à leur niveau de qualification. Ainsi, la présence de travailleurs·euses étrangers·ères ayant fait des études supérieures dans les professions dites peu qualifiées (12 %), est 6,7 fois supérieure à celle des Espagnols (1,8 %)[276]. Ceci s’observe particulièrement dans le secteur du travail domestique, où près de la moitié des emplois sont occupés par des étrangers·ères, en particulier des femmes. Sans compter que près de 30 % des femmes employées dans les activités ménagères seraient en situation irrégulière[277].
La surreprésentation des étrangers·ères dans les professions dites peu qualifiées (37 % de travailleurs·euses étrangers·ères) ou dans la restauration (20 % de travailleurs·euses étrangers·ères)[278] implique une plus grande vulnérabilité au chômage, puisque ces secteurs représentent près de 60 % des chômeurs·euses qui exerçaient une activité avant de perdre leur emploi[279].
L’écart salarial selon la nationalité (espagnole-étrangère) est de 34 % en moyenne, les caractéristiques inégales de l’emploi expliquent la majeure partie de l’écart salarial, à emploi équivalent cet écart brut tombe à 5,3 %[280].
Figure 21. Répartition des étrangers·ères par niveau d’éducation vs. population espagnole
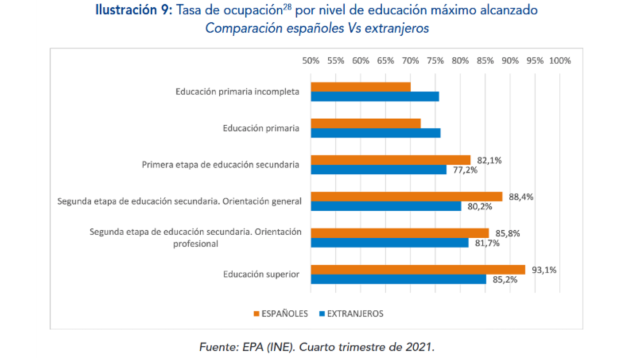
Figure 22. Taux de salarié·es étrangers·ères par type de profession, 2021

Source : Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones[281]
* * *
Les questions d’intégration des immigré·es en Espagne commencent à se poser lorsque le poids de l’immigration dans la démographie espagnole devient plus prégnant. L’histoire de l’immigration espagnole étant relativement récente, l’Espagne ne peut pas s’appuyer sur une tradition nationale relevant d’un projet politique, ni sur une expérience validée par des évaluations périodiques en matière de politique d’intégration. La politique d’intégration se construit donc par mesures successives à partir des années 1990, parallèlement à l’entrée en vigueur de textes de loi. Tandis que l’encadrement législatif relève de l’Etat central, la politique migratoire étant une de ses compétences exclusives, les mesures liées à l’intégration sur le terrain relèvent largement des Communautés Autonomes et des municipalités[282]. Cette répartition a également un effet sur l’opinion publique et le paysage politique.
5. Opinion publique, paysage politique et traitement médiatique : la polarisation
En bref
L’Espagne se distingue en Europe par une opinion publique relativement ouverte à l’égard de l’immigration, bien que marquée par une polarisation croissante. Le gouvernement de Pedro Sánchez assume une position singulière, défendant l’immigration comme une nécessité économique et démographique. Cette approche contraste avec la montée du parti d’extrême droite Vox, qui a fait de l’immigration un levier de mobilisation électorale, notamment dans les régions les plus exposées aux arrivées. Les débats publics restent moins focalisés sur la sécurité que dans d’autres pays européens, et plus orientés vers les enjeux économiques ou humanitaires. Les médias jouent un rôle ambivalent, entre récits anxiogènes sur les arrivées irrégulières et valorisation du rôle des immigré·es. Malgré des tensions locales et une instrumentalisation politique croissante, une large majorité des Espagnol.es adhère à une vision pragmatique de l’immigration, fondée sur l’intégration par le travail et la reconnaissance de la contribution économique et sociale des immigré·es.
Pedro Sánchez et son gouvernement tiennent un discours d’ouverture sur l’immigration qui tranche avec les autres pays européens (5.1), mais, au plan intérieur, l’ascension rapide du parti Vox polarise le débat public (5.2). Malgré cela, un large consensus transparaît dans l’opinion publique espagnole sur la nécessité de l’immigration et ses bénéfices économiques pour le pays (5.3). Le traitement médiatique des migrations a tendance à suivre le débat politique, tout en restant largement stéréotypé aux moments qualifiés de « crises » aux frontières, malgré leurs répétitions depuis 20 ans (5.4).
5.1 Gouvernement Sánchez : une position singulière en Europe
Alors que le sujet de la migration est instrumentalisé par les responsables politiques de nombreux pays européens depuis les années 2000[283], le discours du Gouvernement espagnol actuel dénote, sans que le sujet ne soit absent des débats. Probablement en raison des objectifs économiques d’intégration des immigré·es affichés par le Gouvernement Sánchez, il semble que ce dernier en parle de façon positive, tout en évitant que le sujet ne prenne trop d’importance médiatique, afin d’éviter un backlash, ou un retour de bâton, de la part de l’opinion publique ou de ses adversaires politiques[284].
Ainsi, selon les déclarations de Pedro Sánchez, chef du Gouvernement espagnol, lors d’un discours prononcé en août 2024 depuis la Mauritanie : « Malgré la rhétorique qui se développe en Europe, la migration n’est pas un problème ». Secrétaire général du PSOE (parti socialiste ouvrier espagnol), président du Gouvernement depuis 2018, ayant lui-même des proches qui ont fui la dictature de Franco, il porte une voix singulièrement différente de celle de ses homologues européens sur l’immigration, que l’on retrouve dans ce même discours : « Il n’y a pas si longtemps, l’Espagne était aussi un pays de migrants, et beaucoup de compatriotes espagnols ont cherché ailleurs une vie meilleure, un destin qui leur était impossible dans leur pays ». Il y souligne le bénéfice économique de l’immigration pour l’Espagne : « La contribution des travailleurs migrants à notre économie, notre système social ou à la soutenabilité des retraites, est fondamentale. Pour l’Espagne, la migration est synonyme de richesse, de développement et de prospérité ». Son approche est résumée dans la conclusion de son discours : « la migration n’est pas un problème, c’est une nécessité, qui implique certains problèmes. C’est pourquoi nous devons gérer de manière humaine, sûre et ordonnée le phénomène de la migration au bénéfice de nos sociétés respectives[285] ».
Avec une conception de l’immigration comme une chance pour la prospérité de son pays, il ne suit pas les positions de ses partenaires européens, même si l’extrême droite n’épargne pas l’Espagne, avec la montée du parti Vox. Le 9 octobre 2024, devant le Congrès des député·es, Pedro Sánchez déclare : « Nous, les Espagnols, nous sommes des enfants de l’immigration. Nous n’allons pas être les parents de la xénophobie[286]. » Ouvertement opposé aux députés de droite et d’extrême droite sur le sujet, il les accuse de répandre un discours de haine : « Vox et le PP nous disent que les migrants mettent en danger nos proches, mais la vérité est que la moitié des gens qui travaillent pour s’occuper de nos enfants, de nos parents et de nos grands-parents sont des immigrants. Qu’ils prennent soin d’eux avec respect et affection, comme s’ils étaient de leur propre famille (…) C’est la véritable contribution des migrants à notre économie et à notre société, une contribution similaire et complémentaire de celle des citoyens espagnols. Une contribution qui devrait être maintenue dans les décennies à venir, si nous voulons surmonter ce défi démographique et garantir la prospérité et le progrès de notre société[287] ».
Néanmoins, en raison du statut de l’Espagne de pays de premier arrivée, le gouvernement espagnol soutient l’UE et revendique que « toute l’Europe s’implique dans la gestion des flux migratoires » avec la mise en place d’un mécanisme de répartition au niveau de l’Union européenne. Ainsi, la majorité des député·es européen·nes du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) ont soutenu le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté en mai 2024, pourtant hautement critiqué par les ONG[288]. En effet, les règles adoptées dans le cadre de ce pacte institutionnalisent la pratique des hotspot en créant une procédure d’asile à la frontière, qui s’applique dans le cadre d’une rétention des personnes concernées. Dans le Pacte, il est également prévu une répartition des personnes demandant l’asile, à laquelle tous les Etats doivent participer, mais avec des modalités qu’ils peuvent choisir (admettre des personnes ou participer financièrement[289]).
Juan Fernando López Aguilar, député européen espagnol (PSOE), rapporteur pour l’un des textes du pacte, a défendu son adoption en soulignant qu’il représentait une avancée nécessaire pour une gestion plus solidaire et ordonnée des flux migratoires au sein de l’UE, soulignant que l’accord, après des années de négociations, « est mieux que de laisser les choses telles qu’elles sont, en abandonnant les gouvernements européens à leur sort ».[290] Néanmoins, les solutions proposées maintiennent le système de répartition dit Dublin et une solidarité à géométrie variable et peu contraignante[291]. Certains Etats membres estiment que les règles adoptées dans le Pacte sont insuffisantes et ont appelé en 2024 à la création de hubs de retour communs, qui seraient situés hors de l’Union européenne[292]. L’Espagne ne fait pas partie des 15 Etats membres qui ont adressé cette réclamation à la Commission européenne, pas plus qu’elle n’a signé la lettre critique à l’égard de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant sa jurisprudence à l’égard des éloignements de ressortissants d’Etats tiers[293].
5.2 La polarisation rapide et récente du paysage politique avec l’apparition de Vox
L’ascension rapide, en Espagne, du parti d’extrême droite Vox, peut être lue comme une conséquence de la polarisation de la société espagnole, que le parti tend à renforcer par ses discours et son positionnement idéologique[294]. L’évolution électorale du parti politique Vox est assez marquante en Espagne, car elle témoigne d’un phénomène inédit et récent depuis la transition démocratique du pays en 1978 : l’émergence d’une extrême droite nationale forte. Paradoxalement, en comparaison avec les autres pays d’Europe occidentale, alors que la question migratoire est au centre du programme de Vox, son sursaut en 2018, au coeur de la crise catalane, est surtout déterminé par sa position nationaliste et anti-séparatiste[295].
Figure 23. Alternance politique du Gouvernement espagnol, 1978–2025
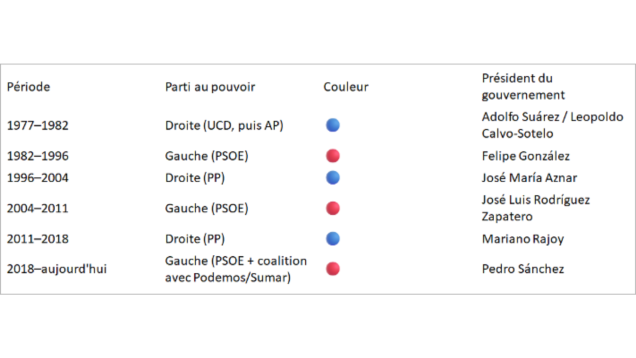
Source : élaboration par les auteurs·rices
L’absence de l’extrême droite dans le paysage politique espagnol depuis plusieurs décennies peut s’expliquer par son expérience d’un régime dictatorial entre 1936 et 1975, et le fait que l’alliance populaire de droite a réussi à attirer les voix plus conservatrices du franquisme (dans les années 1980, 14 % de l’alliance populaire se situe à l’extrême droite). Ainsi, jusqu’à récemment, les notions de nationalisme et de patriotisme ne s’imposaient pas, et les courants d’extrême droite se fédéraient difficilement[296].
Le parti Vox est créé en 2013 par d’anciens membres du Parti populaire (PP), reprochant à ce dernier sa modération, avec comme principale revendication la remise en question du modèle de l’Espagne des autonomies défini par la Constitution de 1978[297]. Ainsi, Vox défend un État unitaire, une recentralisation des compétences d’éducation, de santé, de police et de justice, la suppression des parlements régionaux[298], une limitation de l’immigration et une place importante des valeurs chrétiennes[299].
Ses premiers résultats électoraux sont marginaux : Vox obtient 1,57 % des voix (sans siège) aux européennes de 2014 ; et autour de 0,2 % (sans siège) aux législatives de 2015 et 2016[300]. Le premier choc apparaît en 2018 avec l’entrée de Vox pour la première fois dans un parlement régional avec près de 11 % des voix (12 sièges), aux élections régionales andalouses, avant de devenir la troisième force politique du pays au niveau national en 2019, avec notamment 15,1 % des voix (52 sièges) aux élections législatives anticipées de novembre et l’entrée du parti au Congrès des Députés[301].
L’émergence de Vox coïncide avec une crise politique majeure en Espagne en 2018, autour des revendications indépendantistes de la Catalogne, déclenchée par l’organisation d’un référendum d’indépendance fin 2017 par le Parlement régional, contraire à la Constitution espagnole[302]. Cette crise cristallise la polarisation de la société catalane, divisée entre partisan·es et opposant·es à l’indépendance, et entache plus globalement au niveau national la confiance dans les institutions espagnoles. En réaction, l’indépendantisme catalan a été perçu par une large part de la population espagnole comme une attaque contre l’unité de l’Espagne, une valeur fortement symbolique. Une partie de l’opinion publique, notamment à droite, a réclamé une réaction plus ferme que celle du gouvernement Rajoy, jugé faible ou laxiste. Vox a su capitaliser sur ce sentiment de « trahison nationale » en se présentant comme le défenseur intransigeant de l’unité espagnole, prônant la suppression des autonomies régionales[303].
Le succès de Vox en aux élections régionales en Andalousie en décembre 2018 est ainsi le fruit d’une convergence de plusieurs facteurs[304] :
- le discours anti-séparatiste et nationaliste, agissant en déclencheur au niveau national ;
- le discours anti-élites, qui joue un rôle décisif au niveau local, au sein d’une région bastion historique du Parti socialiste (PSOE) depuis 36 ans, perçu comme corrompu et clientéliste[305] ;
- l’agenda anti-immigration, qui trouve un écho fort dans des zones rurales paupérisées, à fort taux de chômage, et peu habituées à la diversité culturelle. L’Andalousie, région frontalière de l’Afrique du Nord, est en première ligne de la gestion migratoire, avec des arrivées irrégulières sur les côtes d’Almería ou de Cadix et la présence importante de travailleurs·euses immigré·es dans l’agriculture intensive (notamment à Almería et Huelva). Ainsi, le parti obtient ses résultats les plus importants dans les municipalités connaissant le plus fort taux d’immigration[306], en ayant fait campagne sur la promesse de déporter les immigré·és en situation irrégulière ou encore de rendre les murs des enclaves de Ceuta et Melilla infranchissables[307].
L’Andalousie a servi de laboratoire pour le parti, qui transforme l’essai lors des élections régionales de 2019 et devient une force présente dans la plupart des parlements régionaux, à l’exception de ceux où le nationalisme espagnol est minoritaire (Catalogne, Pays Basque). Ses résultats se confirment lors des deux élections générales tenues en 2019.
Figure 24. Résultats électoraux de Vox aux élections générales d’avril 2019.
Une percée sur l’ensemble du territoire à l’exception des régions à forte identité régionaliste ou indépendantiste (Catalogne, Pays basque, Navarre, Galice et Canaries) où son influence reste faible voire inexistante.
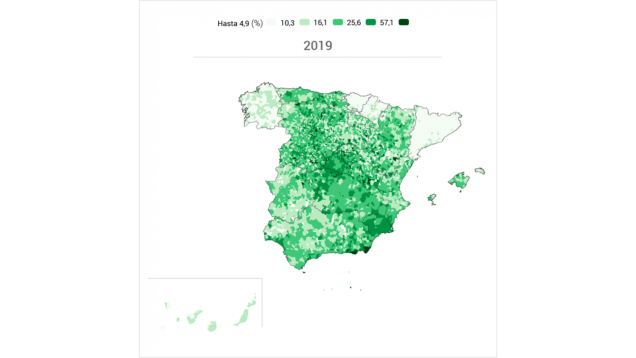
Source : RTVE[308]
Vox connaît par la suite une tendance électorale plutôt à la baisse, maintenant toutefois sa place de troisième force politique du pays, avec 12,4 % des voix aux élections législatives de 2023[309] et 9,6 % aux élections européennes de juin 2024[310].
Figure 25. Résultats électoraux de Vox aux élections nationales (générales et européennes), 2014–2024
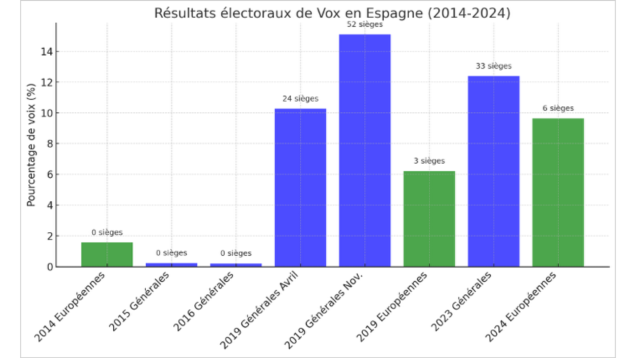
Source : élaboration des auteurs·rices, à partir des publications de résultats officiels[311]
Dans une partie des Communautés autonomes, le parti Vox s’est allié avec le PP (Partido Popular), mais en juillet 2024, Vox retire son soutien de cinq régions autonomes qu’il dirigeait en coalition avec le PP, en raison de désaccords sur la répartition des mineur·es étrangers·ères non accompagné·es[312].
Sur les questions de migration, Vox propose de contrôler l’immigration en fonction des besoins économiques et de la capacité des immigré·es « à s’intégrer et à accepter les valeurs espagnoles[313] ». Le parti suggère la mise en place de quotas, l’expulsion des immigré·es en situation irrégulière et la lutte contre les ONG qui portent assistance à ces derniers. Très critique vis-à-vis des relations avec le Maroc, il propose la construction d’un mur en béton autour de Ceuta et Melilla[314].
Illustration 1. Campagne Vox contre l’accord entre le PP et le PSOE sur la politique de répartition territoriale de l’accueil des sans-papiers et des mineur·es non accompagné·es – 2025
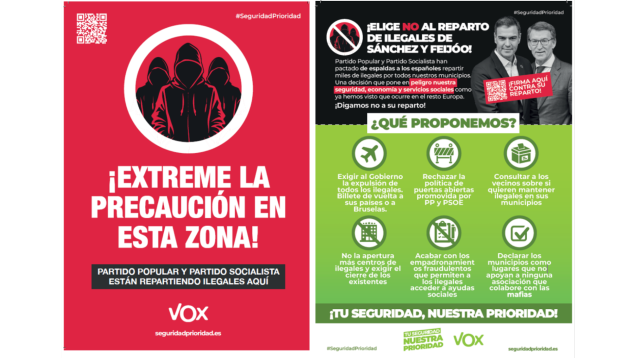
Source : Vox[315]
Plus radical que Vox, un nouveau mouvement politique, « Se Acabó La Fiesta » (littéralement « La fête est finie », abrégé SALF), provoque la surprise en 2024, en emportant environ 4,6 % des suffrages aux élections européennes, lui permettant l’obtention de 3 sièges. Créé quelques mois à peine avant les élections, le mouvement a émergé à partir d’un phénomène sur les réseaux sociaux, notamment autour de la figure d’Alvise Pérez, un influenceur et militant controversé[316]. Il porte en effet un discours qualifié de populiste sur des thèmes tels que l’immigration, la dénonciation de la corruption des élites, la défense de l’ordre public, et une hostilité envers les grands médias[317].
Rapidement néanmoins, le mouvement fait face à des difficultés internes, en raison de multiples enquêtes judiciaires ouvertes contre Alvise Pérez (pour corruption, escroquerie, blanchiment, usage de faux[318]) et d’une sanction du Parlement européen pour des revenus non déclarés. Début mai 2025, Nora Junco et Diego Solier, les deux autres eurodéputés initialement élus avec SALF, décident de quitter le parti et de se déclarer indépendant·es[319]. Au-delà de sa poussée initiale, SALF est en recul dans les sondages, désormais cantonné à environ 2–3 % des intentions de vote, et bien qu’il continue d’exister, il demeure une voix marginale et son avenir politique est incertain[320].
5.3 Opinions positives mais une tendance à la polarisation
La perception croissante de l’immigration comme une menace en termes économiques, culturels et sécuritaires traverse l’ensemble du continent européen, accentuant les divisions politiques et sociales. Cela se reflète à la fois dans l’état de l’opinion publique et dans la montée des formations politiques d’extrême droite[321]. L’Espagne ne fait pas exception.
L’Espagne est une démocratie parlementaire multipartite, avec un système électoral proportionnel, ce qui pourrait laisser penser que les antagonismes entre les groupes politiques sont réduits. C’est cependant l’un des pays les plus polarisés des démocraties occidentales[322], et la radicalisation des positions partisanes sur l’immigration renforce ce phénomène[323].
De façon générale, l’opinion publique d’un pays vis-à-vis de l’immigration dépend d’une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs tels que[324] :
- la position géographique et la pression frontalière ;
- le chômage et la concurrence perçue pour les ressources sociales ;
- la peur et les craintes sécuritaires ;
- les revendications identitaires, souverainistes et religieuses ;
- le débat politique et la couverture médiatique.
L’influence de ces différents facteurs sur l’opinion publique espagnole sur l’immigration sont présentés ci-après.
a. Craintes sécuritaires : impact limité du terrorisme
Entre 2000 et 2020, l’Europe est touchée par une vague d’attentats terroristes revendiqués par des mouvances islamistes[325], dont les attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Catalogne les 17 et 18 août 2017.
Attentats de 2004 à Madrid
Le 11 mars 2004, à Madrid, dix bombes explosent dans quatre trains de banlieue à l’heure de pointe du matin, faisant 191 mort·es et plus de 1 800 blessé·es. C’est l’attentat terroriste le plus grave dans l’histoire contemporaine espagnole. En l’absence de revendications immédiates, le gouvernement attribue dans un premier temps ces attentats à l’ETA, malgré les démentis de l’organisation séparatiste basque. Il faudra plusieurs jours au gouvernement Aznar pour confirmer la piste islamiste, alors que ces attentats ont lieu trois jours avant les élections générales nationales. Le comportement du gouvernement espagnol fait l’objet d’un vif débat quant à la mise en cause de l’ETA trop catégorique[326].
Au soir du scrutin, le 14 mars 2004, alors que les sondages donnaient le PP en tête du avant l’attentat, le PSOE remporte la majorité relative, et le socialiste José Luis Rodríguez Zapatero obtient un mois plus tard l’investiture du Congrès des députés[327].
Considérant que son élection était un signe fort de désapprobation de l’alignement de l’Espagne sur la politique anti-terroriste américaine, Zapatero annonce le retrait d’Irak des troupes espagnoles et met en avant la collaboration avec les pays musulmans dans la lutte contre le terrorisme[328]. Il lance un dialogue politique avec le Maroc, en particulier sur les sujets de lutte anti-terroriste et des migrations, ce pays étant devenu le premier pays d’origine des immigré·es en Espagne. Alors que le Maroc a également été frappée par un attentat islamiste meurtrier à Casablanca en mai 2003, la première visite de Zapatero au Maroc, juste après son élection en 2004, marque la considération de l’Espagne pour le Maroc comme un comme un partenaire privilégié dans la lutte contre le terrorisme[329].
Attentats de 2017 en Catalogne
À Barcelone, le 17 août 2017, une attaque terroriste au véhicule-bélier a lieu sur la Rambla, suivie par une autre le lendemain, sur le même mode opératoire, à Cambrils, en Catalogne. Ces attentats feront 16 mort·es et plus de 130 blessé·es et sont revendiqués par le groupe Etat islamique qui entend cibler l’Espagne au motif de sa participation à la coalition en Syrie et en Irak ; bien que l’Espagne ne mène pas de frappes aériennes dans ces pays et que son rôle au sein de la coalition se limite à des missions de maintien de l’ordre, de déminage ou de premier secours[330].
Ces événements se sont produits dans un climat politique déjà tendu, à quelques semaines du référendum sur l’indépendance de la Catalogne, prévu le 1er octobre 2017. Les attentats ont mis en lumière des divergences entre les forces de sécurité catalanes (Mossos d’Esquadra) et les autorités espagnoles, notamment en matière de partage d’informations et de coordination. Des critiques ont alors émergé concernant le manque de coopération entre les différentes forces de sécurité, ce qui a alimenté les tensions politiques[331]. Les attentats ont donc attisé les tensions entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol, instrumentalisés par les deux camps, d’abord sur les questions sécuritaires, s’accusant mutuellement de négligence ou d’incompétence, puis sur le plan politique, à propos de la feuille de route de la Catalogne vers son indépendance et l’opposition du gouvernement central[332].
Influence sur l’opinion publique au sujet de l’immigration
Les attentats terroristes du 11 mars 2004 sont associés dans l’opinion publique espagnole à un scandale politique intérieur et à un changement de politique étrangère. C’est à leur suite que le Gouvernement a choisi de développer sa coopération anti-terroriste avec le Maroc, pays musulman d’origine de la plus importante communauté d’immigré·es en Espagne. Les attentats de Barcelone en 2017 sont associés à la crise catalane, et à leur instrumentalisation politique par le pouvoir central espagnol comme par le pouvoir catalan. Dans les deux cas, plutôt que de favoriser une union nationale face au terrorisme, les attentats ont accentué des fractures politiques intérieures[333]. La focalisation des médias et du débat public sur une crise politique, plutôt que sur les auteurs des attentats, leurs origines, leur rapport à l’immigration, leur radicalisation et la présence d’un Islam radical en Espagne, explique que, jusque récemment, avec la reprise de cette thématique par Vox et certains médias, l’association de l’immigration au risque sécuritaire est plus faible en Espagne que dans d’autres pays d’Europe ayant subi des attentats islamistes d’ampleur[334].
b. Situation économique : facteur déterminant d’influence de l’opinion publique sur l’immigration
En Espagne, comme le montre l’analyse des facteurs d’influence sur la polarisation de l’opinion publique sur l’immigration[335], le facteur prédominant à l’évolution de l’opinion publique est la situation économique du pays et le taux de chômage.
L’opinion sur l’immigration est fortement corrélée au taux de chômage en Espagne. La baisse du chômage entraîne une évolution positive de l’opinion publique. Depuis fort longtemps, le travail légitime la présence des immigré·es aux yeux des Espagnol·es. En 2007, 75 % d’entre elles et eux se déclaraient favorables à l’entrée de nouveaux immigré·es pourvus de contrats de travail[336], tandis qu’en 2024, 66 % des Espagnol·es pensent que les immigré·es contribuent positivement au pays, avec pour principale raison évoquée, la contribution économique et au marché du travail[337]
Figure 26. Corrélation entre opinion positive sur l’immigration et taux de chômage en Espagne, 2014–2024.
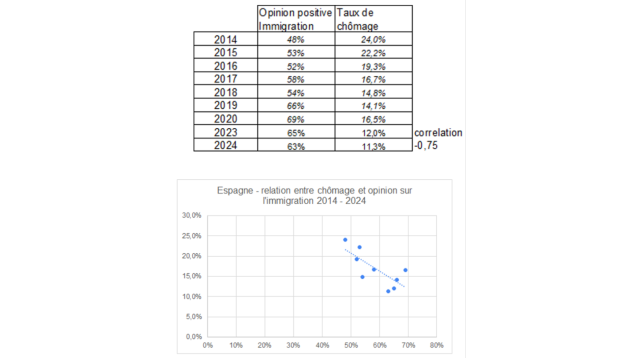
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des. données Eurostat[338]
L’état de l’opinion publique est néanmoins aussi influencé par la couverture sensationnaliste de l’immigration dans nombre de médias et par son instrumentation politique, dans un pays en état « préélectoral » quasi-permanent[339].
c. Etat et évolution de l’opinion publique sur l’immigration
La crise des cayucos en 2006, du nom des pirogues de pêche venues du continent africain[340], a mis à l’épreuve les institutions espagnoles et les organisations de la société civile, propulsant l’immigration au centre de l’attention publique, comme jamais auparavant[341]. C’est notamment à partir de cet épisode que l’immigration est devenue une question prenant de l’importance dans le débat public espagnol, les partis politiques de droite considérant qu’il faille contenir et restreindre le phénomène, ceux de gauche se montrant plus favorables aux droits des étrangers·ères.
La question de l’immigration est devenue un instrument politique, combinant une grande visibilité dans le débat public, un désaccord idéologique dans les positions adoptées et l’utilisation de cadres stéréotypés, accroissant la division sociale à des fins électorales[342]. C’est surtout avec le succès du parti d’extrême droite Vox en 2018, qu’un discours hostile à l’encontre des immigré·es s’est imposé sur la scène politique, contribuant largement à la polarisation du débat[343].
Les orientations électorales suivent en Espagne un schéma traditionnel gauche-droite, la gauche accordant plus d’importance aux questions sociales et aux préoccupation redistributives égalitaires, tandis qu’à droite et à l’extrême droite ce sont les questions socioculturelles, liées à l’identité nationale, à la culture et à l’immigration qui sont primordiales[344]. En Espagne, les principaux partis politiques utilisaient déjà l’immigration comme instrument de compétition électorale avant l’émergence du parti de droite radicale Vox en 2018. Les positions des partis sur l’immigration étaient alors largement divergentes, entraînant une logique de polarisation mettant en avant les aspects positifs du groupe intérieur (nous) et exagérant les aspects négatifs du groupe extérieur (eux), ce qui alimentait les stéréotypes à l’égard des immigré·es. C’est essentiellement la droite qui a changé sa stratégie discursive liée à l’immigration au cours des dernières décennies, en utilisant cette question comme outil de polarisation[345].
L’attitude hostile aux immigré·es de certains dirigeants politiques joue un rôle important dans les perceptions à l’égard des étrangers·ères, en ramenant inlassablement les questions migratoires au centre du débat public. Dans ce contexte polarisé[346], les électeurs·rices ont tendance à suivre plus intensément les positions de leur parti, en accordant moins d’attention aux informations objectives, qui sont souvent rares lorsqu’il s’agit d’immigration. Dans ce contexte, un degré de « polarisation affective » est atteint dans l’opinion, qui se traduit au niveau individuel par un fort rejet des partisans des autres partis et, en même temps, par un fort attachement aux électeurs de son propre parti ou groupe idéologique[347]. Ainsi, l’idéologie et l’esprit de parti sont des facteurs qui alimentent et façonnent le débat sur l’immigration aujourd’hui.
La stratégie de Vox repose sur trois arguments : la perte des valeurs traditionnelles (culturelles), la concurrence pour les avantages sociaux et les emplois (économiques) et les problèmes de coexistence et de sécurité[348], qui font des immigré·es les boucs émissaires des inégalités du système néolibéral et des problèmes de sécurité en Espagne, alimentant la désinformation et la propagation de fausses nouvelles[349].
Pour autant, l’Espagne est un des pays d’Europe gardant une opinion majoritairement positive vis-à-vis de l’immigration et stable dans le temps. Cette opinion est sans corrélation directe avec les flux d’arrivées à ses frontières, et singulièrement plus élevée que dans les pays d’Europe du Sud de première arrivée tels que la Grèce ou l’Italie, ainsi que dans les pays européens recevant des flux d’immigrés importants tels que l’Allemagne ou la France[350].
Figure 27. Evolution des taux d’opinions positives sur l’immigration dans différents pays Européens, 2014–2024
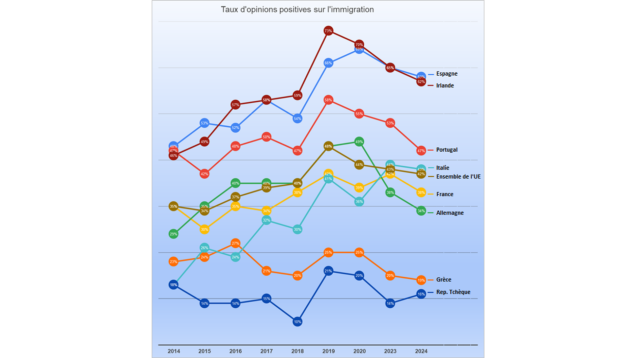
Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données annuelles de l’étude d’opinion Eurostat[351]
L’évolution dans le temps de l’opinion espagnole sur l’immigration suit une tendance observée ailleurs en Europe. En 2019, les élections européennes accentuent la présence des sujets européens dans l’actualité et entraînent une remontée de tous les indicateurs d’opinion vis-à-vis de l’Union européenne, dont celui sur l’immigration. La crise de l’accueil 2015–2016 est passée, les arrivées vers l’Europe baissent et occupent moins les esprits et le débat public et médiatique, notamment dans les pays frontaliers (Espagne, Italie) ou d’asile (Allemagne). En 2020, l’année du Covid19, l’immigration chute drastiquement dans les rangs des préoccupations des européens dans tous les pays, les « premiers de cordée » sont mis en avant, souvent des immigré·es occupant des métiers indispensables, et la perception de l’immigration en bénéficie. L’épisode Covid19 passé, les partis d’extrême-droite percent partout en Europe, les arrivées maritimes de migrants sont de nouveau en hausse et très médiatisées notamment à Lampedusa et aux Canaries, l’opinion positive vis-à-vis de l’immigration chute dans toute l’Europe[352].
Néanmoins, selon les données de l’étude d’opinion de l’Eurobaromètre Standard de novembre 2024[353] :
- Seul·es 21 % des Espagnol·es estiment que l’immigration est un des deux plus importants problèmes auquel doit faire face leur pays, se situant dans la moyenne européenne, les difficultés les plus souvent citées étant l’inflation et le coût de la vie, ainsi que les questions de logement.
- 81 % des Espagnol·es se prononcent pour une politique européenne commune en matière de migration, nettement au-dessus de la moyenne européenne à 69%.
- 66 % des Espagnol·es affirment que les immigré·es contribuent positivement à leur pays, une position singulièrement positive, dans une Europe beaucoup plus partagée (53 % sur l’ensemble de l’UE).
- 87 % des Espagnol·es considèrent que l’Espagne devrait aider les réfugié·es, le plus haut score des pays de l’Union européenne.
Cette plus grande tolérance et acceptation vis-à-vis de l’immigration extra-européenne s’expliquerait par plusieurs facteurs historiques et culturels, en particulier la proximité géographique avec le Maroc, les liens historiques et culturels avec ce pays et l’histoire arabo-andalouse de l’Espagne, ainsi que les liens historiques, économiques et culturels avec les pays d’Amérique Latine, aux populations hispanophones et majoritairement catholiques. Par ailleurs, l’Espagne a été un pays d’émigration tout au long du siècle dernier, nombre d’Espagnol·es ont une histoire familiale liée à l’émigration. Enfin, le mode de vie méditerranéen espagnol favoriserait les interactions sociales quotidiennes entre nationaux·ales et immigré·es[354].
d. L’immigration n’est pas une source d’inquiétude principale
Une autre façon d’observer l’opinion publique est d’interroger la population sur ce qu’elle considère être les problèmes les plus importants du pays, et d’observer le classement de l’immigration et son l’évolution dans le temps. C’est une des données des Baromètres mensuels publiés par le Centre de Recherches Sociologiques (CIS)[355], en enregistrant les réponses spontanées, et non suggérées, ce qui permet de capter la première idée qui vient à l’esprit des répondant·es lorsqu’ils ou elles évoquent les problèmes qui touchent le pays.
Ainsi, bien que l’immigration soit un des thèmes récurrents du débat public en Espagne, l’analyse de la position personnelle de la population espagnole sur l’immigration réalisée par le CIS de septembre de 2024[356], montre que près de la moitié d’entre eux sont équivoques ou ambivalents (48,2 %). Quant à l’autre moitié, la majorité (32,2 %) adopte des positions favorables à l’immigration et seulement une minorité (19,6 %) des personnes interrogées ont des attitudes de rejet clair. Ces données montrent donc que la plus grande part des citoyen·nes espagnol·es ont des positions favorables ou mitigées à l’égard de l’immigration.
La proportion de personnes défavorables à l’immigration est plus forte chez les hommes, les personnes vivant en milieu peu dense, plutôt âgés, croyants et religieux, au niveau d’instruction élémentaire et consultant peu d’informations diversifiées, s’identifiant en général politiquement aux partis PP ou Vox[357].
Figure 28. Place de l’immigration parmi les priorités perçues du pays
Pourcentage des personnes qui citent l’un de ces sujets parmi les trois principaux problèmes du pays : chômage (paro), difficultés économiques (problemas de índole económica), classe politique et partis politiques (la clase política, los partidos políticos), corruption et fraude (corrupción y fraud), santé Covid-19 (salud), immigration (inmigración).
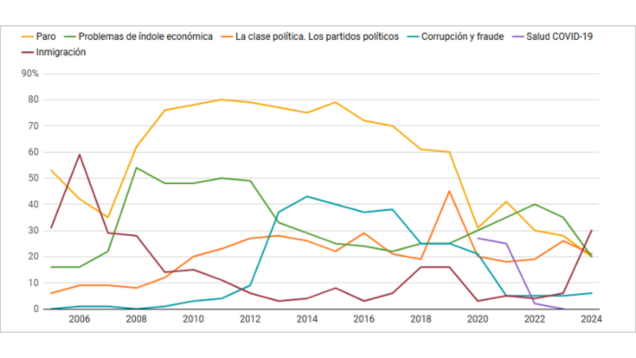
Source : graphique tiré de la publication « L’opinion publique espagnole sur l’immigration dans son contexte » du Real Instituto Elcano, réalisé à partir des données du baromètre CIS[358]
L’immigration a été spontanément mentionnée par au moins 28 % des répondant·es comme l’un des trois principaux problèmes du pays de 2005 à 2010, avec un pic de fréquence le plus élevé en 2006, année de la « crise des cayucos ». Par la suite, pendant toute la décennie et demie qui a suivi, c’est-à-dire de 2010 à aujourd’hui, l’immigration a occupé une place beaucoup plus faible.
La remontée brutale de la préoccupation pour l’immigration en 2024 ne peut être interprétée comme un rejet soudain de l’immigration par les Espagnol·es. En effet, depuis 2007, l’immigration ne figurait plus parmi les principales préoccupations, malgré l’accueil par l’Espagne de 4 millions d’immigré·es durant cette période, qui représentent désormais 18 % de la population espagnole. Par conséquent, ce ne sont pas les immigré·es déjà présent·es dans le pays qui sont à l’origine de ces pics d’inquiétude[359]. Les données historiques du CIS montrent que l’immigration n’est arrivée au troisième rang des préoccupations des Espagnol·es que lorsqu’il y a eu un nombre exceptionnellement élevé d’arrivées de personnes en situation irrégulières par voie maritime ou terrestre, ou lorsque cette question est devenue centrale dans la compétition politique partisane, s’accompagnant d’une couverture médiatique intense. En 2024, i y a eu une augmentation très substantielle de ces arrivées irrégulières, notamment aux îles Canaries, et dernièrement la question migratoire fait l’objet d’une politisation croissante, notamment en ce qui concerne la prise en charge des mineur·es non accompagné·es. Leur accueil est devenu une source de conflit entre les deux principaux partis de droite (PP et Vox) – au point d’avoir rompu leur alliance à la tête de plusieurs Communautés autonomes – et un élément très important dans la compétition entre l’opposition et le gouvernement. Cette présence continue de la migration dans le discours politique lui confère une visibilité accrue et produit un effet d’alarme supplémentaire dans l’opinion publique[360].
e. Large consensus tolérant, positions hostiles à l’immigration très concentrées autour de Vox
L’importance de la perception de l’immigration en tant que problème majeur est très inégale selon différents segments de la population. Les électeurs des partis conservateurs lui accordent beaucoup plus d’importance que les électeurs progressistes : pour les électeurs de Vox, par exemple, il s’agit de la question la plus importante, tandis que les électeurs de Podemos la placent en quinzième position sur leur échelle de priorités[361].
Si une majorité de 53 % de la population espagnole estime que le rapport coût-bénéfice de l’immigration est positif ou neutre, l’écart de perception est principalement idéologique, comme pour presque tous les aspects du débat sur l’immigration, reflet des affinités politiques[362].
Figure 29. Perception du rapport coût-bénéfice de l’immigration dans l’opinion publique espagnole.
Réponse à la question : « En général, considérez-vous que l’immigration apporte plus d’avantages ou plus d’inconvénients à l’Espagne ? Plus de bénéfices que de coûts / Autant de bénéfices que de coûts / Plus de coûts que de bénéfices » ; classement par sensibilité politique.
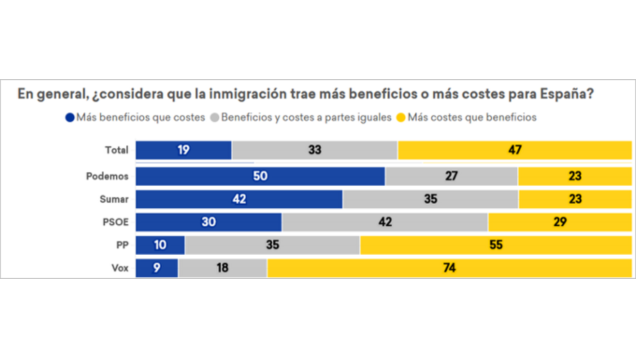
Source : extrait de l’étude « Europe Talks Migration – Spain », More in Commons, mai 2025[363]
Dans le même temps, une majorité de la société considère l’immigration comme une opportunité ou une nécessité : 19 % des espagnol·es pensent que l’immigration est une opportunité que l’Espagne doit saisir et 44 % pensent que l’immigration est un besoin que l’Espagne doit gérer, contre 29 % qui estiment que l’immigration est une menace contre laquelle l’Espagne doit lutter.
Posé en ces termes, l’écart entre les perceptions sur l’immigration fonctionne différemment : parmi les électeurs de la gauche radicale, de gauche et de droite, les opinions positives prédominent (parmi les électeurs·rices du PP, 63 % considèrent l’immigration comme une opportunité ou une nécessité), alors que ce n’est que parmi les électeurs·rices des partis d’extrême droite que la perception d’une menace prédomine[364].
Figure 30. Caractérisation de l’immigration dans l’opinion publique espagnole
Réponse à la question : « En général, diriez-vous que l’immigration est… ? Une opportunité que l’Espagne doit saisir / Une nécessité que l’Espagne doit gérer / Une menace contre laquelle l’Espagne doit lutter / Ne se prononce pas » ; classement par sensibilité politique.
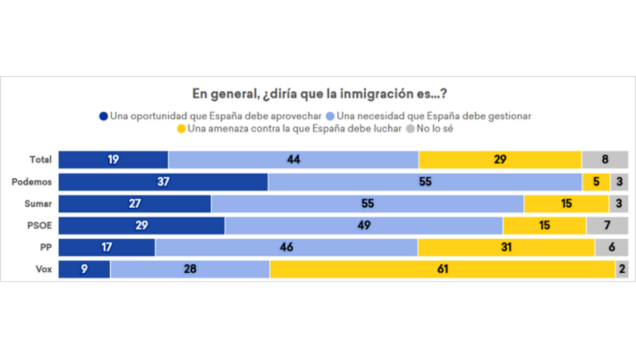
Source : extrait de l’étude « Europe Talks Migration – Spain », More in Commons, mai 2025[365]
Les positions hostiles à l’immigration restent donc fortement concentrées auprès des sympathisants de Vox. Il existe un consensus global en Espagne, y compris parmi les électeur·trices de droite, sur une vision pragmatique de l’immigration comme une nécessité démographique et économique[366].
En définitive, dans le débat sur l’immigration, la volonté de contrôle des entrées sur le territoire prédomine largement par rapport aux avis en faveur de plus ou moins d’immigration, y compris chez les électeurs·trices des partis ayant des positions hostiles. L’Espagne est l’un des pays européens où la population se prononce le plus fortement sur la nécessité première de contrôle des flux migratoires, plutôt que sur leur réduction[367].
Figure 31. Priorité au contrôle ou aux chiffres de l’immigration dans l’opinion publique, comparaison entre 5 pays européens
Réponse à la question : « En matière de politique migratoire, qu’est-ce qui est le plus important pour vous à l’heure actuelle ? Que nous puissions contrôler qui peut et qui ne peut pas immigrer en Espagne / Que nous réduisions le nombre total d’immigrants entrant en Espagne / Que nous augmentions le nombre total d’immigrants entrant en Espagne. »
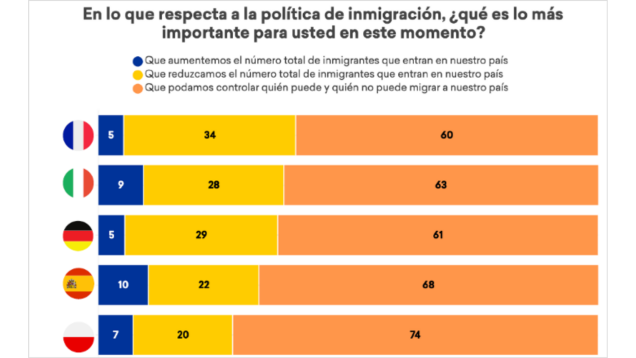
Source : extrait de l’étude « Europe Talks Migration – Spain », More in Commons, mai 2025[368]
60 % de la population espagnole et une majorité d’électeurs·rices toutes forces politiques confondues, s’expriment en faveur d’une politique qui améliore le contrôle de ses frontières et, dans le même temps, augmente les mécanismes et les voies d’immigration légale. Seule 10 % de la population se prononce pour une approche basée exclusivement sur une surveillance accrue des frontières[369].
55 % de la population associe l’immigration à la croissance économique. Interrogée sur les bénéfices de l’immigration, les impacts économiques sont ceux les plus spontanément cités : disponibilité de main-d’œuvre, emplois que les Espagnol·es ne seraient pas disposé·es à occuper et recettes fiscales permettant de financer les pensions de retraite. L’augmentation du taux de natalité fait également partie des impacts sociaux positifs généralement identifiés[370].
Figure 32. Appréciation de la contribution de l’immigration à la croissance économique dans l’opinion publique espagnole
Réponse à la question : « Au cours de l’année passée, l’économie espagnole a connu une croissance supérieure à la moyenne européenne. Diriez-vous que l’immigration y a contribué ? Beaucoup / Plutôt / Peu / Pas du tout / Je ne sais pas » ; classement par sensibilité politique.
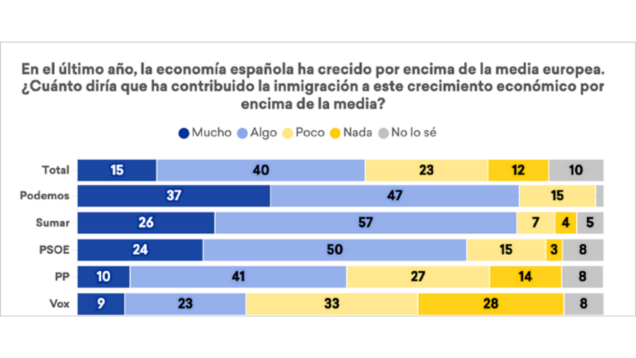
Source : extrait de l’étude « Europe Talks Migration – Spain », More in Commons, mai 2025[371]
L’opinion publique adhère dans sa grande majorité à l’approche pragmatique de la politique migratoire espagnole, faisant des flux migratoires un atout économique (main d’œuvre pour ses secteurs en tension), et démographique (contributions fiscales permettant le maintien du système de retraite par répartition)[372].
Figure 33. Appréciation de la priorité entre réduction de l’immigration ou impact économique dans l’opinion publique espagnole
Réponse à la question : « Quelle affirmation vous correspond le mieux ? Nous devons donner la priorité à une main-d’œuvre suffisante dans des secteurs clés tels que la construction et le tourisme, même si cela implique une augmentation de l’immigration / Nous devons donner la priorité à la réduction de l’immigration, même si cela implique un manque de travailleurs dans des secteurs clés tels que la construction ou le tourisme » ; classement par sensibilité politique.
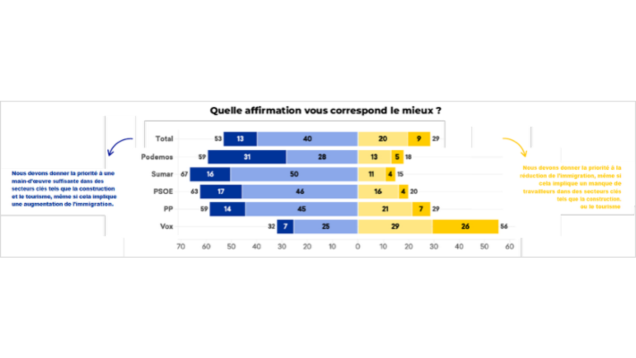
Source : extrait de l’étude « Europe Talks Migration – Spain », More in Commons, mai 2025[373]
Plus qu’une question administrative liée au titre de séjour, la société espagnole considère l’intégration d’abord comme une question économique et linguistique. Les trois aspects les plus importants cités pour une intégration réussie des immigrées sont : travailler et payer des impôts en Espagne, respecter la loi espagnole et connaître ou apprendre la langue locale[374].
f. Une mobilisation croissante de la société civile
L’évolution de l’immigration en Espagne et les mesures prises par les gouvernements successifs sont accompagnées par une mobilisation croissante de la société civile espagnole depuis les années 2000, contre le racisme et pour défendre les droits des personnes étrangères[375]. Les principales ONG luttant contre la précarité intègrent la situation des immigré·es à leur plaidoyer, les mouvements antiracistes se structurent, tandis que de nombreux collectifs citoyens qui agissent pour l’accueil des nouveaux·elles arrivant·es émergent.
Figure 34. Aperçu de la mobilisation croissante de la société civile espagnole contre le racisme et sur les politiques migratoires depuis les années 2000
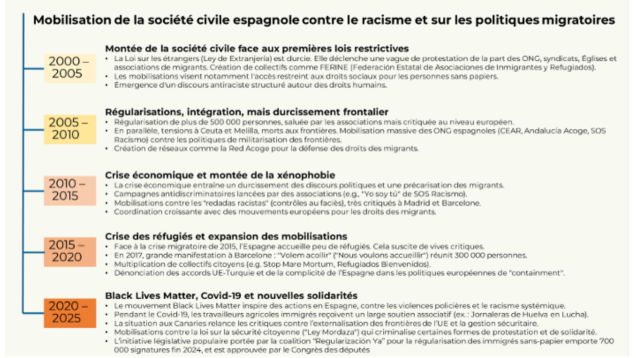
Source : élaboration par les auteurs·rices à partir de diverses publications[376]
Ainsi, la plus grande manifestation d’Europe contre la politique migratoire de l’Union européenne a eu lieu le 18 février 2017 à Barcelone, à l’occasion de laquelle 300 000 personnes sont descendues dans les rues pour soutenir les réfugié·es, des routes migratoires sûres et la liberté de circulation[377].
Autre exemple, le « guide welcome2Spain » est publié par des associations et de petits livrets contenant des informations utiles et des points de contact sont distribués dans toute l’Espagne. Les initiatives citoyennes réclament des espaces publics pour un accueil digne. Dans certaines localités de Catalogne et du Pays basque, des maisons sont occupées pour héberger les étrangers·ères et permettre aux mouvements citoyens de s’organiser[378].
Depuis 2010, le groupe « CIEs No » milite pour l’abolition des centres de rétention (CIE) et des expulsions depuis l’Espagne. À la suite de scandales relatifs aux conditions de détention dans ces centres, une décision de justice a autorisé en 2011 des ONG à y accéder. À Malaga, un CIE a été fermé à la suite de protestations continues[379].
Plus récemment, de nombreuses ONG critiquent l’approche « utilitariste » de la politique migratoire espagnole, axée sur l’emploi avant les considérations de droits humains. Plus de 20 ONG, dont Amnistía Internacional, CEAR, Accem, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja et Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), ont ainsi publiquement mis en garde contre une politique migratoire centrée sur la main-d’œuvre, lors de l’application du Pacte asile et migrations de l’UE. Elles craignent un recul des droits fondamentaux, avec un risque de rétention en pays tiers et une externalisation des contrôles migratoires qui met en danger le droit d’asile[380].
g. La mobilisation populaire inédite « Regularizacion Ya »
La mobilisation populaire « Regularización Ya[381] » pour la régularisation des immigré·es sans-papier, qui a emporté 700 000 signatures fin 2024, est une illustration récente de l’attitude globalement positive des Espagnol·es vis-à-vis de l’immigration et de leur capacité de mobilisation.
Lancée par un collectif citoyen, « Regularización Ya » (Régularisation Maintenant), est une Initiative Législative Populaire (ILP) visant à régulariser environ 500 000 personnes en situation irrégulière en Espagne (voir 2.2. c.). Une plateforme de mobilisation citoyenne a été lancée pour porter cette ILP, rassemblant plus de 900 organisations à travers l’Espagne : associations de défense des droits des migrant·es, syndicats, ONG et collectifs citoyens engagés dans la lutte pour les droits des personnes migrantes[382].
Illustration 2. Manifestation du collectif Regularizacion Ya

Source : Regularizacion Ya[383]
L’initiative a reçu un large soutien transpartisan. Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), le Parti populaire (PP), Sumar, Podemos et le Parti national basque (PNV) ont exprimé leur appui, bien que certains aient proposé des amendements pour encadrer la régularisation. L’Église catholique espagnole, à travers notamment de l’organisation Cáritas et la Conférence épiscopale espagnole, a également soutenu l’initiative, influençant le vote favorable du PP.
Après plus de deux ans de mobilisation, plus de 700 000 signatures ont été déposées au Congrès des députés. Le 9 avril 2024, l’initiative a été acceptée pour examen par le Congrès avec 310 voix pour et 33 contre, principalement de la part du parti d’extrême droite Vox. A la mi-juin 2025, le Gouvernement a transcrit l’initiative en projet de loi, qui est en phase de négociation avec les groupes parlementaires afin de pouvoir la présenter au vote des députés en procédure accélérée.
5.4 Une couverture médiatique largement stéréotypée
Depuis la « crise des cayucos » en 2006, les arrivées de migrant·es par la mer, en particulier vers les îles Canaries, sont désignées par le gouvernement espagnol comme une « question d’État ». Une notion plutôt symbolique pour signifier la priorité de l’action gouvernementale, mais qui associe ce phénomène à un état de « crise » permanente. En conséquence de cette priorité, les arrivées en provenance d’Afrique subsaharienne aux Canaries focalisent rapidement l’attention des médias espagnols. Pour décrire le phénomène, les journalistes utilisent un vocabulaire sensationnaliste, avec des termes tels que « avalanche », « assaut », « invasion » ou « massif », repris dans la plupart des médias[384].
En se concentrant sur les questions frontalières, notamment à Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux îles Canaries, les médias entérinent une disproportion entre leur importance symbolique et la dimension quantitative des flux[385]. En effet, si près de 47 000 personnes sont arrivées par la mer aux îles Canaries en 2024[386], le nombre total d’immigré·es a augmenté de plus de 458 000 personnes au total en Espagne cette même année[387]. Il est ainsi paradoxal de constater le traitement politique et médiatique réservé à un phénomène ancien et récurrent, sous l’angle d’une situation imprévisible qualifiée de « crise migratoire », alors même qu’il se répète depuis plus de vingt ans[388].
Une étude approfondie de la couverture médiatique en Espagne de 2015 à 2016, au pic de la « crise migratoire » – ou crise de l’accueil – en Europe, révèle que les questions migratoires sont en général traitées sous deux angles superficiels. Le premier décrivant des africain·es sub-saharien·nes essayant déespérement de franchir les murs des enclaves de Ceuta et Melilla depuis le Maroc, ou bien de embarcations précaires surpeuplées s’échouant sur les côtes espagnoles ; le second associant les immigré·es en Espagne à des activités criminelles, des marocains impliqué·es dans le trafic de drogue, des gangs roumains de crime organisé, ou de jeunes latino-américains commettant des actes de violence[389].
À la télévision ou sur les photographies de presse, les immigré·es apparaissent en général sous la figure d’un jeune homme démuni, acteur passif du récit, la voix des personnes concernées étant rarement entendue et peu de contexte donné sur leur situation. Dans la presse ou à la radio, des analyses plus poussées sont néanmoins parfois proposées. Selon leur orientation idéologique, les médias de courant conservateurs défendent des positions hostiles à l’immigration, tandis que ceux progressistes se montrent plus attachés aux questions humanitaires et plus critiques des réponses autoritaires[390].
La migration n’est en général couverte qu’à sens unique. Il est, à ce titre, marquant que la question de l’émigration espagnole soit absente des médias, même lorsqu’elle concerne des centaines de milliers de jeunes diplômé·es ne trouvant pas d’emploi en Espagne, comme ce fut le cas après la crise économique de 2008, jusqu’en 2013. Les plus de 700 000 personnes qui ont quitté l’Espagne ne sont pas qualifiées de migrant·es, mais simplement d’Espagnol·es de l’étranger[391].
Lors des épisodes de « crise », bien que les aspects humanitaires et sécuritaires coexistent dans leur traitement médiatique, c’est bien le second qui prédomine. C’est ainsi qu’une analyse de la presse espagnole relatant l’incident de Ceuta et Melilla le 17 mai 2021, met en évidence des tendances d’un discours à tonalité négative, l’invisibilisation des femmes migrantes et une narration opposant « nous » à « eux »[392].
L’analyse de la couverture de l’immigration par les titres de la presse nationale les plus lus en Espagne[393], montre par ailleurs que les angles adoptés varient nettement selon la famille politique du gouvernement au pouvoir[394]. Une étude comparée sur la période des 5 derniers mois de l’administration Rajoy (PP) et des 5 premiers mois de celle de Sánchez (PSOE) en 2018, révèle ainsi des changements notables dans les lignes éditoriales[395].
Figure 35. Nature des questions d’immigration abordées dans quatre titres de presse en 2018 et leur volume de couverture Comparaison entre la période de la présidence Rajoy et celle de Sánchez.
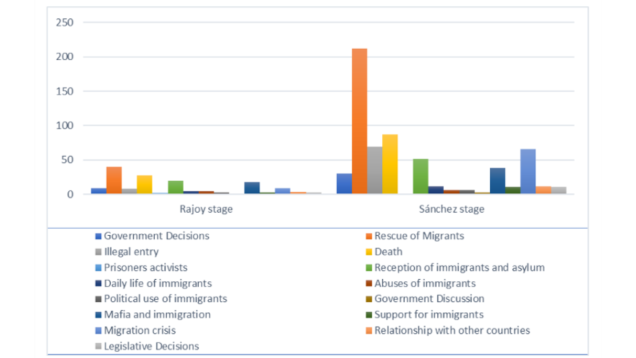
Source : Sosa-Valcarcel et al., « Humanitarian crisis and public opinion. Treatment of immigration in the Spanish media[396]. »
Au début de la présidence Sánchez, bien que le traitement de l’immigration reste très restreint, voire polémique de la part des médias soutenant l’opposition, des angles plus diversifiés émergent dans d’autres médias, tels qu’El Pais. En particulier, par la reconnaissance des causes géopolitiques et environnementales des processus migratoires ou par l’explication de la composition des flux migratoires (montrant que les flux ne proviennent pas que des pays les plus pauvres). Ainsi, le média se positionne face au discours qui tente de présenter la migration comme un phénomène nouveau qui ne pourrait être traité que sous un angle sécuritaire. Ce cadre varié s’accompagne d’un champ lexical différent, avec l’utilisation d’expressions telles que « migrations forcées » au lieu de « migration irrégulière »[397].
Bien que le traitement médiatique de l’immigration reste aujourd’hui largement stéréotypé au sein du paysage médiatique espagnol, les observateurs·rices notent des évolutions significatives ces dernières années, en particulier à propos de la reconnaissance du rôle positif que joue l’immigration dans la santé économique du pays[398]. De plus, que ce soit pendant la période de pandémie de Covid19, qui a durement touché l’Espagne, ou plus récemment lors des inondations catastrophiques de Valence en novembre 2024, l’image d’immigré·es investi·es au sein de la communauté espagnole pour faire face, a été assez largement reprise par les médias. Cela s’accompagne d’évolutions sémantiques avec l’usage du terme « irrégulier » qui supplante « illégal » ou encore celui, moins déshumanisant, de « mineur étranger » à la place du sigle « MENA ».[399]
Conclusion
L’étude révèle la trajectoire singulière de l’Espagne en matière de politique migratoire au sein de l’Union européenne, façonnée par une histoire récente d’immigration, une dynamique économique soutenue et une réalité démographique marquée par le vieillissement de sa population. En croisant les dimensions historiques, législatives, économiques, sociales et géopolitiques, l’étude met en lumière un modèle hybride, pragmatique et ancré dans les spécificités espagnoles.
L’Espagne est d’abord confrontée à un enjeu démographique majeur, auquel l’immigration constitue une réponse partielle mais essentielle. Face à une natalité structurellement basse et à un solde naturel négatif depuis 2015, les flux migratoires permettent à la population espagnole de se maintenir, voire de revitaliser certaines régions. La population immigrée, plus jeune que la moyenne espagnole, participe activement au tissu économique et social du pays. Ce contexte explique l’attention portée dès les années 1990 à l’immigration de travail, qui reste aujourd’hui au cœur de la politique migratoire espagnole.
La deuxième singularité espagnole réside dans son recours massif aux régularisations, procédé souvent décrié ailleurs en Europe. Avec plus d’un million de personnes régularisées depuis 1985 et près de 500 000 prévues en 2025, l’Espagne a fait le choix d’une reconnaissance formelle de la présence des travailleurs·euses sans-papiers déjà inséré·es. Ces régularisations ont montré leur efficacité : augmentation des recettes fiscales, recul du travail informel, insertion professionnelle sans effet négatif sur l’emploi national, absence d’appel d’air. La réforme adoptée en 2024 et l’initiative citoyenne « Regularización Ya » témoignent de la vitalité démocratique et du consensus social et politique autour des régularisations.
Troisièmement, l’Espagne a su lier sa politique migratoire à une vision d’inclusion par le travail. L’intégration passe avant tout par l’emploi, appuyée par une forte implication des syndicats et des organisations patronales. L’État délègue largement la mise en œuvre aux Communautés autonomes, renforçant une logique locale d’insertion. Malgré les inégalités persistantes (déclassement, précarité, inégal accès aux droits), ce modèle permet une intégration progressive, fondée sur des principes de proximité, de reconnaissance et de participation.
Cependant, cette position singulière comporte aussi des limites et des tensions. La gestion des frontières, en particulier à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries, reste marquée par une logique sécuritaire sous pression des exigences européennes. Le rôle de l’Espagne comme pays de première entrée dans l’espace Schengen l’oblige à adopter des dispositifs de contrôle strict et l’incite à la mise en œuvre de coopération bilatérale sur la migration, avec le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal, parfois contestés pour leurs effets sur les droits fondamentaux. De même, le système d’asile espagnol reste en retrait, avec un taux de protection faible, une gestion saturée et un accueil inégal. La priorité donnée à l’immigration économique réduit l’asile à une voie marginale, souvent contournée au profit de régularisations par le travail.
Enfin, l’Espagne se distingue par une opinion publique relativement ouverte et une polarisation politique plus concentrée qu’ailleurs en Europe. Cela tient en partie à des facteurs culturels (proximité linguistique avec l’Amérique latine, mémoire de l’émigration espagnole), mais aussi au choix assumé d’un discours politique valorisant les apports de l’immigration. Cette vision se reflète dans la politique menée par le gouvernement Sánchez, qui assume publiquement l’idée que l’immigration est une nécessité démographique, sociale et économique, et non un problème.
En définitive, la politique migratoire espagnole se caractérise par une cohérence pragmatique : elle cherche à répondre aux besoins structurels du pays tout en intégrant les contraintes européennes. Si des défis importants demeurent, notamment aux frontières et dans le traitement des demandes d’asile, l’Espagne démontre qu’une gestion humaniste, régulée et inclusive de la migration peut non seulement fonctionner, mais aussi devenir un atout stratégique dans un contexte européen dominé par la défiance et le rejet.
Retrouvez les fiches focus en téléchargeant le PDF
Acronymes
A
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – Agence espagnole pour la coopération internationale au développement
C
CAR Centro de Acogida de Refugiados – Centre d’accueil de réfugiés
CCOO Comisiones Obreras – Commissions ouvrières
CETI Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes – Centre d’accueil temporaire des immigrés
CIAR Comisión Interministerial de Asilo y Refugio – Commission interministérielle de l’asile et des réfugiés
CIE Centro de Internamiento de Extranjeros – Centre de rétention des étrangers
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas – Centre de recherches sociologiques
CNC Confederación Nacional de la Construcción – Confédération nationale de la construction
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales – Confédération espagnole des organisations patronales
CEPYME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa – Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises
COVID Coronavirus Disease
F
FIIAPP Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques
H
HCR / UNHCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
I
ILP Iniciativa Legislativa Popular – Initiative législative populaire
INE Instituto Nacional de Estadística – Institut national de la statistique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques (France)
M
MENA Menores Extranjeros No Acompañados – Mineurs étrangers non accompagnés
MI Ministerio del Interior – Ministère de l’Intérieur
O
OAR Oficina de Asilo y Refugio – Bureau de l’asile et des réfugiés
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ONG Organisation non gouvernementale
P
PACI Plan de Ciudadanía e Integración – Plan de citoyenneté et d’intégration
PECI Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración – Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration
PNV Partido Nacionalista Vasco – Parti nationaliste basque
PP Partido Popular – Parti populaire
PSOE Partido Socialista Obrero Español – Parti socialiste ouvrier espagnol
S
SALF Se Acabó La Fiesta – La fête est finie (nom d’un parti politique)
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior – Système intégré de surveillance extérieure
SAPI Sistema de Acogida de Protección Internacional – Système d’accueil de la protection internationale
U
UGT Unión General de Trabajadores – Union générale des travailleurs
UE Union européenne
[1] Gemma Larramona, « Espagne : l’émigration des immigrés », Populations, 2013, vol. 68, p. 249 ; Verónica Viteri et Santiago Martínez Sánchez, « L’Espagne de pays d’émigration à pays d’accueil », Outre-terre, 2017, n° 3, p. 97.
[2] Définition de l’INED : le solde migratoire (ou accroissement migratoire) est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur un territoire (immigrants) et le nombre de personnes qui en sont sorties (émigrants), calculé le plus souvent au cours d’une année.
[3] Sources disponibles sur Eurostat ainsi que celles de l’Université de Sherbrook (Canada) pour compléter d’un point de vue historique les données Eurostat.
[4] Franck Chignier-Riboulon, « L’Espagne devenue un grand pays d’immigration : histoire et géographie de sa présence étrangère », Populations & Avenir, 2023, n° 761, p. 17. Les Espagnol·es ont notamment immigré à Oran, en Algérie : Guy Brunet et Kamel Kateb, « Les Espagnols dans la région d’Oran au milieu du XIXe siècle. Mariages, comportements matrimoniaux, liens familiaux et liens sociaux », Annales de démographie historique, 2018, n° 1, p. 81.
[5] José Naranjo Ramírez, « Espagne : de l’émigration à l’immigration », ATALA, “Les Espagnes”, 2008, p. 130.
[6] José Naranjo Ramírez, « Espagne : de l’émigration à l’immigration », ATALA, “Les Espagnes”, 2008, p. 130.
[7] Alberto Capote Lama, Sandra López Pereiro et Belén Fernández Suárez, « Pourquoi les Espagnols émigrent à nouveau vers la France et le Royaume-Uni ? », Populations et Sociétés, n° 629, janvier 2025, p. 1., Alberto Capote Lama et Belén Fernández-Suárez, « La nouvelle émigration espagnole au-delà des « Eurostars » », Hommes & Migrations, 2023, n° 1341, p. 57.
[8] Gemma Larramona, « Espagne : l’émigration des immigrés », Populations, 2013, vol. 68, p. 249.
[9] Ibid.
[10] Instituto Nacional de Estadistica, Continuous Population Statistics, avril 2025.
[11] Franck Chignier-Riboulon, « L’Espagne devenue un grand pays d’immigration : histoire et géographie de sa présence étrangère », Populations & Avenir, 2023, n° 761, p. 18.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Franck Chignier-Riboulon, L’Espagne devenue un grand pays d’immigration : histoire et géographie de sa présence étrangère, Populations & Avenir, 2023, n° 761, p. 18.
[15] Instituto Nacional de Estadistica ; OCDE, Perspectives des migrations internationales.
[16] Estadística Continua de Población (ECP), INE, 1/04/2025.
[17] Ibid.
[18] Population on 1 January 2024 by country of birth, Eurostat.
[19] Population on 1 January 2024 by country of birth, Eurostat.
[20] Population on 1 January by age group, sex and country of birth (code : migr_pop3ctb), 2000 – 2024, Eurostat
[21] Population on 1 January by age group, sex and country of birth (code : migr_pop3ctb), 2000 – 2024, Eurostat.
[22] OCDE, Perspectives des migrations internationales.
[23] De l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), qui inclut les pays de l’Union européenne (UE) ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (OCDE).
[24] Perspective des migrations internationales 2024, publication OCDE (novembre 2024).
[25] OCDE, Perspectives des migrations internationales, Notes par pays : Espagne – Novembre 2024.
[26] Franck Chignier-Riboulon, L’Espagne devenue un grand pays d’immigration : histoire et géographie de sa présence étrangère, Populations & Avenir, 2023, n° 761, p. 18. Voir également à ce sujet : Benoît Pellistrandi, « L’Espagne, un grand acteur européen aux prises avec ses fragilités », Questions internationales, Dossier « La démographie, une inconnue décisive », 2025, n° 130, p. 117.
[27] Voir notamment les projections de l’Institut national de statistiques espagnol.
[28] Eurostat – Short term population projections 2023 – 20250.
[29] Eurostat – long terme population projections – Europop2023, mars 2023.
[30] Au sujet du déclin, voir également les chiffres sur le site Eurydice de la Commission européenne.
[31] Alex Clark, « Visualised: Europe’s population crisis », The Guardian, 18/02/2025.
[32] Instituto Nacional de Estadística, Población inmigrante en España por área de origen (2024).
[33] Franck Chignier-Riboulon, L’Espagne devenue un grand pays d’immigration : histoire et géographie de sa présence étrangère, Populations & Avenir, 2023, n° 761, p. 19.
[34] Jordi Giner-Monfort et Kelly Hall, « Older British migrants in Spain », 2023, Population, Space and Place.
[35] Fabiola Mancinelli, « Nomades numériques. La mobilité comme « projet du soi », Erudit, 2021, n° 2, p. 41.
[36] The Other Immigrants: EU Citizens from Rich Countries », Real Instituto Elcano, 6/10/2008.
[37] Población residente por fecha, sexo, grupo de edad y país de nacimiento, Instituto Nacional de Estadística.
[38] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 62.
[39] Ibid., p. 63.
[40] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 62.
[41] OCDE – Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023 – Composition des populations et ménages immigrés.
[42] INE Población extranjera por sexo, país de nacionalidad y edad Archivado.
[43] Article 23 du code civil espagnol, voir également Alberto Martin-Perez et Francisco Javier Moreno-Fuentes, « Migration and Citizenship Law in Spain : path-dependency and Policy Changes in a Recent country of Immigration », International Migration Review, 2012, n° 46.
[44] Voir le site dédié à ce sujet par le gouvernement espagnol.
[45] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) – Concesiones de nacionalidad española por residencia, 22/05/2025.
[46] « Quelle est la nationalité des personnes naturalisées dans l’Union européenne ? », Toute l’Europe, 26/03/2025.
[47] Instituto Nacional de Estadística – Estadística de adquisiciones de nacionalidad española de residentes.
[48] Article 17 du code civil, Boletín Oficial del Estado.
[49] Convenios de doble nacionalidad, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
[50] UNDESA, Division de la population, « Migrations de remplacement : une solution aux populations en déclin et vieillissantes », 2000.
[51] Isabel Piquer, « España necesitará 12 millones de inmigrantes de aquí al año 2050, según la ONU », El País du 7 janvier 2000.
[52] Augustin Baron Rault et Alexandre Simcic, « Le dynamisme économique espagnol depuis la crise sanitaire : miracle ou mirage ? », Note de conjoncture de l’INSEE, 17 décembre 2024.
[53] Brèves économiques d’Espagne, n° 01/2025, Direction générale du Trésor, ministère de l’Economie : La croissance du PIB espagnol atteint 3,2% en 2024, à comparer à 2,5 % pour la zone euro, +1,1 % pour la France, + 0,7 % pour l’Italie et –0,2 % pour l’Allemagne, selon les données provisoires.
[54] Augustin Baron Rault et Alexandre Simcic, « Le dynamisme économique espagnol depuis la crise sanitaire : miracle ou mirage ? », Note de conjoncture de l’INSEE, 17 décembre 2024.
[55] Eurostat – Real GDP growth rate.
[56] Augustin Baron Rault et Alexandre Simcic, « Le dynamisme économique espagnol depuis la crise sanitaire : miracle ou mirage ? », Note de conjoncture de l’INSEE, 17 décembre 2024.
[57] Ibid. Écouter également « En Espagne, l’immigration dynamise la croissance », Regarde le monde, Marie Boëton, 19 février 2025.
[58] Claudia Finotelli and Sebastian Rinken, « A pragmatic bet: The Evolution of Spain’s Immigration System », 2023, Migration Policy Institute.
[59] « Le « miracle » de l’immigration espagnole », Les échos, 17/11/2006.
[60] Gemma Pinyol-Jiménez et Silvia Carabello, « Immigration and integration Management in Spain », 2018, Friedrich Ebert Stiftung, p. 15. Le système de quotas a été créé en 1993, et un plan appelé « GRECO » a été élaboré à partir de 2000. Selon les autrices, les quotas ne couvraient que 30 % des besoins du marché du travail. Il a finalement été remplacé par un catalogue des métiers en tension, à partir de 2009.
[61] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 53.
[62] Ibid., p. 54.
[63] Ibid, , p. 59.
[64] María Nieves Moreno Vida, « Consulta a los agentes sociales : la concertación tripartita y el diálogo social como medio de gobernanza para el progreso económico y social », Universidad de Granada, BOE, 01/2024
[65] Voir 2.2. b).
[66] Miguel Martãnez Lucio, « Trade unions and immigration in Spain: The politics and framing of social inclusion within industrial relations, » 2017, Chapters, in: Stefania Marino & Judith Roosblad & Rinus Penninx (ed.), Trade Unions and Migrant Workers, chapter 14, p. 287, Edward Elgar Publishing ; Miguel Martínez Luciok, Stefania Marino, and Heather Connolly, « Broadening and reimagining regulation: Trade unions, ‘active servicing’ and immigration in Spain since the early 1990s », Journal of Industrial Relations, 2013, n° 55.
[67] Inara Stürckow, « Undocumented Workers in Spain and the Politics of Regularization », Ifri, 21/05/2012.
[68] Publication au Boletín Oficial del Estado, Orden TAS/1713/2005, de 3 de junio 2005.
[69] Par exemple, comme le dispose l’article 65 du Règlement de la Loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, la consultation de la Commission est une étape obligatoire dans le processus d’élaboration trimestrielle du Catalogue des professions en tension (Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura), qui identifie les métiers pour lesquels le recrutement de travailleurs étrangers est facilité en raison de pénuries de main-d’œuvre. La dernière publication au Bulletin officiel date du 17 janvier 2025.
[70] « Patronal y sindicatos respaldan cuatro años de política de inmigración », El País, 21/02/2008.
[71] « La construcción busca acabar con el déficit de trabajadores con cursos cortos para regularizar extranjeros », El Pais, 20/03/2025.
[72] « Los trabajadores extranjeros salvan la hostelería y suponen un « desahogo » para el sector », El Economista, 15/09/2024
[73] Gurría Gascón José Luis, Reques Velasco Pedro, Rodriguez Rodriguez Vicente, Neffar López María. « Le vieillissement de la population espagnole et les défis sociaux futurs ». In Sud-Ouest européen, tome 26, 2008. La population espagnole en ce début de XXIe siècle. pp. 57–69.
[74] « Los trabajadores extranjeros salvan la hostelería y suponen un « desahogo » para el sector », El Economista, 15/09/2024
[75] Catherine Vincent, « Une précarisation institutionnelle des migrants en réponse aux besoins du marché du travail », Chronique Internationale de l’IRES, 2024, N° 188, p. 211.
[76] Ibid. Voir également la directive de l’Union européenne sur l’emploi saisonnier : directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.
[77] « En Espagne, Pedro Sánchez veut contrer le récit sécuritaire et met en avant une “migration synonyme de richesse et de développement” », Le Monde, 28/11/2024.
[78] Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.
[79] « L’Espagne adopte une nouvelle loi permettant à des milliers de migrants d’intégrer le marché du travail », InfoMigrants, 12/08/2022. Voir Viviana Echeverria, « Recent changes to the Spanish Alien Act and their implications », sur le blog du cabinet d’avocats Echeverria Abogados, qui souligne une augmentation de 30,4 % de titres de séjour entre 2022 et 2023.
[80] « Los marroquíes ya son la principal fuerza laboral extranjera de España », El País, 16/3/2025.
[81] Conseil de l’Europe, rapport sur Programmes de régularisation des migrants en situation irrégulière, Juillet 2007.
[82] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 51.
[83] Ibid..
[84] Ibid.
[85] Ibid, p. 53.
[86] Joaquin Arango et Maia Jachimowicz, « Regularizing Immigrants in Spain: a New Approach », Migration Information Source (MPI), 2005.
[87] Lorenzo Cachón, L’immigration en Espagne (1996–2006) : logique de marché et « institutionnalisation », Travail et Emploi, 2008, n° 115, p. 81, qui évoque les conflits à partir des années 2000, pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs·euses immigré·es.
[88] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 60.
[89] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 65.
[90] Joaquin Arango et Maia Jachimowicz, « Regularizing Immigrants in Spain: a New Approach », Migration Information Source (MPI), 2005.
[91] Selon les propos du ministre espagnol du Travail, Jesús Caldera, en conférence de presse du 7 avril 2005, repris par El Pais ou Ultima Hora.
[92] Joaquin Arango et Maia Jachimowicz, « Regularizing Immigrants in Spain : a New Approach », Migration Information Source (MPI), 2005.
[93] Joaquin Arango et Maia Jachimowicz, « Regularizing Immigrants in Spain : a New Approach », Migration Information Source (MPI), 2005.
[94] Données historiques : Una evaluación del último proceso de regularización de trabajadores extranjeros en España, Instituto Real Elcano, 14/08/2006, à partir des données issues des archives officielles du ministère du Travail, de la Direction Générale de l’Emigration, et du ministère de l’Intérieur espagnols ; données prévisionnelles : communiqué du Conseil des Ministres du 19/11/2024 publié par La Mancloa.
[95] Décret Royal espagnol publié le 20 novembre 2024 sous la référence Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, dans le Boletín Oficial del Estado (BOE). Ce décret approuve le nouveau règlement de la Ley Orgánica 4/2000, qui encadre les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
[96] Le décret prévoit un délai de 6 mois entre sa publication au Boletin Oficial del Estado et son entrée en vigueur.
[97] Olivier Lecucq, « La surprenante réforme du droit des étrangers en Espagne », Le Club des juristes, 28/11/2024.
[98] « Régularisation des migrants en Espagne : ce que contient la nouvelle loi », InfoMigrants, 22/11/2014.
[99] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Permanente de la Inmigración – Personas con autorización de residencia por arraigo en vigor.
[100] En Espagne, le gouvernement souhaite régulariser 900 000 sans-papiers en trois ans, France 24, 21/12/2024.
[101] "Ces campagnes de régularisation sont un piège" – comment les personnes en déplacement sont empêchées d’obtenir un statut légal dans la région occidentale de la Méditerranée », AlarmPhone, 12/12/2023.
[102] « Espagne : bientôt un nouveau titre de séjour par le travail pour les sans-papiers, le « Arraigo Sociolaboral » », InfoMigrants, 4/9/2024.
[103] Sénat, « Les procédures décentralisées de l’Allemagne et de l’Espagne », Étude de législation comparée, mars 2019.
[104] « Vers la régularisation massive de 500 000 migrants sans papiers ? », Le Courrier d’Espagne, 21/5/2025.
[105] Immigration : l’Espagne examine un projet de loi qui pourrait permettre de régulariser 500 000 migrants, France Info, 21/05/2025.
[106] Cette étude a été rédigée en juillet 2025.
[107] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Permanente de la Inmigración – Personas con autorización de residencia por arraigo en vigor, mars 2025.
[108] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Permanente de la Inmigración – Personas con autorización de residencia por arraigo en vigor, 3/04/2025.
[109] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Permanente de la Inmigración – Personas con autorización de residencia por arraigo en vigor, mars 2025.
[110] Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants, Ferran Elias, Joan Monras and Javier Vázquez-Grenno – 2023.
[111] Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants, Ferran Elias, Joan Monras and Javier Vázquez-Grenno – 2023, p. 5.
[112] INE, Flujo de inmigración et OPI Flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extranjeros.
[113] UEtats parties à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
[114] À compter de mai 1991, voir Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 53.
[115] Mohammed Charef et Juan A. Cebrián, Des Pateras aux Cayucos, danger d’un parcours, stratégies en réseau et nécessité des passeurs, Migrations Sociétés, vol. 21, n° 125, 2009, p. 103.
[116] Ceuta et Melilla sont des petits territoires, restés espagnols après la fin du protectorat au Maroc en 1956, voir également Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 65.
[117] Le premier décès daterait de 1988, sur une plage de Tarifa : Jesús A. Cañas, « 30 years on since first migrant death, still no end to tragedy at sea », novembre 2018, El Pais.
[118] Mohammed Charef et Juan A. Cebrián, Des Pateras aux Cayucos, danger d’un parcours, stratégies en réseau et nécessité des passeurs, Migrations Sociétés, vol. 21, n° 125, 2009, p. 104.
[119] Concrètement, le SIVE est géré par la Guardia civil, comprend des radars, détecteurs thermiques, hélicoptères et patrouilleurs, voir Lorenzo Gabrielli, « La construction de la politique d’immigration espagnole : ambiguïtés et ambivalences à travers le cas des migrations ouest-africaines », thèse soutenue en 2011 à l’Université de Bordeaux, p. 192.
[120] Guillaume Le Boedec, « Le détroit de Gibraltar. Les limites d’un espace modèle de la luttre européenne contre les migrations irrégulières », Echo Géo, 2007, n°2 : « Le SIVE entre en fonction en 2002 à Algésiras, avant d’être étendu à Tarifa et Malaga en 2003, Cadix et Huelva en 2004, Ceuta et Melilla en 2005 et Almeria en 2006. Le SIVE a au total coûté 260 millions d’euros et dispose aujourd’hui de 25 stations de surveillance ».
[121] Le SIVE est déployé également aux Îles Canaries à partir de 2007. Cette croissance va notamment être financée par l’Union européenne, voir à ce sujet : Olivier Clochard et Claire Rodier, « Circulez, c’est privé ! », Plein droit, 2014, n° 101, p. 26.
[122] Même si « Les premières embarcations en provenance des côtes africaines sont arrivées aux Îles Canaries dans les années 1990, suite à l’intégration de l’Espagne dans l’espace Schengen. En tant que territoire frontalier situé à moins de 100 km de la côte africaine, ces arrivées ont été une constante dans l’archipel pendant les trois dernières décennies à différents degrés d’intensité », Andrea Gallinal Arias, « L’accueil humanitaire d’urgence aux Îles Canaries : encampement et pandémie aux frontières de l’Europe », Journal des Anthropologues, 2024, n°1, p. 57.
[123] Mohammed Charef et Juan A. Cebrián, « Des Pateras aux Cayucos, danger d’un parcours », stratégies en réseau et nécessité des passeurs, Migrations Sociétés, vol. 21, n° 125, 2009 p. 107.
[124] « La mortalité s’aggrave sur les routes migratoires vers l’Europe », Libération, 17/01/2022.
[125] Anaïck Pian, « Aux portes de Ceuta et Melilla : regard sociologique sur les campements informels de Bel Younes et de Gourougou », Migrations Société, 2008, n° 116, p. 11.
[126] Ibid.
[127] Guillaume Le Boedec, « Le détroit de Gibraltar. Les limites d’un espace modèle de la lutte européenne contre les migrations irrégulières », Echo Géo, 2007, n° 2.
[128] Voir le rapport de l’ONG Caminando Fronteras, « Massacre frontières Nador-Melilla », 24 juin 2022 ».
[129] Voir la publication du CNES (centre national d’études spatiales), « Espagne/Maroc – Ceuta : une enclave entre enjeux géostratégiques, tensions migratoires et zone grise économique ».
[130] Marlène Panara, « Route algérienne : près de 4000 migrants sont arrivés aux Baléares depuis le début de l’année, un record », InfoMigrants, publié le 31/10/2024.
[131] Guillaume Le Boedec, « Le détroit de Gibraltar. Les limites d’un espace modèle de la lutte européenne contre les migrations irrégulières », Echo Géo, 2007, n° 2.
[132] Frédéric Dubessy, « Ceuta et Melilla, baromètres des relations entre le Maroc et l’Espagne », Econostrum, publié le 9 décembre 2020.
[133] Nora El Qadim, « La politique migratoire européenne vue du Maroc : contraintes et opportunités », revue Politique européenne, 2010, p. 91.
[134] Claudia Cortes-Diaz, « Le Maroc et l’Espagne contre les pateras », Plein droit, 2004, n° 62, p. 30.
[135] Ibid.
[136] Ibid.
[137] Le territoire du Sahara Occidental était contrôlé par l’Espagne jusqu’en 1975. Un mouvement indépendantiste naît alors : le Front Polisario qui s’oppose au Maroc qui en revendique la souveraineté.
[138] « A Ceuta, la frontière entre le Maroc et l’Espagne s’apaise mais les tensions diplomatiques restent fortes », Le Monde, 21/05/2021.
[139] « L’Espagne renoue avec le Maroc après un an de brouille », Le Monde, 08/04/2022.
[140] « Maroc-Espagne : les frontières terrestres rouvrent après deux ans de crise », Le Monde.fr, 17/05/2022.
[141] « Drame de Melilla : comment une tentative d’entrée en Europe a conduit à la mort de dizaines de migrants », Le Monde.fr, 8/07/2022.
[142] Anna Amiach, « L’externalisation des politiques migratoires espagnoles : cadre légal », Migreurop, 5 mai 2020.
[143] Gemma Pinyol-Jiménez et Silvia Carabello, Immigration and integration Management in Spain, 2018, Friedrich Ebert Stiftung, p. 8 et 9.
[144] Anna Amiach, « L’externalisation des politiques migratoires espagnoles : cadre légal », Migreurop, 5 mai 2020. Voir plus récemment, le rôle de la Mauritanie dans la gestion des migrations au nom de l’Union européenne : « Mauritania: Mass Arrests and Deportations as EU Continues Efforts to Create « Bulwark » Against Irregular Migration », publication du Global Detention Project du 27 mai 2025 ainsi que le plan de la Mauritanie de 2010 « Document de stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration », qui permet de suivre les financements européens et espagnols.
[145] Lorenzo Gabrielli, « Flux et contre-flux entre l’Espagne et le Sénégal. L’externalisation du contrôle des dynamiques migratoires vers l’Afrique de l’Ouest », Asylon(s), n° 3, 2008.
[146] Rapport d’Amnesty International “Mauritanie : personne ne veut de nous. Arrestations et expulsions collectives de migrants interdits d’Europe”, juillet 2008, p. 9.
[147] Voir le dossier Grand Format « Espagne-Afrique, à l’heure des retrouvailles », Revue Jeune Afrique, mars 2019, spécifiquement p. 90.
[148] Lorenzo Gabrielli, « Flux et contre-flux entre l’Espagne et le Sénégal. L’externalisation du contrôle des dynamiques migratoires vers l’Afrique de l’Ouest », Revue Asylon(s), n° 3, mars 2008.
[149] Frontex, « Longet Frontex coordinated operation – HERA, the Canary Island », 2006 ; pour un avis critique sur l’opération, voir Vera Wriedt et Darius Reinhardt, « Opaque and Unaccountable : Frontex Operation Hera », Statewatch, 2017.
[150] Anna Amiach, « L’externalisation des politiques migratoires espagnoles : cadre légal », Migreurop, 5 mai 2020.
[151] Ibid.
[152] Mohammed Charef et Juan A. Cebrián, « Des Pateras aux Cayucos, danger d’un parcours, stratégies en réseau et nécessité des passeurs », Migrations Sociétés, vol. 21, n° 125, 2009, p. 111.
[153] Anna Amiach, « L’externalisation des politiques migratoires espagnoles : cadre légal », Migreurop, 5 mai 2020.
[154] Guy Arsene B Kimbatsa, « Analyse des effets du IIIe Plan Espagne-Afrique à travers le modèle de gravité structurel en équilibre partiel », EENI Global Business School, 2022
[156] Dossier Grand Format « Espagne-Afrique, à l’heure des retrouvailles », Revue Jeune Afrique, mars 2019, p. 92.
[157] Lorenzo Gabrielli, « Flux et contre-flux entre l’Espagne et le Sénégal. L’externalisation du contrôle des dynamiques migratoires vers l’Afrique de l’Ouest », Asylon(s), n° 3, 2008.
[158] Point 7 du Focus Afrique 2023.
[159] Ibid.
[160] Plan « Espagne-Afrique, 2025–2028. Travailler ensemble dans le cadre d’une relation stratégique », p. 25.
[161] « Europe Talks Migration – Spain », More In Commons, mai 2025.
[162] Ibid.
[163] « Espagne-Afrique, 2025–2028. Travailler ensemble dans le cadre d’une relation stratégique », p. 57.
[164] Site focus2030.org « L’Espagne adopte une nouvelle loi sur le développement durable et s’engage sur la voie du 0,7 % », avril 2023.
[165] « OECD Development Cooperation Peer Reviews: Spain 2022 », OCDE, février 2022.
[166] Site focus2030.org « L’Espagne adopte une nouvelle loi sur le développement durable et s’engage sur la voie du 0,7% », avril 2023.
[167] « Espagne-Afrique, 2025–2028. Travailler ensemble dans le cadre d’une relation stratégique », p. 58.
[168] Cours en ligne « Migrasafe ».
[169] Jesse Chase-Lubitz, « Europe is cutting development spending, and it’s not because of Trump », Devex, 25/03/2025.
[170] Guillaume Le Boedec, « Le détroit de Gibraltar. Les limites d’un espace modèle de la luttre européenne contre les migrations irrégulières », Echo Géo, 2007, n°2,
[171] Gabriel Echeverria, Gabriele Abbondanza et Claudia Finotelli, « The Externalisation Gamble: Italy and Spain at the Forefront of Maritime Irregular Migration Governance », Social Science, 2024, p. 517.
[172] Ibid.
[173] « Espagne-Afrique, 2025–2028. Travailler ensemble dans le cadre d’une relation stratégique », p. 57.
[174] Ibid., p 57.
[175] Ibid., p 76.
[176] Loi 5/1984 (BOE) celle qui s’applique actuellement est la loi 12/2009 sur l’asile, dont le chapitre III porte sur les droits sociaux, la possibilité de travailler etc.
[177] Voir pour plus d’information le document de l’OAR sur le sujet.
[178] HCR/ACNUR en Espagne, fiche d’information du HCR.
[179] Rapport sur l’Espagne par AIDA (ECRE), mis à jour en 2023.
[180] Rapport du gouvernement espagnol sur le système de protection internationale en Espagne, juin 2024, p. 2.
[181] « En Espagne, une nouvelle campagne de régularisation à contre-courant du repli européen », France Terre d’Asile, Vues d’Europe, 2/05/2025
[182] Romain Philipps, « Migrants return to Spain hoping to obtain asylum », Infomigrants, 17/04/2025.
[183] Fondé sur l’article 46 de la loi sur l’asile de 2009.
[184] Juan Iglesias, Rut Bermejo et Isabel Bazaga, « Beyond the asylum growth. The limits of the Spanish refugee reception program », International Migrations, 2024.
[185] Ibid.
[186] Juan Iglesias, Rut Bermejo et Isabel Bazaga, « Beyond the asylum growth. The limits of the Spanish refugee reception program », International Migrations, 2024.
[187] Rapport du gouvernement espagnol sur le système de protection internationale en Espagne, juin 2024, p. 2.
[188] Rapport du gouvernement espagnol sur le système de protection internationale en Espagne, juin 2024.
[189] Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, remplacée par la directive 2024/1436.
[190] Short overview of the reception system, Spain, version 12/05/2025, ECRE.
[191] Informe 2023: La personas refugiadas en España y Europa, CEAR.
[192] Rapport du gouvernement espagnol sur le système de protection internationale en Espagne, juin 2024.
[193] Cristina Fernández Bessa, « Quelques caractéristiques et conditions de l’internement des étrangers en Espagne », Enfermés dehors, 2009, Editions du Croquant, p. 163.
[194] Voir la publication du CNES (centre national d’études spatiales), « Espagne/Maroc – Ceuta : une enclave entre enjeux géostratégiques, tensions migratoires et zone grise économique ».
[195] Report of the fact-finding mission by Ambassador Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary General on migration and refugees, to Spain, SG/Inf(2018)25 -, 18–24 March 2018.
[196] Defensor del Pueblo, ‘Informe anual 2021 y debates en las Cortes Generales Volumen l. Informe’, March 2022, p. 158.
[197] Europe discussion paper regarding integration of asylum seekers and refugees, International Ombudsman Institute, July 2020, p. 7. Par exemple, concernant le transfert de mineur·es, voir « Spain adopts measures to move lone migrants minors away from Canary Islands’, 19/03/2025, Euronews.
[198] Country Report Spain, AIDA, ECRE, 2023.
[199] Types of accommodation in Spain, AIDE, ECRE, dernière mise à jour 12/05/2025.
[200] Juan Iglesias, Rut Bermejo et Isabel Bazaga, « Beyond the asylum growth. The limits of the Spanish refugee reception program », 2024, International Migrations.
[201] « Spain: boosting migrant accommodation as a priority », 06/12/2024, Infomigrants.
[202] Types of accommodation in Spain, AIDE, ECRE, dernière mise à jour du 12/05/2025: « In January 2024, the declaration of the migration emergency was extended, and the Council of Ministers approved an allocation of 60.6 million Euros. Before this new declaration and since October 2023, a total of 10,000 new reception places within both the asylum and the humanitarian assistance programs, and a total of almost 100 million Euros have been employed to face such a situation ».
[203] Isaline Roverato, « Ceuta, au péril de leur vie », visionscarto, 25/02/2025.
[204] Lorenzo Gabrielli, « Récurrence de la crise frontalière : l’exception permanente en Espagne », Culture & Conflits, n° 99–100, 2015, p. 75.
[205] « Tarajal and the legacy of racism in Spain’s migration system », Picum Blog, 08/02/2021.
[206] Visite de l’Espagne par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 29/11/2022.
[207] Differential treatment of specific nationalities in reception, AIDA, ECRE, dernière mise à jour du 12/05/2025.
[208] Loi organique 4/2015 du 30 mars 2015 sur la protection sécuritaire des citoyens.
[209] En violation de l’article 4 du Protocole 4, décision de la Cour EDH, 3/10/2017, N.D et N.T. c/ Espagne, req. n° 8675/15 et 8697/15.
[210] Qui peut être saisie par l’une des parties après une décision de chambre.
[211] Décision de Grande Chambre, 13/02/2020, N.D. et N.T. contre Espagne, req. n° 8675/15 et 8697/15, point 229.
[212] Cristina Fernández Bessa, « Quelques caractéristiques et conditions de l’internement des étrangers en Espagne », Enfermés dehors, Editions du Croquant, 2009, p. 163.
[213] ‘Diferencias que generan desigualdad. Informe CIE 2022, Servicio Jesuita a Migrantes, juin 2023
[214] Country Report Spain, AIDA, ECRE, 2023, p. 148.
[215] « Spain: Case into Martine Samba’s detention centre death to be reopened », Statewatch, 06/02/2014.
[216] Country Report Spain, AIDA, ECRE, 2023, p. 151.
[217] « Spain: over 16,000 young migrants obtain residence permits thanks to 2021 reform », PICUM blog, 04/04/23.
[218] Augustín Villafañe et Lidia Carnicero, « Les mineurs étrangers non accompagnés en Espagne », Revue Vie sociale et traitement, 2016, n° 130, p. 84.
[219] Voir à ce sujet le rapport du Sénat de 2023 sur les mineurs étrangers non accompagnés, la partie sur l’Espagne, étude de législation comparée n° 297, octobre 2021.
[220] Rapport de la mission d’information effectuée par l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés, en Espagne du 18 au 24 mars 2018 (SG/Inf(2018)25).
[221] « Spain: over 16,000 young migrants obtain residence permits thanks to 2021 reform », PICUM blog, 04/04/23.
[222] Claudia Cortes-Diaz, « Le Maroc et l’Espagne contre les Pateras », Revue Plein droit du GISTI, 2004, p. 30.
[223] Nora El Qadim, « La politique migratoire européenne vue du Maroc : contraintes et opportunités », Politique européenne, 2010, p. 91.
[224] Voir la fiche de Migreurop sur le sujet de l’externalisation (non datée) et la loi 2/2009 sur le séjour des étrangers·ères (article 35), qui prévoit la signature d’accords de collaboration avec les pays d’origine sur la migration irrégulière, la protection et le retour des mineur·es non accompagné·es.
[225] « Atlantic Route and Spain: Rescues and Tragedy, Moroccan Migration Cooperation Morocco, Judge Orders Return Of Expelled Minors, Border Procedure Plans Spanish Enclaves », ECRE, 18/02/2022.
[226] Country Report Spain, AIDA, ECRE, 2023.
[227] « Îles Canaries : un bras de fer politique, mais pas de solution pour les mineurs isolés étrangers », France Terre d’Asile, Vues d’Europe, 13/11/2024.
[228] « Spain adopts plan to relocate unaccompanied minors from Canaries », RFI, 11/04/2025.
[229] « The Government of Spain establishes a model of solidarity, objectivity and flexibility for the reception of unaccompanied migrant children », La Moncloa, 18/03/2025.
[230] Ibid.
[231] « The Government of Spain establishes a model of solidarity, objectivity and flexibility for the reception of unaccompanied migrant children », La Moncloa, 18/03/2025.
[232] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Observatorio Permanente de la Inmigración. Menores Extranjeros No Acompañados. Datos acumulados mensuales, 2025
[233] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Observatorio Permanente de la Inmigración. « Menores y jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia en vigor ». Datos mensuales, 2025.
[234] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Programa de atención a jóvenes extutelados. Informe OPI 2024–2025.
[235] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Observatorio Permanente de la Inmigración. Menores Extranjeros No Acompañados. Datos acumulados mensuales, 2025.
[236] « Spain adopts plan to relocate unaccompanied minors from Canaries », RFI, 11/04/2025 : "These children will be part of our economic structure, of our labour, social and cultural potential in the future. Let us invest in their future, because their future will be everyone’s future ».
[237] Madrid – Aluche (~280 places), Barcelona – Zona Franca (~80 places), Murcia – Sangonera la Verde (~130 places), Valence (~160 places), Las Palmas de Gran Canaria (~168 places), Tenerife – Hoya Fría (~238 places), Algeciras + Tarifa (~170 places cumulées).
[238] Voir la fiche Espagne de la Cimade (mise à jour en août 2022).
[239] Escamilla Martínez E. et al., « Expulsiones en caliente. Cuando el estado actúa al margen de la Ley », Docta Complutense, 2014.
[240] Juan David Sempere Souvannavong, « Evolution de la situation migratoire de l’Espagne de 1991 à nos jours », Migrations Société, 2009, vol. 21, n° 125, p. 53.
[241] Cristina Fernández Bessa, « Quelques caractéristiques et conditions de l’internement des étrangers en Espagne », Enfermés dehors, 2009, Editions du Croquant, p. 163.
[242] Madrid – Pozuelo : 406 places, Madrid – Vallecas : 96 places, Madrid – Alcobendas : 90 places, Valence – Mislata : 121 places, Séville : 120 places.
[243] Eurostat, Third country nationals returned following an order to leave.
[244] Eurostat, Enforcement of immigration legislation statistics.
[245] Ibid.
[246] Anna Terron, Secrétaire d’Etat espagnole à l’Immigration et à l’Emigration, communication au colloque « Identité européenne », organisé le 8 avril 2010 au Conseil supérieur du Notariat à Paris.
[247] https://www.inclusion.gob.es/
[248] “Le rôle des Communautés autonomes dans le modèle contemporain d’intégration des immigrants en Espagne : variabilité de réalisation” – Encarnación La Spina – Universidad de Deusto – 2015.
[249] Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration. Verónica Viteri et Santiago Martínez Sánchez, « L’Espagne de pays d’émigration à pays d’accueil », Outre-Terre (2017/3 N° 52).
[250] Sylvie Koller, « Politiques d’intégration en Espagne », Etudes, 2007, p. 177.
[251] Par exemple, le Revenu Minimum Vital (IMV), prestation nationale, s’articule avec des revenus minimums régionaux (rentas mínimas autonómicas) qui varient fortement d’une communauté à l’autre, les délais d’ouvertures de droits à prestations pour les personnes dépendantes ainsi que le montant par bénéficiaire dépend de chaque région, de même pour les aides au logement ou les soins de santé complémentaires.
[252] Sylvie Koller, « Politiques d’intégration en Espagne », Etudes, 2007, p. 177.
[253] Bruquetas-Callejo, María et al, . « Políticas de integración en España: Estado y Comunidades Autónomas en perspectiva comparada ». Fundación CIDOB, 2011, p.48 ; et Rapport du ministère espagnol de l’Inclusion sur le Plan Estatal de Ciudadanía e Integración, 2023, p. 27.
[254] Ibid.
[255] Francisco Colom González, La cuestión nacional en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018
[256] Ibid.
[257] Castillan, Catalan, Galicien, Basque, Aranais.
[258] « Políticas de Integración en España: balance y desafíos », Institut européen de la Méditerranée (IEMed), 2019
[259] Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión, contra el Racismo y la Xenofobia, 2023–2027
[260] Ashifa Kassam, « How Spain’s radically different approach to migration helped its economy soar », The Guardian, 18/02/2025.
[261] Voir la page du site internet de l’Observatoire Permanent sur l’Immigration.
[262] Avec moins de 10 habitants au kilomètre carré (135 000 en tout), celle-ci est considérée comme un désert démographique.
[263] « Espagne : des migrants redonnent vie à un village dépeuplé », TV5 Monde, 20/2/2025.
[264] https://www.accem.es/
[265] « Dans l’Espagne rurale, des réfugiés redonnent vie à un village dépeuplé », France 24, 19/02/2025.
[266] « Burbáguena, le village espagnol sauvé par les réfugiés », Géo, 20/02/2025.
[267] Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Boletín Oficial del Estado (BOE).
[268] Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud., Boletín Oficial del Estado.
[269] Real Decreto-Ley 7/2018 « sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud » BOE-A-2018–10752. Ce dispositif se distingue du système français de l’Aide médicale d’État par son panier de soins largement équivalent à celui des assurés ordinaires.
[270] Bolivia, Cape Verde, Chile, Colombia, Korea, Ecuador, Iceland, Norway, New Zealand, Paraguay, Peru, the United Kingdom and Trinidad and Tobago ; Voting reciprocity agreements, INE, 2022.
[271] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
[272] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
[273] Informe sobre la Integración de la población extranjera en el mercado laboral español, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2023.
[274] Ibid.
[275] Statista, Unemployment rate in Spain from 1st quarter 2005 to 2nd quarter 2024.
[276] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Observatorio Permanente de la Inmigración. Informe 2022, publié en 2023.
[277] Carcedo Ana, “Mujeres migrantes en el trabajo de cuidados en España.” Fundación Alternativas, 2021, p.16.
[278] Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Observatorio Permanente de la Inmigración. Informe 2022, publié en 2023.
[279] Encuesta de Población Activa (EPA), INE, 2022–2023.
[280]“El impacto económico de la discriminación laboral por origen nacional en España”, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), 2023, p. 24.
[281] Informe sobre la Integración de la población extranjera en el mercado laboral español, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2023.
[282] Sylvie Koller, « Politiques d’intégration en Espagne », Etudes, 2007, p. 177.
[283] Joëlle Bastien, « L’ambiguïté des objectifs et le pouvoir discrétionnaire informel dans l’administration des politiques publiques : le cas de la politique d’immigration en Espagne », Revue internationale des sciences administratives, 2009, n° 75, p. 738.
[284] Claudia Finotelli and Sebastian Rinken, « A pragmatic bet: The Evolution of Spain’s Immigration System », Migration Policy Institute, 2023.
[285] « Sánchez affirme depuis la Mauritanie que “l’immigration n’est pas un problème mais une nécessité” et apporte des bénéfices », Migrant.es, 28/8/2024.
[286] « Pedro Sánchez: « Acoger al que viene de fuera no es sólo un deber, sino un paso para garantizar el Estado del bienestar » », La Moncloa, 9/10/2024.
[287] Discurso del presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso, La Moncloa, 9/10/2024.
[288] Voir par exemple, Alyssa McMurtry, “Spanish NGOs warns of ‘devastating effects of EU’s new Migration pact”, 10/04/2024.
[289] Voir à ce sujet, le règlement de l’Union européenne relatif à la gestion de l’asile et de la migration n° 2024/1351, spécifiquement l’article 56 sur la réserve annuelle de solidarité.
[290] « El Parlamento Europeo aprueba el Pacto de Migración y Asilo tras superar las discrepancias internas », HuffPost, 10/4/2024.
[291] Christina Cerfontaine, « Révision du système de Dublin : le Pacte européen sur la migration et l’asile vu de Belgique. », Analyses de l’IRFAM, n°6, 2025.
[292] Charlotte Boitiaux, « Expulsions de migrants : les « hubs de retour » dans des pays tiers divisent les pays de l’UE », InfoMigrants, 18/10/2024.
[293] « L’Italie, le Danemark et 7 autres pays de l’Union européenne veulent modifier la CEDH », Euronews, 23/05/2025.
[294] Alcoceba Hernando, José Antonio, et al., « Análisis del discurso parlamentario de Vox en la XIV Legislatura. Crispación, polarización y nacionalpopulismo », Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 29, nº 1, 2023, pp. 1–14.
[295] Benjamin Biard, « L’extrême droite en Europe occidentale (2004–2019) », CRISP, 2019, n° 2420–2421, p. 54.
[296] Ibid., p. 52.
[297] « ABC Sevilla 17–01–2014 página 45 », ABC Sevilla, 6/12/2019.
[298] Manuelle Peloille, « L’extrême droite en Espagne ou les ressorts d’une séduction retrouvée », Université d’Angers, 2018.
[299] Benjamin Biard, « L’extrême droite en Europe occidentale (2004–2019) », CRISP, 2019, n° 2420–2421, p. 53.
[300] Benjamin Biard, « L’extrême droite en Europe occidentale (2004–2019) », CRISP, 2019, n° 2420–2421, p. 53.
[301] Ibid.
[302] Le scrutin, entaché par l’absence de garanties et la répression policière, déclare une large victoire du « oui » à l’indépendance, suite auquel, le 27 octobre 2017, le Parlement catalan déclare unilatéralement l’indépendance. En réponse, le gouvernement central espagnol, alors dirigé par Mariano Rajoy (Parti populaire), applique l’article 155 de la Constitution, suspendant l’autonomie de la Catalogne et dissolvant le parlement régional. Plusieurs dirigeants catalans sont poursuivis en justice. De nouvelles élections régionales sont organisées en décembre 2017. Les partis indépendantistes remportent de justesse une majorité. Mais l’investiture d’un nouveau président de la Generalitat est bloquée à plusieurs reprises, jusqu’en en mai 2018. En juin 2018, Mariano Rajoy est renversé par une motion de censure. Le socialiste Pedro Sánchez devient président du gouvernement espagnol. Il affiche une volonté de dialogue, sans pour autant accepter de référendum légal sur l’indépendance.
[303] Benjamin Biard, « L’extrême droite en Europe occidentale (2004–2019) », CRISP, 2019, n° 2420–2421, p. 54
[304] Carmen González Enríquez et Sebastian Rinken, « La opinión pública ante la inmigración y el efecto de VOX », Real Instituto Elcano, 16/03/2021.
[305] Un scandale de corruption touche l’exécutif régional (affaire des ERE).
[306] Carmen González Enríquez et Sebastian Rinken, « La opinión pública ante la inmigración y el efecto de VOX », Real Instituto Elcano, 16/03/2021, p. 9.
[307] « L’extrême droite en Andalousie : Pedro Sánchez en difficulté », RFI, 3/12/2018.
[308] Elecciones generales 2019 : El mapa electoral de Vox, RTVE, 30/04/2019.
[309] Elecciones Generales 2023, El País.
[310] Parlement Européen, Élections Européennes 2024, Résultats par parti national – Espagne.
[311] Parlement européen (résultat des élections européennes par pays – session constitutive – Espagne : 2024, 2019, 2014) ; Ministerio del Interior, Info Electoral, Resultados electorales.
[312] « Vox acusa a Feijóo de provocar la ruptura de sus pactos de gobierno al aceptar el acogimiento de 347 menores migrantes », El País, 10/07/2024. Voir développements sur les mineur·es à ce sujet.
[313] « En las entrañas de la campaña de Vox », France 24, 19/7/2023.
[314] « Far-right Spanish political party Vox: What are its policies? », El Pais, 3/12/2018.
[315] https://www.voxespana.es/
[316] « El curioso caso de un pueblo de 14 habitantes donde Se Acabó la Fiesta ganó las elecciones europeas junto con el PP », ABC, 17/06/2024.
[317] https://www.seacabolafiesta.com/
[318] « El Supremo abre dos causas contra Alvise Pérez », Huffington Post, 11/04/2025.
[319] « Se acabó la fiesta también para Alvise », Huffington Post, 27/04/2025.
[320] « La extrema derecha ya suma casi un 17% en estimación de voto, su mejor dato desde las elecciones », El País, 7/04/2025.
[321] Hervé Le Bras, Le Grand Enfumage. Populisme et immigration dans sept pays européens, Éd. de L’Aube/Fondation Jean-Jaurès, coll. Monde en cours, 2022.
[322] Noam Gidron., James Adams et Will Horne, « American Affective Polarization in Comparative Perspective ». 2020, Cambridge: Cambridge University Press.
[323] Christoph Arndt, « Issue Evolution and Partisan Polarization in a European Multiparty System:Elite and Mass Repositioning in Denmark 1968–2011 ». European Union Politics, 2016, p. 660.
[324] Caoimhe Goya García de Paor, « La polarización de la opinión pública europea ante la inmigración: Análisis de los factores influyentes », 2021, Comillas Journal of International Relations, p. 21.
[325] Notamment le 7 juillet 2005 à Londres, quatre explosions coordonnées dans les transports en commun, 52 morts et plus de 700 blessés, attentat-suicide revendiqué par Al-Qaïda. Le 7 janvier 2015 à Paris, attaque du siège du journal Charlie Hebdo, tuant 12 personnes, les attaquants se revendiquent d’Al-Qaïda: 13 novembre 2015, le 13 novembre à Paris, attaques coordonnées avec fusillades dans des cafés et restaurants, explosions près du Stade de France, prise d’otages au Bataclan, 130 morts, plus de 400 blessés, revendiqués par l’État islamique; le 22 mars 2016, à Bruxelles, deux attentats-suicides à l’aéroport de Zaventem et un dans le métro à la station Maelbeek, 32 morts et plus de 340 blessés, attentats revendiqués par l’État islamique ; le 14 juillet 2016, à Nice un camion, fonce dans la foule sur la Promenade des Anglais, 86 morts, plus de 400 blessés, revendiqué par l’État islamique ; le 19 décembre 2016 à Berlin, un camion fonce sur un marché de Noël. 13 morts et 55 blessés, attentat revendiqué par l’État islamique; le 22 mai 2017, à Manchester, explosion au milieu de la foule quittant un concert à la Manchester Arena, 23 morts et 237 blessés, revendiqué par l’Etat islamique.
[326] « 11-M, el fin de una investigación Islamistas criminales contra la guerra de Irak », El País, 17/07/2006.
[327] « El PSOE gana las elecciones con una mayoría holgada sobre el PP », El País, 14/03/2004.
[328] Luis M. González de la Cuesta, « La política exterior de Zapatero: cambios y continuidades », Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 2005; et Charles Powell (2010), « José Luis Rodríguez Zapatero: una nueva política exterior », Real Instituto Elcano, 2010.
[329] Nora El Qadim, « La politique migratoire européenne vue du Maroc : contraintes et opportunités », Politique européenne, 2010, p. 91.
[330] « Attentat de Barcelone : « Le but est de faire le plus de victimes et de radicaliser l’opinion », Le Nouvel Obs, 19/08/2017.
[331] « Divergences entre Madrid et Barcelone dans l’enquête sur les attentats », Le Figaro, 21/08/2017.
[332] « Espagne: après les attentats, le spectre de l’autonomie de la Catalogne », RFI, 19/08/2017.
[333] María José Canel, « Communicating strategically in the face of terrorism : the Spanish government’s response to the 2004 Madrid bombing attacks », 2012, Public Relations Review, p. 214.
[334] González Enríquez, Carmen, « España y el terrorismo yihadista: Resiliencia social y respuesta política » Real Instituto Elcano, 2017; et Ballesteros Peña, Miguel Ángel, « España ante el terrorismo yihadista », Chapitre in Seguridad Nacional y Defensa en España. Contexto actual y perspectivas, ed. Alianza Editorial, (2019
[335] Caoimhe Goya García de Paor, « La polarización de la opinión pública europea ante la inmigración: Análisis de los factores influyentes », 2021, Comillas Journal of International Relations, p. 21.
[336] Oberaxe, Rapport de l’Observatoire Espagnol sur le Racisme et la Xénophobie, 2007.
[337] Baromètre CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), septembre 2024
[338] Données d’opinion: Eurobaromètre Standard, réponses positives à la question QB4.2 ; “Veuillez me dire si la proposition suivante vous évoque un sentiment positif ou négatif: L’immigration de personnes venant de pays en dehors de l’Union européenne” (%); Taux de chômage : données annuelles Eurostat.
[339] En effet, en raison du modèle démocratique (notamment le scrutin proportionnel et la nécessité de coalitions gouvernementales), des élections sont fréquemment organisées. Ainsi, il y a eu cinq élections législatives depuis 2015. Voir à ce sujet : Bakdid Albane, Kaoutar; Clavero Mira, Esther y García Escribano, Juan José, « La inmigración como tema polarizador en España », 2025, Revista Más Poder Local, p. 102.
[340] « Flux migratoires sur les routes occidentales », Conseil européen, rév. 14/04/2025.
[341] « Canarias recibe 31.000 irregulares, casi los mismos que en cuatro años », El País, 27/12/2006.
[342] Berta Chulvi, Mariangeles Molpeceres, María F. Rodrigo, Alejandro H. Toselli et Paolo Rosso, « Politization of Immigration and Language Use in Political Elites: A Study of Spanish Parliamentary Speeches », 2023, Journal of Language and social Psychology, p. 1.
[343] Bakdid Albane, Kaoutar, Clavero Mira, Esther et García Escribano, Juan José, « La inmigración como tema polarizador en España », 2025, Revista Más Poder Local, p. 102.
[344] Ian P. McManus, « Socio-economic and socio-cultural foundations of voter support for far-left and far-right parties », 2021, Journal of Contemporary European Studies, p. 214.
[345] Berta Chulvi, Mariangeles Molpeceres, María F. Rodrigo, Alejandro H. Toselli et Paolo Rosso, « Politization of Immigration and Language Use in Political Elites: A Study of Spanish Parliamentary Speeches », 2023, Journal of Language and social Psychology, p. 1.
[346] James N. Druckman, Erik Peterson et Rune Slothuus, « How Elite Partisan Polarization Affects Public Opinion Formation », 2013, American Political Science Review, p. 1.
[347] Ismael Crespo Martínez, « Introducción », 2024, IV Encuesta Nacional de Polarización Política, Grupo Especial de Investigación CEMOP.
[348] Ismael Crespo Martínez et Alberto Mora Rodríguez, « El auge de la extrema derecha en Europa: el caso de Vox en la Región de Murcia », 2022, Política y Sociedad, p. 3.
[349] Laura Camargo Fernández, « El nuevo orden discursivo de la extrema derecha española: de la deshumanización a los nulos en un corpus de tuits de Vox sobre la inmigración », 2021, Cultura, lenguaje y representación, XXVI, p. 63.
[350] José Bautista, Isabella Carril Zerpa, Lucía Fernández, Ana Acatrinei, Angelina Boufi et Lide Mandicisor, Externalisation, 2024, PorCausa, p. 23.
[351] Eurostat, Standard Eurobarometer, réponse à la question QB4.2 ; Veuillez me dire si la proposition suivante vous évoque un sentiment positif ou négatif: L’immigration de personnes venant de pays en dehors de l’Union européenne (%).
[352] Eurobaromètre Standard (2019–2024), Commission européenne ; Claudia Finotelli et Sebastian Rinken, « A pragmatic bet: The Evolution of Spain’s Immigration System », Migration Policy Institute, 2023.
[353] Standard Eurobarometer 102 – Autumn 2024.
[354] José Bautista, Fondacion porCausa, entretien avec les auteurs, 12/05/2025.
[355] Barómetros, Centro de Investigaciones Sociológicas.
[356] Estudio 3.419 del Centro de Investigaciones Sociológicas, de septiembre de 2024.
[357] Bakdid Albane, Kaoutar; Clavero Mira, Esther et García Escribano, Juan José, « La inmigración como tema polarizador en España », 2025, Revista Más Poder Local, p. 102.
[358] Rut Bermejo et Carmen González Enríquez, « La opinión pública española sobre la inmigración en contexto », Real Instituto Elcano, 3/10/2024, graphique élaboré à partir des données des baromètres mensuels CIS Barómetros (Centro de Investigaciones Sociológicas).
[359] Rut Bermejo et Carmen González Enríquez, « La opinión pública española sobre la inmigración en contexto », Real Instituto Elcano, 3/10/2024,
[360] Ibid.
[361] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[362] Ibid.
[363] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[364] Ibid.
[365] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[366] Ibid.
[367] Ibid.
[368] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[369] Ibid.
[370] Ibid.
[371] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[372] Ibid.
[373] Europe Talks Migration, España, More In Commons, mai 2025.
[374] Ibid.
[375] María José Aguilar Idáñez et Daniel Buraschi « Del racismo y la construcción de fronteras morales a la resistencia y el cambio social:la sociedad civil frente a las migraciones forzosas », revue Servicios Sociales y Política Social du Consejo General del Trabajo Social, n°111, août 2016.
[376] María José Aguilar Idáñez et Daniel Buraschi « Del racismo y la construcción de fronteras morales a la resistencia y el cambio social:la sociedad civil frente a las migraciones forzosas », revue Servicios Sociales y Política Social du Consejo General del Trabajo Social, n°111, août 2016.; Carla Höppner, migration-control.info, 10/07/2020.
[377] Carla Höppner, migration-control.info, 10/07/2020.
[378] Carla Höppner, migration-control.info, 10/07/2020.
[379] Ibid.
[380] « Más de 20 organizaciones reclaman al Gobierno participar en la aplicación del pacto migratorio de la UE », El País, 5/12/2024
[381] https://regularizacionya.com
[382] Ibid.
[383] https://regularizacionya.com.
[384] Lorenzo Gabrielli, « Récurrence de la crise frontalière : l’exception permanente en Espagne », Culture & Conflits, n° 99–100, 2015, p. 75.
[385] Ibid.
[386] « Espagne : près de 47 000 migrants ont rejoint les îles Canaries en 2024, record historique », Info Migrants, 03/01/2024.
[387] « La población española supera los 49 millones de habitantes gracias al aumento de extranjeros », El País, 13/02/2025.
[388] Lorenzo Gabrielli, « Récurrence de la crise frontalière : l’exception permanente en Espagne », Culture & Conflits, n° 99–100, 2015, p. 75.
[389] « How does the media on both sides of the Mediterranean report on migration ? », le cas de l’Espagne par Jose Miguel Calatayud, the Ethical Journalism Network, International Centre for Migration Policy Development, 2017, p. 59.
[390]« How does the media on both sides of the Mediterranean report on migration ? », le cas de l’Espagne par Jose Miguel Calatayud, the Ethical Journalism Network, International Centre for Migration Policy Development, 2017, p. 59.
[391] Ibid, p. 63.
[392] Teresa Terrón-Caro, Rocío Cárdenas-Rodríguez et Fabiola Ortega-de-Mora, « Discourse, Immigration and the Spanish Press: Critical Analysis of the Discourse on the Ceuta and Melilla Border Incident”, Pablo de Olavide University, 29/03/2022.
[393] La Razon (droite conservatrice), ABC (droite catholique), El Mundo (centre droit), El Pais (centre gauche).
[394] Aimiris Sosa-Valcarcel, A. Leticia Quintana-Pujalte et Antonio Castillo-Esparcia, « Humanitarian crisis and public opinion. Treatment of immigration in the Spanish media », Universidad de Málaga, 12/07/2019.
[395] Ibid.
[396]Aimiris Sosa-Valcarcel, A. Leticia Quintana-Pujalte et Antonio Castillo-Esparcia, « Humanitarian crisis and public opinion. Treatment of immigration in the Spanish media », Universidad de Málaga, 12/07/2019.
[397] Ibid.
[398] José Bautista, Fondacion porCausa, entretien avec les auteurs, 12/05/2025.
[399] José Bautista, Fondacion porCausa, entretien avec les auteurs, 12/05/2025.